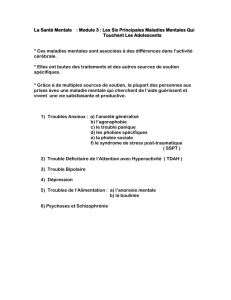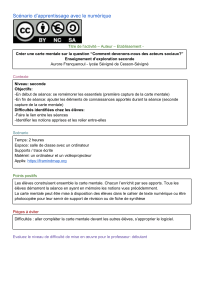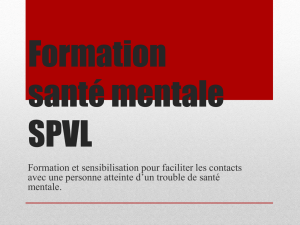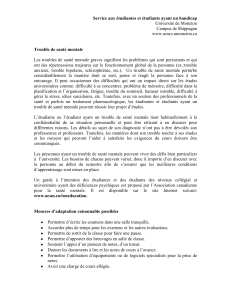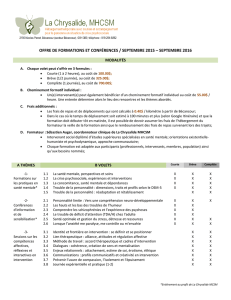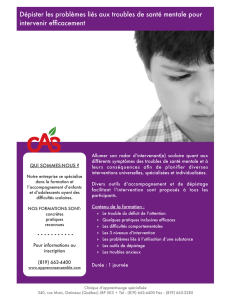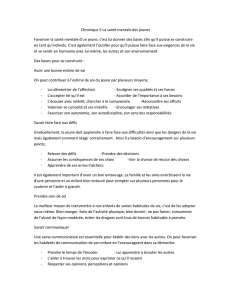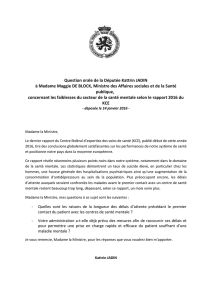Collaborer avec les familles - Institut universitaire en santé mentale

DOSSIER LA FAMILLE DANS LES SOINS
72 SANTÉ MENTALE |159 |JUIN 2011
© Christian Fafet.
Collaborer avec les familles :
SM159_12_BONIN.qxp 1/07/11 10:03 Page 72

LA FAMILLE DANS LES SOINS DOSSIER
Jean-Pierre BONIN*,
Mélanie LAVOIE-TREMBLAY**,
Guylaine CYR***,
Dominique LAROCHE****
*Ph.D Professeur agrégé Faculté des sciences
infirmières Université de Montréal,
** Ph.D., Associate Professor Université McGill,
*** Ph.D., Centre de recherche Fernand-Seguin,
**** M.Sc. Centre de recherche Fernand-Seguin.
En 2005, le ministère de la
santé et des services sociaux du Québec
lance un Plan d’action en santé mentale
(PASM) (1) qui, en lien avec les recom-
mandations de l’Organisation mondiale de
la santé (2001) (2), vise à favoriser le trai-
tement des personnes atteintes de troubles
mentaux dans les services de santé pri-
maire, plutôt que dans des hôpitaux psy-
chiatriques. Un autre objectif est de favo-
riser la participation des usagers et de leurs
proches aux structures de décision. À la
suite de ce plan d’action, des changements
majeurs ont lieu dans l’organisation des
services de santé mentale, mais on s’in-
terroge sur la place réelle de la famille
dans ces transformations.
Dans ce contexte, un projet de recherche
est mis sur pied, impliquant les familles,
les établissements de santé, les organismes
communautaires, les groupes d’entraide
familiaux. Ses objectifs sont d’évaluer,
entreautres, les facteurs qui facilitent ou
entravent l’implication et la collaboration
des familles dans ces transformations, et
de dégager des recommandations pouvant
informer les décideurs et les familles.
Dans cet article, les réponses des familles
ont été regroupées en fonction de trois rôles
proposés par la Fédération des familles et
amis de la personne atteinte de maladie
mentale (FFAPAMM) en collaboration avec
l’équipe de recherche, les questions et les
thèmes de la grille d’entrevue ayant été
choisis en fonction de ces rôles.
– L’accompagnateur :c’est le rôle imposé par
le fait d’être un proche de personne souf-
frant de maladie mentale. En tant qu’ac-
compagnateur, la famille a besoin d’établir
des liens avec les intervenants. Selon le
PASM (1), «La famille représente la prin-
cipale source de soutien. Les familles
demandent un rapprochement avec les
équipes traitantes. Elles veulent êtrerecon-
nues, à juste titre, comme partenaires. »
–Le client : c’est le rôle qui découle de
celui d’accompagnateur lorsque le proche
aidant bénéficie de soins pour ses pro-
blèmes psychiques ou physiques liés au
fait de soutenir une personne malade.
En tant que client, la famille éprouve
des besoins particuliers :«Besoin d’être
accueillis, informés, soutenus et orientés
dans le réseau de soins. »(3)
–Le partenaire : c’est le rôle relatif à l’im-
plication (ou non) du membre de la famille
dans l’organisation des soins. C’est un
rôle de participation, de prise de décision,
de prise en considération. Dans ce cadre,
on parle aussi de participation aux consul-
tations. Ceci passe aussi par les groupes
de soutien qui « … doivent être reconnus
pour leur expertise et soutenus, puisque
les services qu’ils offrent correspondent
àdes éléments de la gamme de services
qui doit être disponible dans le réseau de
la santé et des services sociaux. »(4)
ACCOMPAGNATEUR
Dans notre recherche (la moitié des familles
ont un proche atteint de schizophrénie), la
durée moyenne du rôle d’accompagnateur
est de 13,7 ans, variant de 8 mois à
53 ans (2010). En 18 mois, la « cote de
santé mentale » estimée par les familles
pour leur proche sur une échelle de 1 (pire
état de santé imaginable) à 10 (meilleur
état de santé imaginable) est passée de
4,8 à 6,4. Le type de soutien le plus sou-
vent apporté par les familles à leur proche
atteint est un soutien affectif et 80 %appor-
tent un soutien financier.
Lors de la première évaluation, moins
de 25 %des familles estimaient que les
besoins de leur proche étaient restés
stables depuis un an, 18 mois plus tard,
ils sont 40 %. Par ailleurs, pour 70 %
des familles, l’accès à ces soins n’a pas
évolué malgré la mise en place du PASM.
Les familles mentionnent que la continuité
des services, la relation thérapeutique
et l’accessibilité sont les éléments qu’ils
apprécient le plus dans les services de
santé mentale. Certains de ces éléments
ont aussi dans le même temps été les moins
appréciés : accessibilité, continuité des
soins et collaboration avec l’aidant. Selon
Au Québec le dernier plan d’action en santé mentale affirmait vouloir impliquer les
familles dans l’organisation des soins. Une étude a évalué leur « participation ». Comme
en France, il reste beaucoup à faire…
SANTÉ MENTALE |159 |JUIN 2011 73
Méthodologie de la recherche
En 2009, 1 496 questionnaires sont envoyés à
des familles québécoises dont 573 sont
éligibles (taux de réponse = 38,3 %). Ce taux
d’éligibilité s’explique par le fait qu’il avait
été demandé aux familles qui ne prenaient
plus soin de leur proche atteintde retourner
le questionnaire vide (N = 119 vides). Dix-huit
mois plus tard, sur ces 573 questionnaires
éligibles adressés de nouveau à ces familles,
386 questionnaires sont reçus. De plus, parmi
les personnes ayant signifié dans ce
questionnaire leur désir de participer à une
entrevue de groupe (N = 130), 6 groupes de
familles, soit 54 personnes au total ont été
rencontrées, et 24 de celles-ci ont été
interviewées de nouveau 18 mois plus tard.
plus qu’une philosophie…
SM159_12_BONIN.qxp 1/07/11 10:03 Page 73

DOSSIER LA FAMILLE DANS LES SOINS
74 SANTÉ MENTALE |159 |JUIN 2011
les familles, ces points sont à améliorer
tout comme l’information et le soutien pour
les aidants et le rétablissement.
Du point de vue des familles rencon-
trées, l’accessibilité aux soins et aux ser-
vices pour le proche est plus difficile
avant puis après l’hospitalisation.
Avant, l’accès aux soins se fait tardive-
ment, car il faut attendre que le patient
soit en état de crise, ce qui peut impli-
quer d’avoir recours à la police : « … Par-
fois le psychiatre dit : bien, non, c’est pas
encore assez, il n’est pas dangereux pour
lui-même ou pour les autres, on le ren-
voie chez lui. »
Une fois admis en urgence, l’accès aux
soins risque d’être encore plus réduit si
le proche use de ses droits, car au Qué-
bec, le client peut refuser de recevoir
des soins si le psychiatre considère qu’il
n’est plus dangereux lors d’une évalua-
tion dans les 96 heures (loi P 38). Cette
situation est inquiétante, stressante, voire
culpabilisante pour la famille.
Après l’hospitalisation, l’accès aux soins
diminue en phase de stabilisation de la
maladie, d’une part, à cause du manque
de médecins (psychiatres, médecins de
famille peu nombreux ou surchargés),
et, d’autrepart, à cause du patient lui-
même qui refuse l’aide offerte, arrête
son traitement ou nie sa pathologie. La
continuité des soins est alors remise en
cause et la collaboration avec les familles
apparaît particulièrement difficile dans ce
contexte : «… j’ai appelé au CLSC (Centre
local de services communautaires), il y
avait huit mois d’attente. »
Par ailleurs, le rôle d’aidant est difficile
et ne va pas sans heurts. Ainsi, les deux
tiers des proches affirment jouer ce rôle
avec une certaine difficulté, et environ 20 %
disent se sentir dépassés ou stressés la
plupart du temps devant les exigences de
ce rôle. Il est donc nécessaire de propo-
ser des services d’aide et de soutien pour
la famille, sinon l’accompagnateur devient
lui-même consommateur de soins et la
collaboration devient plus difficile.
L’accompagnateur est donc souvent celui
qui prend la relève des soins et des ser-
vices ou qui comble le fait qu’il ne soit
pas accessible. C’est aussi celui sur qui
les services se « libèrent » du patient, mais
sans lui procurer l’aide ou l’appui néces-
saireet sans l’impliquer.Dans ce contexte
l’accompagnateur est donc un interve-
nant avec qui les soignants devraient
collaborer :«…ils nous disent :débrouillez-
vous… À peu près ».
Pourtant, on constate que la majorité des
familles estime que les intervenants ne les
ont pas orientées vers des ressources afin
de les soutenir dans leur rôle d’aidant :
« … il a fallu que je fasse moi-même les
démarches pour qu’on trouve de l’aide »
et qu’elles n’ont pas été informées sur les
services de santé mentale disponibles
dans leur région : « Au niveau des services,
moi, je trouve que c’est très difficile à trou-
ver pour quelqu’un qui ne s’y connaît
pas, il faut passer par les organismes
communautaires, sinon à l’hôpital, il n’y
ajamais personne qui t’explique rien.
C’est le dernier de leur souci. »
CLIENT
Le rôle d’accompagnateur décrit précé-
demment semble avoir des effets néfastes
sur la santé physique et mentale des
aidants. Ainsi, leur score moyen de santé
émotionnelle s’est maintenu autour de 7 sur
une échelle de 1 (pire état de santé ima-
ginable) à 10 (meilleur état de santé
imaginable). Environ 1 aidant sur 5 dit
prendredes médicaments prescrits par
un médecin pour ces problèmes. De
même, le score moyen de santé physique
de l’aidant s’est maintenu autour de
7,5 (40 % prenant des médicaments à
cet effet).
En moyenne, le nombrede familles pré-
sentant une détresse psychologique éle-
vée est passé de 53 % à 50 % en 18 mois,
ce qui représente une légère amélioration,
mais il faut savoir que la moyenne de la
population générale est de 20 %. Par
ailleurs, 40 % des familles continuent de
présenter une détresse psychologique
élevée après 18 mois. Notons que la
détresse est composée de quatre groupes
de symptômes, soit :la dépression, l’ir-
ritabilité, les troubles cognitifs et l’anxiété.
En entrevue, les familles évoquent sou-
vent ce lien entre leur santé et leur rôle
d’accompagnateur :«Elle m’a tellement
fatiguée depuis des années que moi-
même, je prends des antidépresseurs » ;
«Quand il y a une personne malade dans
une famille, la famille est malade… c’est
quelque chose qui ne finit jamais, c’est
un deuil perpétuel. »
Près de la moitié des familles (46 %) affir-
ment avoir participé à des groupes d’en-
traide proposés par des associations de
familles et amis. Près de 40 %affir-
ment avoir participé à des activités d’in-
formation et un peu plus de 30 % men-
tionnent avoir pu bénéficier d’interventions
individuelles. Toutefois, les familles
rencontrées estiment ne pas disposer
suffisamment de services et de pro-
grammes d’aide pour elles-mêmes.
Les familles ont retiré de nombreux béné-
fices des services proposés par les asso-
ciations de familles et amis, en particu-
lier l’accompagnement, le support, les
conseils et l’information et la formation :
« Moi, je ne serais pas ici, j’étais aussi à
terre que ma fille… mais j’ai compris qu’il
fallait que je m’aide avant de pouvoir
aider. Mais sans des organismes comme
ça, je ne sais pas… je ne sais pas où je
serais, aujourd’hui, c’était invivable ».
PARTENAIRE
Un peu plus de 20 % des familles affir-
ment avoir eu l’occasion de participer
aux décisions concernant l’organisation
des services proposés dans leur région par
le biais des organismes communautaires,
qui font le lien avec les autorités politiques.
Par ailleurs, 45 % des familles estiment
que les intervenants des services de santé
mentale n’ont pas du tout tenu compte
de leur opinion dans la prise de déci-
sion concernant leur proche. Selon l’en-
semble des familles, la loi sur le secret
professionnel, qui empêche la divulgation
au proche aidant de renseignements
confidentiels relatifs au malade sans le
consentement de ce dernier, constitue
une entrave importante à la collabora-
tion. Cette loi est perçue comme donnant
tous les droits aux patients majeurs et aucun
droit aux proches : « Effectivement, à
chaque fois que j’ai essayé d’intervenir,
d’avoir de l’information, c’était toujours :
bien ton gars est majeur. Là, il fallait
comme avoir le consentement de mon
fils pour que je puisse aller plus loin. Je
pense que c’est la plus grosse probléma-
tique qu’il y a dans toute l’organisation,
dans toute la structure. » Dans tous les
entretiens avec les familles, il ressort
que la réticence du psychiatreàcollabo-
rer constitue un frein majeur à l’implica-
tion de la famille dans les services :
«…je téléphonais au psychiatre, il ne
m’a jamais, jamais rappelée. Jamais ».
DES RECOMMANDATIONS ?
Au cours des entrevues de groupes, plu-
sieurs recommandations sont ressorties
de la partdes familles concernant leur
collaboration au sein des services de
santé mentale. Voici donc les principales,
avec les propos associés.
•Puisque le proche est celui qui connaît
le mieux le patient, il devrait êtreimpliqué,
SM159_12_BONIN.qxp 1/07/11 10:03 Page 74

LA FAMILLE DANS LES SOINS DOSSIER
SANTÉ MENTALE |159 |JUIN 2011 75
formé, informé, et disposer des services
nécessaires afin qu’il puisse jouer son rôle
de collaborateur et d’accompagnateur.
« Quand on est renseignés, on a un peu
moins peur, ça ne nous ôte pas nos
inquiétudes, ça ne nous ôte pas la peine
qu’on a quand c’est un proche, mais au
moins, quand on sait… De l’information,
ça ne guérit pas, mais ça aide à mieux
vivre la situation. »
•Revoir la loi afin de permettre au proche
d’avoir une prise de décision, un pouvoir
d’agir. On suggère un mandat d’inaptitude
(ou une procuration) qui permettrait au
proche atteint de désigner une personne
de son entourage qui serait chargée de
prendre les décisions à sa place lorsqu’il
est trop malade, comme on le fait avec les
troubles physiques. Des membres de familles
suggèrent que ce soit le psychiatre qui
demande au patient de désigner une per-
sonne à qui il donne l’autorisation d’être
impliquée lorsque son état se dégrade.
«…je voudrais que le système accepte de
mettre une personne proche des patients
comme étant la personne à qui on ouvre
les dossiers, qu’on lui donne accès ».
•Avoir des appartements supervisés serait
excellent, car cela donnerait un cadre
au patient tout en le sortant de l’isole-
ment. Dans le même esprit, on pourrait
créer des lieux d’accueil pour le patient
afin que les membres de la famille puis-
sent avoir un temps de répit. « Moi, j’ai-
merais ça qu’il y ait, un jour, des endroits
où ça ressemble à un hôtel de vacances
où les personnes qui ont des problèmes
de santé mentale pourraient aller, de
façon à ce que ceux qui vivent avec ces
proches-là puissent avoir un répit. »
•Qu’il y ait un intervenant pivot pour faire
les relances, le suivi, auprès du patient
une fois que celui-ci retourne dans la
communauté. Un service de visites à
domicile qui s’assurerait du suivi dans la
communauté.
•Informer les psychiatres, surtout, de l’exis-
tence des organismes communautaires
afin que ceux-ci puissent adresser les
proches à l’un ou l’autre des centres
selon les besoins des proches.
•Mieux informer la population sur les-
problèmes de santé mentale, surtout les
jeunes, et impliquer les anciens patients
dans ces programmes de sensibilisation.
•Augmenter le financement des organismes
communautaires qui apportent aide et
appui aux patients et aux proches.
POUR NE PAS CONCLURE
Le Plan d’action en santé mentale 2005-
2010 visait à impliquer les familles dans
le processus de soin de leur proche et dans
les transformations de l’organisation des
soins en santé mentale du Québec. Force
est de constater, au terme de cette période
d’intenses changements, que l’on n’a pas
eu ou pris le temps d’instaurer une véri-
table collaboration avec les familles de
personnes atteintes de troubles mentaux.
En effet, ce plan n’avait pas de véritable
stratégie d’implication des familles et
s’en tenait davantage à une « philoso-
phie ». Il reste donc beaucoup à faire…
1– Ministère de la santé et services sociaux (2005). Plan d’ac-
tion en santé mentale : La force des liens. Québec, MSSS (2005).
2– Organisation mondiale de la santé (2001). Rapport sur la
santé dans le monde 2001 – la santé mentale. Genève, OMS.
3– Ministère de la santé et services sociaux (2005). Plan
d’action en santé mentale : La force des liens. Québec, MSSS
(2005). pages 66-67.
4– ibid page 41.
5– ibid page 91.
© Christian Fafet.
Résumé :
Au Québec, un Plan d’action en santé mentale a été émis par le ministère de la Santé et des Services sociaux, dans lequel on disait
favoriser la participation des personnes utilisatrices de services et de leurs proches dans les structures de décision. Une étude s’est penchée sur la percep-
tion des familles de leur collaboration avec les services de santé mentale suite à ce Plan d’action. Des recommandations sont énoncées par les familles.
Mots-clés :Familles – Santé mentale – Collaboration – Politiques de santé – Évaluation des services.
SM159_12_BONIN.qxp 1/07/11 10:03 Page 75
1
/
4
100%