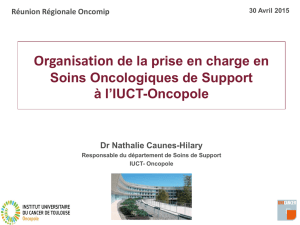dossier sur les liens

Newsletter n°2
Octobre 2014
Édito
Alors lA rentrÉe ?
C’est la rentrée des classes. Quel moment chargé d’émotions,
d’angoisse, d’enthousiasme et de questions pour l’enfant qui
grandit, intègre la société ! L’école, cet espace commun, « ordi-
naire » est un des rares lieux où la « normalité » semble possible
pour l’enfant concerné par une maladie chronique, sévère ou sans
traitement curatif. Certes, la mobilisation forte des associations et
la loi du 11 février 2005 ont considérablement augmenté le taux
de scolarisation des enfants atteints de maladie grave. Cependant,
cette scolarisation reste régulièrement soumise à nombre d’aléas :
aménagements et auxiliaire de vie scolaire non disponibles repor-
tent la rentrée tant attendue ; les difficultés organisationnelles et
administratives ne permettent qu’une scolarisation de quelques
heures hebdomadaires. À l’école, les enfants et les parents s’affron-
tent alors à un « déficit éducatif » et ces situations génèrent une
forme de surhandicap.
La première motivation de l’école est celle de l’intégration par la
socialisation, le détachement d’avec le groupe familial. Jusqu’ici
protégé par le domicile ou l’hôpital, l’enfant gravement malade
affronte pour la première fois la réalité extérieure. Il se sent seul,
en décalage, questionné, moqué. À côté du handicap connu, évi-
dent, presque accepté parce qu’anticipé par les adultes, se trouve
la différence discrète, presque invisible. « Tu es moche », moquerie
la plus souvent rapportée par les enfants, souligne l’image per-
çue par le groupe et renvoie à cette incurable solitude. La discri-
mination précoce est dévastatrice pour l’estime de soi. Bien sûr
l’accompagnement est indispensable. Peut-être est-il possible de
réfléchir pour prévenir, préparer l’enfant et son entourage face à
ces difficultés...
La seconde motivation, celle de l’instruction pour l’acquisition de
compétences, pour la possible insertion professionnelle concerne
davantage les enfants qui « grandissent ». Comment une scolari-
sation si chaotique, si dépendante des logiques institutionnelles,
peut-elle conduire à l’intégration professionnelle ? Une réalité ou
une utopie ?
Hélène Dufresne, chef de projet socio-éducatif,
Hôpital Necker Enfants-Malades
www.paliped.fr
Votre Équipe Ressource Régionale en Soins Palliatifs Pédiatriques d’Île-de-Fance
dossier : liens entre Équipes
sommAire
• Résultats d’enquête OnPedIF
• dOssIeR Liens entre équipes :
- seRvIces hOsPItalIeRs de PédIatRIe sPécIalIsée
- seRvIces de PédIatRIe généRale
- had
- ÉquIPes mObIles sOIns PallIatIFs
- Réseaux de sOIns PallIatIFs
• RessOuRces et actualItés

2
&
&
PALIPED enquête
An de mieux cerner les actions de formation et d’ac-
compagnement à mettre en place pour de meilleurs
soins palliatifs pédiatriques, le réseau d’Île-de-France
d’Hématologie et d’Oncologie Pédiatrique (RIFHOP) et
l’Équipe Ressource de Soins Palliatifs Pédiatriques d’Île-
de-France (PALIPED) ont entrepris en 2011, une étude
en deux phases. La première partie s’est intéressée au
parcours de soins des enfants atteints de cancer, résidant
et traités en Île-de-France, dans l’un des 4 services de
référence en oncologie pédiatrique, et décédés en 2010.
Les dossiers médicaux et inrmiers de 51 patients ont pu
être étudiés de façon rétrospective : modalités de prise en
charge, de décision de passage
en soins palliatifs, parcours de
soins des trois derniers mois
de vie, description de la prise
en charge thérapeutique et
psychologique pendant la der-
nière semaine, évaluation de
l’implication du médecin trai-
tant. La seconde partie, dont
il est question ici, cherche à
évaluer le vécu des familles et
du personnel soignant de ces
mêmes enfants pendant cette
période de prise en charge
palliative.
Cette deuxième phase com-
porte un volet centré sur
les parents endeuillés, et un
volet centré sur les soignants.
Les parents susceptibles de par-
ticiper à l’étude devaient être
contactés par une lettre du
médecin référent du centre
concerné pour présenter les
objectifs de l’étude et son
déroulement. Le courrier
précisait qu’ils seraient contactés par téléphone par un
psychologue-chercheur, en l’absence de refus exprimé de
leur part. Le psychologue proposait alors aux parents de
répondre, lors d’un entretien semi-dirigé ou d’un ques-
tionnaire écrit, à des questions portant sur la décision de
passage en soins palliatifs, la transmission de l’information,
les soins et traitements reçus durant la dernière semaine
de vie et l’après-décès. Lorsque les parents acceptaient
l’entretien, les soignants du ou des services concernés
(hôpital de référence, hôpital de proximité et HAD) et
tous ceux qui s’étaient occupés de l’enfant (quelque soit
leur secteur d’activité) étaient conviés à un Focus-Group
(Le Focus Group est un outil de recherche sociologique
constitué d’un groupe de personnes et animé par un pro-
fessionnel). Si le questionnaire était choisi par les parents,
l’équipe du service de référence devait à son tour remplir
un questionnaire.
Les 51 enfants concernés par l’étude ont été suivis
dans les 4 services spécialisés par 24 médecins réfé-
rents. Il a été demandé à chacun d’entre eux d’envoyer
une lettre aux parents et, après parfois plusieurs mois de
réexion, 19 médecins ont accepté le principe d’adresser
ce courrier aux parents de 37 enfants. 4 courriers n’ont
pas pu être envoyés ou sont revenus faute d’adresse. Les
médecins de 4 enfants ont souhaité ne pas envoyer de
courrier pour des situations qu’ils jugeaient trop « vio-
lentes », « conictuelles » ou
« compliquées » et 10 courriers
n’ont pas été envoyés sans que
les 6 médecins référents ne
motivent leurs refus. Sur les
33 familles ayant reçu le cour-
rier, 4 ont refusé de participer
lors de l’appel du psychologue
(« c’est trop dur »), 6 n’avaient
plus le même numéro, et 4 ne
se sont pas manifestées malgré
les messages vocaux laissés.
19 entretiens ont pu être réali-
sés concernant 18 familles (les
deux parents séparément pour
un enfant) et 2 familles ont
choisi le questionnaire mais
une seule l’a renvoyé, soit 20
participants.
À
ce jour 15 Focus-Groups
ont pu être réalisés avec
les soignants. Les problèmes
rencontrés dans l’envoi des
courriers, puis l’organisation
des Focus-Groups, au-delà
d’un manque de temps mani-
feste des soignants, lève le voile sur la difculté de ce
travail de mémoire : volonté de protection des parents
endeuillés, crainte de ne pas se souvenir 3 ans après ou
limite protectrice du soignant … beaucoup de choses ont
pu être échangées lors de ces rencontres appréciées des
participants.
Malgré ces difcultés, les renseignements obtenus
sont d’une très grande richesse et permettront, nous
l’espérons, de mieux comprendre les attentes des parents,
d’enrichir la connaissance des soignants et de mieux anti-
ciper les difcultés de chacun. Que tous ceux, parents
comme soignants, qui vont nourrir notre réexion par
des témoignages si forts, soient grandement remerciés.
Dr P.Boutard, consultant
pAroles de soignAnts et de pArents d’enfAnts Atteints de cAncer,
en soins pAlliAtifs, rÉsidAnt en Île-de-frAnce et dÉcÉdÉs en 2010 :
l’Étude onpedif

&
&
3
AnAlyse
Dans le cadre de cette étude Paliped-Rifhop une
quarantaine de professionnels a participé à des
rencontres animées par une socio-anthropologue,
enseignant-chercheur en médecine. Une quinzaine de
Focus-Groups ont ainsi été organisés dans 4 centres de
référence et un hôpital périphérique, d’une durée de 70
minutes en moyenne. Tous les échanges ont été enre-
gistrés, retranscrits intégralement et anonymisés. A été
privilégiée une analyse thématique des données. De ces
rencontres difciles à mettre en place - il y a eu un long
travail de persuasion et de recrutement des médecins et
paramédicaux - se dégage une grande richesse de conte-
nus, dont on peut extraire ces quelques points:
À
la différence des parents, les professionnels consi-
dèrent tous que le délai de 3 ans depuis le décès du
patient est trop long. Ils ont souvent oublié les situations
non conictuelles ou celles qui n’étaient pas marquées
par une afnité forte avec l’enfant ou ses parents. Le
souci de la douleur est présent dans tous les échanges,
et semble avoir généré une mobilisation effective des
professionnels. La dégradation du corps, la mutilation,
la transformation du visage par les traitements ont été
plus malaisément évoquées. Les trajectoires thérapeu-
tiques paraissent jalonnées d’une variété d’émotions et
de valeurs, et des éléments culturels et sociaux ont appa-
remment généré un décalage entre soignants et familles.
Les soignants ont pu dire leurs difcultés à admettre l’al-
térité sociale, culturelle, religieuse, psychique. Le « temps
d’après » le décès avec différentes questions autour des
condoléances, des obsèques, des parents qui reviennent
ou pas... montre une grande diversité des manières de
faire. Il conviendra de rapprocher ensuite ces conduites
de ce qu’en disent les parents, pour comprendre et déve-
lopper celles qui sont aidantes.
L’objectif initial qui visait à repérer les difcultés
ressenties par le personnel soignant est atteint. Il a
été apprécié de pouvoir repenser à ces situations à dis-
tance. Les participants se sont conés en reconnaissant
tirer bénéce de ce temps d’exception. Ils ont rééchi
notamment aux mécanismes de la mémoire (collective et
individuelle) et se sont étonnés des souvenirs qui surgis-
sent en entendant leurs collègues parler de l’enfant et de
ses proches. Apparaissent des tensions et des inquiétudes
dans ce travail d’accompagnement mais aussi les modes
de solidarité qui s’y déploient. À distance, les relations
avec les familles semblent plutôt apaisées.
Catherine Le Grand-Sébille, Socio-anthropologue,
enseignant-chercheur
Suite à la première partie de l’étude portant uniquement
sur les dossiers et qui ne permettait pas de répondre à
certains aspects, il nous a été coné le soin de rencontrer
les parents, après qu’un courrier leur ait été envoyé par le
médecin référent de leur enfant les informant du déroulé
de cette étude. Seuls quelques points peuvent être rapide-
ment évoqués dans le cadre de cet article. Ils seront plus
longuement développés dans une communication orale
au 6ème Congrès international de soins palliatifs pédia-
triques les 2-3 octobre 2014 Saint-Malo, puis dans des
publications à venir. 19 entretiens, d’une durée moyenne
de 75 minutes, on été menés, concernant 18 enfants (2
parents d’un même enfant ont témoigné séparément). Il
s’agissait de 7 mères, 3 pères et 9 couples. Dix de ces
entretiens ont eu lieu au domicile et 9 dans un autre lieu
(siège de PALIPED, café …).
Informer leur enfant de la gravité de sa maladie et/
ou de sa n de vie prochaine semble difcile, sinon
impossible pour la majorité des parents. C’est, pour beau-
coup, indicible quand l’enfant est jeune. Cependant ils
acceptent volontiers que le médecin référent réponde aux
questions de leur adolescent si la relation est de bonne
qualité. Néanmoins, dans certains services, des progrès
quant à l’empathie et au tact dans les annonces est, selon
eux, encore à faire. Ce que les parents redoutent le plus
c’est que leur enfant souffre. La prise en charge de la dou-
leur est une de leur première demande. Ils se disent, en
majorité sur ce point, satisfaits. Même si certaines souf-
frances sont encore évitables.
Ce qui ressort fortement de cette étude c’est que tout
au long de la maladie de l’enfant, les parents s’ou-
blient en tant que personnes. Ils sont peu attentifs à
leurs propres besoins (sommeil, nourriture, etc.) pour se
consacrer entièrement à ceux de l’enfant. C’est un temps
traversé par la peur, la tristesse et la colère. Un de leurs
souhaits, dont ils disent là aussi qu’il est en partie satisfait,
est de mieux participer aux décisions de traitement et de
limitation et/ou arrêt de traitement de leur enfant. Des
compromis liés aux conditions du mourir ont été accep-
tés par les parents (sédations en phase terminale, lieu du
décès, etc).
Après le décès : une lettre de condoléance personna-
lisée est bienvenue, la présence des soignants aux
obsèques et toutes les manifestations d’émotion de la part
des équipes sont grandement appréciées. Enn, il semble
se dégager le désir que soit privilégié une écoute ouverte
du parent endeuillé en évitant l’écueil d’une pathologi-
sation excessive. Le deuil n’est pas une maladie, comme
l’ont rappelé certains. Ce que les parents attendent des
médecins et soignants, c’est à la fois une grande expertise
et de réelles qualités humaines, ce dont ils attestent bien
souvent dans leurs témoignages.
Gérard Sébille, psychologue clinicien, chercheur
Des professionnels D’hémato-
oncologie péDiatrique acceptent
D’évoquer leurs souvenirs De
situations De fins De vie
« on a voulu se consacrer à mille
pour cent à notre enfant,
et pas à nous » (un père)

4
&
&
liens entre équipes
Coordonner des compétences complémentaires
retour à la maison D’un nouveau-né
en insuffisance rénale terminale
Histoire de Louis
Lors de la 3ème grossesse d’un couple jeune en bonne
santé, le diagnostic de valves de l’urètre postérieur
avec complications sur les voies urinaires a été posé
lors de l’échographie du 2ème trimestre. Plusieurs réu-
nions multidisciplinaires ont eu lieu en anténatal avec les
obstétriciens et les néphrologues. Les parents n’ont pas
souhaité interrompre la grossesse et plusieurs interven-
tions chirurgicales ont été tentées (intervention par voie
cystoscopique avec pose d’un drain, drain vésico amnio-
tique, amnio-infusions…) pour préserver la fonction
rénale. Louis est né eutrophe à terme et a été transféré en
réanimation suite à une détresse respiratoire aiguë (intubé,
ventilé) et une insufsance rénale. Il est resté 3 semaines
en réanimation. Malgré l’autonomie respiratoire acquise,
l’évolution a été défavorable sur le plan métabolique avec
majoration de l’insufsance rénale néonatale. La déci-
sion de ne pas entreprendre de mesures invasives, dont
la dialyse, a été prise avec l’équipe de la réanimation, les
néphrologues, l’équipe mobile de soins palliatifs, la psy-
chologue en accord avec les parents. Louis a été transféré
dans le service de néphrologie dans une chambre mère-
enfant personnalisée par les parents (photos, cadeaux,
…). Après concertation avec les équipes et la famille, la
surveillance biologique et les prises de constantes ont été
arrêtées. Louis était somnolent, eupnéique, cachectique,
hypotonique mais réactif. Le traitement symptoma-
tique a été ajusté selon les signes cliniques observés.
Les parents ont souhaité ardemment rentrer chez eux
avec Louis pour la n de vie mais étaient inquiets sur la
faisabilité de ce retour, en particulier le père, soucieux
de protéger les autres enfants. Au cours des différents
entretiens, les parents ont cheminé et se sont appropriés
le projet de retour à domicile avec l’HAD (hospitalisa-
tion à domicile).
Ce retour à la maison a été préparé lors d’une ren-
contre préalable entre l’équipe HAD (puéricultrice et
pédiatre), le service de néphrologie (médecins et équipe
soignante, assistance sociale et pédopsychiatre) et l’équipe
mobile de soins palliatifs pédiatriques. Les parents ont
rencontré la puéricultrice et le pédiatre de l’HAD dans le
service de néphrologie pour poser leurs questions concer-
nant le projet de vie, les soins de confort pour Louis, la
prise en charge des symptômes de n de vie et l’accom-
pagnement de la famille. Les parents ont souhaité que
Louis décède à la maison entouré de sa famille. Louis a pu
rentrer. Il avait une alimentation maternelle à la demande,
recevait du paracétamol ainsi que des doses inmes de
morphine toutes les douze heures débutée en raison
d’un inconfort. Des prescriptions anticipées d’Hypno-
vel® intra rectal en cas de convulsions ou de symptômes
réfractaires ont été faites. Le SAMU a été prévenu sur le
projet palliatif de cet enfant (projet de soins raisonnables,
pas de réanimation en cas de détresse vitale, ni de geste
invasif).
Initialement, la puéricultrice de l’HAD venait au domi-
cile une fois par jour pour l’évaluation clinique et
l’adaptation des traitements en lien étroit avec le pédiatre
de l’HAD. Ce rythme a été adapté à deux fois par jour,
les visites étaient conjointes avec le pédiatre de l’HAD.
Le médecin de l’équipe mobile de soins palliatifs était en
lien quotidiennement avec les parents et l’équipe HAD.
L’enfant s’épuisait et tétait de moins en moins. En accord
avec les parents, il a été décidé de ne pas débuter d’assis-
tance nutritionnelle ni d’hydratation intraveineuse, mais de
respecter ses besoins d’hydratation des muqueuses avec
des soins de bouche. L’ensemble des traitements était
donné soit per os, soit en intra rectal. Louis réagissait aux
paroles réconfortantes de ses parents, de son frère et sa
soeur. Le traitement a été réajusté avec une augmentation
progressive des doses et de la fréquence de la morphine,
et l’introduction de Laroxyl® devant des geignements et
une augmentation du score d’EDIN. Dans un second
temps, de petites doses d’Hypnovel® à visée anxiolytique
ont été débutées en intra rectal. Ainsi, Louis a pu être
paisible, serein et confortable. Il est décédé 48 heures
après l’ajustement du traitement, la nuit dans son som-
meil, entouré de ses parents qui dormaient à ses côtés.
Pendant ces 8 jours au domicile, le cadre de vie habituel
a été préservé pour le frère et la soeur, les parents ont
préparé l’après (choix des habits, cercueil et préparation
de la cérémonie), les grands-parents étaient très présents.
La famille était soutenue par son entourage proche, dont
la communauté de leur paroisse. Les rites religieux ont pu
être débutés au domicile en présence de la fratrie.
L’HAD a pu accompagner les parents dès le début de
la prise en charge, jusqu’au décès de leur bébé puis
lors des démarches administratives. L’histoire de Louis
met l’accent sur l’importance de la construction d’un pro-
jet coordonné, commun et anticipé par les différentes
équipes, à la fois à l’hôpital et au domicile, le respect du
choix des parents centré sur le bien être et le confort
de leur enfant tout en respectant leur rythme et leurs
émotions.
Service de Pédiatrie spécialisée & HAD
Dr Édith Gatbois, HAD AP HP et
Dr Aude Le Divenah, EMSPP Necker Enfants malades

5
&
&
centre hospitalier De versailles...
Il est toujours difcile - quelque soit le lieu de soin -
d’accompagner un enfant au décès. Dans un service de
pédiatrie générale, le plus souvent tourné vers la guéri-
son et vers la vie, la mort d’un enfant peut être vécue par
l’équipe comme un échec. Même si ces situations se pré-
sentent rarement dans notre service, le vécu est toujours
très douloureux et violent, autant pour les médecins que
pour les paramédicaux. Ces dernières années notre ser-
vice a été sollicité de manière de plus en plus régulière
pour des prises en charge palliatives. Ces expériences, à
chaque fois singulières, nous ont amenés à penser diffé-
remment la
prise en
charge glo-
bale de ces
enfants.
Ainsi nous
avons pu
identifier
un certain
nombre de pré requis pour que l’accompagnement se
fasse de la manière la plus harmonieuse possible pour
l’enfant, sa famille et l’équipe.
En amont, un lien solide avec les services de référence
est indispensable pour pouvoir disposer de données
médicales les plus complètes et récentes possibles. De
même, l’évaluation psychologique et sociale de l’enfant
et de sa famille se fait le plus souvent en complémenta-
rité entre le centre de référence et le centre de proximité.
Nous avons constaté combien il était précieux d’avoir
des interlocuteurs privilégiés et bien identiés dans ces
situations. Cette étroite collaboration va permettre une
relation de conance « triangulaire » indispensable entre
le centre de référence, le centre de proximité et la famille.
En aval, nous travaillons activement au développement
de la collaboration avec différents réseaux et équipes en
interne (équipe mobile de soins palliatifs) et en externe
(par exemple dans les Yvelines : HAD Santé Service,
Réseau Pallium, médecin traitant, …). Les réseaux
externes et le médecin traitant ayant pour mission de se
déplacer au domicile du patient, représentent pour nous
les garants de la continuité et de la cohérence de la prise
en charge de l’enfant et de sa famille dans son environne-
ment habituel.
Enn, la proximité du domicile nous confère un rôle
d’intermédiaire entre le centre de référence et le
patient. Les parents trouvent dans le centre de proximité
un lieu plus facilement accessible dans cette période si
sensible. Si, pour la famille et l’enfant, cette proximité
géographique apparaît souvent bénéque, elle peut
être, paradoxalement pour nos équipes, source de fra-
gilité. Dans ce contexte, les actions du RIFHOP et de
PALIPED constituent une grande aide ; nous permettant
d’assurer notre rôle d’accompagnement auprès de l’en-
fant et de son entourage.
Dr Véronique Hentgen, pédiatre, Virginie Pirou, psychologue,
Sadia Berard, cadre de santé
...et réseau De soins palliatifs
le pallium
Léo, âgé de 5 ans, a été adressé au Réseau par l’hôpi-
tal de proximité. L’enfant est atteint d’une tumeur
cérébrale et les traitements curatifs ont été suspendus.
Le médecin et deux inrmières du Réseau se rendent au
domicile de l’enfant, après avoir reçu les comptes-ren-
dus médicaux. Les parents ontété informés de la n de
vie de leur enfant et cherchent à satisfaire ses moindres
désirs. Le Réseau met à leur disposition sa permanence
téléphonique et propose des visites et appels réguliers.
La psychologue du Réseau contacte la psycholo-
gue de l’hôpital pour lui faire un retour de la visite
au domicile. Les parents sont centrés sur leur
enfant et ne s’investissent plus à l’extérieur. Le
père a cessé son activité professionnelle. L’équipe
hospitalière s’inquiète de la capacité des parents à
faire face à la perte de leur enfant. Pour optimiser
le suivi, la famille est vue en consultation chaque
semaine.
Au cours des jours suivant la visite, Léo va moins
bien : maux de tête, vomissements, mauvaises nuits.
Le surlendemain le papa appelle le Réseau, Léo n’est pas
bien, il a du mal à le réveiller. Le médecin généraliste
est absent, alors le Réseau cherche et trouve un rempla-
çant pour aller voir Léo sur place. 48 heures plus tard,
la mère informe le Réseau qu’il y a eu une aggravation,
le SAMU a été appelé la nuit pour un problème respi-
ratoire. La mère se met à pleurer en expliquant que son
mari est sorti faire les démarches pour les obsèques de
leur enfant. Les propositions de visites sont refusées,
ils préfèrent rester seuls tous les trois. Le Réseau fait le
point avec le service de soins à domicile et le service de
pédiatrie de l’hôpital. Une réunion pluridisciplinaire est
organisée pour permettre aux équipes de se rencontrer et
d’échanger autour de la situation de l’enfant. Le médecin
généraliste informe le Réseau que Léo est dans le coma
avec des pauses respiratoires, mais serein. Les parents
semblent plus apaisés mais trouvent que « c’est long
». C’est le généraliste qui annoncera le décès de Léo à
l’équipe du Pallium.
L’équipe mobile du Pallium apporte son expertise de
terrain puisqu’elle se rend au domicile des patients
an d’évaluer les besoins et faire des propositions qui
sont retranscrites aux hospitaliers. Tout ajustement de
traitement est fait en concertation avec le médecin hos-
pitalier référent. Le Réseau établi également un lien avec
les soignants du domicile auxquels il apporte son sou-
tien. Les visites à domicile, les échanges téléphoniques,
et les soutiens psychologiques sont suivis de concerta-
tion avec les soignants référents de l’hôpital. Lorsque
l’aggravation de l’état des enfants ne leur permet plus
de faire des allers et retours à l’hôpital, les liens entre
leurs soignants référents et l’équipe mobile du domicile
sont particulièrement importants pour poursuivre au
mieux l’accompagnement des jeunes malades et de leurs
familles.
Sylvie Rufn, psychologue
Service de Pédiatrie générale & Réseau
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%