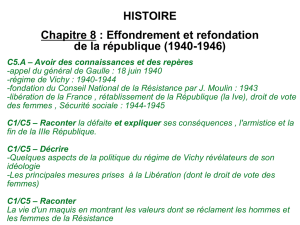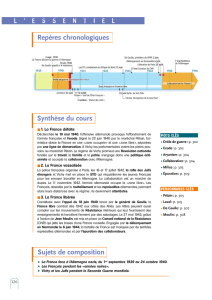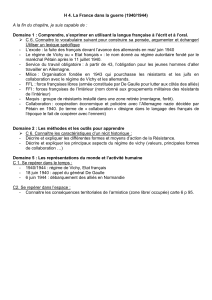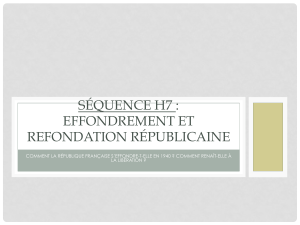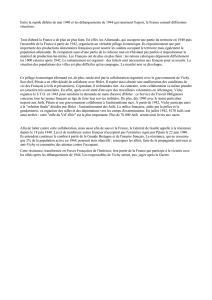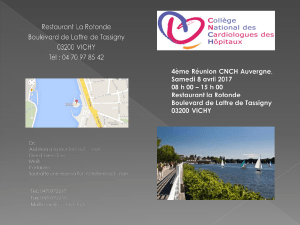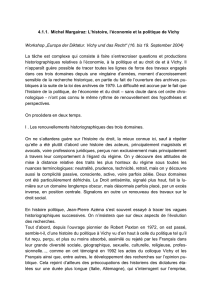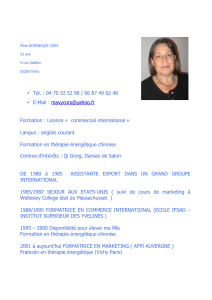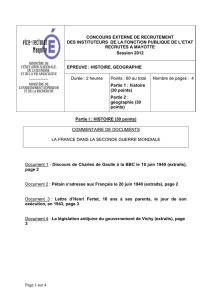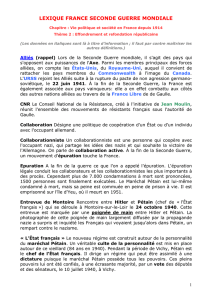Discussion

153
D
Discussion
Evelyne Sinnassamy
„Héritage de Vichy“ ou complexité de l’histoire?
L’ouvrage de Cécile Desprairies, L’héritage de Vichy. Ces cent mesures toujours
en vigueur1 qui a donné lieu à de multiples passages de l’auteure à la radio et à la
télévision, et à une ‚Une‘ enthousiaste de Libération,2 est-il vraiment une révélation
fracassante sur ce que l’auteure appelle „les acquis de Vichy“ et fait-il réellement
la leçon aux historiens comme le prétendent certains médias?3
C’est d’abord un objet singulier: la couverture sous le titre en majuscules rouges
L’héritage de Vichy est occupée par la photographie Keystone en noir et blanc
d’un pignon de maison sur lequel est reproduite en grand une affiche de Philippe
Noyer, drapeau tricolore et portrait de Pétain avec képi de maréchal, intitu-
lée „Révolution nationale“, qui fut imprimée et diffusée dès décembre 1940 et tirée
jusqu’en 1944 à des millions d’exemplaires.4 A l’intérieur des chapitres5 richement
illustrés en noir et blanc et en couleur (photographies, caricatures, images pieu-
ses, affiches, publicités, opuscules, cartes) qui comportent de 6 à 18 entrées, cha-
que fiche se termine – nostalgie ou dérision plutôt macabre? – par une petite fran-
cisque, des feuilles de chêne ou les sept étoiles de maréchal comme cul-de-
lampe!
Quant aux „cent mesures“,6 si l’on considère ces fiches de plus près, Cécile
Desprairies sous la rubrique Un peu d’histoire, avec laquelle elle commence
chaque fiche, ne cache certes pas que la plupart existaient avant Vichy, remon-
taient même parfois à la Révolution française honnie, à la IIIe République, et sur-
tout qu’une grande partie de ces mesures avait été décidée ou préparée par le
Front populaire, en particulier par Jean Zay,7 mais cela ne l’empêche pas de les
mettre au compte de „l’héritage de Vichy“, là où il s’agit plutôt de la réalisation ou
de la poursuite de projets élaborés dans les années trente,8 ou même bien avant.9
Cela témoigne plus du temps long, de la continuité due au „poids de l’adminis-
tration et des bureaux“10 et permet de comprendre que ce nombre tout compte fait
réduit de lois n’ait pas été aboli lors du rétablissement de la légalité républicaine.11
Cela relativise le titre en rouge sur la couverture „L’héritage de Vichy“, comme
Cécile Desprairies le reconnaît elle-même dans l’introduction: „Sur un certain nom-
bre de points le gouvernement parachève sans les nommer les initiatives du Front
populaire que la IVe République entérinera“ (12).
Tout aussi discutable est le sous-titre „Ces cent mesures toujours en vigueur“.
Pour arriver au chiffre magique de „cent“, l’auteure ajoute à cela des fiches, plutôt
anecdotiques, parfois amusantes, mais qui, comme elle le souligne elle-même, ne
correspondent à „aucune disposition législative“ (35) de ‚Vichy‘: Le renouveau des
pèlerinages (28); Du „Noël du Maréchal“ au Noël des entreprises (35); La sirène
du premier mercredi de chaque mois („sous contrôle allemand“, 38); L’invention de

154
D
Discussion
la télévision („et son développement sont revendiqués par l’occupant allemand dès
1940“ dit-elle, sans rappeler qu’il y avait en France depuis 1937 la diffusion d’une
émission quotidienne, 39); Les „carreaux vichy“ à la mode (41); Quand la chimie
allemande s’en mêle: Fanta et Pamprel (50) où Cécile Desprairies révèle que le
conservateur utilisé dans ces boissons (Fanta, produit par la filiale allemande de
Coca Cola, et Pampryl, inventé en Bourgogne, devenu sous l’occupation Pamprel)
est aussi utilisé pour les „gaz lacrymogènes“ (52); Le riz de Camargue où elle as-
sure que „les Français se mettent à manger du riz de Camargue“ (75) alors que la
production n’atteint en 1944 que 2200 tonnes, ce qui ne fait pas beaucoup pour 40
millions d’habitants; La musique allemande, où elle écrit (87): „Quant à l’auteur du
livret, Da Ponte [„librettiste juif“], on ‚oublie‘ de le mentionner“, alors que l’affiche
pour la représentation au Théâtre des Champs-Elysées en janvier 1941 qu’elle re-
produit indique bien „Dichtung von Lorenzo de Ponte“ (82); Le renouveau d’une
certaine musique française où elle évoque les „concerts de la Pléiade“ indiquant
qu’ils „perdurent jusqu’en 1947“ (90), sans préciser que justement le 22 mai 1947
c’est la cantate Figure humaine pour 2 chœurs qui y est donnée, composée en
1943 sur le poème d’Eluard, Liberté, par Francis Poulenc, qui avait été diffusée en
1945 par la BBC et donnée à Bruxelles par des chœurs qui avaient répété clan-
destinement;12 Danseuse étoile au firmament où elle reconnaît certes que la pre-
mière consécration d’une danseuse étoile a eu lieu le 1er mars 1940, donc avant
l’instauration du régime de „Vichy“, mais elle l’inclut dans l’„héritage“ avec
l’argument curieux que les „étoiles font partie de la symbolique et de l’esthétique
de Vichy. Le maréchal Pétain, de par sa fonction, n’est-il pas lui-même porteur de
sept étoiles?“ (96); Les héros de l’histoire revisités (en particulier Jeanne d’Arc,
tout autant d’ailleurs revendiquée par la Résistance, comme on peut le constater
dans de nombreux poèmes d’Aragon); Le film en couleur où elle affirme que „la
projection du premier film en couleur et la commercialisation des premières pelli-
cules photo couleur relèvent de l’occupant. La société Agfa qui les produit est alle-
mande“13 (109), alors que la première représentation d’un film en couleur
(Technicolor) a eu lieu en France le 4 octobre 1935: Becky Sharpe de Rouben
Mamoulian; Le film d’animation; Le déploiement de la cinémathèque française
(créée comme association loi 1901 en 1936, mais „autorisée à poursuivre ses acti-
vités“ après l’armistice, 116); La formule d’emploi des sulfamides; Des autostrades
aux autoroutes.
Pour ce qui est de la fiche Changer de nom sous Vichy (19), la loi „signée par
Laval le 17 décembre, et parue le 9 janvier 1943“ suspend „la procédure du chan-
gement de nom“ qui sera rétablie après la Libération, il ne s’agit donc pas là de
„mesure toujours en vigueur“, mais exactement du contraire. De même la carte
nationale d’identité qui existait depuis 1921 sans être obligatoire et qui à partir de
„la loi de l’automne 1940“ „possède un ‚caractère obligatoire‘“, est redevenue
facultative.
Cécile Desprairies considère que c’est par „anglophobie“ que la ligue française
de rugby à XIII (sport ouvrier) a été dissoute par Carcopino et ce sport interdit,

155
D
Discussion
mais comment expliquer alors le soutien au rugby à XV (sport de l’élite) qui est tout
autant „d’origine anglo-saxonne“ (190)?
Bon nombre de fiches concernent l’influence allemande, comme Heure d’hiver,
heure d’été qui impose à la France l’heure de Berlin (36), et selon Cécile Desprai-
ries diverses habitudes alimentaires: Le retour aux eaux minérales, „coutume ger-
manique“ (53-55),14 la suppression du diplôme d’herboriste („L’herboristerie de-
vient une affaire allemande, et l’occupant fournit la liste des ‚plantes autorisées‘“)
et l’habitude des tisanes, du „viandox“ et autres „boissons chaudes“ (56), L’huile
de pépins de raisins (69), La saccharine, édulcorant de synthèse (76), et plus
curieusement Fromage fondu et pâte à tartiner fromagère (71), alors que le
créateur de la Vache-qui-rit est Suisse et que Léon Bel a repris pour le nom de son
fromage depuis 1921 un dessin de Benjamin Rabier créé pour les camions mili-
taires de ravitaillement français (les poilus parlant de la „Wachkyrie“ opposée à la
„Walkyrie“ apposée sur les camions ravitailleurs allemands pendant la Première
Guerre mondiale).15
L’archéologie allemande a certes inspiré „de l’aveu de son instigateur Carco-
pino“ (106) Un statut pour l’archéologie, mais il est cependant étrange que Cécile
Desprairies mette au crédit du développement de l’archéologie grâce aux „lois
Carcopino“ la „découverte de la grotte de Lascaux [] en mai 1941“, alors qu’elle
a été faite par hasard en septembre 1940 par un jeune garçon à la recherche de
son chien.16
Dans les fiches La police nationale et Des GMR aux CRS, Cécile Desprairies
souligne que „le modèle allemand est prégnant“ jusque dans l’uniforme et
l’orchestre, mais ses remarques sur „l’étatisation des polices“ avant, pendant et
après ‚Vichy‘ ne sont pas très claires, et elle passe bien vite des GMR de ‚Vichy‘
aux CRS de 194417 (158-160). Dans Normalisation et norme AFNOR elle indique
certes que c’est en Allemagne que „le premier comité des normes de l’industrie a
été créé, en 1917», donc bien avant l’instauration du Troisième Reich, mais bien
que l’AFNOR ait été créée en France en 1926, elle considère que „l’arrêté du 24
mai 1941 signe la véritable date de naissance de l’AFNOR“ et que ce serait donc
un „héritage de Vichy“, alors que, comme bien d’autres institutions, il s’agit du
développement de ce qui existait déjà et continuera d’exister ensuite. Tout en rap-
pelant les „mouvements régionalistes“ de la fin du XIXe siècle et la création des
régions économiques en 1919 par Etienne Clémentel (précurseur également de la
planification économique et des organisations professionnelles et adversaire de
Pierre Laval dans les années trente), Cécile Desprairies détecte pourtant dans Le
préfet régional et la création des régions l’influence du géographe Walter Christal-
ler sans en donner de preuve, „mais il est permis de le penser“, dit-elle.18 Et alors
que le statut de Cartographe comme créateur remonte à la convention de Berne
de 1886, elle y voit l’„influence allemande“ (174). Cette influence serait plus rece-
vable pour Le handball, sport allemand ou Le certificat prénuptial ou même Mas-
sage et kinésithérapie.

156
D
Discussion
Ainsi que pour la fiche Le Code de la route: en effet même si on propose en
France un „code de la route et du roulage“ dès 1828 et que le premier „code de la
route“ y date de 1921, il y avait peu de panneaux indicateurs, et c’est à travers le
VOBIF (Verordnungsblatt der Militärbefehlshaber in Frankreich) qu’est imposée
une nouvelle signalisation routière: on remplace les „panneaux écrits en français,
incompréhensibles pour l’occupant“, par exemple la pancarte en français „sens
interdit“ par le disque rouge barré de blanc, avec „schémas à l’appui, sur près de
cinquante pages“ (222).19 Et en 1941, puis 1942 le „Journal officiel recopie [] le
Vobif“ (224). Mais il est exagéré de mettre au compte des occupants et de ‚Vichy‘
le tracé du „périphérique“ („suivant les plans établis sous Vichy“, 235) qui, avant et
après la guerre, ne peut que suivre celui de l’ancienne enceinte des fortifications.
Ce qui relève plus de l’„héritage de Vichy“, c’est La réorganisation des trans-
ports parisiens (230) qui fusionne le réseau d’autobus et le métro parisiens, c’est
peut-être L’agrégation de géographie (128), même si elle avait déjà été réclamée
par Ludovic Dupeyron au XIXe siècle20 et bien que des géographes comme Théo-
dore Lefebvre, Jacques Ancel, René Musset ou Henri Baulig aient été emprison-
nés ou tués par les nazis, que d’autres durent se réfugier à l’étranger comme Jean
Gottmann,21 et que certains passèrent d’Uriage22 à la Résistance comme Paul-
Henry Chombart de Lauwe.23 Mais même cette création de l’agrégation en 1943
s’insère dans un développement antérieur qui se prolongera après guerre: „L’inté-
rêt pour les méthodes actives en géographie s’inscrit dans un mouvement de plus
longue durée, fortement impulsé sous le Front populaire. Du côté de la géographie
universitaire, pendant la guerre et dans l’après-guerre, nombre de géographes
jouent un rôle important dans les organismes de conseil, de planification, de
reconstruction. Si l’on ajoute à cela la renommée mondiale de l’Ecole française de
géographie, on comprend que ce qui était au départ l’instrumentation de la
géographie au service de l’idéologie pétainiste se soit transformé en promotion de
la géographie scolaire et de la géographie universitaire.“24
Outre la création de La fonction de président-directeur général (146) peut-être
inspirée de l’Allemagne, relève vraiment de „l’héritage de Vichy“ celle des ordres –
des médecins (150), des architectes (152), des experts comptables (154) – qui
correspondent alors à l’idéologie corporatiste du gouvernement de Pétain et qui
appliquent tous la politique d’exclusion des juifs et des étrangers du régime. Ils
sont réformés après 1945, mais demeurent. C’est aussi „le retour des congréga-
tions“ (31). C’est la „réorganisation de la vie dans l’entreprise“ (139), fondée sur la
„Charte du Travail“,25 mais dont „l’échec est tellement patent qu’il met en évidence
a contrario la réussite, on le sait, d’un autre dispositif, beaucoup plus résiduel, de
la Charte, celui des comités sociaux d’entreprise“,26 ces comités sociaux d’établis-
sement (143-144) qui subsisteront – à ce sujet Cécile Desprairies évoque un „ser-
vice médical et social du travail“ inspiré par „une instance similaire dans l’Alle-
magne nazie, l’Ausschuss für öffentliche Sicherheit“ qu’elle traduit par „Comité sur
la santé publique“ (au lieu de „sécurité publique“). C’est La fondation de l’hôpital
public (198-199), L’autorisation de mise sur le marché pour un médicament (203-

157
D
Discussion
204),27 La médecine du travail (200), fiche où Cécile Desprairies assure qu’„une
nouvelle profession est née“, ce qui n’est pourtant pas un „héritage de Vichy“,28
mais l’inscription dans la loi d’un corps de doctrine élaboré dans les années trente.
‚Vichy‘ a cependant, même si cette politique a, elle aussi, commencé dans les
années trente et en particulier sous le Front populaire, entrepris une politique
sociale et familiale29 avec une première notion de salaire minimal (alors que „les
salaires sont bloqués et contrôlés par l’occupant“; 145), L’extension des alloca-
tions familiales (25) ou La protection maternelle et infantile (214), „validées à la
Libération“ (27).
Mais pour les femmes mariées, si la loi de 1940 supprime celle de 1938 qui leur
permettait de travailler, celle de 1942 se contente (par nécessité) de reprendre
„l’essentiel des dispositions de la loi de février 1938“ (140), il ne s’agit donc pas
vraiment d’un „héritage de Vichy“, d’autant plus qu’il ne faut pas oublier „la vio-
lence spécifique de la politique du régime à l’égard des femmes due, en grande
partie, à leur désignation collective comme élément clé de la déchéance et de la
régénération nationales“.30
Ce n’est pas non plus „un héritage de Vichy“ que le „numéro d’inscription au ré-
pertoire des personnes physiques“ (163) développé pour d’autres raisons dès
1934 par René Carmille31 et qui deviendra le numéro de sécurité sociale toujours
en vigueur aujourd’hui.
Quant aux lois contre l’alcoolisme – La nouvelle place des apéritifs (59) avec
l’interdiction des apéritifs titrant plus de 16 degrés, La fin du bouilleur de cru (62),
Vers la fin des cafés (80) – le gouvernement de Pétain s’y emploie au nom du
combat contre „la décadence nationale“ (60),32 alors que c’est pour des raisons de
„santé publique“ que luttait la IIIe République avec par exemple l’interdiction de
l’absinthe. La continuité, là, n’est qu’apparente – et il ne faut pas oublier que
l’occupant allemand s’employa à transporter en Allemagne les plus grands vins,
les champagnes, les cognacs et autres alcools et que des „Weinführer“ étaient
chargés d’en vendre dans le monde entier au profit de l’Allemagne pour financer la
guerre.33
C’est aussi une fausse continuité que le titre de la fiche Du Centre Alexis Carrel
à l’INED suggère, contre laquelle Henri Wallon s’était déjà élevé en 1947.34
Dans les deux fiches sur l’alpinisme et „la montagne pour tous“ (185),35 il est dit
que la station de Courchevel a été créée par ‚Vichy‘: en réalité, même si un rapport
de 1942 du Commissariat Général à l'éducation générale et sportive (CGEGS)
s’intéresse au site des Trois Vallées (déjà envisagé comme domaine skiable dans
les années 20), c’est en 1946 que le Conseil général du département de la Savoie
avec Pierre de la Gontrie et Pierre Cot a réalisé, pour rendre la montagne acces-
sible au plus grand nombre, le projet d’aménagement des Trois Vallées, déve-
loppé de mémoire pendant sa captivité dans un oflag par l’urbaniste et architecte
Laurent Chappis,36 et la construction de la station de Courchevel (en partie finan-
cée par les „dommages de guerre“ payés par l’Allemagne).
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%