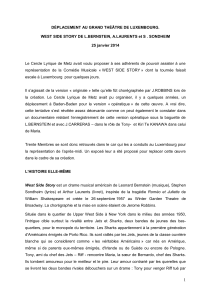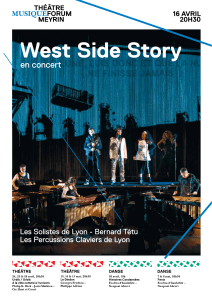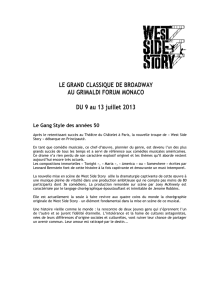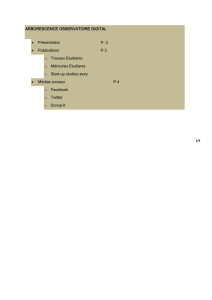west side story - Clac Sin El Fil

WEST SIDE STORY
FICHE TECHNIQUE
USA‐1961‐2h32
Réalisateurs:RobertWise&JeromeRobbins
Scénaristesetdialoguistes:JeromeRobbinsetErnestLehmand’aprèslacomédiemusicaleécrite
parArthurLaurents
Image:DanielL.Fapp
Montage:ThomasStanford
Musique:LeonardBernstein
Interprètes:NatalieWood:(Maria)RichardBeymer(Tony)RussTamblyn(Riff)RitaMoreno
(Anita)GeorgeChakiris:(Bernardo)SuzieKaye(Rosalia)
CRITIQUE
(…)LescénariodelacomédiemusicaledoitbeaucoupauRoméoetJuliettedeShakespeare.La
séquencechantéequicomporteletitre«Tonight»s’inspiredirectementdelascènemythiquedu
balconoùJulietteetRoméos’échangentleurpremierbaiser.TonyetMarias’avouentquantàeux
leurssentimentssurlesescaliersdesecoursinstallésdanslacourdel’immeublevétusteoùelle
vientd’emménager.Dès1949,JeromeRobbinsavaitpenséadapterledrameshakespearienenle
transposantàNewYork.Dansunpremiertemps,ilvoulaitopposerdesJuifsetdesIrlandais
catholiques,maisilapréféréabandonnerlathématiquereligieusepours’intéresseràune
actualitébrûlante,celledel’immigrationportoricaine.C’esteneffetdanslesannées1950quela
«GrossePomme»acommencéàservirdecadreauxpremiersaffrontementsethniquesentre
PortoricainsetAméricains«desouche»(c’est‐à‐diredesimmigrésdeladeuxièmeoutroisième
génération).Àl’époque,WestSideStoryadoncfaitl’effetd’unevéritablerévolutiondans
l’universsucrédelacomédiemusicale.Pourmieuxsaisirl’atmosphèreduWestSidede
Manhattan,unepartiedutournageaétéeffectuéedanslequartier(68eet110erues),
notammentlaséquencedanséed’ouvertureoùl’onvoitlesSharksetlesJetssedéfiersurun
terraindejeufermépardesgrillagesmétalliques.
Aujourd’huiencore,onnepeutquesaluerleréalismedesdécorsetdespersonnagesmisenscène
parRobertWise.Lesimmeubleslépreuxabritentdesfamillesmisérablesoudesatelierssordides,
parfoisilluminéspardestissusmulticolores.Lesruesetlescourssontjonchésdedétritus.Quand
TonyagonisedanslesbrasdeMaria,ilalesmainssalesetlesonglesnoirs:samortn’estpas
édulcoréeparlacaméra.Delamêmemanière,l’accentexagérédesPortoricainspeutprêterà
sourire,maisils’inscritdansunelogiquedeclasseetderacequiconduitàl’enfermementdes
communautésdansleurterritoiregéographiqueetsymbolique.
OnestloindeMarcelPagnoletdesonSchpountz.Tonyn’estpasMariusetMarian’estpasFanny
(dontl’accentméridionallaissed’ailleursàdésirer).Bernardo,lechefdesSharks,nemanquepas
delesouligner:siunPortoricainveutlouerunappartementàNewYork,ilvautmieuxqu’ilperde
sonaccent‐remarquequin’arienperdudesonactualité,auxÉtats‐Unisouailleurs.(…)La
dialectiqueentrel’ouvertetlefermé,entrel’espacepublicetl’espaceprivé,entrelesdifférentes
«coquillesdel’homme»,pourreprendrelaterminologied’AbrahamMoles,occupeuneplace
centraledansWestSideStory.Laruen’estplusseulementundécor,c’estl’undesprincipaux
acteursdelacomédiemusicale.Espacepublicparexcellence,elleestmenacéeparlamontéede
laviolenceinter‐ethniqueetparl’actiondesgangsquisel’approprient.Lespouvoirspublics
doiventreconnaîtreleurimpuissanceàcontrôlercetteévolution,mêmesilepolicierShrank
déclaresansconvictionauxJetsetauxSharksque«laruenevousappartientpas».Quantaux
habitantsduquartier,ilsnepeuventqueselamenterdevoirdisparaîtreleursderniersespacesde
convivialité,commeleDoc,propriétairedudrugstorelocal,quitentedeconvaincrelesJets
rassemblésdanssaboutique:«sedisputerunboutderue,est‐cesiimportant?».Commele

Bernstein, l'homme-orchestre
Compositeur, chef d'orchestre, pianiste ou pédagogue: Leonard Bernstein ne put jamais choisir. A l'instar de
Gustav Mahler, son modèle, il considérait la composition comme la grande affaire de sa vie. Mais il ne connut
qu'un seul triomphe en la matière, avec West Side Story, qui mélangeait l'énergie du jazz à des mélodies
irrésistibles. Pourtant, Bernstein affichait son mépris pour cet ouvrage «populaire», au point de demander à ses
attachés de presse, à la fin de sa vie, de ne jamais le présenter comme «le compositeur de West Side Story». Il
souffrait de ne pas avoir réussi le grand opéra contemporain américain dont il rêvait, d'être pris pour un
compositeur trop sérieux dans les milieux de Broadway et de ne l'être pas assez pour ceux de la musique classique.
C'est cependant de cette carrière hétérogène typiquement américaine qu'est né West Side Story. Un chef-d'oeuvre.
N'en déplaise à son auteur.
Bertrand Dermoncourt
faisaitremarquerJaneJacobsdansTheDeathandLifeofGreatAmericanCities(ouvragesortila
mêmeannéequeWestSideStory),cesontlesruesetlesplaces,lesendroitsoùl’onpeut
marcher,quisontl’essencedelaviecitadineetdel’urbanité.Lescontactsréguliers,la
connaissancedel’autreetlesrelationsentrevoisinspermettentàcetespaceouvertàtousde
conserversonrôledecreusetetdemédiateur,carlespassantsdoivents’ysentiràl’abridelapeur
etdelabarbarie(«safefrombarbarismandfear»)‐cesdeuxmenacesqui,danslesmétropoles
modernes,détruisentleliensocial.LesdernièresimagesdugénériquedefindeWestSideStory
sontàcetégardparticulièrementrévélatrices:aprèsavoirmontrélesmurscouvertsdegraffitis
entrelesquelsapparaissentlesnomsdesacteursetdestechniciensquiontcontribuéautournage,
lesultimescréditscinématographiquessontgriffonnéssurdespanneauxdesignalisationentassés
dans2unecourd’immeuble.Lacamérasefixealorssurunpanneauquiportelamention
«street»,avantderemonterlentementetdelaisserapparaîtrelapréposition«of»,puislemot
«end».«EndofStreet»:DansWestSideStory,lafindufilmannonceaussilafindelarue.Compte
rendu:AlainMusset,directeurd’étudesàl’EHESS,Groupedegéographiesocialeetd’études
urbaines.
(…)CequifaitlalégendedeWestSideStory,c’estpar‐dessustoutsapartitionetsesnuméros
musicaux.InscritsdanslamémoirecollectiveaumêmetitrequelethèmeduParrainoucelui
d’AutantenemporteleVent,IFeelPrettyetMariasontd’authentiquesmerveillesqui
transportenttoutel’âmevibrantedel’œuvredanschacunedeleursnotes.Lescompositionsde
LeonardBernsteinreflètentidéalementtantôtledésiramoureux,lahainebestialeoulechagrin
sansfondquianimelespersonnages,etsemblentendéfinitiveémanerdeleurcorpsmême
commeuneaurasonore.EnsonttémoinsparexempleAmerica,l’undesnuméroslesplusenlevés
etaboutisdetous,oùlesSharksetleursdulcinéesdébattentsurlerêveaméricainavecforce
posesetattitudesentenduessurunrythmetrépidantdecordesetdepercussions,etlesplendide
Somewhere,préludeàlaluttefinalequiverras’affronterlesdeuxclansetquijuxtapose
différentesvoixetthèmessansqu’aucunsonnes’entrechoque,pouraboutir,bienaucontraire,à
unfeud’artificedéchirant.Commentalorsnepass’inclinerdevantlesfiguresemblématiquesde
Maria,TonyetAnitaentreautres,quiinspirenttouràtourtantd’émotionsdifférentesparleur
tragédieetlejeuparfaitdeleursinterprètes.WestSideStoryestunecomédiehumaine,unœil
rougeardentjetésurl’absurditédesorgueilleuxdésirsmatériels,enregarddessentimentsetdu
bonheurnécessairequ’ilpeutapporteràchacun.C’estunfilmsage,clépourlegenre,d’une
modernitéahurissantedanslefondetlaforme:onconnaîtpeudequadragénairesquiparaissent
sijeunes.GrégoryBringand‐Dédrumel
1
/
2
100%