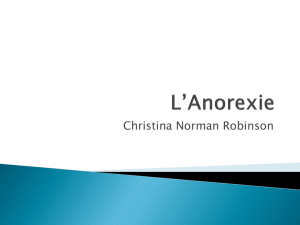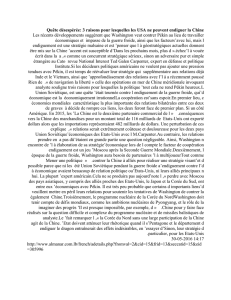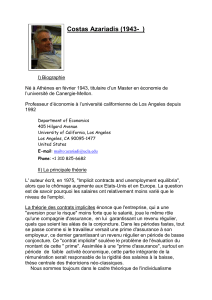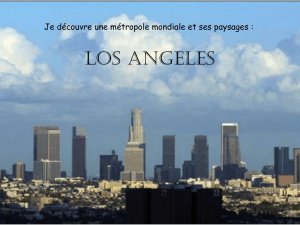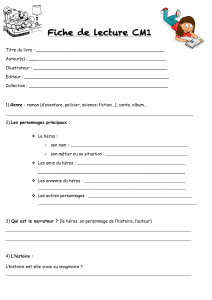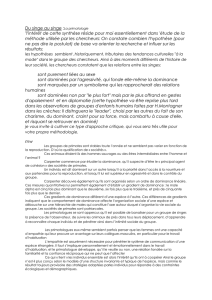Sauvegarder

critikat.com - le site de critique de films
le site de critique de films
http://www.critikat.com
Les Relations sociales chez John Carpenter
Author : Vincent Avenel
Date : 17 janvier 2012
Au fil d’une carrière cinématographique longue de trente-cinq ans, John Carpenter n’aura jamais
battu sa coulpe, multipliant les films autour d’une certaine idée du cinéma qui ne se sera jamais
éloignée d’une vision sociale et politique du monde – une tendance qui lui aliène, aujourd’hui
encore, une bonne partie du public, mais dont l’intransigeance intellectuelle et artistique lui assure
un vivier d’admirateurs. À la vision de ses premiers brûlots paranoïaques (Assaut, The Thing,
Halloween ou New York 1997), il apparaît que le réalisateur charge avec une bonne santé
anarchiste dans les brancards de la société occidentale. Cet aspect, loin de s’être atténué avec le
temps dans les errements de sa filmographie, reste un facteur central pour appréhender l’ampleur
intellectuelle de l’œuvre d’un réalisateur des plus singuliers.
Contamination: la société comme vecteur
S’il devait y avoir un thème propre au cinéma de John Carpenter, ça serait bien celui de la
contamination: comment se transmet le Mal. Car ce dernier, chez lui, est cette notion abstraite qui
s’infiltre et se propage parmi les individus et les détruit de l’intérieur: une forme invisible et
indicible qui trouve refuge dans le cocon douillet que lui tendent nos esprits, là où elle pourra
éclore bien au chaud. Car si le Mal est une entité à part entière, c’est toujours par rapport à
l’homme qu’il se définit. On retrouve cette idée concrètement matérialisée dans Prince des
Ténèbres, où un démon a besoin d’un réceptacle humain pour se réincarner parmi nous. Cette
notion du Mal, on s’en rend aisément compte, est une idée très chrétienne qui renvoie à l’image
du Malin corrompant les esprits faibles. Carpenter est un cinéaste moins profane que Stanley
Kubrick par exemple – chez qui le Mal est n’est qu’une conséquence de la veulerie de l’homme –
mais tout fervent chrétien qu’il est, il n’en demeure pas moins un réalisateur pragmatique. Ce qui
l’inquiète ce n’est pas tant le Mal en soi, que la capacité de l’homme à le recueillir. Son cinéma
se joue alors entre deux sentiments: la fascination pour la figure maléfique et la répulsion que lui
inspire ce qui permettrait à cette figure d’exister.
Le Mal par intraveineuse
Comprendre comment le Mal se répand est alors l’une des grandes questions qui animent l’œuvre
du cinéaste – qui pourrait s’assimiler à une observation sociologique. Car pour que le Mal se
transmette efficacement (c’est-à-dire toucher le plus grand nombre), il doit contaminer des
individus au sein d’un groupe, et non des cas isolés. En ce sens, la société et tous les éléments
qui la constituent deviennent de parfaits vecteurs de contamination. Un des exemple les plus
parlants est le troisième long-métrage de Carpenter, qu’il réalisa pour la télévision: Meurtre au
42ème étage. Une jeune femme, Leigh Michaels, s’installe à Los Angeles, dans un appartement
© 2017 critikat.com - tous droits réservés

confortable en haut d’un building situé en plein complexe immobilier résidentiel. Carpenter filme
longuement ces immeubles au nombre infini de fenêtres comme autant de compartiments d’une
fourmilière humaine. Y vivre c’est être membre de l’infrastructure qui compose une société. C’est
pourtant l’appartement qui va littéralement exposer Leigh Michaels au danger puisqu’il va
permettre à un pervers de l’observer à travers les grandes baies vitrées de sa fenêtre dont le vis-à-
vis n’est autre qu’un immeuble voisin. Pire encore, il va même pouvoir s’imposer dans sa vie
sans qu’elle puisse jamais le voir en contrôlant le flux d’électricité qui aliment la lumière, en la
harcelant au téléphone, en s’introduisant à son insu chez elle. En réalité, le pervers n’est autre
qu’un employé de service chargé de la maintenance des différents immeubles. Il fait partie
intégrante de leur fonctionnement, mais du coup il est également capable d’en contrôler les
moindres aspects. Carpenter, comme toutes les figures maléfiques de son cinéma, le
dépersonnalise, allant jusqu’à ne pas clairement révéler ses motivations, ne le réduisant qu’à sa
seule fonction (de fonctionnaire). Il n’est pas une pièce dégénérescente de la mécanique du
système (comme l’ordinateur Hal 9000 de 2001, l’Odyssée de l’espace) mais offre au Mal une voie
d’accès direct vers Leigh Michaels en exerçant sur elle une pression qui va la pousser à adopter
les mêmes méthodes que le pervers pour le combattre, en tentant de l’espionner à son tour et en
pénétrant chez lui par effraction. La proie va finir par se transformer en traqueur, et lors du face à
face final, comme pour achever la contamination, c’est elle, dans un moment de rage, qui le
défenestrera.
Au-delà des individus dont la profession est directement liée aux différents rouages de la société,
la symbolisation de cette dernière peut aussi passer par des objets emblématiques. Une voiture
par exemple, comme dans Christine. Arnie est un jeune lycéen rejeté, qui n’arrive pas à s’intégrer
à son environnement familial et social. Il tombe un jour par hasard sur une vieille automobile (une
Plymouth Fury 1958), à laquelle il va directement s’attacher. L’automobile est la représentation la
plus iconique de la société de consommation, ayant notamment contribué à son développement et
incarnant ses différentes composantes hiérarchiques. La voiture est un signe très distinctif
d’appartenance à la société. C’est ce qui permet ici à Arnie de se trouver une activité qui le
passionne (il travaille dans un garage de récupération de vieilles pièces détachées) mais surtout
d’affirmer son identité (il arrive enfin à sortir avec une fille). La Plymouth est filmée comme un être
démoniaque, capable de se régénérer toute seule mais surtout de tuer quiconque s’interposerait
entre elle et son propriétaire. Va naître entre elle et le jeune homme, un rapport quasi fusionnel et
aliénant. Arnie, de plus en plus possédé par sa “liaison” avec son engin motorisé, va, sous son
influence, se métamorphoser en un impitoyable meurtrier vengeur.
Là où on ne l’attend pas
Le Mal, parfois, peut emprunter les aspects les plus retors pour s’infiltrer. Dans son film le plus
explicite sur la contamination, The Thing, c’est sous l’apparence d’un chien, fidèle ami de
l’homme, soit l’un des rares animaux à être toléré dans les sociétés humaines, qu’il franchit
l’enceinte qui abrite un petit groupe de personnes isolées en Antarctique. Plus pervers encore,
dans Prince des Ténèbres, c’est dans une église qu’un démon doit se réveiller, lieu symbolique
© 2017 critikat.com - tous droits réservés

par excellence, dont l’utilité est de préserver spirituellement la société du mal et de ses tentations.
De même dans Assaut, un commissariat devient l’étau qui se ressert sur un groupe d’individus
qui s’y sont réfugiés pour se protéger d’une bande de voyous. Dans Ghosts of Mars, c’est une
exploitation minière dans laquelle travaillent plusieurs ouvriers qui recèle une substance les
transformant en zombies brutaux. Plus vicieux: dans L’Antre de la folie, c’est l’imagination d’un
romancier qui cache le Mal, et dans La Fin absolue du monde, l’épisode qu’il réalisa pour la
première saison de la série Masters of Horror, c’est un film mystérieux qui rend fou au point de
faire se mutiler tous ceux qui le regardent [1].
Mais Carpenter va encore plus loin dans Halloween où le Mal apparaît directement au sein du
foyer familial [2], soit la première cellule qui constitue une société mais aussi ce par quoi elle se
renouvelle. Michael Myers, un jeune garçon d’une huitaine d’années, assassine sauvagement et
sans raison apparente sa grande sœur tandis qu’elle se préparait pour un rendez-vous. Plus tard,
alors devenu un tueur sanguinaire dépourvu de sentiments, il détruira implacablement tous ceux
qui ont des aspirations sexuelles (seule la frigide et dépourvue de désir Jamie Lee Curtis lui
échappera). Le milieu petit-bourgeois – l’idéal de la société capitaliste – engendre ce qui veut lui
empêcher de se reproduire. Le puritanisme (dont on est autorisé à voir en Michael Myers une
métaphore) qui est la base impulsive des films catastrophes ou d’horreurs américains (style Les
Dents de la mer), n’est plus ici ce qui conduit le récit mais en devient le sujet: rien d’autre qu’une
des nombreuses apparences dont se revêt le Mal.
Le totalitarisme pour une contamination totale
Dans New York 1997 et Los Angeles 2013, sa suite/remake, une Amérique tombée dans le
totalitarisme absolu envoie les criminels et les opposants au régime en place sur une île
(Manhattan ou Los Angeles) totalement isolée, livrant à eux-mêmes ses détenus. Sur l’île s’est
créé un microcosme dominé par un tyran mégalomane, où règne la violence et la terreur. Une
société qui serait définitivement contaminée, en rejetant radicalement ce qui est issu d’elle mais
qu’elle estime gênant à son fonctionnement, engendre une autre société directement imprégnée
du Mal, ce qui renforce la représentation qu’en fait Carpenter comme porteuse d’un virus.
Mais c’est encore dans Invasion Los Angeles que cette vision se radicalise. Un vagabond (c’est-à-
dire quelqu’un exclu de la société), John Nada, grâce à une paire de lunettes spéciales voit ce que
les autres ne voient pas: des extra-terrestres maintiennent les humains sous contrôle en
dissimulant leurs aspirations fascistes sous les apparats du monde capitaliste. Chaque affiche
publicitaire, chaque panneau de signalisation, chaque journal télévisé “cache” une volonté de
soumission à une pensée unique. Carpenter explicite l’illusion métonymique des médias, la façon
dont, sous la variété des informations qu’ils divulguent, tous ne convergent que vers un seul sens.
Serge Daney explique: «Mais lorsque manque la possibilité de la métaphore, lorsque c’est la
métonymie qui l’a emporté, les choses se gâtent. Revient alors (c’est l’intégrisme) la nostalgie
d’un noyau dur, d’un vrai objet, d’une vérité incarnée, d’une sortie catastrophique de la
consommation du sociétal vers la consumation du social. Revient alors la bigoterie de la terreur.»
© 2017 critikat.com - tous droits réservés

[3] C’est sous l’emprise d’une peur inconsciente que les humains sont canalisés par les extra-
terrestres. Nada, en voulant dévoiler la vérité, lutte contre des moulins: non seulement les E.T.
tentent de l’arrêter, mais les humains ne veulent pas voir les choses telles qu’elles sont. À la fin
du film, au prix de son propre sacrifice il détruit l’émetteur qui permet de tronquer la vision des
humains. Tous alors finissent par se rendre compte de l’odieuse réalité de la situation, le regard
médusé par cette prise de conscience soudaine. Cette fin sonne comme l’aveu ultime de
Carpenter sur la vocation de son cinéma: parvenir à ouvrir les yeux des peuples occidentaux, dont
la peur du fascisme est telle qu’ils le nient, sur la réalité du monde. C’est un véritable fantasme de
gauche comme on en trouve peu dans le cinéma américain. C’est ce qui rend l’œuvre de John
Carpenter si précieuse.
Ensemble, le pire est possible
Une chose frappe dans l’œuvre de Carpenter: sous divers genres, revient une prédilection pour les
menaces posées dans une multitude. Évidemment, sa filmographie comporte quelques exceptions
restées fameuses (tel Halloween et son tueur solitaire aux victimes isolées). Il reste que la question
du collectif, ceux qui assaillent ou ceux qui se défendent, s’invite régulièrement dans ses films. Le
simple mot «plusieurs» semble être une menace pour les protagonistes, soit parce qu’ils font face
à une multitude organisée, soit parce que l’équilibre précaire de leur propre collectivité, au fond un
assemblage artificiel d’individualités disparates, ne fait qu’accélérer leur chute. Des états de fait
dont le cinéaste n’hésitera pas, dès que l’occasion s’en présente, à poser en une certaine vision
des conflits d’intérêt entre l’individu et le collectif, notamment dans la société américaine.
Son nom est Légion
Les groupes humains uniformes sont toujours suspects chez Carpenter. Il se peut que ce ne soit
qu’une unité de surface (cela concerne généralement les personnages «bons»), façade qui finit
par se craqueler face à l’adversité, révélant des disparités morales génératrices de conflits.
Dans Assaut déjà, les très honnêtes occupants du commissariat, assaillis par une bande de
malfrats à la recherche du père de famille qui a tué l’un des leurs, en viennent à se disputer sur la
question de leur livrer ou non le quidam pour sauver leur peau… Mais plus fréquemment, on se
trouve en face d’une foule aux objectifs, mouvements et actions coordonnés. Cependant, cette
coordination même pose problème: fruit de rites ou d’une puissance supérieure, elle est aussitôt
pointée comme contre-nature, malsaine, signe d’une force malfaisante en marche. Dans Assaut,
New York 1997 et Ghosts of Mars, les assaillants contre lesquels il faut lutter – gangs, mineurs
possédés – observent de concert des rites primitifs et barbares, comme hérités d’âges obscurs de
l’Humanité: parfois reconnaissables (les combats de gladiateurs dans New York 1997), mais au
sens souvent énigmatique pour le spectateur moderne dont ils brusquent la notion de civilisation
policée. Les adorateurs du Prince des Ténèbres, eux, obéissent à une force mystique d’essence
maléfique, mais utilisant le décorum de la religion (le lieu sacré de ce culte n’est autre qu’une
église catholique, laissée intacte, la foi dans le Bien et celle dans le Mal ne pouvant qu’aller de
pair…). Dans ces films-là, l’attitude inébranlable de la foule menaçante n’est pas sans évoquer, à
© 2017 critikat.com - tous droits réservés

des degrés divers, la démarche aveugle des morts-vivants chers à George Romero, autre
réalisateur de genre marqué à gauche pour qui Carpenter se fend parfois d’une citation
nominative (notamment à la fin d’Invasion Los Angeles): une forme d’hommage d’un franc-tireur à
un autre, les discours critiques des œuvres des deux cinéastes s’avérant complémentaires sur
plusieurs points, notamment dans leurs regards mordants sur la société américaine. Sous une
autre forme, dans Invasion Los Angeles justement, la foule consommatrice écho direct de
l’époque (reaganienne) sert de couverture à une autre collectivité, plus réduite mais plus
puissante, qui manipule la première de l’intérieur.
L’unisson, pour Carpenter, ne peut être qu’un danger, synonyme d’aveuglement et d’absence de
pensée destructeurs à terme. Par cette figure, le cinéaste suggère une tendance ancienne de
l’être humain à commettre le pire dès qu’il fait fi de son individualité pour adopter un esprit de
corps – d’où sa préférence marquée pour les héros «outsiders» farouchement individualistes,
même quand ceux-ci sont amenés à collaborer. Il a pu aussi par cet biais, au moins dans ses films
les plus frontalement contestataires, renvoyer aisément aux réflexes communautaires les plus
discutables (telle la ferveur religieuse pour Prince des Ténèbres, la soumission aux diktats de la
publicité et de l’information tronquée dans Invasion Los Angeles…) qui tendent à animer les États-
Unis contemporains.
Par élimination, l’assimilation
Carpenter n’a pas l’extrémisme de rejeter sans nuance l’idée d’individus rassemblées par une
cause commune. Mais dans toutes ces alliances de circonstance, il met en avant les disparités et
les conflits d’intérêts qui les mettront en danger – et qui contribueront, directement ou non, à les
réduire graduellement et inexorablement à deux ou trois survivants à la fin. La mise en évidence de
ces difficultés à être ensemble devient chez le cinéaste un acte militant, en opposition avec les
discours fédérateurs en usage en politique et dans le cinéma grand public, par lesquels on voudrait
tout simplifier. En témoigne sa seule insistance à mettre en scène des groupes multi-ethniques
(dans tous ses films, tout rassemblement de plus de trois personnes est sûr de l’être). Ces
portraits collectifs, alors rares dans une imagerie américaine où on n’usait pas encore de la
présence de minorités pour satisfaire aux hypocrites exigences du «politiquement correct», valent
comme remises en question des représentations standardisées du peuple américain, mais aussi
comme images de la disparité et de l’exposition inévitable aux tensions internes de toute
communauté humaine. Ironiquement, dissemblance et individualisme en viennent d’ailleurs à être
les dénominateurs communs qui unissent in fine ceux qui auront survécu à l’horreur et à la
violence – ainsi d’Assaut, de The Thing et de Ghosts of Mars qui s’achèvent sur deux
protagonistes survivants de couleur et de milieu différents. The Thing radicalise cette conclusion
jusqu’à l’absurde en faisant de MacReady (Kurt Russell) et Childs (Keith David) les deux uniques
survivants dans un désert glacé, alors que, contredisant la convention voulant que «l’union fait la
force», ils n’auront pas franchement œuvré de concert pour leur survie, constamment séparés par
une méfiance mutuelle. On trouvera d’ailleurs un envers intéressant et tout aussi radical à la fin
de The Thing dans celle d’Invasion Los Angeles, où les personnages blanc et noir incarnés
© 2017 critikat.com - tous droits réservés
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
1
/
11
100%