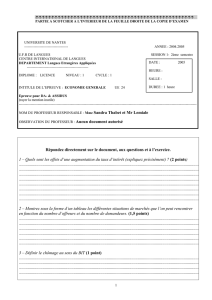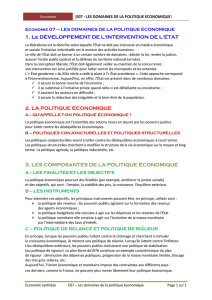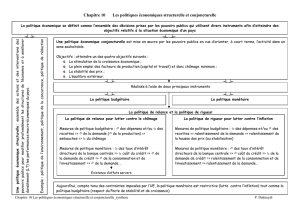Politique économique et sociale

Politique
économique et
sociale
Pour réduire les déséquilibres économiques et résorber les
inégalités sociales, l’Etat intervient et il le fait dans le cadre de sa
politique économique et sociale.
I. La notion de pol. économique et sociale
!
Définition
La politique économique et sociale de l’Etat est l’ensemble des
mesures prises par les pouvoirs publics afin d’améliorer la situation
économique et sociale du pays.
!
Objectifs
Les objectifs de la politique économique et sociale sont repris par
le carré magique de Kaldor ; ils sont au nombre de 4 :
1 - la croissance économique ; 2 - le plein emploi ; 3 - la stabilité
des prix ; 4 - l’équilibre des échanges extérieurs.
!
Classification des politiques économiques
On dénombre deux types de politiques :
• D’une part, les politiques conjoncturelles qui sont de court terme.
Ce sont des mesures ponctuelles (Ex. : relancer un secteur en
perte de vitesse).
• D’autre part, les politiques structurelles qui ont pour objet la
modification durable des structures de l’économie. Ainsi, les
politiques de privatisation sont un exemple caractéristique de
pol. structurelles.
!
Instruments
L’état dispose de nombreux instruments afin de mettre en œuvre
les mesure de politiques économiques. Notons entre autre le
budget, la création monétaire, l’action sur les taux d’intérêt ou sur
les revenus dans le cadre d’une politique de redistribution.
II. Les politiques économiques
On recense deux types de politiques : les politiques de relance et
de rigueur.
!
La politique de relance
Ce type de politique a pour objectif principal de relancer l’activité
économique. Pour cela, on utilise soit la politique monétaire soit la
politique budgétaire. La première consiste à relancer la
consommation. La seconde a pour objectif d’augmenter les
dépenses publiques et/ou de réduire les recettes fiscales.
Il faut tout de même faire attention car ce type de politiques ont
pour corollaire un dérapage inflationniste ce qui pourrait être
nuisible pour le commerce extérieur.
!
La politique de rigueur
Ce type de politique est la réciproque de la précédente. En effet,
les techniques sont identiques. Lorsque l’Etat souhaite maîtriser la
masse monétaire il utilise la politique monétaire mais fait en sorte
que les taux d’intérêt soient élevés. S’agissant de la politique
budgétaire, l’Etat privilégie la restriction des dépenses. Enfin, il
peut également user de la politique des revenus en instaurant la
rigueur salariale.
Il faut là aussi faire attention aux effets que peuvent engendrer ce
type de politique. En effet, cela risque de ralentir la croissance
économique et donc de favoriser le chômage.
III. La politique sociale
!
La politique d’emploi
D
epuis le premier choc pétrolier (1974), les pays occidentaux
connaissent une hausse inexorable du chômage. Les pouvoirs
publics ont alors du intervenir afin d’endiguer ce fléau. Pour cela ils
disposent de 2 types de politiques :
La traitement social du chômage :
Ensemble de dispositifs qui permet d’améliorer la situation d’un
chômeur.
Cela consiste à indemniser les chômeurs mais aussi à les inciter à
suivre des formations professionnelles à travers des contrats
précaires (C.E.S., C.I.E. ou contrats d’apprentissage). L’autre volet
de cette politique consiste à aider les actifs à partir en retraite.
Le traitement économique du chômage :
L’objectif est clair il s’agit de faire reculer le chômage voire
encourager les entreprise à embaucher. Pour cela, l’Etat peut
augmenter le nombre d’emplois publics ou partager les emplois
existant en réduisant la durée du travail (objectif annoncé des 35h)
ou en favorisant l’embauche dans le privé par la réduction des
charges sociales ce qui est le cas pour le travail à temps partiel par
exemple.
!
La politique de protection sociale
Ensemble des actions ayant pour finalité d’assurer aux individus
des ressources face à certains risques.
Ces risques sont nombreux et variés maladie, invalidité, vieillesse,
retraite… La retraite présente des enjeux particuliers.
En effet, elle est actuellement en péril compte tenu de
l’accroissement démographique et plus particulièrement de
l’élévation du poids des retraités. En 2000, on compte 1 retraité
pour 3 actifs, en 2040 on dénombrera 2 retraités pour 3 actifs. La
conséquence est la suivante : la logique de répartition qui
caractérise notre système de retraite veut que les actifs cotisent
pour assurer le paiement de la pension des retraités du moment. Si
les actifs devenaient relativement moins nombreux les retraites
pourraient ne plus être payées. Il faut alors réformer ce système ;
pour cela, on recense comme mesure la capitalisation, mais
aussi l’élévation de l’âge de la retraite ou l’accroissement des
cotisations.
Il faudra alors composer avec le système de répartition sans le
remettre fondamentalement en cause. Car en France la protection
sociale fonctionne sur le principe de la solidarité : l’Etat prélève et
redistribue.
Editeur : MemoPage.com SA © / 2006 / Auteur : Sébastien KNOCKAERT
1
/
1
100%