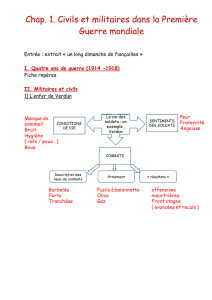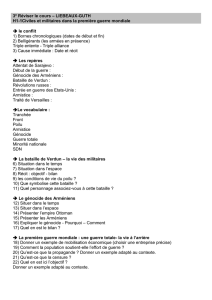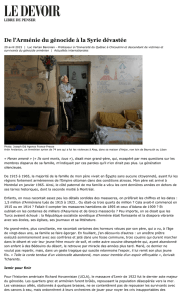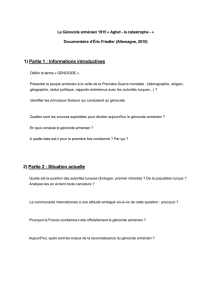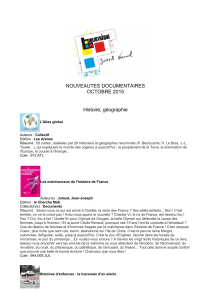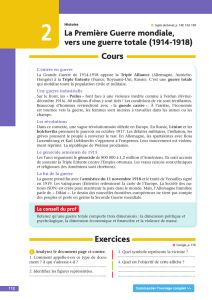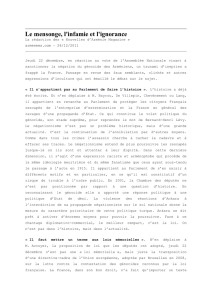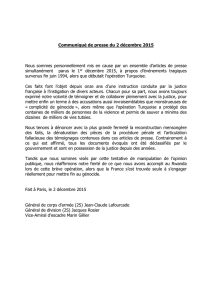il y a cent ans, le génocide des Arménie

ACTUALITÉ
22 u Hommes & Libertés N° 171 u Septembre 2015
Histoire
Il y a
cent ans
, le
génocide
des Arméniens ottomans
Le 24 avril 2015, le monde a commémoré le centenaire
du génocide d’un million et demi d’Arméniens.
L’occasion de revenir sur le long silence de l’Occident
et sur les progrès de la (re)connaissance.
Vincent DUCLERT, historien, chercheur à l’Ecole des hautes études en sciences sociales-
EHESS (Centre d’études sociologiques et politiques Raymond-Aron)*
H istoriens et chercheurs
en sciences sociales s’ac-
cordent massivement
pour reconnaître la qua-
lité de génocide à la destruction
planifiée, intentionnelle et niée
par ses auteurs de 1,5 million
d’Arméniens dans l’Empire otto-
man, de 1915 à la fin définitive de
la civilisation arménienne d’Ana-
tolie, consacrée par le traité de
Lausanne de 1923 et la naissance
de la Turquie nouvelle.
Cette reconnaissance par la
recherche se fonde sur de très
importants travaux comme la
somme de l’historien français
Raymond Kévorkian
(1), traduite
dans de nombreux pays. Elle a
connu une forte accélération en
cette année de commémoration
avec la tenue en mars dernier, en
France également, d’un colloque
international sur « Cent ans de
recherche », ouvert à la Sorbonne
par la ministre de l’Education
nationale, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche. Il
a déjà donné lieu à une première
publication d’actes
(2) incluant
des travaux de chercheurs de Tur-
quie très en pointe sur ce sujet,
en attendant une seconde par les
soins de la revue Etudes armé-
niennes contemporaines.
A mesure que progresse ce tra-
vail des chercheurs, on découvre
l’ampleur du premier génocide
du XXe siècle, précédé à la fin du
XIXe siècle et dans les premières
années du siècle nouveau d’un
ensemble de meurtres de masse
* Auteur de La France face au
génocide des Arméniens, Paris,
Fayard, 2015 et de Comprendre le
génocide des Arméniens, Paris, Tal-
landier, 2015 (avec Hamit Bozars-
lan et Raymond H. Kévorkian).
à dimension génocidaire comme,
à nouveau contre les Arméniens,
les « grands massacres » de 1894-
1896 décidés par le sultan Abdül-
hamid II, ou bien le « génocide
colonial » perpétré par le coloni-
sateur allemand dans l’actuelle
Namibie contre les Hereros et
les Namas, en 1904-1905. Les
travaux sur Raphaël Lemkin
démontrent en parallèle que l’in-
venteur du concept juridique de
génocide (définitivement adopté
par les Nations unies à travers la
Convention pour la prévention et
la répression du crime de géno-
cide du 9 décembre 1948) a com-
mencé par enquêter et réfléchir,
dès le début des années 1930,
sur la destruction des Arméniens
ottomans.
Ne pas froisser
la Turquie…
A cet engagement de la recherche
a répondu, en cette année de
commémoration, une faible
mobilisation civile et surtout
politique dans le monde. Seuls
chefs d’Etat de grande puissance,
François Hollande et Vladimir
Poutine, étaient présents aux
cérémonies d’Erevan en Armé-
nie, le 24 avril dernier. Si le Pré-
sident allemand Joachim Gauck a
reconnu, la veille du 24 avril, lors
d’une cérémonie religieuse à Ber-
lin, le « génocide » des Arméniens,
soulignant même « une corespon-
sabilité, et même, potentiellement,
une complicité » allemande dans
ce crime, en revanche la chance-
lière s’est employée à ménager la
Turquie, indispensable selon elle
à la diplomatie moyen-orientale
de l’Allemagne, et les quatre mil-
lions de Turcs ou d’Allemands
d’origine turque vivant en Alle-
magne. Seule concession de la
part d’Angela Merkel, l’engage-
ment de soutenir au Bundestag
une proposition de résolution
minimale « qui fait du sort des
Arméniens durant la Première
Guerre mondiale un exemple des
meurtres collectifs, des nettoyages
ethniques, des expulsions, et,
oui, des génocides du XXe siècle »
(20 avril 2015). Le gouvernement
allemand redoute également
d’être accusé de vouloir atté-
nuer ses responsabilités dans la
Shoah, en paraissant relativiser
la destruction des juifs d’Europe
avec l’introduction du premier
génocide. A cela Josef Schuster,
président du Conseil central des
(1) Le Génocide des Arméniens,
Odile Jacob, 2006.
(2) Armand Colin, 2015.
© MARCO FIEBER, LICENCE CC

Hommes & Libertés N° 171 u Septembre 2015 u 23
Il y a
cent ans
, le
génocide
des Arméniens ottomans
juifs d’Allemagne, a répondu :
« Il y a cent ans, plus d’un million
d’Arméniens ont été déportés à la
demande de l’Empire ottoman.
Ils ont été froidement assassinés
ou sont morts de faim et de soif
dans le désert. Ce terrible événe-
ment devrait être appelé comme
il se doit : c’était un génocide. »
(15 avril 2015)
Une faible mobilisation
de l’Occident
Absent lui aussi à Erevan, le
Premier ministre britannique
David Cameron a résolument
occulté l’événement tandis que
le Président américain, pourtant
très déterminé lors de sa cam-
pagne présidentielle de 2008 à
défendre la reconnaissance du
génocide des Arméniens par les
Etats-Unis, a refusé de le quali-
fier ainsi dans sa déclaration du
centième anniversaire. La décla-
ration pontificale de reconnais-
sance du 12 avril 2015 n’a pas
entraîné une vague de reconnais-
sance internationale, soulignant
à la fois la puissance des actes
d’intimidation de la Turquie et
la permanence d’un désintérêt
des opinions publiques pour cet
événement annonciateur du XXe
siècle des génocides et des totali-
tarismes. C’est en Turquie même,
cependant, que sont venus les
signes les plus encourageants
d’une évolution positive. Le 24
avril a été commémoré place
Taksim, à Istanbul, notamment
par l’Association des droits de
l’Homme (IHD), tandis que les
études, témoignages et traduc-
tions sur le génocide se sont
multipliés ces dernières années,
et non des moindres
(3), attestant
d’une volonté collective, certes
minoritaire, de s’attaquer au
tabou majeur de la société éta-
tique turque, conditionnant la
mise en question d’autres tabous
(dont le tabou kurde).
La raison profonde qui explique
ce relatif désintérêt de l’humanité
pour le génocide des Arméniens
tient dans la disparition complète
de l’Arménie ottomane après la
destruction des trois quarts de
sa population. Les rescapés
deviennent de misérables réfu-
giés sans retour possible dans
leurs foyers, systématiquement
spoliés par la nouvelle puissance
turque, que personne n’écoute ni
ne regarde, hormis quelques écri-
vains, historiens et intellectuels,
et qui tentent de survivre dans les
camps de transit de Grèce ou du
Liban, dans l’attente d’un hypo-
thétique asile en France ou aux
Etats-Unis. Cet anéantissement
d’un peuple et d’une civilisation
matérielle autant que culturelle et
sociale (avec notamment la des-
truction systématique des cime-
tières arméniens en Turquie) fait
du génocide un événement total
si effrayant que la conscience occi-
dentale a choisi de l’occulter. A la
négation organisée de l’Etat turc
s’est donc ajoutée l’occultation
généralisée de l’événement par
l’Occident, incapable d’assumer
le poids d’une dette inqualifiable.
L’histoire du
« meurtre d’une nation »
L’abandon des rescapés armé-
niens et la disparition de l’Armé-
nie ottomane ont leur histoire.
Après l’armistice de Moudros du
30 octobre 1918, qui met fin à la
guerre en Orient, le génocide des
Arméniens se poursuit malgré la
victoire des Alliés. L’Asie Mineure
n’étant pas occupée, contrai-
rement à Constantinople, ou à
la Cilicie et à la Syrie qui seront
bientôt sous mandat français, les
massacres des rescapés armé-
niens reprennent, perpétrés cette
(3) Voir Hasan Cemal, 1915. Le
génocide arménien, traduit du
turc, Les Prairies ordinaires, 2015.
«
«
Les études,
témoignages
et traductions
sur le génocide
se sont multipliés
en Turquie
ces dernières
années, attestant
d’une volonté
collective, certes
minoritaire,
de s’attaquer
au tabou majeur
de la société
étatique turque.
La « Flamme
éternelle »,
mémorial
du génocide
arménien
à Erevan.

24 u Hommes & Libertés N° 171 u Septembre 2015
aCtualité
Histoire
fois par les nationalistes turcs
dont Mustafa Kemal a pris la tête.
D’abord résolus à punir l’Empire
pour ses « crimes contre l’huma-
nité et la civilisation » – recon-
nus dès le 24 mai 1915 dans
une déclaration solennelle – et
à garantir aux survivants la pro-
tection d’un Etat indépendant
ou d’un foyer national, les Alliés
renoncent rapidement à leurs
engagements et se résolvent à
abandonner l’Arménie et les
Arméniens ottomans. Les der-
niers d’entre eux sont condam-
nés à un exil définitif en Syrie, au
Liban, en Egypte, en Grèce, en
Europe. Quant à la République
d’Arménie, née de la proclama-
tion de son indépendance au
printemps 1918 et située sur les
territoires de l’ancien Empire
russe, elle subit les attaques des
kémalistes et doit se soumettre
au pouvoir bolchevique. Elle ne
recouvre sa liberté qu’en 1991,
et plonge aussitôt dans la guerre
avec l’Azerbaïdjan qui tente
de soumettre la province à peu-
plement arménien du Haut-
Karabagh.
En 1923, le traité de Lausanne
reconnaît la victoire des kéma-
listes et leur souveraineté sur
toute l’Asie Mineure, niant qu’une
civilisation arménienne y a existé
durant plusieurs millénaires. Le
bilan du premier génocide est
à la mesure de cet événement
inqualifiable – que les contempo-
rains tentent pourtant de définir,
comme l’historien britannique
Arnold J. Toynbee, qui constate
« le meurtre d’une nation » (4).
L’expression est d’autant plus
pertinente qu’elle souligne la
spécificité radicale du premier
génocide : à la fois l’extermination
physique de 1,3 million d’Armé-
niens ottomans, par le régime
en place à Constantinople, entre
1915 et 1917, et sa poursuite après
1918 ainsi que l’éradication com-
plète de la présence du peuple
arménien sur les terres qui ont
vu naître et s’épanouir sa civili-
sation. Pour ce premier génocide
du XXe siècle, 1,5 million d’êtres
humains sont massacrés pour ce
qu’ils représentent : un groupe
religieux minoritaire, une société
civile et culturelle convertie en
ennemi absolu par les unionistes,
et dont l’avenir ne réside alors
que dans leur destruction impla-
cable et totale. Si l’on envisage
l’hypothèse, que je défends, d’un
« continuum génocidaire », débu-
tant avec les grands massacres de
1894-1896 – auxquels Jean Jaurès
s’était alors vivement opposé (5) –,
ce sont 1,8 million d’Arméniens
qui périssent, et toute une civi-
lisation d’Asie Mineure qui dis-
paraît. Jamais un génocide ne se
sera à ce point caractérisé par
une double destruction, démo-
graphique et humaine, sociale et
nationale.
Le long chemin
vers la reconnaissance
En Lituanie, en Pologne, en
Ukraine, en Roumanie, au Rwan-
da, on observe aujourd’hui la
volonté de protéger les dernières
traces de ces mondes engloutis
dans la violence de l’inhuma-
nité. Avec le traité de Lausanne
du 24 juillet 1923, les vainqueurs
de la Première Guerre mondiale
acceptent de sacrifier non seule-
ment la vérité sur la destruction
des Arméniens ottomans, mais
également le maintien des sur-
vivants et de la présence armé-
nienne dans le nouvel Etat turc
qui naît de cet acte international.
Les derniers Arméniens présents
en Asie Mineure sont soit mas-
sacrés, soit expulsés de Turquie.
Ils ne peuvent plus espérer dans
l’avenir d’un foyer national qui
aurait pu s’édifier en Cilicie, un
temps détenue par la France puis
évacuée au profit des kémalistes.
Une fois signé le traité de Lau-
sanne, les puissances mon-
diales, notamment européennes,
opposent un silence définitif au
besoin de justice et de recon-
naissance des rescapés et des
descendants des victimes. Bien
qu’informées depuis les grands
massacres de 1894-1896 des pro-
cessus de destruction anti-armé-
nienne dans l’Empire ottoman,
bien que mobilisées dès le début
de la guerre dans une volonté
de justice internationale par
leur déclaration solennelle du
24 mai 1915, elles acceptent de
renoncer à leurs engagements, et
donc à une part d’elles-mêmes en
tant que communauté humaine.
Seuls quelques écrivains, Paule
Henry Bordeaux avec L’Immor-
telle de Trébizonde (1930), Franz
Werfel avec Les Quarante Jours
du Musa Dagh (1933), main-
tiennent une mémoire de l’his-
toire perdue.
La découverte par le monde, à
partir de 1943, d’un deuxième
génocide, cette fois perpétré
par l’Allemagne nazie accom-
plissant la « Solution finale » des
juifs d’Europe, ne modifie en
rien l’amnésie sur le génocide
des Arméniens ottomans. Alors
même que Raphaël Lemkin a
compris le caractère annoncia-
teur des événements de 1915,
les Alliés n’envisagent pas, après
la guerre, de reconnaître le pre-
mier génocide contemporain. La
marche vers la reconnaissance
sera difficile durant le second
XXe siècle, entraînant même cer-
tains nationalistes arméniens
dans le terrorisme (du milieu
des années 1970 au milieu des
années 1980). Elle est loin d’être
achevée aujourd’hui. Mais le
centenaire de 2015 a marqué
incontestablement un tournant.
Le pouvoir de la vérité historique
s’est grandement renforcé par
l’engagement des chercheurs.
Elle a aussi, comme en France,
déterminé la réponse politique
comme en a témoigné le discours
de François Hollande, à Erevan, le
24 avril. Le négationnisme, certes
toujours puissant, est un combat
d’arrière-garde qui se centre sur
les thèses complotistes et une fal-
sification des faits. Ces acquis sont
l’héritage d’un long combat où se
sont illustrés la Ligue des droits
de l’Homme
(6) et des historiens
précurseurs comme Anahide Ter
Minassian, Yves Ternon ou Pierre
Vidal-Naquet.
●
(4) Arnold J. Toynbee, Les Mas-
sacres des Arméniens, 1915-1916,
préface de Lord Bryce, Payot, 1916 ;
rééd. Payot-Rivages, 1987, préface
de Claire Mouradian (titre ori-
ginal : Armenian Atrocities. The
Murder of a Nation, 1915).
(5) Jean Jaurès, Il faut sauver les
Arméniens, textes édités par
Vincent Duclert, Mille et une
nuits, 2006, rééd. 2015.
(6) Emmanuel Naquet, Pour
l’Humanité : La Ligue des droits
de l’Homme, de l’affaire Dreyfus
à la défaite de 1940, Pur, 2014.
«
«
L’anéantissement
du peuple
arménien
et de sa
civilisation
fait du génocide
un événement
total si effrayant
que la conscience
occidentale
a choisi
de l’occulter.
1
/
3
100%