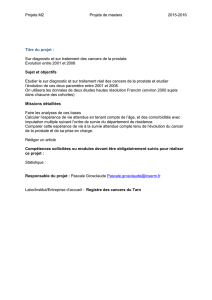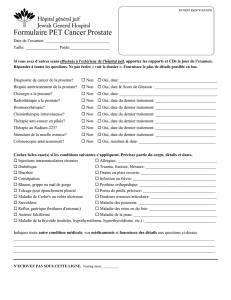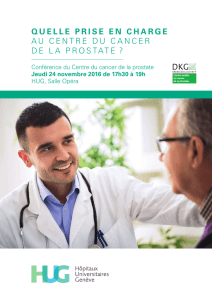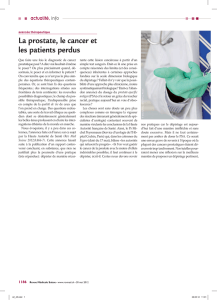Lire l`article complet

50 | La Lettre du Cancérologue • Vol. XXI - n° 1 - janvier 2012
RÉTROSPECTIVE 2011
Cancers urologiques
Urological cancers
Coordination : P. Beuzeboc1
1 Institut Curie, Paris.
2 Service d’urologie, hôpital Foch,
Suresnes.
3
Département d’oncologie médicale,
institut de cancérologie Gustave-
Roussy, Villejuif.
4
Département d’oncologie médicale,
institut Bergonié, Bordeaux.
5 Université catholique de Louvain,
Belgique ; Inserm U674, génomique
fonctionnelle des tumeurs solides,
université Paris-Descartes.
6 Service de cancérologie médicale,
hôpital européen Georges-Pompidou,
Paris, et université Paris- Descartes.
Cancer de la prostate
P. Beuzeboc1, Y. Neuzillet2, C. Massard3,
G. Roubaud4, B. Beuselinck5, S. Oudard6
Biologie
➤Prostasomes
Les prostasomes sont des microvésicules (diamètre
moyen : 150 nm) produites et sécrétées par les
cellules acineuses prostatiques normales ou tumo-
rales. La détection des prostasomes a utilisé une
technique dite 4PLA (Proximity Ligation Assay) se
servant de la reconnaissance de 5 épitopes sur
au moins 4 protéines différentes par 4 anticorps
monoclonaux ou polyclonaux différents, auxquels
sont accrochés de courts oligonucléotides. Dans
cette étude, dont les résultats ont été présentés par
G. Tavoosidana et al. (1), la cohorte des 59 patients
prostatectomisés était divisée en 3 groupes en
fonction du score de Gleason – bas (≤ 6 ; n = 20),
intermédiaire (7 ; n = 19) et élevé (8 ou 9 ; n = 20) –,
ils étaient comparés aux niveaux de témoins et de
patients dont les biopsies étaient négatives. Seuls les
patients avec des cancers des groupes intermédiaire
et élevé avaient des taux de prostasomes significa-
tivement plus élevés, avec des médianes 2,5 à 7 fois
plus importantes. Cette nouvelle approche pourrait
être, dans l’avenir, utile dans la détection précoce
et le pronostic du cancer de la prostate localisé.
➤
Il n’a pas été retrouvé de relation entre le statut
d’ERG et la récidive biologique dans une série de
2 800 cancers localisés traités par prostatectomie
radicale sans hormonothérapie (HT) [2]
➤
L’expression de gènes de fusion TMPRSS2-ERG
altère différemment la réponse à la radiothérapie
(RT), en l’augmentant, et à la chimiothérapie (CT),
en la diminuant, dans des modèles de culture cellu-
laire androgéno-indépendante (3)
➤
La signature d’expression d’ARNm du score
de Gleason est prédictive de la létalité du cancer
de la prostate
K.L. Penney et al. (4) ont présenté les résultats
de leur analyse portant sur 358 patients ayant un
score de Gleason ≤ 6 sous surveillance active et sur
116 patients ayant un score de Gleason ≥ 8. Cette
étude avait pour but d’améliorer la valeur prédic-
tive du risque d’évolution péjorative du cancer de
la prostate. L’extraction d’ARN était réalisée à partir
de blocs paraffinés ; l’analyse a testé 6 100 gènes et
440 voies métaboliques. Elle a montré que 107 gènes
étaient significativement associés à un score de
Gleason ≤ 6 ou ≥ 8, et que 157 gènes permettaient
de prédire avec une fiabilité de 91 % si le score de
Gleason était ≤ 6 ou ≥ 8. Cette signature, appliquée à
une population présentant un score de Gleason de 7
(3 + 4 ou 4 + 3), permet de déterminer chez quels
patients l’évolution sera péjorative (45 versus 29 %
de patients en rechute) avec un OR de 1,46. Le profil
est plus homogène dans la population présentant
un score de Gleason ≤ 6.
➤
La compréhension des mécanismes molé-
culaires conduisant à la dissémination et au déve-
loppement métastatiques se heurte à l’absence
de matériel tissulaire adapté. Leur connaissance
constitue cependant un élément majeur de la prise
en charge des cancers prostatiques en échappe-
ment (5)
➤
L’heure du profil génomique est-elle aussi celle
du retour aux autopsies ?
Une équipe du Michigan (Howard Hughes Medical
Center et University of Ann Harbor) a présenté, dans
un article paru dans Clinical Cancer Research (6),
une technique autopsique dite “à chaud” (dans les
3 heures suivant le décès) permettant d’obtenir
d’importantes quantités de matériel histologique
et tumoral. Dans une série de 13 cas, les auteurs
précisent leur modus operandi visant à extraire
P. Beuzeboc

La Lettre du Cancérologue • Vol. XXI - n° 1 - janvier 2012 | 51
Points forts
»
2011 fut encore une grande année marquée l’enregistrement de l’abiratérone, du cabazitaxel, du
dénosumab, la positivité des études de phase III du MDV3100 et de l’alpharadine. Il faut aussi relever la
confirmation à 15 ans du bénéfice de la prostatectomie versus surveillance dans l’étude suédoise ainsi que
la validation de l’hormonothérapie intermittente dans les rechutes biologiques après traitement radical.
»Pour 2011, il faut surtout relever, sur le plan biologique, un nouveau phénotype épigénétique (MRES+)
associé à une voie agressive de progression tumorale liée à la voie des CIS dans les tumeurs de vessie et
au plan clinique
»Trois études randomisées ont apporté des résultats susceptibles d’enrichir l’arsenal thérapeutique: le
T-BEP dans les formes à pronostic intermédiaire, l’axitinib en deuxième ligne du cancer du rein, la combi-
naison dose dense tous les 15 jours de gemcitabine + cisplatine dans certains cancers urothéliaux avancés
chez des sujets jeunes en bon état général.
Mots-clés
Abiratérone
MDV3100
Dénosumab
Cabazitaxel
Alpharadine
Phénotype
épigénétique MRES+
T-BEP
Axitinib
Dose-dense
gemcitabine/cisplatine
du tissu osseux (vertébral, huméral et fémoral) et
métastatique en de multiples localisations. Cette
méthode semble offrir une qualité suffisante pour
une analyse de l’ARN lésionnel.
➤
Une incidence élevée de grade 4 du score de
Gleason prédominant dans les cancers de la pros-
tate localisés est associée à une testostéronémie
basse
Dans une étude prospective, H. Botto et al. (7)
ont mesuré le taux sérique de testostérone avant
prosta tectomie radicale réalisée entre janvier 2007
et janvier 2011 de 431 patients : un grade 4 prédo-
minant chez 132 patients (31 %) a pu être montré.
Chez ces patients, le taux sérique de testostérone
totale était significativement plus bas (4,0 versus
4,5 ng/ ml ; p = 0,001) alors que le taux de PSA était
plus élevé (8,4 versus 6,6 ng/ml ; p < 0,00001).
Le taux d’extension extraprostatique et les marges
positives y étaient plus importantes (49 versus
20 % et 23 versus 14 % ; p < 0,000001 et p = 0,02,
respectivement).
➤
Parmi les mécanismes de la dérégulation du
récepteur aux androgènes (RA) et de la transition
vers la résistance à la castration, Rb (Retinoblas-
toma tumor suppressor) agit comme un suppres-
seur de tumeur par l’intermédiaire d’une régulation
négative de l’expression de gènes (Knusen KE et al.,
ASCO® GU)
Rb supprime la progression du cancer de la pros-
tate en contrôlant le RA. Dépléter les xénogreffes
humaines en Rb suffit pour favoriser la transition
vers le cancer de la prostate résistant à la castration
(CPRC). La perte de l’ARNm de Rb est surreprésentée
dans les CPRC. Le nouveau paradigme du rôle des
interactions entre RA et Rb peut se résumer en
5 points clés :
•
une résurgence de l’activité du RA sous-tend la
transition vers le CPRC ;
•
Rb bloque cette transition en supprimant l’expres-
sion du RA et son activité ;
•la perturbation de la fonction Rb est un driver clé
du développement du CPRC ;
•
une signature de la fonction a été établie, qui
distingue des tumeurs déficientes (> 60 %) ou non
en Rb ;
•
l’appréciation du statut de Rb pourrait servir de base
à une intervention personnalisée. En effet, dans les
tumeurs avec persistance de Rb, la fonction suppres-
sive peut être activée par des inhibiteurs de CDK4. En
revanche, des tumeurs ayant perdu Rb pourraient être
particulièrement sensibles à des CT sélectionnées.
Épidémiologie
➤
Actualisation des données épidémiologiques
américaines (ASCO® GU 2011)
En 2010, 217 730 nouveaux cas ont été enregistrés
aux États-Unis, avec 32 050 décès. Un homme sur 6
au cours de sa vie a un cancer de la prostate (environ
3 % en décéderont), avec un âge moyen de 68 ans au
diagnostic et de 80 ans au moment du décès. La baisse
des décès spécifiques a été approximativement de
35 % entre 1997 et 2007. Parmi les explications, il faut
intégrer un meilleur traitement primaire (chirurgie,
RT), le mode de vie et les médicaments (statines,
inhibiteurs de COX-2), le dépistage précoce ainsi que
l’utilisation d’une thérapeutique adjuvante multi-
modale dans les tumeurs à haut risque.
➤
Mortalité spécifique à 10 ans des cancers présen-
tant un score de Gleason de 5 à 7, un stade T1/T2
(ASCO® GU 2011)
Le tableau I montre la faible mortalité spécifique
actuelle des cancers localisés ayant un score de
Gleason de 5 à 7, et l’amélioration de 60 à 74 % du
pronostic en un peu plus d’une décennie. Pour les
tumeurs présentant un score de Gleason de 8 à 10,
la diminution est de l’ordre de 36 à 46 %.
Tableau I. Taux de mortalité spécifique des cancers localisés
ayant un score de Gleason de 5 à 7.
65-69 ans 70-74 ans
Statin
(JNatl Cancer Inst, 2010)
4 % (3-5) –
Lu-Yao
(JAMA, 2009)
6 % (4-8) 6 % (4-6)
Albertsen
(JAMA, 2005)
21 % 23 %
Johansson
(JAMA, 2004)
15 % 15 %
Lu-Yao
(Lancet, 1997)
23 % 23 %
Chodak
(New Engl JMed, 1994)
16 % 16 %

52 | La Lettre du Cancérologue • Vol. XXI - n° 1 - janvier 2012
RÉTROSPECTIVE 2011 Cancers urologiques
Dépistage
➤
Depuis la publication des résultats des
2 grandes études randomisées américaine (PLCO)
et européenne (ERSPC), diminution des dosages du
PSA de 3 et 2,7 % chez les hommes âgés respecti-
vement de 40 à 54 ans et de 55 à 74 ans (8)
➤
Prédiction d’un cancer de la prostate significatif
diagnostiqué 20 à 30 ans après un seul dosage
avant 50 ans
Dans cette étude réalisée à partir de prélève-
ments sanguins collectés entre 1974 et 1986 chez
21 277 hommes âgés de 33 à 50 ans, d’une même
ville suédoise (taux de participation de 74 %), H. Lilja
et al. (9) ont diagnostiqué 1 408 cancers de la pros-
tate. Le suivi médian est de 23 ans. Le taux de base
du PSA était fortement associé au risque de cancer
de la prostate : 81 % des cancers avancés touchaient
des hommes présentant un PSA au-dessus du taux
médian (0,63 ng/ml entre 44 et 50 ans).
➤
Un seul dosage du PSA entre 45 et 49 ans n’est
pas suffisant : il faut, même pour une population
à bas risque, conseiller 3 tests au milieu de la
quarantaine, de la cinquantaine et de la soixan-
taine
C’est ce qui ressort de l’actualisation de l’étude
précédente (10). Les patients ayant un PSA < 1 ng/ml
à 60 ans ont un risque faible de décéder d’un cancer
de la prostate. Ces nouvelles données devraient faire
évoluer les pratiques.
➤
Rôle et intérêt des nouvelles techniques d’IRM
pour améliorer la détection initiale du cancer de
la prostate en guidant les biopsies (11)
Ces techniques devraient prendre plus d’importance
à l’avenir, notamment dans la surveillance active et
dans les thérapies focales, pour mieux préciser quels
patients peuvent en bénéficier.
Chirurgie
➤
Prédiction de la mortalité spécifique 15 ans
après prostatectomie radicale à partir des données
de 11 521 patients opérés dans 4 institutions
académiques américaines entre 1987 et 2005 (12)
Le taux de mortalité spécifique à 15 ans est de
7 %. Le grade de Gleason primaire et secondaire
(p < 0,001 pour chacun), l’envahissement des vési-
cules séminales (p < 0,001) et l’année de la chirurgie
(p < 0,002) représentent des facteurs pronostiques
significatifs. Le risque de mortalité spécifique à
15 ans est de 0,8 à 1,5 %, 2,9 à 10 %, 15 à 27 % et
22 à 30 % pour les tumeurs confinées à la glande,
une extension extraprostatique, un envahissement
des vésicules séminales et des métastases ganglion-
naires. Seuls 3 des 9 557 patients présentant une
tumeur intracapsulaire et un score de Gleason ≤ 6
sont décédés de leur cancer.
➤
Prostatectomie radicale versus “watchful
waiting” dans les cancers de la prostate précoces :
une confirmation du bénéfice de la chirurgie à
15 ans (13)
L’actualisation des résultats de l’étude suédoise
portant sur 695 patients randomisés entre octobre
1989 et février 1999 entre prostatectomie radicale et
“watchful waiting” (surveillance/ traitement différé)
confirme le bénéfice de la chirurgie avec 3 ans de
suivi supplémentaires. Avec un suivi médian de
12,8 ans, 166 des 347 patients du groupe prosta-
tectomie et 201 des 348 patients du groupe
surveillance sont décédés ; 55 et 81 de ces décès,
respectivement, étaient dus au cancer. Cela corres-
pond à une incidence cumulée de décès à 15 ans de
14,6 % dans le groupe prostatectomie et de 20,7 %
dans le groupe surveillance (différence de 6,1 % ;
IC
95
: 0,2-12,0), et à un risque relatif (RR) par rapport
à la chirurgie de 0,62 (IC95 : 0,44-0,87 ; p = 0,001).
Ce bénéfice, observé aussi dans le groupe à bas
risque, est confiné aux hommes âgés de moins de
65 ans. Le nombre de patients à traiter pour éviter
1 décès est de 15 ; il est de 7 pour les patients de
moins de 65 ans.
Parmi les hommes traités par prostatectomie, ceux
qui présentaient une extension extracapsulaire
avaient un risque de décès environ 7 fois supérieur
(RR = 6,9 ; IC95 : 2,6-18,4). Il faut relever que près
de 80 % des hommes inclus avaient une tumeur
palpable, avec une extension extracapsulaire chez
46 % des patients traités dans le bras prostatec-
tomie.
Les données de cette étude princeps confirment que
la prostatectomie dans les formes diagnostiquées
précocement permet une réduction significative du
risque de métastases et de décès, avec une différence
qui reste constante après 9 ans. Si ce bénéfice est
évident chez les patients de moins de 65 ans, il l’est
moins pour des patients plus âgés, mais cela doit
être pondéré du fait du manque de puissance pour
l’analyse de ce sous-groupe. De plus, les traitements
hormonaux peuvent entraîner des rémissions suffi-
samment prolongées pour que les patients âgés
puissent mourir d’autres causes (figure 1).

A.
Watchful waiting
Prostatectomie radicale
Patients à risque (n)
Prostatectomie
radicale 347 339 311 271 214 109
Watchful
waiting
348 334 306 251 192 96
B.
Décès par cancer de la prostate,
ensemble de la cohorte C.
Métastases,
ensemble de la cohorte
p = 0,007 par test de Gray
Watchful waiting
Prostatectomie radicale
347 339 311 271 214 109
348 334 306 251 192 96
p = 0,01 par test de Gray
Watchful waiting
Prostatectomie radicale
347 323 291 252 194 99
348 322 281 229 173 78
p < 0,001 par test de Gray
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0 3 6 9 12 15
Probabilité
Années
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0 3 6 9 12 15
Probabilité
Années
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0 3 6 9 12 15
Probabilité
Années
D. Décès de toute cause,
hommes âgés de 65 ans ou plus
Watchful waiting
Prostatectomie radicale
p = 0,89 par test de Gray
Patients à risque (n)
190 185 166 135 99 42
Watchful
waiting
182 177 162 133 101 42
Prostatectomie
radicale
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,6
0,5
0,7
0 3 6 9 12 15
Probabilité
Années
E.
Décès par cancer de la prostate,
hommes âgés de 65 ans ou plus
Watchful waiting
Prostatectomie radicale
190 185 166 135 99 42
182 177 162 133 101 42
p = 0,41 par test de Gray
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,6
0,5
0,7
0 3 6 9 12 15
Probabilité
Années
F. Métastases,
hommes âgés de 65 ans ou plus
Watchful waiting
Prostatectomie radicale
190 176 151 125 91 38
182 171 149 122 93 37
p = 0,14 par test de Gray
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,6
0,5
0,7
0 3 6 9 12 15
Probabilité
Années
G. Décès de toute cause,
hommes âgés de moins de 65 ans
Watchful waiting
Prostatectomie radicale
157 154 145 136 115 67
166 157 144 118 91 54
p < 0,001 par test de Gray
Patients à risque (n)
Watchful
waiting
Prostatectomie
radicale
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,6
0,5
0,7
0 3 6 9 12 15
Probabilité
Années
H.
Décès par cancer de la prostate,
hommes âgés de moins de 65 ans
Watchful waiting
Prostatectomie radicale
157 154 145 136 115 67
166 157 144 118 91 54
p = 0,008 par test de Gray
I.
Métastases,
hommes âgés de moins de 65 ans
Watchful waiting
Prostatectomie radicale
157 147 140 127 103 61
166 151 132 107 80 41
p < 0,001 par test de Gray
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,6
0,5
0 3 6 9 12 15
Probabilité
Années
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,6
0,5
0 3 6 9 12 15
Probabilité
Années
Décès de toute cause,
ensemble de la cohorte
Figure 1. Prostatectomie versus surveillance/traitement retardé (13).
La Lettre du Cancérologue • Vol. XXI - n° 1 - janvier 2012 | 53
RÉTROSPECTIVE 2011
➤
Étude de la qualité de vie dans cette étude
suédoise après un suivi moyen de 12 ans (14)
La prévalence de la dysfonction érectile était de 84 %
dans le groupe prostatectomie et de 80 % dans le
groupe “watchful waiting” (surveillance/traitement
différé). Le taux de fuites urinaires était respective-
ment de 41 versus 11 %.
➤
Prostatectomie de sauvetage après échec d’un
traitement par High-Intensity Focused Ultrasound
(HIFU)
N. Lawrentschuk et al. (15) ont montré la faisabilité
de ce traitement, mais avec une morbidité majorée,
dans une petite série de 15 patients. Il faut insister
sur le pourcentage élevé d’extension extracapsulaire
alors que le délai après HIFU était court (22 mois).
➤
Prostatectomie et HT adjuvante dans les
cancers de la prostate à haut risque de récidive :
données du SWOG S9921
Les critères d’inclusion étaient un score de
Gleason ≥ 8, un PSA préopératoire ≥ 15 ng/ml,
un stade ≥ pT3b, N1 ou un score de Gleason ≥ 7,
un taux de PSA > 10 ng/ml, des marges positives.
Le taux de PSA postopératoire devait être inférieur
à 0,2 ng/ml. Au total, 983 patients ont été inclus

54 | La Lettre du Cancérologue • Vol. XXI - n° 1 - janvier 2012
RÉTROSPECTIVE 2011 Cancers urologiques
entre 2000 et 2007. L’étude a été arrêtée dans le
bras mitoxantrone en raison de 3 cas de leucémie.
T.B. Dorff et al. (16) rapportent le suivi des
481 patients traités dans le bras prostatectomie +
privation hormonale pendant 2 ans. Avec un suivi
médian de 4,4 ans, la survie globale (SG) à 5 ans
était de 96 %, et de 92,3 % pour les N+ (n = 79).
Vingt-sept pour cent des patients avaient reçu une
RT complémentaire. L’étude GETUG 20, qui vient
de débuter en France, permettra d’évaluer l’intérêt
de l’HT adjuvante dans ces formes à haut risque.
➤
Curage ganglionnaire pelvien et rétropéritonéal
chez des patients en récidive biologique après
prosta tectomie totale, avec une rechute ganglion-
naire détectée par PET à la choline (17)
Avec un suivi médian de 39,8 mois après curage, la
survie sans récidive (SSR) biologique à 5 ans était de
19 % dans cette série limitée de 72 patients.
Radiothérapie
➤
Résultats à 5 ans de l’essai GETUG 06 (n = 306)
comparant 70 versus 80 Gy dans les tumeurs loca-
lisées (18)
Avec un suivi médian de 61 mois, les taux de réci-
dive biochimique suivant la définition du Radiation
Therapy Oncology Group (RTOG) étaient respective-
ment de 39 et 28 % (p = 0,036). Suivant la définition
de Phoenix, ils étaient de 32 et 23,5 % (p = 0,09).
Les taux de toxicité rectale de grade ≥ 2 suivant
l’échelle du RTOG étaient de 14 % à 70 Gy et de
19,5 % à 80 Gy (p = 0,22), ceux de toxicité urinaire
de grade ≥ 2 étaient de 10 et 17,5 % respectivement
(p = 0,046).
➤
RT et HT courte pour les cancers localisés :
résultats à 10 ans en SG de l’essai RTOG 94-08 (19)
De 1994 à 2001, l’essai RTOG a randomisé 1 979 patients
(T1b, T1c, T2a ou T2b avec un PSA < 20 ng/ml) entre :
•RT seule (46,8 Gy dans le pelvis, 66,6 Gy dans la
prostate) ;
•
blocage androgénique complet de 4 mois débutant
2 mois avant la même RT.
Avec un recul médian de 9,1 ans, la SG est de 62 %
dans le groupe HT + RT versus 57 % dans le groupe RT
(p = 0,03), avec une baisse de la mortalité spécifique
de 8 à 4 % (p = 0,001).
Une nouvelle analyse par sous-groupes a montré
que l’amélioration ne concernait que le groupe à
risque intermédiaire et qu’il n’y avait aucun impact
sur le groupe à bas risque.
➤Résultats à 10 ans de l’essai du Trans-Tasman
Radiation Oncology Group (TROG) 96.01 (20)
Entre 1996 et 2000, 818 patients ont été inclus (T2b,
T2c, T3, T4, N0 M0), dont 85 % présentaient des
formes à haut risque et 15 % des formes intermé-
diaires. Ils ont été traités selon 3 bras : RT exclusive
(n = 270), 3 mois d’HT débutant 2 mois avant la RT
(n = 265), 6 mois d’HT débutant 5 mois avant la RT
(n = 267). La dose de RT était de 66 Gy.
Six mois d’HT améliorent le risque de progres-
sion à distance (p = 0,001), la survie spécifique
(p = 0,0008) et la SG (p = 0,0008).
➤
Moins bons résultats de la RT en cas de tumeurs
ayant un score de Gleason de 8 à 10 avec diffé-
renciation neuroendocrine (21)
➤
RT de rattrapage après échec biologique
et risque de décès : étude rétrospective de
4 036 patients traités entre 1988 et 2008 à la
Duke University (22)
Le suivi médian est de 11,3 mois et 195 patients
sont décédés. Une RT de rattrapage paraît asso-
ciée à une réduction du risque de mortalité, que le
temps de doublement du PSA (PSA-DT) soit infé-
rieur (HR = 0,35 ; p = 0,042) ou supérieur à 6 mois
(HR = 0,60 ; p = 0,04).
Hormonothérapie intermittente
➤
Étude de phase III (NCIC CTG PR.7) compa-
rant un traitement hormonal intermittent à une
suppression hormonale continue chez des patients
en progression après traitement radical (Klotz L,
ASCO® GU)
Le traitement hormonal intermittent diminue les
effets indésirables aigus et chroniques, améliore la
qualité de vie et minimise les coûts. Le critère de
jugement principal de cette étude de phase III était
la SG. Les 1 386 patients inclus présentaient un taux
de PSA > 3 ng/ml, une testostéronémie > 5 nmol/l,
une absence de métastases, un maximum de 12 mois
d’HT adjuvante ou néo-adjuvante, une espérance
de vie > 5 ans. Le bras traitement continu associait
un agoniste de la Luteinizing Hormone-Releasing
Hormone (LH-RH) et un antiandrogène. Dans le
bras traitement intermittent, l’agoniste était délivré
pendant 8 mois et l’antiandrogène uniquement le
premier mois. Le traitement était repris quand le PSA
était supérieur à 10 ng/ml et arrêté en cas d’échec. La
durée du traitement par agoniste de la LH-RH dans
le bras traitement intermittent a été de 15,4 mois,
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
1
/
22
100%