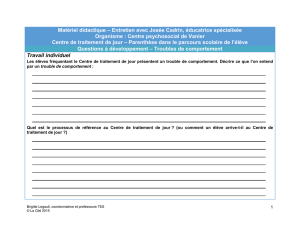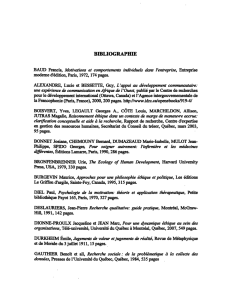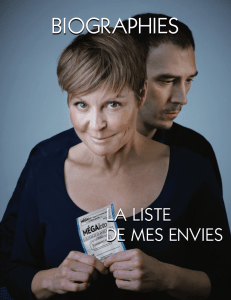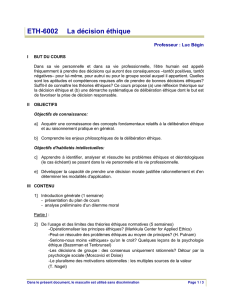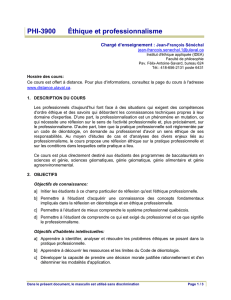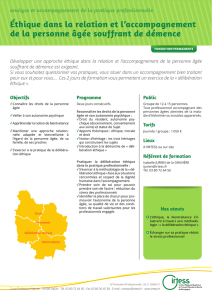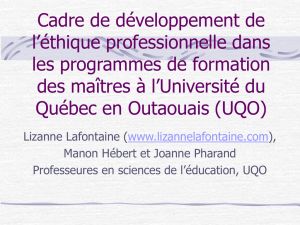Approche dialogique ou génétique de la gouvernance. À propos de

Approche dialogique
ou génétique de la gouvernance.
À propos de la théorie
de la délibération éthique de G. Legault
Par
Jacques Lenoble et Marc Maesschalck
Professeurs de philosophie du droit
Université catholique de Louvain
Le texte de G. Legault publié dans cet ouvrage n’est pas sans poser
question. Bien entendu, nous ne pouvons que partager avec lui le
geste « politique » qui souligne les risques d’inefficience de
l’approche de la gouvernance par le droit et qui valorise la forme
de régulation par délibération éthique qui tente d’émerger dans
plusieurs secteurs de notre vie collective. Alors que la première
conditionne son application sur la seule force de l’imposition nor-
mative et de l’appareil public de coercition, la seconde assure son
effectuation par l’implication des acteurs concernés dans une né-
gociation commune sur la signification concrète et contextuée des
références axiologiques portées par leur vivre ensemble.
Notre interrogation porte plutôt sur l’argumentation théorique
mobilisée pour « justifier » ce geste « politique » et définir les
conditions de construction du dispositif de négociation qu’il ap-
pelle. Notre interrogation est double. D’une part, les critiques
adressées par G. Legault au positivisme juridique nous paraissent
problématiques et ne permettent pas de cerner la nature réelle de
l’insuffisance du positivisme. D’autre part, l’approche du dispositif
de gouvernance proposée en alternative – c’est-à-dire le dispositif
de délibération éthique – nous paraît devoir être elle-même pro-
longée sur trois plans.
Une reformulation de la critique du positivisme juridi-
que par G. Legault
Notre interrogation est double. Tout d’abord, la critique adressée
par G. Legault à l’approche positiviste du concept de droit ne nous
paraît pas exempte d’ambiguïté. En effet, peut-on soutenir, sans
autres précisions, que le positivisme implique une séparation du
droit et de la morale et ne prend pas en compte la condition

76 LA PLACE DU DROIT
DANS LA NOUVELLE GOUVERNANCE ÉTATIQUE
d’acceptation pratique des destinataires privés de la norme? En-
suite – et surtout – peut-on se contenter de dénoncer le positi-
visme en relevant l’inefficacité à laquelle conduirait une forme de
normativité qui s’appuierait ainsi sur le seul mécanisme de la règle
appuyée de sanction.
Tout d’abord, la double ambiguïté. Bien entendu, le positivisme
implique une séparation du droit et de la morale si l’on entend par
là le refus de subordonner l’existence (c’est-à-dire la validité)
d’une règle à une morale substantielle que la raison serait suppo-
sée pouvoir définir a priori. Mais quel auteur sérieux, à commen-
cer d’ailleurs par R. Dworkin, n’endosserait pas aujourd’hui une
telle dénonciation des démarches du droit naturel classique ou
moderne? Et nous sommes certains d’ailleurs que G. Legault sous-
crit aussi à une telle dénonciation. Par contre, n’est-il pas hasar-
deux d’imputer au positivisme une acception plus étendue de la
nécessaire séparation du droit et de la morale. Bien des auteurs
positivistes – comme H. Hart et J. Coleman notamment – ont clai-
rement défendu, à l’encontre de J. Raz, ce qu’on appelle une ap-
proche incorporationniste qui pose qu’un système juridique peut
faire dépendre la validité de ses règles d’une référence à la morale.
Dans le même ordre d’idées, d’ailleurs, J. Coleman a bien montré
que la compréhension dworkinienne de l’opération du juge en
termes d’intégrité n’est en rien contraire au positivisme tel
qu’interprété, par exemple, par H. Hart. C’est dire, comme plu-
sieurs auteurs l’ont récemment montré, que le positivisme est
moins spécifié par la thèse de la séparabilité du droit et de la mo-
rale que par ce qu’on a coutume d’appeler la « conventionality
thesis », c’est-à-dire par l’idée que la normativité du droit est toute
entière fondée sur une convention sociale, ou, à le dire en d’autres
termes, sur une pratique sociale. Et si tel est effectivement le trait
distinctif du positivisme, ne doit-on pas l’avaliser? Bien entendu,
on peut – et selon nous, on doit - se différencier de la manière
dont le positivisme conçoit cette pratique sociale. Mais le débat est
ainsi porté sur un autre plan que celui de la distinction droit-
morale. Il porte sur la manière dont il faut définir les éléments
constitutifs de la pratique sociale par laquelle les membres d’un

À PROPOS DE LA THÉORIE 77
DE LA DÉLIBÉRATION ÉTHIQUE DE G. LEGAULT
groupe social se dotent de normes collectives et donc définissent
les formes de leur vivre ensemble (c’est-à-dire leur morale so-
ciale). C’est d’ailleurs, sur le plan de la conception positiviste de
cette pratique sociale constitutive de la normativité de la norme
que se situe la seconde ambiguïté de la manière dont G. Legault
entend dénoncer le positivisme.
Nous voudrions ici relever un double élément pour ouvrir la ré-
flexion sur cette seconde ambiguïté. Premier élément : il n’est pas
rigoureusement exact que les positivistes n’inscrivent pas la néces-
sité d’une « acceptation pratique » des destinataires privés de la
norme juridique dans les éléments constitutifs de la pratique so-
ciale où se fonde l’obligatoriété du droit. Certes, comme G. Le-
gault, nous nous inscrivons en faux contre la manière dont le
positiviste conçoit cette condition d’acceptation pratique. Mais,
pour les positivistes, celle-ci n’est pas toujours déjà supposée exis-
ter comme semble le dire G. Legault. Ce qui est exact c’est que les
auteurs positivistes – de Kelsen à Coleman en passant par Hart –
conçoivent cette condition d’acceptation pratique des destinataires
privés en termes de condition d’efficacité : le droit n’existe que si
une partie substantielle de la population applique et respecte les
règles identifiées par la règle de reconnaissance. À la différence
donc des autorités publiques, « acceptance from an internal point
of view by a substantial proportion of the populace is neither a
conceptual nor an efficacy requirement »1 . De là aussi, le second
élément qui nous semble révéler une ambiguïté dans la démarche
de G. Legault : n’y a-t-il pas une forte intuition de sens commun
dans cette thèse positiviste? N’est-il pas exact que, dans bien des
cas, s’observe « l’efficacité » de la régulation par le droit? Dans
bien des cas, l’observance habituelle du pouvoir des autorités pu-
bliques laisse augurer l’efficacité des règles. En ce sens, les formu-
les de G. Legault risquent de ne pas être sans ambiguïté sur cette
question de l’efficacité de la gouvernance par le droit. Dans bien
1. J. Coleman, « Incorporationism, Conventionality, and the Practical Differ-
ence Thesis », Hart’s Postcript, edited by J. Coleman, Oxford UP, Oxford,
2001, 115.

78 LA PLACE DU DROIT
DANS LA NOUVELLE GOUVERNANCE ÉTATIQUE
des cas, cette efficacité est avérée. Et, de ce point de vue, il est tout
aussi de sens commun qu’il serait bien inefficace de proposer un
développement des formes de négociation par délibération éthique
et des dispositifs de médiation dans l’ensemble des secteurs de
l’action collective actuellement régulés par ce que G. Legault ap-
pelle un droit positiviste.
L’enjeu pour nous n’est pas de confronter le raisonnement de G.
Legault à l’exactitude formelle des thèses positivistes. L’enjeu est
ailleurs. Notre hypothèse est, en effet, que le double élément
d’ambiguïté que l’on vient de relever a, selon nous, valeur de
symptôme. Symptôme de ce qu’une critique du positivisme et,
corrélativement, une meilleure définition des conditions à respec-
ter pour assurer une meilleure garantie de réalisation de la finalité
régulatoire de la règle appelle un détour épistémologique, et donc,
un prolongement de la démarche initiée par G. Legault. Loin de
nous de ne pas partager les intuitions de base de G. Legault sur
l’insuffisance du positivisme et la nécessité de repenser
l’implication des destinataires privés d’une règle dans son proces-
sus d’élaboration et d’application. Mais, pour penser cette double
intuition, il nous semble qu’une meilleure élucidation de
l’insuffisance du positivisme s’impose. Cette insuffisance, selon
nous, est profonde et est de nature épistémologique. Où nous ar-
rivons à notre seconde interrogation critique s’agissant de la dé-
nonciation par G. Legault du positivisme juridique. En effet,
l’insuffisance du positivisme est une insuffisante construction de
la récursivité ou réflexivité de l’opération normative. En ne cons-
truisant pas cette nature profonde de l’insuffisance du positivisme,
non seulement G. Legault risque de dénaturer l’approche positi-
viste du concept de droit, mais aussi, et surtout, risque de succom-
ber lui-même à cette même insuffisance épistémologique dans la
construction du dispositif de délibération éthique qu’il suggère
pour pallier les carences régulatoires du « droit positiviste ». Ex-
plicitons rapidement cette double idée.
Risque de dénaturation tout d’abord. Certes, G. Legault a raison de
souligner la déficience du positivisme tant en ce qui concerne la

À PROPOS DE LA THÉORIE 79
DE LA DÉLIBÉRATION ÉTHIQUE DE G. LEGAULT
condition d’acceptation des règles par leurs destinataires privés
qu’en ce qui concerne l’efficacité du mode de gouvernance
qu’assure ce qu’il appelle un droit « positiviste ». Mais, au contrai-
re de ce que semble indiquer G. Legault, cette déficience ne consis-
te pas en l’absence de toute prise en compte de la condition
d’acceptation pratique par la population des règles, mais dans la
manière dont cette conditionnalité est conçue. De même, la consé-
quence de cette déficience n’est pas l’inefficacité d’une gouver-
nance par le droit, mais la non garantie de son efficacité : elle
réside dans l’impossibilité pour le droit d’anticiper les conditions
qui garantissent une telle efficacité.
La différence de formulation est importante. En effet, souligner
que la déficience du positivisme tient dans la manière dont celui-ci
conçoit la conditionnalité de l’acceptation pratique par les citoyens
oblige à construire une dimension passée sous silence par G. Le-
gault. La dimension est celle qui permet d’expliquer pourquoi c’est
à tort que les principaux auteurs positivistes conçoivent cette
condition d’acceptation pratique en termes d’« efficacy condi-
tion ». Nous ne développons pas ici cette question qui a été expo-
sée ailleurs dans le présent ouvrage (cf. le texte de J. Lenoble en
début de cet ouvrage) et, surtout, dans le première partie de notre
livre Démocratie, Droit et Gouvernance2. Il suffit de rappeler que
cette dimension est la récursivité ou la réflexivité de l’opération
normative et, plus précisément en l’espèce, la récursivité ou la ré-
flexivité de cette condition d’acceptation pratique de la règle par
ses destinataires privés. C’est cette récursivité qui empêche que
cette condition soit conçue en termes d’efficacy condition, comme
le croient les positivistes, c’est-à-dire dans les termes d’un constat
du respect majoritaire du système juridique en vigueur par la ma-
jorité de la population. Cette récursivité implique que le jugement
d’acceptation suppose toujours déjà sa propre vérification pour
pouvoir être validé. Il n’y a donc pas de “point fixe” sur lequel
s’appuyer pour pouvoir formaliser l’opération de vérification. Par
2. J. Lenoble et M. Maesschalck, Démocratie, droit et gouvernance, Sher-
brooke (Québec), Éditions R.D.U.S., 2011.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
1
/
24
100%