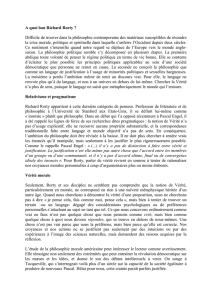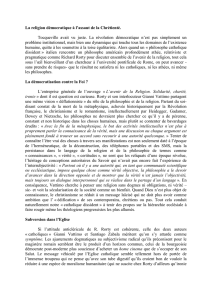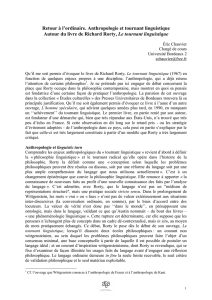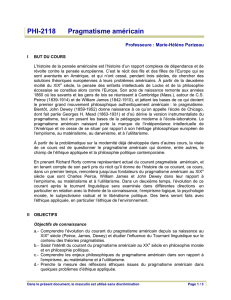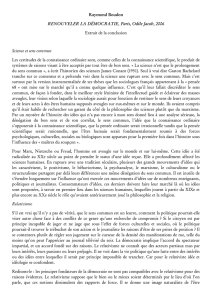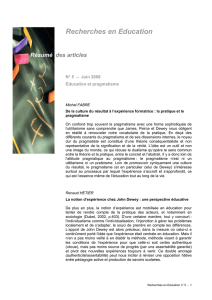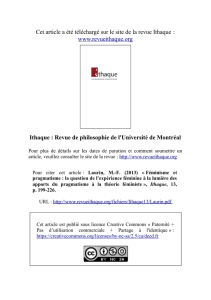RICHARD RORTY ET LE « SPECTRE DU RELATIVISME »

Jean-Claude Gens
Professeur de philosophie, Dijon
RICHARD RORTY
ET LE « SPECTRE DU RELATIVISME »
Pour la tradition philosophique dominante comme pour l'opinion la plus répandue, la phi-
losophie a pour tâche de fonder ou de justifier rationnellement nos pratiques culturelles, et par
là de répondre au défi représenté par la diversité de ces pratiques, et donc au problème du relati-
visme. Or, malgré toutes les tentatives de fonder nos pratiques sur des principes universels et
intemporels, c'est-à-dire métaphysiques (Dieu, les droits naturels, etc.), la philosophie n'a cessé
d'être suivie de son ombre, d'être hantée par le spectre du relativisme (ou du scepticisme, puis-
que leurs différences sont négligeables par rapport à une telle exigence de rationalité). Face à
cette tradition, le caractère à la fois naïf ou léger et iconoclaste de la pensée de Richard Rorty est
d'affirmer que cette exigence de fondation est non seulement vaine mais inutile
;
on n'a pas man-
qué d'y voir l'expression d'un cynisme, de quelque chose de « répugnant » — pour reprendre le
qualificatif de l'un de ses critiques — car renoncer à découvrir de tels principes transculturels,
n'est-ce-pas en venir à considérer toutes les pratiques comme équivalentes, et par là « devenir un
vrai salaud »l
?
Liquider la fameuse question du relativisme, c'est pour Rorty surmonter l'alter-
native entre l'universalisme et le relativisme. Mais le sens d'une telle critique est politique; elle
invite à une sécularisation de nos pratiques afin qu'advienne une culture qui permette une diver-
sité
radicale
des pratiques inter- et intra-culturelles et une authentique solidarité.
La critique rortienne commence par mettre en évidence le caractère confus de la notion de
relativisme qui recouvre en réalité trois conceptions qu'il convient de distinguer. La première
HERMÈS 20, 1996 251

Jean-Claude Gens
pose que toute croyance — et par la même toute pratique — est aussi valable qu'une autre. Or,
non seulement une telle conception n'est soutenue par personne, mais elle est insoutenable;
d'une part, «à l'exception de l'éventuel débutant de service, on ne trouvera personne qui
accepte, sur une question importante, de tenir pour également bonnes deux opinions incompa-
tibles » (Rorty, 1993a, p. 309) et, d'autre part, une telle affirmation est logiquement insoutenable
car autoréfutante.
La seconde conception du relativisme, c'est celle selon laquelle « vrai » est un terme équi-
voque qui a autant d'acceptions que de procédures de justifications (par exemple lorsqu'on qua-
lifie de vraies des affirmations comme
:
il fait chaud aujourd'hui, la somme des angles d'un
triangle est égale à deux droits) (Rorty, 1994b, p. 38
sqq.).
Mais l'indétermination ou la « flexibi-
lité » de la signification de ce terme comparable à celle de « ici », « là », « vous », vient de ce
qu'il n'est employé que comme une « expression de recommandation », d'approbation, comme
le sont aussi souvent « bien », « mal
» ;
en tant que tel « vrai » a un sens univoque quelque soit
par ailleurs l'objet de l'approbation.
Enfin, si Rorty qualifie respectivement de « stupide » et « obtuse » les deux premières
conceptions (Rorty, 1990b, p. 51), le terme de relativisme sert encore à en désigner une troi-
sième, mais celle-ci n'est qu'indûment appelée « relativiste ». On nomme ici « relativiste » celui
qui affirme que l'on ne saurait accéder à un point de vue neutre,
objectif,
à partir duquel toutes
les croyances et pratiques culturelles pourraient être comparées. Or n'est-ce pas là une simple
évidence à moins de croire que l'on pourrait s'extraire de son propre point de vue pour prendre
celui de Dieu, c'est-à-dire littéralement considérer la diversité des cultures de nulle part ou en
dehors de tout point de vue? L'acceptation de notre finitude implique celle de notre eth-
nocentrisme puisque toute vue, tout jugement, suppose un point de vue qui ne nous offre jamais
qu'un angle de vision, qu'une perspective; autrement dit, c'est seulement à partir de nos pra-
tiques culturelles qu'il est possible de se prononcer sur la valeur d'autres pratiques. Mais la cri-
tique du fondationnalisme ou du platonisme de la métaphysique vise également la tentative de
déduire la nécessité de nos pratiques de la connaissance d'une nature ou d'une essence humaine,
de droits naturels
;
l'acceptation de notre finitude implique ici de reconnaître la contingence his-
torique de nos croyances et de nos pratiques, rien ne permettant d'affirmer qu'elles sont plus que
la « création fortuite des temps modernes » (Rorty, 1993b, p. 106), ni qu'elles seront celles de
demain. L'accusation de relativisme telle qu'elle est couramment formulée repose donc sur un
fantasme à partir duquel sont confondus l'ethnocentrisme et l'idée stupide que toute pratique en
vaut une autre, c'est-à-dire le troisième et le premier sens de la notion de relativisme. Il suffit au
contraire de reconnaître que la prétention de se placer du point de vue de Dieu, de découvrir ce
qui vaudrait de façon universelle et nécessaire, intemporelle, est un fantasme, pour que se dis-
solve du même coup son double tout aussi fantastique mais ténébreux
:
le spectre du relativisme
;
celui-ci n'a donc pas à être combattu ou réfuté — ce qui supposerait qu'on puisse lui opposer un
absolu — il
s'agit
au contraire de « surmonter » (Rorty, 1994b, p. 110) à la fois les deux visages
d'un même fantasme. La critique ne saurait pourtant en rester là car il faut encore expliquer
l'origine d'une telle confusion.
252

Richard Rorty et le «
spectre
du
relativisme
»
Rorty suggère d'abord que ce spectre n'est qu'un épouvantail, une fiction, inventé par la
métaphysique afin d'enfermer toute autre conception à l'intérieur de l'alternative entre l'univer-
salisme et le relativisme. Brandir cet épouvantail relève donc d'une simple stratégie, voire même
d'un jeu
:
celui que l'on accuse ainsi d'être relativiste « n'est jamais que l'un de ces petits copains
imaginés par les platoniciens et les kantiens, qui partagent le même univers de fantasmes que le
solipsiste, le sceptique et le nihiliste moral. Selon leurs désillusions et leurs caprices, les platoni-
ciens et les kantiens jouent à être l'un ou l'autre de ces personnages. Mais, dans ce cas, il ne
s'agit
jamais de faire du relativisme, du scepticisme ou du nihilisme une alternative sérieuse à notre
manière ordinaire de procéder» (Rorty, 1993a, p. 310). Une lecture charitable de ce genre de
métaphysiciens implique de croire que ceux-ci ne pouvaient pas prendre au sérieux un tel épou-
vantail. L'expression de « spectre du relativisme », fréquemment employée par Rorty — mais qui
se trouve déjà chez Heidegger — renvoie donc à la fois à l'épouvante de la culture métaphysique
à l'égard de ce qui lui apparaît comme sa négation même, comme à la stratégie — voire au jeu —
des métaphysiciens (Rorty, 1990a, p. 411; 1994b, p. 208).
La seconde explication avancée par Rorty, c'est que ce qui motive l'accusation de relati-
visme et l'épouvante réelle face à ce spectre repose sur la croyance que les pratiques des sociétés
démocratiques, les « habitudes de vie intellectuelle, sociale et politique » héritées des Lumières
(Rorty, 1994b, p. 47), seraient mises en péril s'il s'avérait qu'elles ne puissent être fondées sur des
vérités éternelles. Autrement dit, si l'on admet l'impossibilité de se placer du point de vue de
Dieu, est-il néanmoins possible de justifier nos habitudes de
vie ?
L'invitation rortienne à dépla-
cer la question du champ théorique au champ pratique explique aussi qu'il faille préférer le
terme d'ethnocentrisme à celui de relativisme, puisqu'à la différence de ce dernier il n'a pas la
prétention d'énoncer une théorie positive quelconque — d'ordre métaphysique ou épistémolo-
gique — quant à la connaissance de la vérité, mais renvoie au contraire aux problèmes pratiques
de l'incompréhension, voire du conflit, posés par la rencontre de pratiques culturelles
dif-
férentes. La véritable question est donc maintenant de savoir au nom de quoi une pratique méri-
terait d'être défendue et préférée à une autre.
Pour la tradition philosophique classique, humaniste, pouvoir défendre une croyance ou
une pratique, c'est idéalement pouvoir avancer un ou des arguments capables de convaincre tout
homme doué de raison. Or cela est à la fois impossible et inutile. Rorty commence par rappeler
l'abîme argumentatif qui sépare par exemple l'humaniste du nazi, c'est-à-dire des formes de vie
incommensurables; aussi convient-il simplement de prendre acte de l'impuissance de l'argu-
mentation rationnelle humaniste à modifier le comportement d'une brute ou d'un nazi. Par ail-
leurs,
une telle exigence d'argumentation est inutile à moins de penser qu'il est nécessaire de dis-
poser d'arguments rationnels pour ne pas être une brute et secourir autrui. En réalité pour
adopter et défendre telle ou telle pratique, nous n'estimons pas avoir besoin d'attendre la garan-
tie de sa validité universelle et intemporelle. Il suffit que nous la considérions comme la meil-
leure dont nous disposons à ce jour. Par conséquent, et pour assumer l'ethnocentrisme auquel
253

Jean-Claude Gens
nous sommes condamnés, la seule question véritable — plus simple et plus concrète — est : y a
t-il de meilleures pratiques que celles de la tradition des Lumières
?
La thèse rortienne est que nous, nous les libéraux, ne connaissons pas de meilleures pra-
tiques que celles des Lumières, même si nous ne pouvons pas fonder ou démontrer cette supé-
riorité. Cela revient à substituer au critère de la preuve dite rationnelle, celui de l'expérience, à
considérer qu'une pratique meilleure est telle, que celui qui en serait devenu familier, qui en
aurait fait l'expérience, la tiendrait pour préférable à celle(s) qu'il connaissait jusque là. On ne
saurait pourtant sauver ainsi l'universalité de certaines pratiques en supposant que pourrait se
dégager progressivement un consensus des hommes sur la supériorité de telles ou telles pra-
tiques. D'une part, l'expérience montre que tous les Européens ayant fait l'expérience du sys-
tème nazi et l'ayant comparé au système démocratique n'ont pas unanimement reconnu la supé-
riorité de l'un de ces deux systèmes. D'autre part, à supposer même qu'un consensus à venir soit
possible, rien ne garantit que ce serait sur ce que les Lumières ont jugé être le meilleur et qu'il y
aura encore des démocraties demain.
L'incapacité à fonder les habitudes de vie libérales des Lumières, implique seulement que
celles-ci peuvent être désolidarisées du rationalisme métaphysique classique
;
l'effondrement du
sol métaphysique de notre culture, qui pourrait être perçu comme tragique, est au contraire
considéré par Rorty comme une libération, comme l'achèvement du processus de sécularisation
ou de désenchantement de notre culture. Dans l'essai intitulé De la
Priorité
de la
démocratie
sur
la
philosophie,
il avance une comparaison pour le moins provocante destinée à éclairer ce que
requiert l'achèvement d'une telle sécularisation puisqu'il
s'agit
de faire de la philosophie ce que
Jefferson a fait de la religion : une affaire purement privée. Or c'est justement ce à quoi conduit
la critique du fondamentalisme, car si nos pratiques culturelles ne peuvent être fondées cela
signifie que les représentations susceptibles de les justifier n'ont de validité que d'un point de
vue privé en tant que descriptions, modèles, grâce auxquels chacun est libre de redécrire sa vie et
ses pratiques dans des termes qui lui soient propres, c'est-à-dire de les poétiser (Rorty, 1993b,
p.
86-87). Par conséquent une culture est constituée par un réseau de pratiques que divers
ensembles de valeurs ou de croyances sont également susceptibles de justifier. Pourtant si
« devenir rortien » — comme le dit H. Putnam — devrait nous rendre « plus tolérants, moins
enclins à céder à toutes sortes d'intolérances religieuses et de totalitarismes politiques » (Rorty,
1992,
p. 136), abandonner le fondement métaphysique constitué par une théorie des droits de
l'homme, n'est-ce pas perdre du même coup l'instance critique à l'égard des pratiques qui
méritent d'être changées ou améliorées
?
On peut au contraire considérer que toute culture sera d'autant plus prête à réformer ses
pratiques qu'elle y verra seulement celles d'une tradition historique contingente, ce qui signifie
qu'il peut toujours en exister de meilleures, que « quelqu'un peut toujours se présenter avec une
meilleure idée » (Rorty, 1994b, p. 38). Dès lors, l'idée même de culture s'en trouve changée,
puisqu'au lieu de renvoyer à des fondements immuables, elle implique — et c'est ce qui fait sa
vie — (Rorty, 1990a, p. 414) la révision, la recomposition, permanente de ses croyances et de ses
254

Richard Rorty et le «
spectre
du
relativisme
»
pratiques par leur confrontation avec d'autres pratiques, c'est-à-dire par le dialogue. Mais ce
terme est ambigu dans la mesure où on peut l'entendre comme une discussion dont l'objet est de
trouver des arguments définitifs dont rêvent les métaphysiciens. Aussi, pour désigner la pratique
par excellence d'une culture post-métaphysique, Rorty lui substitue le terme de « conversation ».
Celle-ci permet d'une part de s'ouvrir à d'autres possibles, et d'autre part de franchir la distance
qui nous sépare de Γ« autre », d'élargir le sens du « nous ». « Concevoir la culture comme
conversation» (Rorty, 1990a, p. 354; 1993a, p. 317
sqq.),
c'est considérer que «les croyances
émanant d'une autre culture doivent être testées au moyen d'un effort visant à les entretisser à
celles que nous possédons déjà » (Rorty, 1994b, p. 43). De ce point de vue, le désir de fonder nos
pratiques sur des principes métaphysiques est au contraire une « entrave aux progrès des socié-
tés démocratiques » (Rorty, 1993b, p. 76, p. 92).
Il reste à préciser à quoi ressemblerait une culture post-métaphysique qui permettrait la
coexistence de la plus grande diversité de pratiques individuelles, sociales et culturelles, comme
l'avènement d'une authentique solidarité.
S'inspirant de la comparaison suggérée par un de ses critiques entre le monde contemporain
et un bazar koweïtien, Rorty invite à penser une telle culture sur le modèle d'un « bazar envi-
ronné d'une quantité innombrable de clubs strictement privés » (Rorty, 1994b, p. 243). Aussi
étrange qu'elle puisse paraître, une telle représentation constate la dissolution de la relative
homogénéité des cultures antérieures et l'avènement d'un monde qui ressemble de plus en plus à
un gigantesque collage ou patchwork. La diversité des pratiques n'est plus seulement ce qui dis-
tingue les diverses cultures les unes des autres, mais ce qui à l'intérieur même de chaque culture
en menace l'unité, de sorte qu'il devient plus difficile de penser la diversité des éléments consti-
tutifs d'une culture comme celle des pièces d'un puzzle s'ajustant les unes aux autres pour for-
mer un tout cohérent, et encore moins comme celle des parties d'un organisme
;
autrement dit
encore, la substitution de la métaphore du collage, du modèle du bazar, à la métaphore orga-
nique — romantique ou moderne — implique qu'il n'est plus possible de penser l'identité de la
culture à partir de l'unité d'une langue, d'une vision du monde, c'est-à-dire finalement d'une
nation, dès lors que les individus définissent leur identité par leur appartenance à des groupes
plus restreints — clubs, ethnies ou tribus — dans lesquels ils cherchent à réaliser leurs fantasmes
idiosyncrasiques. Dans une telle culture, la seule chose nécessaire, c'est « la capacité de contrôler
ses sentiments lorsque des gens dont des différences irrémédiables nous choquent se présentent
à l'hôtel de ville, chez le marchand de légumes ou dans l'enceinte du bazar. Lorsque cela se pro-
duit, vous souriez beaucoup, vous faites les meilleures affaires que vous pouvez, et après une
rude journée de marchandages, vous vous retirez dans votre club. Là, vous trouverez le réconfort
que vous apporte la compagnie de vos pairs moraux » (Rorty, 1994b, p. 243).
Mais on peut se demander si les pratiques culturelles ne se réduisent pas alors à celles de la
société marchande, alors qu'un souk est aussi un lieu de sociabilité. Or si Rorty ne voit rien de
désolant dans ce bazar, c'est justement qu'il permet à chacun de s'accomplir dans la sphère de sa
255
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%