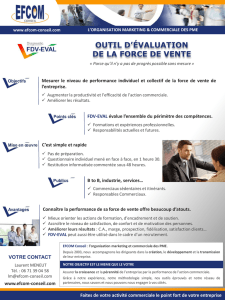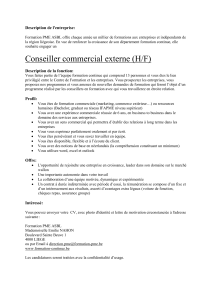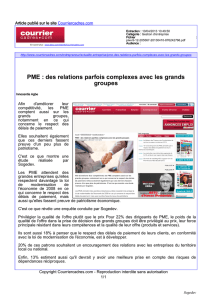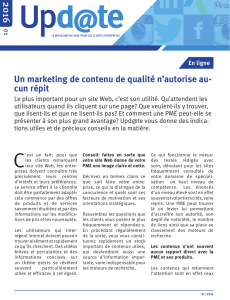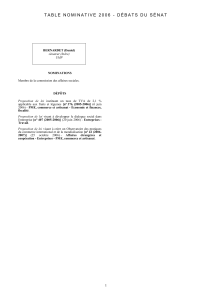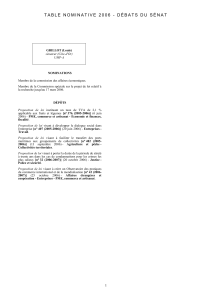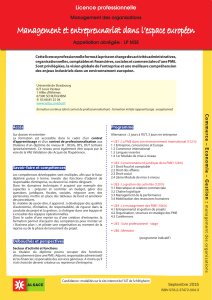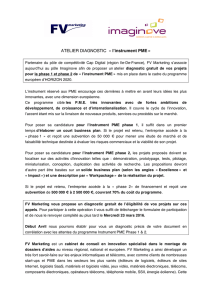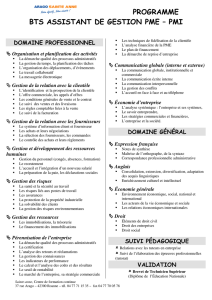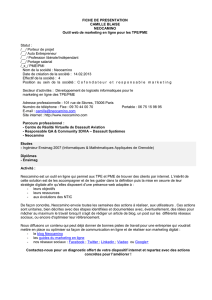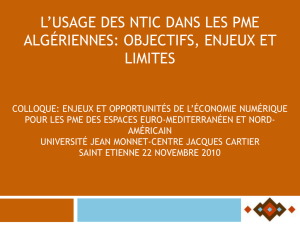Les PME et la grande distribution

dossier
Des PME très actives vers la grande distribution
Un taux d’investissement assez important
Des PME très présentes dans l’alimentaire
Avril 2003

Le Monde des Entreprises n° 22
Page II
a grande distribution occupe une place prépondérante sur le marché des produits de grande consommation : produits
alimentaires, produits d’hygiène et d’entretien… La grande distribution s’y taille la part du lion : plus de 80 % de
part de marché pour certains produits comme l’épicerie, par exemple. Pour l’ensemble des produits alimentaires,
les grandes surfaces détiennent une part de marché de 66,2 % en 2001, et de 74,7 % si l’on y ajoute les
supérettes. La place des PME dans la fourniture des hyper et des supermarchés n’a rien de négligeable. Les
PME du secteur alimentaire représentent en effet une part de production qui mérite d’être prise en compte : du tiers
à la moitié, selon les secteurs.
L
DES PME TRES ACTIVES
DANS L’ALIMENTAIRE
Petites et moyennes entreprises sont très actives dans les industries
agroalimentaires : l’on recense près de 60 000 entreprises privées et coopératives
employant moins de 250 salariés dans les secteurs concernés par les produits
de grande consommation. En dépit des nombreuses restructurations des deux
dernières décennies, les PME occupent une place majeure : elles constituent
plus de 95 % des entreprises, réalisent 44,3 % du chiffre d’affaires, emploient
61,7 % des salariés.
De nombreuses PME appartiennent à un groupe, qu’il soit français ou
étranger. Ces groupes sont fortement implantés dans l’industrie laitière et les
corps gras, moins dans celle du poisson. Selon l’INSEE, les groupes d’entreprises
dégagent, en 1999, 63 % de la valeur ajoutée des industries agroalimentaires. Pour
65 %, cette valeur ajoutée émane de groupes français. Les sociétés étrangères,
elles, sont particulièrement présentes dans les secteurs des corps gras, des boissons,
des industries alimentaires diverses (sucre, chocolaterie, conserie, thé, café,
biscuiterie, pâtisserie de conservation…).
Part des PME dans la production en 2000
Pourcentage
Secteur des PME (0-249 salariés) Contribution des PME
dans le nombre d’entreprises (0-249 salariés) au CA du secteur (%)
Industries agroalimentaires
Industrie de la viande 99,0 51,3
Industrie du lait 94,5 35,6
Industrie des boissons 97,1 37,6
Industries alimentaires diverses 99,7 46,2

Le Monde des Entreprises n° 22
Page III
Presque tous les secteurs comp-
tent une ou plusieurs entreprises
françaises de taille nationale, voire
européenne. Néanmoins, celles-ci
pèsent moins dans le classement par
chiffre d’affaires des 20 premiers
groupes européens en 2000 que
les sociétés britanniques. Seuls, six
groupes français figurent dans le
peloton de tête. Parmi eux, Danone
se place au quatrième rang. Le groupe
italien Eridiana Béghin Say, dont
le siège social est en France, arrive
au sixième rang. Suivent Lactalis
(onzième rang) Pernod-Ricard
(quatorzième rang), Bongrain (dix-
huitième rang) et Sodiaal (vingtième
rang).
Selon le Ministère de l’agri-
culture, les PME, elles, sont
principalement présentes dans
l’industrie de la charcuterie, des
plats préparés ou de la découpe
de viandes, des boissons ou dans
le chocolat. Leur réussite tient la
plupart du temps au choix d’un
segment de marché porteur ou d’une
niche. En outre, les PME d’origine
familiale et à vocation régionale,
sont souvent à l’origine de groupes
performants : Bonduelle, Roquette,
Besnier, etc.
LA STABILITE
DES COOPERATIVES
Depuis 1998, les taux de
concentration dans les industries
agroalimentaires en France évoluent
de façon modérée. Les branches
d’activité qui ont le plus bougé
entre 1998 et 2000 sont la trans-
formation et la conservation des
fruits, la fabrication de glaces et
de sorbets, celle d’aliments pour
animaux de compagnie ainsi que
celle du sucre. En revanche,
les éclatements de groupes nés des
restructurations ont réduit le
niveau de concentration de cer-
tains secteurs : dans les industries
de viande de volailles, dans celles
du poisson ou d’autres industries
alimentaires comme les soupes
et les pâtes alimentaires, le poids
des quatre entreprises classées
premières dans leur domaine
diminue dans le chiffre d’affaires
du secteur.
L’analyse des restructurations
dans l’agroalimentaire français,
réalisée entre 1996 et 2000
par l’Institut de Management
international agroalimentaire de
l’ESSEC, met en perspective les
modes opératoires, les objectifs
afchés ainsi que les choix stra-
tégiques des entreprises et des
coopératives. Au cours de cette
période, les entreprises réalisent
84 % des opérations et les coo-
pératives 16 %. L’évolution vers
l’international, évidente pour
les entreprises (65 % de leurs
restructurations en 2000), s’avère
plus modérée pour les coopératives
(27 % du total).
LA CONCENTRATION,
STRATÉGIE PRÉFÉRÉE
DES ENTREPRISES
Des motivations industrielles
et commerciales sont généralement
à l’origine des rapprochements qui
permettent d’atteindre la taille
critique afin de rentabiliser des
investissements lourds en marketing
et en publicité, de diversifier les
risques, de se recentrer sur quelques
activités ou d’accroître son marché.
En termes de modes opératoi-
res, les prises de contrôle - rachats et
prises de participation majoritaire
- dominent. Elles ne cessent de
se développer pour atteindre, en
2000, plus de 60 % des opérations.
Viennent ensuite les alliances stra-
tégiques sous forme de prise de
participation minoritaire, de liale
commune ou de fusion. Elles ne
représentent plus que 24 % des
interventions en 2000, contre 43 %
en 1996. Le bilan des différentes
opérations entre 1996 et 2000 est
instructif.
dossier

Le Monde des Entreprises n° 22
Page IV
Enn, 15 % environ des opé-
rations recensées sont constituées
de cessions. Une part importante
de celles-ci, durant cette période,
provient du groupe Danone qui a
choisi de se recentrer sur trois métiers
et sur ses marques fortes.
En termes de choix stratégiques,
les opérations de concentration
dominent les autres : plus de 72 %
du total cumulé sur cinq ans.
Les intégrations verticales restent
marginales (2 % des opérations),
les diversifications plafonnent
autour de 5 %. Les opérations de
cession -recentrage caractérisent,
parallèlement aux concentrations,
la décennie 1990.
Les restructurations à l’inté-
rieur de l ‘Europe occidentale sont
majoritaires (77 % des opérations
dont 59 % strictement françaises).
On observe que, parmi les pays
européens, près de 77 % des opéra-
tions sont réalisées par la France.
Secteurs les plus actifs : les produits
laitiers, les boissons alcoolisées et les
boissons non alcoolisées.
L’étude IMIA ESSEC met aussi
en évidence la contribution essentielle
de onze entreprises agroalimentaires
à l’ensemble des opérations. Elles
représentent 30,5 % des opérations
de restructuration entre 1996 et
2000. Quatre coopératives -Sodiaal,
Unicopa, Coopagri Bretagne et le
groupe 3A - s ‘y distinguent. Parmi
les sept entreprises privées, le groupe
Danone aurait réalisé environ 10 %
des 696 opérations comptabilisées,
suivi de Pernod Ricard, Bongrain,
Eridiana Beghin Say, Guyomarc ‘h
NA, Lactalis, et LVMH.
PRODUCTION
MANUFACTURIÈRE :
PEU DE PLACE POUR LES PME
Dans les autres secteurs de la
production manufacturière, les PME
sont nettement moins nombreuses :
373 entreprises de moins de 250
salariés seulement dénombrées en
2000 qui contribuent à 23 % du
chiffre d’affaires du secteur.
Ainsi, dans le secteur de la
fabrication des savons, des détergents
et des produits d’entretiens, sept
grands groupes internationaux
tiennent le haut du pavé : Procter
et Gamble (Etats-Unis), Henkel
(Allemagne.), Colgate-Palmolive
(Etats-Unis), Lever (Pays-Bas -
Royaume-Uni), Reckitt-Benckiser
(Pays-Bas - Royaume-Uni),
Hutchinson (France), Bourjois
(Suisse).
Il arrive, aussi, que les appa-
rences soient trompeuses et qu’il
faille y regarder à deux fois pour
cerner la place exacte occupée par les
PME. Ainsi, le secteur des parfums
et des cosmétiques comporte plus
de 600 entreprises. Les produits de
grande diffusion ne représentent
que 28 % du marché tandis que
la distribution sélective reste pré-
pondérante avec 46 % du marché.
Toutefois, ce secteur est largement
dominé par les sept grands groupes
leaders dans la fabrication de savons
et de détergents. Auxquels il con-
vient d’ajouter l’Oréal et Sanofi
Synthelabo.
Enn, le secteur de la fabrica-
tion d’articles en papier à usage
sanitaire ou domestique est encore
plus concentré. Les PME de ce
secteur n’y réalisent que 14 % du
chiffre d’affaires.
UN POIDS
ÉCONOMIQUE LIMITE
Un nombre important de PME
fournit la grande distribution, qui
fait appel à 7 900 petites et moyennes
entreprises de 20 à 500 salariés -
5 200 sont françaises, 2 700 sont
d’origine étrangères - auxquelles
s’ajoutent 293 groupes industriels.
C’est par eux tous qu’elle s’appro-
visionne en produits de grande
consommation : épicerie, liquides,
hygiène et parfumerie, produits frais
en libre-service et bazar courant).
La contribution des PME au chiffre
Part des PME
dans le chiffre d’affaires
d’une grande surface
Tous rayons % du CA en GMS moyenne
1999 2001
PME 17,7 % 17,3 %
Française 14,8 % 14,6 %
Étrangère 2,9 % 2,7 %
MDD 18,2 % 20,3 %
GROUPES 64,1 % 62,4 %
Français 21,8 % 21,8 %
Étrangers 42,3 % 40,6 %
source : Panel international. Etude FCD 03/2001

Le Monde des Entreprises n° 22
Page V
dossier
Incidence du format de magasins
sur la présence de PME
Part des PME dans l’offre
d’une GSA moyenne
françaises étrangères
En hypermarché 21,5 % 5 %
En supermarché 16 % 2 %
En maxidiscompte 11 % 6 %
Moyenne, toutes GSA confondues 19 % 3,5 %
source : Panel international. Etude FCD 03/2001
Origine des MDD
Nombre de références % des références
par GMS moyenne
1999 2001 1999 2001
MDD 2099 2495 100 % 100 %
Produites par :
- PME françaises 1528 1755 72,8 % 70,5 %
- PME étrangères 384 445 18,3 % 18,3 %
- grands groupes français 101 152 4,8 % 6,0 %
- grands groupes étrangers 86 143 4,1 % 5,5 %
source : Panel international. Etude FCD 03/2001
d’affaires des grandes surfaces est,
cependant, limité - environ 18 %,
hors marques de distributeurs. En ce
qui concerne le rayon produits frais
en libre-service, les PME réalisent
un résultat nettement supérieur.
Elles contribuent à 25 % du CA du
rayon et les marques de distributeurs
à 29 %.
Cependant, l’origine des four-
nisseurs évolue et la période récente
montre un effritement des entre-
prises françaises (tant PME que
groupes) au prot de celles d’origine
étrangère. L’européanisation des
approvisionnements de la grande
distribution explique en partie
ce phénomène. Les opérations
de cessions - acquisitions entrent
également en jeu.
Le maxi-discompte fait surtout
appel aux grands groupes : la part
des PME de 20 à 500 salariés, en
nombre de références, présentes dans
les magasins de maxidiscompte est
nettement inférieure à la moyenne.
De plus, la proportion de produits
provenant des PME étrangères est
beaucoup plus élevée que celle
des supermarchés. Ce phénomène
s’explique certainement par l’origine
des deux leaders (Aldi et Lidl) de ce
format de distribution.
LES MARQUES DE
DISTRIBUTEURS :
L’AVENIR DES PME ?
La part des marques de dis-
tributeurs (MDD) représente en
valeur 23 % du marché des produits
alimentaires, mais près de 41 %
pour la charcuterie libre service,
35 % pour les surgelés et 31 % pour
les produits traiteurs en libre service
- source : Secodip. Les MDD du
secteur des glaces et sorbets arrivent
en première position avec un tiers
du marché. De même, le marché
des pâtes alimentaires est largement
occupé par les MDD qui, avec 28 %
du marché, se placent au deuxième
rang derrière Panzani qui en détient
un tiers. Les domaines d’expansion
visées par la grande distribution
seraient principalement ceux de la
conserie -biscuiterie, des surgelés
et des boissons.
Produire sous marques de
distributeurs (MDD) n ‘exclut pas,
pour un industriel, la possibilité de
produire sous sa propre «marque»
(c’est le cas des sociétés Cantalou et
Senoble). La production sous marque
de distributeur procure un volume
d’activité aux PME partenaires qui
leur permet d’alléger les coûts relatifs
aux services connexes à la production
(effort de marketing, etc).
L’on constate que la fabrication
de produits sous marques de distri-
buteurs est, de fait, dévolue aux
PME. Ils représentent en effet
20 % du CA d’une grande surface
moyenne et 22 % d’un linéaire
moyen. Ils sont produits à près
de 90 % par des PME de 20 à
500 salariés (dont 70 % de PME
françaises).
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%