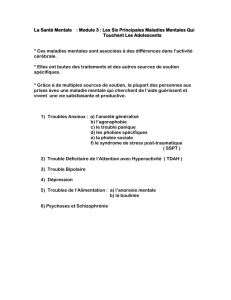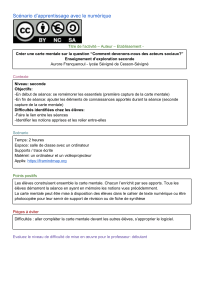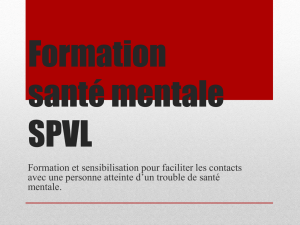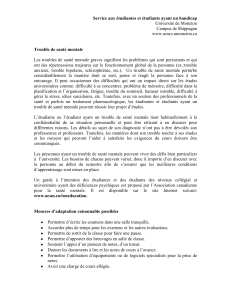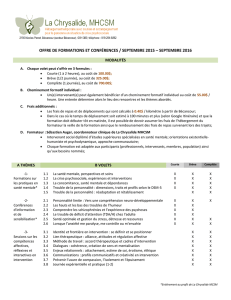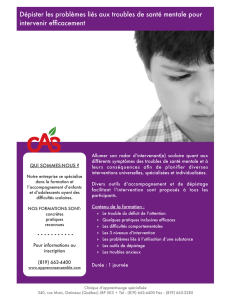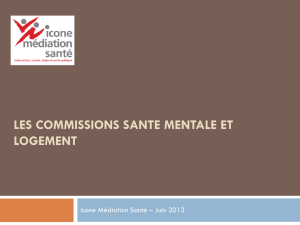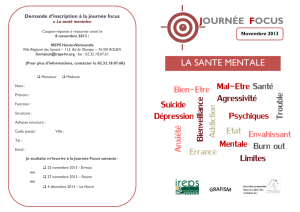Synthèse

Reintegration Awards 2014
Synthèse de la table ronde - 26.02.2015
CRéSaM, Centre de référence en santé mentale, asbl
1
Reintegration Award 2014
Synthèse de la table ronde
« Parler de santé mentale avec les médias »
26 février 2015 à Namur (Cap Nord-SPW)
Présidence : Francis PITZ, Administrateur, Membre du bureau du CRéSaM
Avec la participation de
Patrick COUPECHOUX, Journaliste indépendant et Ecrivain, auteur de l’ouvrage « Un homme
comme vous. Essai sur l’humanité de la folie », Collaborateur au Monde Diplomatique, à Paris
Christophe DAVENNE, Animateur au Centre Franco Basaglia à Liège, en charge d'un projet de
lexique et guide à l'usage des journalistes
Benjamin DELAUNOIT, Directeur médical au CRP Les Marronniers à Tournai
Jean-François DUMONT, Secrétaire général adjoint AJP à Bruxelles
Nadia EL ABASSI, Responsable de communication à l'Hôpital Psychiatrique du Beau Vallon à
Saint-Servais, chargée notamment des événements du centenaire de l'hôpital
Hélène GABERT, Co-auteure du livre « J'ai choisi la vie »
A l’occasion de la 14ème édition des Reintegration Awards, la rencontre portait sur le thème « Parler
de santé mentale avec les médias ». C’est notamment au travers des médias que le public peut
découvrir la santé mentale et se forger une représentation de la maladie mentale. Quelle sont les
images qui sont véhiculées et comment se travaille l’information en la matière ? En amont, comment
les acteurs de la santé mentale peuvent-ils communiquer avec les médias, faire passer les messages
constructifs et positifs qu’ils souhaitent transmettre, et s’y préparer ?
Pour en parler, une table ronde réunissait usagers et professionnels de la santé mentale et des médias.
L’occasion pour chacun et pour le public de partager connaissances, expériences et bonnes pratiques.

Reintegration Awards 2014
Synthèse de la table ronde - 26.02.2015
CRéSaM, Centre de référence en santé mentale, asbl
2
En ouverture
Francis PITZ
Si ce n’est par sa propre expérience ou celle d’un proche, c’est souvent au travers des médias que le
public entend parler de santé mentale et qu’il se forge une représentation de la maladie mentale. Ce
qui pose la question suivante : quelles sont les images et les propos qui sont véhiculés, et comment se
travaille l’information en la matière ? Comment faire en sorte de pouvoir faire évoluer les
représentations du grand public vis-à-vis de la maladie mentale, afin qu’émerge une opinion publique
positive, non discriminante vis-à-vis de ceux qui en sont atteints ? En effet, force est de constater que
dans les médias généralistes, les faits divers font plus souvent recette que les sujets traitant de
questions de fond.
Ces dernières années, nombre de nos institutions et services ont développé des projets pilotes et de
nouvelles pratiques : ici une équipe d’outreaching, là une équipe mobile, ailleurs des thérapies
multifamiliales, des groupes de parole thématiques, on pourrait citer des exemples à foison. A chaque
fois, il peut y avoir une opportunité de faire connaître son institution, son service, ses approches
thérapeutiques, ses expertises et son savoir-faire mais est-il aussi aisé de rendre compte d’un travail
thérapeutique, par nature, par essence, immatériel, non visible ?
En communiquant publiquement à plus grande échelle, on peut espérer une reconnaissance mais
quels sont les risques éventuels auxquels on s’expose ?
Certains auraient plutôt peur, en communiquant, d’attirer trop de nouveaux patients qui ne feraient
qu’engorger davantage leur service et rallonger leur liste d’attente ?
Une question importante est celle de la déstigmatisation de la maladie mentale mais surtout des
personnes qui en souffrent. Comment tous les acteurs de la santé mentale, patients, proches,
associations et professionnels peuvent-ils communiquer avec les médias pour faire passer des
messages constructifs, positifs et s’y préparer ? Certaines institutions ont choisi, par exemple, de
recruter des spécialistes en communication. En outre, à l’instar de ce qui existe depuis longtemps, au
Canada, aux USA ou en France, les usagers eux-mêmes ou leurs proches prennent des initiatives, et de
plus en plus, afin d’expliquer leur situation, leurs besoins, tels qu’ils les ressentent et les vivent ; ils
amènent, dans l’espace public, leur propre expertise quant à la gestion de la maladie, des symptômes,
des relations avec les professionnels, …
Autant de questions et d’exemples qui seront étayés lors de cette table ronde au travers des
expériences personnelles, professionnelles et institutionnelles des intervenants rassemblés.

Reintegration Awards 2014
Synthèse de la table ronde - 26.02.2015
CRéSaM, Centre de référence en santé mentale, asbl
3
Introduction : Un homme comme vous
Patrick COUPECHOUX
Depuis toujours, toute politique concernant la folie, tous les rapports qu'entretiennent avec elle les
hommes et la société, ont dépendu d'une vision dominante de celle-ci. On ne considère pas le fou
aujourd'hui de la même façon qu'il y a 100 ans par exemple. Et au cœur de cette vision, il y a toujours
la question de l'humanité de la folie, autrement dit : considère-t-on le fou comme un être humain à
part entière ?
Si l'on se penche sur l'histoire, on se rend compte qu'il n'a jamais été considéré comme tel : possédé
du démon au Moyen Age, responsable de la dégénérescence de la race dès le 19ème siècle, sous-homme
qu'il faut enfermer - pour son bien - au temps de l'asile...
Pourtant, la folie appartient à l’humanité : elle concerne l’existence même, et pas seulement des
symptômes ou ce qui pourrait être leur fondement biologique. Oublier cela, c’est la condamner au
rejet, à l’exclusion, à l’enfermement. C’est se condamner à ne jamais la comprendre et à ne jamais
entendre ce qu’elle dit de notre monde. La psychiatrie désaliéniste, née au cœur de la Résistance
française, en fait la démonstration : le fou peut vivre parmi nous, comme les autres citoyens, à
condition qu’on le considère et qu’on le traite comme une personne. À condition que l’on défende
cette idée simple : le soin, c’est la relation.
Le paradigme actuel de la santé mentale a tendance à délaisser l’humanité de la folie au profit d’une
conception scientiste et gestionnaire de l’individu :
- La vision scientiste de la maladie mentale :
Aujourd’hui, l’approche scientiste dominante dans la société conduit à la réification du patient,
appréhendé comme un objet d’étude et non plus comme une personne. Considérer la folie comme
une maladie comme une autre, un produit d’un dysfonctionnement génétique, ou du système nerveux,
ne couvre pas ce que signifie la maladie mentale ou la folie, loin de là. Cette vision ramène la question
de la maladie mentale à la maladie. Face à cette vision, les voix se font entendre et il n’est pas anodin
de voir apparaître l’émergence d’ouvrages aux titres revendicateurs comme « Je suis une personne,
pas une maladie !
1
».
En dépit des ambitions, la science n’explique pas tout, elle n’offre pas une approche globale de la folie.
La compréhension de la maladie se travaille aussi en dehors de la personne, dans ses rapports sociaux,
dans son histoire personnelle, …
Bref, on fait face soit à une approche humaine et globale, soit à une approche segmentée et inhumaine
qui ne donne pas toutes les clés.
1
De Marie-Luce Quintal, Performance, juin 2013.

Reintegration Awards 2014
Synthèse de la table ronde - 26.02.2015
CRéSaM, Centre de référence en santé mentale, asbl
4
Il reste donc une part de mystère, mais comme on est aux prises avec une ambition totalisante de
vouloir tout expliquer, cela renforce les interrogations. Ce mystère alimente ce que Lucien Bonafé
appelle « la pensée magique » qui anime les gens dès le moment où ils ont à faire à la maladie
mentale selon cette idée qu’il y a quelque chose de mystérieux, une sorte de possession, qui fait que
comme le dit Sivadon, « le fou serait d’une essence différente ». Cela touche au travail sur l’humanité
de la folie. Le malade mental est-il un humain à part entière ?
Nicolas Sarkozy s’engouffre dans cette faille. Plutôt que d’analyser ce qui s’est passé en France à Pau,
le message est : « cette catégorie de personnes est dangereuse » ; démarche archaïque où la pensée
magique est à l’œuvre, qui renvoie à quelque chose de bizarre, d’étrange.
Cette conception scientiste dominante dans la société règne aussi souvent dans les médias. Elle
explique pourquoi on monte en épingle tel ou tel fait plutôt qu’essayer de comprendre ce qu’est la
maladie mentale, et quelles sont les questions qui se posent.
- La vision gestionnaire / néolibérale de la maladie mentale :
Cette vision considère le malade mental comme un citoyen souffrant certes, mais individuellement
responsable de sa maladie et de son traitement. En cela, il ne se distingue pas d’un autre malade. La
science va régler le problème (« vous faites une crise, on vous emmène en hôpital ») et puis la
personne doit tout de suite se prendre en charge (« quel est votre projet de vie ? ») dans une
perspective de réinsertion obligatoire.
Cette vision renvoie à l’individu lui-même la responsabilité de son état.
Les deux conceptions ont un défaut majeur : elles évitent de poser la question de notre
responsabilité. C’est dans la relation que la société a avec le patient que se situe pour une part le cœur
du problème. Quel est le rapport que nous avons à la maladie mentale ? N’est-il pas stigmatisant ?
Quand le rapport est le rejet, l’exclusion, les conditions ne sont pas favorables à la guérison.
Quand on observe la trajectoire qui conduit à la réinsertion, certains patients seulement vont pouvoir
y arriver. Que deviennent les autres ? Le système les considère comme une population à risque, qu’il
faut surveiller, réguler, gérer.
Ces idées dominantes, amplifiées par les médias, font que l’opinion publique ne connaît pas la maladie
mentale et trouve normal qu’un malade qui n’est pas dans la norme soit enfermé.
Il est important de replacer la question des médias dans ce contexte, ceux-ci étant porteurs de cette
vision dominante, naturellement. Les médias ne sont que le reflet de la société dans laquelle ils
travaillent. Ils sont souvent un reflet amplificateur de ce qui se passe dans la société, des idées
dominantes.
Dans le contexte actuel de concurrence de plus en plus sauvage, les grands médias de services publics
ont tendance à s’aligner aussi sur la manière de fonctionner des grands médias privés.
Par ailleurs, on a assisté depuis 20-30 ans à un bouleversement du monde des médias, sur la base
d’une marchandisation extrême de l’information. Les faits divers ont pris une importance de plus en
plus grande. En France par exemple, avec le drame de Pau, on a assisté à un déferlement des médias.
L’analyse critique est relayée au second plan, au profit de l’audience. Or un sujet comme la santé

Reintegration Awards 2014
Synthèse de la table ronde - 26.02.2015
CRéSaM, Centre de référence en santé mentale, asbl
5
mentale demande de connaître le sujet, d’être capable de le comprendre, pour le transmettre de
façon intéressante. Le constat est trop souvent que la maladie mentale n’intéresse que si elle est
considérée comme dangereuse. Quelques exemples : le cas de Pau, l’affaire de Grenoble, le discours
de Sarkozy où il désigne les malades mentaux comme des gens potentiellement dangereux dont il faut
se protéger. Les médias s’emparent de l’affaire parce que c’est porteur, c’est du sang, de la violence,
de la peur, de l’émotion, qui font vendre. La maladie mentale n’intéresse trop souvent que sous cet
angle.
Tout cela alimente une certaine vision de la folie, elle n’émane pas des médias mais de la vision
dominante, qu’on retrouve aussi dans les discours politiques des décideurs.
Table ronde
Tandis que le journaliste agit au rythme effréné de la diffusion du flux d’information et doit rendre
compte en peu de temps d’une réalité, le spécialiste de la santé mentale analyse une situation dans le
temps nécessaire avant d’établir un diagnostic. C’est dire si tâche qui revient au journaliste est ardue…,
d’autant plus que parler de santé mentale reste complexe, même pour le professionnel de la santé
mentale. Dans ce contexte, cette table ronde envisage de dresser des ponts entre ces deux sphères
d’activités, en partant du principe que mieux connaître ce que recouvre la réalité de chacun avec ses
difficultés et ses besoins, participe à un meilleur dialogue.
Aujourd’hui, les impératifs économiques entraînent une certaine marchandisation de l’information qui
a tendance à faire la part belle aux faits divers et à relayer au second plan l’analyse, sans épargner
certains médias de services publics. Le risque est que l’amalgame santé mentale et dangerosité
nourrisse dans l’esprit des gens une image fausse et stigmatisante envers les personnes en souffrance
psychique avec les risques d’exclusion que cela comporte.
Ceci étant, la presse n’est pas un tout homogène : la presse qui serait en quête de sang, de
sensationnalisme, de faits divers et d’émotion, certes elle existe, mais il n’y a pas que celle-là. Des
médias ont aussi une excellente rubrique santé comme c’est le cas de certaines émissions scientifiques
où des experts témoignent de la santé mentale à l’occasion d’une actualité, d’un film, où la rédaction
prend l’initiative de refaire le point sur un phénomène de société … LA presse cela n’existe pas ; il faut
s’en convaincre pour ne pas tomber dans des généralisations abusives, qui d’ailleurs seraient
reprochés aux médias s’ils généralisaient à propos de la santé mentale.
Une communication avec la presse, un contact avec les médias vaut toujours mieux qu’un silence. Le
Centre Régional de soins Psychiatrique (CRP Les Marronniers) à Tournai en est convaincu. Auparavant,
il communiquait de manière très exceptionnelle avec les médias au vu du caractère presque
exclusivement sensationnel de l’information parue dans la presse écrite et audiovisuelle ; la plupart
des articles étaient consacrés à la Défense Sociale, et plus particulièrement à un certain nombre de
faits divers. Il n’était jamais question du métier de soignant ni de prise en charge. Le CRP décide alors
d’être proactif et multiplie les initiatives : invitations à visiter la Défense Sociale, autorisation donnée
à plusieurs TV de participer à la vie de la Défense Sociale mais aussi d’autres sections de l’hôpital,
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%