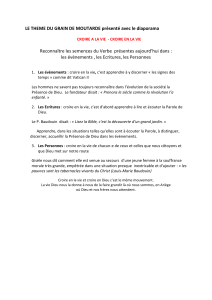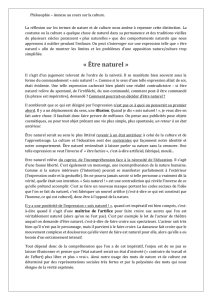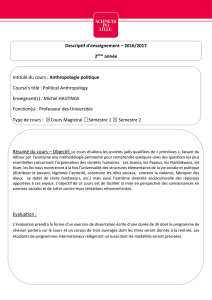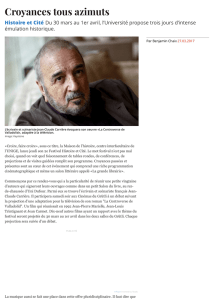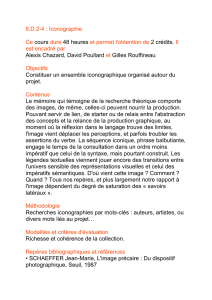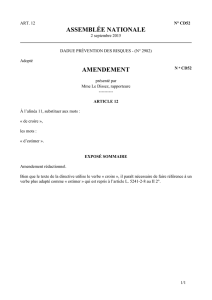Croire en l`histoire

Extrait de la publication

Extrait de la publication

Croire en l’histoire

D
U MÊME AUTEUR
Le Miroir d’Hérodote. Essai sur la représentation de l’autre, Galli-
mard, coll. « Folio », 2001.
Mémoire d’Ulysse. Récits sur la frontière en Grèce ancienne, Galli-
mard, 1996.
L’Histoire, d’Homère à Augustin. Préfaces des historiens et textes
sur l’histoire, réunis et commentés par F. Hartog, traduits
par M. Casevitz, Le Seuil, 1999.
Le
XIX
e
siècle et l’histoire. Le cas Fustel de Coulanges, nouvelle
édition, Le Seuil, coll. « Points », 2001.
Régimes d’historicité. Présentisme et expériences du temps, Le Seuil,
édition augmentée, « Points », 2012.
Anciens, Modernes, Sauvages, Le Seuil, coll. « Points », 2008.
Évidence de l’histoire. Historiographie ancienne et moderne, Galli-
mard, coll. « Folio », 2007.
Vidal-Naquet, historien en personne. L’homme-mémoire et le
moment mémoire, La Découverte, 2007.
Plutarque, Vies parallèles, volume dirigé et préfacé par
F. Hartog, Gallimard, coll. « Quarto », 2001.
Polybe, Histoire, édition publiée sous la direction et préface de
F. Hartog, Gallimard, coll. « Quarto », 2003.
Les Usages politiques du passé, sous la direction de F. Hartog et
J. Revel, Éditions de l’École des hautes études en sciences
sociales, 2001.
La Chambre de veille. Entretiens avec Felipe Brandi et Thomas
Hirsch, Flammarion, 2013.
Extrait de la publication

François Hartog
Croire en l’histoire
Flammarion
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
1
/
22
100%