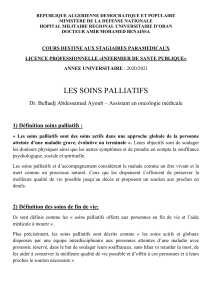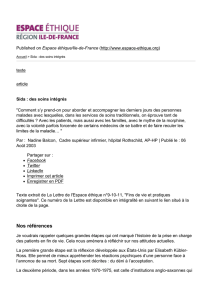GAUDEFROY Agathe Promotion 2009 – 2012 Le

GAUDEFROY Agathe
Promotion 2009 – 2012
Le vécu des soignants en service de soins palliatifs
Travail de fin d’étude en vue de l’obtention du diplôme d’état d’infirmier.
Institut de Formation en Soins Infirmiers Lionnois _ CHU Nancy université de Lorraine.
PAGE DE REMERCIEMENTS

Je remercie ma famille, mes parents et mes deux sœurs, qui par leur présence, m’ont
accompagné tout au long de ce mémoire, et m’ont soutenue dans les moments de doutes.
Je remercie mon ami Quentin pour sa présence, son endurance, et ses mots
réconfortants.
Je remercie ma cousine Sophie, très patiente dans ses longs mails de soutien.
Je remercie ma guidante, pour sa disponibilité sans faille, et les professionnels pour le
précieux temps qu’ils m’ont accordé.
Je pense également à mon grand-père Papierre, qui par delà son absence a été plus que
présent dans mon cœur tout au long de l’élaboration de ce mémoire…
« Si la maladie est une ennemie à combattre, la mort n’en est pas une… elle fait partie de
la vie… Il y a deux façons de réagir : faire face, ou fuir. »
MARIE DE HENNEZEL

INTRODUCTION
Me voila à l’aube de ma vie professionnelle, après trois ans de formation. Trois ans
passés à me battre pour réussir, tant dans la théorie que dans la pratique. Trois ans
passés à prouver jour après jour que l’étudiante que je suis aujourd’hui sera une infirmière
compétente demain.
En arrivant à l’IFSI en septembre 2009, j’avais une certaine vision de ce qu’est le travail
d’une infirmière. J’avais mes représentations, et mes valeurs. J’avais ma propre idée du
mot « soin ».
C’est seulement lors du début de ma deuxième année, quand j’ai effectué mon stage en
service de soins palliatifs, que j’ai retrouvé cette vision du soin.
Cette philosophie propre aux soins palliatifs: le patient au cœur des soins, la famille au
centre de la prise en charge. Le soin du « prendre soin ».
En fin de deuxième année, et en début de troisième année, nos formateurs nous on
recommandé de commencer à réfléchir à un sujet de Travail de fin d’Etude, sur lequel
nous souhaiterions travailler.
Depuis cette rencontre avec les soins palliatifs en novembre 2010, je savais que mon sujet
de mémoire porterait sur ces services encore mal connus, et dont la réputation
s’apparenterait plus à un « mouroir » qu’à un service « d’accompagnement » à la mort.
Au cours de ce stage, j’ai pu remarquer que tous les soignants ne réagissent pas de la
même façon face à la mort. Chacun a sa propre histoire, ses propres appréhensions, ses
propres craintes, ses propres doutes. La mort d’autrui renvoie à sa propre mort, et certains
l’appréhenderont mieux que d’autres, car leur histoire personnelle leur a permis de s’y
confronter.
D’une façon générale, la mort est crainte par bon nombre d’Hommes, car elle est à la fois
terriblement familière, et pourtant si inconnue.
Platon disait de la mort : « Qu'est-ce que craindre la mort sinon s'attribuer un savoir que
l’on n'a point ? »
Mon sujet de départ portait sur l’importance du sourire en soins palliatifs. Cependant,
après m’être renseignée, je me suis aperçue que ce type de sujet n’avait à priori pas fait
l’objet de recherches poussées, et face à la rareté des informations sur lesquelles j’aurais
pu me baser pour élaborer mon cadre conceptuel, j’ai préféré en changer.
En recherchant un nouveau sujet pour composer ce travail de fin d’étude, toujours sur la
base des soins palliatifs, j’ai fais un lien avec mon vécu personnel lors de la mort de mon
grand-père, pendant les vacances d’été.
Après son décès, je me suis demandé si là, j'arriverais à retourner en service de soins
palliatifs. Et je savais que non. Les choses n'étaient pas encore passées, la perte encore
trop proche et la douleur encore trop grande. Mais qu'en est-il des soignants qui vivent
des décès dans leur vie personnelle et qui ensuite doivent retourner travailler? Qu'en est-il
si un patient leur rappelle une situation qu'ils ont déjà personnellement vécue? Comment
font-ils pour passer au dessus de leurs émotions et assurer des soins?
Cette réflexion m'a donc amené à mon sujet de TFE: le vécu des soignants en soins
palliatifs, et à ma question de départ :
En quoi travailler en service de soins palliatifs peut-il avoir une influence sur le
soignant ?

PREMIERE PARTIE : PROBLEMATIQUE ET QUESTION DE RECHERCHE
Après avoir défini ma question de départ, et m’être renseignée sur mon sujet, je me suis
posée plusieurs questions, m’amenant de ce fait à ma question de recherche.
Lors de ma phase exploratoire, pendant laquelle j’ai pu me composer une base de
recherches plutôt solide, je me suis rendue compte à quel point le vécu des soignants en
soins palliatifs semblait être perçu comme négatif.
Quels que soit les livres, les revues, ou les sites internet que je consultais, il était très
souvent question d’ « épuisement professionnel », de « burn-out » , de « stratégies de
défense inconscientes » ou encore de « risques inconscients ». Au vu de mes recherches,
j’avais l’impression qu’un poste de soignant en soins palliatifs était le commencement
logique d’un cheminement vers la dépression.
Au dire de toutes ces informations recueillies pendant ma phase exploratoire, travailler en
soins palliatifs semblait mener directement les soignants à l’arrêt de travail pour « burn-
out ».
A ce moment, il était évident pour moi, que la confrontation des soignants à la fin de vie
n’était pas toujours aisée, mais je restais persuadée qu’il était tout à fait possible de
s’épanouir professionnellement dans un service de soins palliatifs. D’ailleurs, lors de mon
stage, tous les soignants semblaient heureux de dispenser des soins. La douceur avec
laquelle ils les prodiguaient, et le sourire avec lequel il entrait dans les chambres, me
confirme d’ailleurs que travailler dans un service de soins palliatifs n’était pas pour eux un
combat quotidien contre la menace de la dépression.
Alors pourquoi les soins palliatifs renvoient-ils une image si négative ?
Pourquoi sont-ils perçus comme psychologiquement épuisants ?
Pourquoi un soignant ne pourrait-il trouver dans ce type de service, qu’une valorisation de
sa pratique professionnelle et non un épanouissement tant personnel que professionnel ?
Et si la relation avec une personne en fin de vie parait si difficile, pourquoi trouve-t-on
encore des soignants dans les services de soins palliatifs ?
Ces recherches, ont donné naissance à ce questionnement, et ce questionnement à lui-
même donné naissance à ma question de recherche :
Y’a-t-il une influence positive sur les soignants à travailler en service de soins
palliatifs ?
DEUXIEME PARTIE : CADRE CONCEPTUEL
Le temps passant, le moment d’élaborer mon cadre conceptuel est arrivé. Comme tout
étudiant élaborant un Travail de Fin d’Etude, je me suis posée cette question : qu’est ce
qu’un cadre conceptuel ?
Les rendez-vous avec ma formatrice référente pour ce mémoire, m’ont aidée à

comprendre cette partie…
Le cadre conceptuel, c’est donc la définition des mots de la question de recherche, et la
réflexion menée autour de ces termes.
Je souhaite ainsi, dans un premier temps, rappeler ma question de recherche :
Y’a-t-il une influence positive sur les soignants, à travailler en service de soins
palliatifs ?
Mon cadre conceptuel se divisera donc en plusieurs parties afin de bien distinguer, les
différents mots que je souhaite aborder.
Une partie sur « Les soignants », une partie sur « Les services de soins palliatifs », et une
dernière partie sur « L’influence ».
•Qui sont les soignants ?
•Définition
Définis comme « Qui fait profession de soigner, de donner des soins », je n’aborderai
dans ce travail de fin d’étude que la profession infirmière, car c’est celle qui me concerne à
ce jour.
Le terme infirmier(e) est défini comme étant une « personne habilitée à donner aux
malades les soins nécessités par leur état et à participer à diverses actions liées à la
préservation de la santé. ».
Qu’en est-il de la définition donnée par les textes législatifs ?
Selon le code de la santé publique, est considérée comme exerçant la profession d'infirmière ou
d'infirmier toute personne qui donne habituellement des soins infirmiers sur prescription ou conseil médical,
ou en application du rôle propre qui lui est dévolu. L'infirmière ou l'infirmier participe à différentes actions,
notamment en matière de prévention, d'éducation de la santé et de formation ou d'encadrement.
•Formation
A ce jour il n’existe plus qu’un seul programme au sein des Instituts de Formation en Soins
Infirmiers (IFSI), encore dit « Nouveau programme ». Réformée, la formation en IFSI,
comportait encore il y a quelques mois dans ses rangs, deux sortes de programmes : celui
de 1992, actuellement dit « Ancien programme » et celui entré en vigueur en septembre
2009, dont notre promotion fait partie.
Je ne traiterai ici que de ce « Nouveau programme » dont je suis issue.
Pour entrer en IFSI, tout candidat doit être âgé au minimum de 17 ans au 31 décembre de
l’année de passage du concours d’entrée. Il n’existe aucune limite d’âge supérieure.
Tout candidat doit être en possession soit :
•D’un baccalauréat (toutes séries) ou en classe de terminale en vue de l’obtention
de ce diplôme. L’entrée en IFSI ne se fera que sous réserve de l’obtention du
baccalauréat.
•D’un diplôme d’aide-soignante ou d’auxiliaire de puériculture, et justifier de trois ans
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
1
/
20
100%