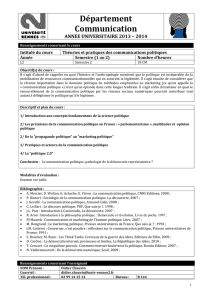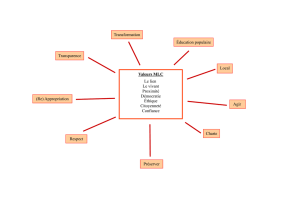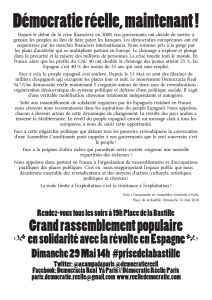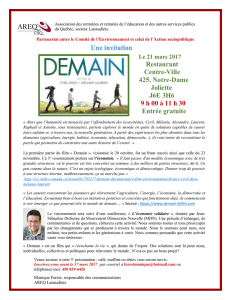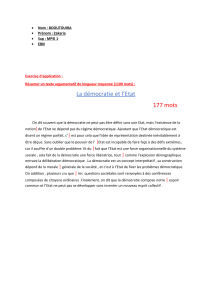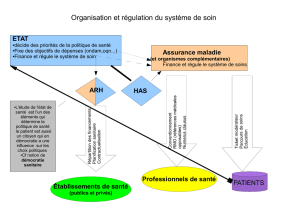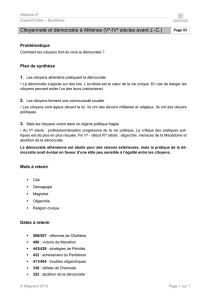Amnésia, «hybris» e implosão institucional Amnésie, hubris

55
Amnésia, «hybris» e implosão institucional
Amnésie, hubris et implosion institutionnelle
Patrick Boumard (Université de Brest)
Resumo
Uma ilusão pedagógica dominou quase todo o século XX, resumida no lema de uma revista de pedagogia
francesa: mudar a escola para mudar a sociedade, mudar a sociedade para mudar a escola.
A educação, tal como foi vista pelos grandes pedagogos do século XX, traduz-se mais por valores do que
por uma missão (cf., em França, os «Hussards noirs de la République»). Enquanto prática social, a
educação é uma intervenção (daí o interesse, mais tarde, de muitos educadores e sobretudo de muitos
teóricos da educação pela investigação-acção).
Pode questionar-se a validade do conceito de deontologia na educação, na medida em que a docência
vai para além de uma simples «profissão» (embora tenha pro-fiteo), e ainda mais porque a educação
não é um ofício, ao contrário da insistência actual sobre a funcionalidade («ofício de aluno», com
réplica da metáfora do «ofício de professor»).
Em contrapartida, a ética está sempre presente, não só no sentido de referências sociais a que
chamados valores.
Embora não traga para este debate essas noções, nos termos flutuantes na história da filosofia da
distinção entre ética e moral, a dimensão educativa obriga a introduzir na práxis do educador uma
relação entre ética e política, nem que seja para as separar como o faz Espinosa, ao contrário de
Platão, que as hierarquiza.
Que especificidade ao nível do Ensino Superior?
Amnésia:
esquecemo-nos das Universidades da Idade Média, que dominavam de forma organizada todos os
saberes, assim como revelavam a necessidade de adquirir conhecimentos e métodos específicos de cada
universidade na Europa.
«Hybris»:
não tanto no sentido de excessos como de desmedida, ou seja, ausência de regulamentação. Na
universidade actual, não há nenhum mediador.
A pretexto da liberdade (cf. George Lapassade «Nós, professores universitários, somos pagos para ser
livres»), a Universidade tem todos os poderes.
Sobre os alunos:
O professor define o programa, escolhe os assuntos, corrige os trabalhos.
Também sobre os valores:
Esta liberdade, sem mediação, deixa toda margem a Maquiavel contra Jean-Jacques Rousseau (o
Contrato Social).
Mas é Maquiavel em pequena escala que tomou o poder, numa deriva da democracia. A democracia
grega era o poder do número e do discurso persuasivo (e era por isso que Platão a detestava, tal como
ela era na visão pelos sofistas, onde tudo se apoiava aliás na grande maioria de excluídos da dita
democracia). A democracia das Luzes, tal com a define Condorcet (incluída na forma extrema de
Robespierre e Saint-Just), acrescenta-lhe a Virtude.

56
A implosão institucional:
Assim temos, e muito mais na universidade do que nos outros sectores da instituição educativa, a
prosperidade dos vícios.
Paradoxo: há uma secundarização do funcionamento interno (o controlo administrativo infindável
perturba a lógica universitária de um trabalho que só se baseia no controlo e na quantificação)
Mas a falta de avaliação e de mediação permite, externamente, todos os abusos de uma democracia
degenerada e pervertida.
Ultrapassada a Idade Média, a universidade, que parecia ter, pela crítica ao poder absoluto dos
«mandarins» tradicionais, perdeu o pé na transição para o Iluminismo e hoje funciona como um
despotismo não iluminado, ao sabor de interesses pessoais, que podem gerar, ao longo de mudanças de
atmosfera, inversões de alianças, de onde a ética é banida ou é mesmo um tabu.
Résumé
Une illusion pédagogique a dominé la quasi-totalité du XXe siècle, résumée dans la devise d’une revue
pédagogique française : changer l’école pour changer la société, changer la société pour changer
l’école.
L’éducation, telle qu’on la voit chez les grands pédagogues du XX, c’est des valeurs plus une mission (cf
en France, les « Hussards noirs de la République »). En tant que pratique sociale, l’éducation est une
intervention (d’où l’intérêt, plus tard, de nombreux éducateurs et surtout théoriciens de l’éducation
pour la Recherche-action).
On peut s’interroger sur la validité de la notion de déontologie dans l’éducation, dans la mesure où le
métier d’enseignant déborde de beaucoup une simple « profession » (même si on y met pro-fiteo), et
encore plus où l’éducation n’est pas un métier, au contraire d’une insistance actuelle sur la
fonctionnalité (« métier » d’élève, en métaphore de « métier d’enseignant »).
En revanche, l’éthique est bien présente, et pas seulement au sens des références sociales qu’on
appelle valeurs.
Sans revenir ici sur le débat, aux termes fluctuants dans l’histoire de la philosophie, entre éthique et
morale, la dimension éducative oblige à introduire dans la praxis de l’éducateur une articulation entre
éthique et politique, fût-ce pour les séparer comme le fait Spinoza, au contraire de Platon qui les
hiérarchise.
Quelle spécificité au niveau du Supérieur ?
L’amnésie :
on a oublié les Universités du Moyen-âge, avec à la fois la maîtrise organisée de tous les savoirs
(Aristote, mais aussi la Renaissance), ainsi que la nécessité d’acquérir les connaissances et démarches
spécifiques de chaque université en Europe.
L’hubris :
non pas tant au sens d’excès que de dé-mesure, i.e. absence de régulation. Dans l’université actuelle, il
n’y a aucun médiateur.
Sous prétexte de liberté (cf. Georges Lapassade : « nous autres, professeurs d’université, sommes payés
pour être libres »), l’universitaire a tous les pouvoirs.
Sur les étudiants :
L’enseignant fixe son programme, il choisit les sujets, il corrige les copies.

57
Sur les valeurs aussi :
Cette liberté sans médiation laisse toute latitude à Machiavel contre Jean-Jacques Rousseau (le contrat
social).
Mais ce sont les Machiavel au petit pied qui ont pris le pouvoir, dans une dérive de la démocratie. La
démocratie grecque, c’était le pouvoir du nombre et de la parole convaincante (et c’est pourquoi
Platon la détestait sous l’espèce des sophistes ; le tout appuyé d’ailleurs sur une énorme majorité
d’exclus de ladite démocratie). La démocratie des Lumières, au contraire, telle que la définit Condorcet
(y compris sous sa forme extrême de Robespierre et Saint-Just), y ajoute la Vertu.
L’implosion institutionnelle :
Ainsi s’étalent aujourd’hui sous nos yeux, et beaucoup plus dans l’université que dans les autres
secteurs de l’institution éducative, les prospérités du vice.
Paradoxe : une secondarisation du fonctionnement à l’interne (les contrôles administratifs incessants
perturbent la logique universitaire d’un travail qui ne repose pas que sur le contrôle et la
quantification).
Mais une absence d’évaluation et de médiation qui permettent, à l’externe, tous les abus d’une
démocratie dégénérée et dévoyée.
L’université, qui semblait avoir, par une critique du pouvoir absolu des « mandarins » traditionnels,
dépassé le Moyen-âge, a raté le passage aux Lumières et fonctionne aujourd’hui comme un despotisme
non éclairé, mais simplement mené par les intérêts personnels, qui peuvent générer au fil des
changements d’atmosphère des renversements d’alliance d’où l’éthique est bannie, voire taboue.
Une illusion pédagogique a dominé la quasi-totalité du XXème siècle, résumée dans la devise d’une
revue pédagogique française (Les cahiers pédagogiques): « changer l’école pour changer la société,
changer la société pour changer l’école ».
L’éducation, telle qu’on peut la voir décrite chez les grands pédagogues du XXème siècle, consiste à
articuler des valeurs avec une mission (en France, on pense aux instituteurs de la IIIème République,
qu’on appelait les « Hussards noirs de la République »). Puis on s’est aperçu que, en tant que pratique
sociale, l’éducation est une intervention, comme peut en décerner les prémices chez Freinet et ensuite,
plus explicitement, dans la Pédagogie institutionnelle (d’où l’intérêt, plus tard, de nombreux
éducateurs et surtout théoriciens de l’éducation pour la Recherche-action).
On peut s’interroger sur la validité de la notion de déontologie dans l’éducation, dans la mesure où le
métier d’enseignant déborde de beaucoup une simple « profession » (même si on y met pro-fiteo), et
encore plus si on ne réduit pas l’éducation à un métier, au contraire d’une insistance actuelle sur la
fonctionnalité (« métier » d’élève, en métaphore de « métier d’enseignant ». On parle même
aujourd’hui de « métier de parent » !).
En revanche, l’éthique est bien présente, et pas seulement au sens des références sociales qu’on
appelle valeurs.
Je ne m’attarderai pas longuement sur la distinction, aux termes fluctuants dans l’histoire de la
philosophie, entre éthique et morale. Retenons seulement ici que l’éthique concernant l’être en tant
qu’être, alors que la morale s’attache à des valeurs universelles, on ne s’étonnera pas que les
éducateurs exhibent souvent une sorte de tropisme moralisateur, référé ou non à une transcendance.
Un clivage plus fécond se fera jour si on compare le sens de la focalisation sur l’individu ou sur

58
l’institution. L’être en tant qu’être questionné par l’éthique n’envisagera pas, dans le champ de
l’éducation, la dimension des valeurs universelles telles que la pose la morale.
La dimension éducative oblige à introduire dans la praxis de l’éducateur une articulation entre éthique
et politique, fût-ce pour les séparer comme le fait Spinoza, au contraire de Platon qui les hiérarchise.
On pourrait objecter à bon droit que les présentes considérations, à supposer du moins qu’on les
partage, s’appliquent à l’ensemble du système éducatif. Existe-t-il une spécificité de l’enseignement
supérieur, et si oui, quelle est-elle ? C’est ainsi la validité de ce thème, dans la cadre du colloque, qui
se trouve interrogée.
Si légitimité il y a, celle-ci ne peut pas s’étayer sur une fallacieuse hiérarchie, laissant supposer que le
niveau de l’enseignant est proportionnel à l’ancienneté des élèves. Même si cet implicite existe, de fait,
sous toutes les latitudes, fondée sur une conception réductrice de l’éducation à la complexité des
savoirs acquis (tout en se doublant, dans un grand paradoxe, d’un discours généralisé sur la
prééminence des compétences sur les connaissances !).
Par ailleurs, l’invasion récente de la professionnalisation dans l’appréciation sur la valeur des
universités tend à faire disparaître tout spécificité de l’université, en tout cas en France, dans un fatras
où sont mélangées universités, Grandes écoles de tous genres, classes prépas à n’importe quoi, voire
BTS et DUT (diplômes sans doute d’autant plus recherchés sans doute que, stricto sensu, ils n’existent
plus, puisque la normalisation européenne pose la licence à Bac + 3, alors qu’il s’agit là de diplômes à
bac + 2 !). Tout ce grand mélange a au moins en commun de faire disparaître la spécificité de
l’université, dans sa mission originelle, non réductible à un lycée prolongé de quelques années d’études
en plus.
C’est donc du côtés de l’histoire qu’il faut se retourner pour comprendre quelque chose et distinguer
des éléments particuliers, constitutifs de l’université, et justifiant par la même occasion le présent
thème de réflexion !
L’amnésie :
La pratique actuelle des Universités (normalisation, concurrence, chiffrage des sorties
professionnalisantes, jusqu’au ridicule classement de Shanghai) repose sur le fait qu’on a oublié la
logique des Universités du Moyen-âge, avec à la fois la maîtrise organisée de tous les savoirs (Aristote,
mais aussi la Renaissance), ainsi que la nécessité d’acquérir les connaissances et démarches spécifiques
de chaque université en Europe. Dès la fin du XIème siècle (Université de Bologne, fondée en 1088),
l’université se pose comme « Alma Mater studiorum ». Puis ce sont Paris, Oxford, Salamanque, Padoue,
Coimbra etc.
En 1158, l'empereur Frédéric Barberousse promulgue la Constitutio Habita par laquelle l'université
devient un lieu où la recherche se développe indépendamment de tout autre pouvoir, qu’il soit politique
ou religieux.
Tout cela semble bien loin aujourd’hui, et il a fallu le succès médiatique du Nom de la rose pour faire
revenir le questionnement sur la dimension universelle du savoir (thématique fructueuse des
controverses, à partir de la théologie comme science racine), mais aussi sur l’aspect institutionnel que
pose la prééminence de l’église catholique.
Reste que l’imposition de la norme produit, on le sait, solidairement de la déviance. Et de la dialectique
entre norme et déviance découlent l’apparition des nouvelles connaissances, même si ces ruptures

59
épistémologiques ont pu entraîner quelques ennuis pour des Galilée, Giordano Bruno, sans parler de
Miguel Servet.
La notion d’indépendance du savoir envers le pouvoir repose sur le postulat que l’épistémophilie est au
cœur de l’humain. « L’homme a naturellement la passion de connaître », selon la formule qui débute la
Métaphysique d’Aristote. Cette indépendance ne se justifie que par une confiance dans une sorte de
vertu interne de la démarche de connaissance.
Mais l’université médiévale intègre en premier lieu la valeur de l’institution. C’est parce qu’ils ont
conscience de faire partie d’un même corps que les docteurs du Moyen-âge ont pu défendre à travers
les siècles la légitimité de leur indépendance. On pourrait donc soutenir que l’université classique ne
croise pas la sphère de l’éthique, en tant que celle-ci suppose la dimension individuelle, sans nul besoin
d’une contrepartie collective, telle que la fournit l’institution.
En revanche, la déontologie est au cœur de la pratique universitaire. Elle est une manière de garantie
de la crédibilité de la transmission du savoir, tout autant que de sa production elle-même.
La situation actuelle est très loin de ce tableau historique.
L’hubris :
Comment expliquer cette corruption (au sens chimique du terme) de l’université ?
On peut faire plusieurs hypothèses. J’en distinguerai ici trois, d’ordre différent :
La première explication est d’ordre économique.
La fonction actuelle de l’université, telle que prônée par les pouvoirs, mais aussi recherchée par ses
utilisateurs, devenus aujourd’hui des consommateurs de savoirs directement utilitaires (i.e. injectables
dans un emploi) est précisément des mettre les étudiants sur le marché du travail. Utilitarisme et
rentabilité sont désormais les deux mamelles de l’université. Il s’agit là d’un gauchissement
considérable et très dangereux. Car la fonction de l’université n’est pas, historiquement, d’assurer un
emploi aux étudiants, mais bien de produire et de transmettre les savoirs les plus avancés et les plus
vastes. D’où le nom « Universitas studiorum », qui demeure aujourd’hui en italien : « Università degli
studi ».
La seconde explication est d’ordre social.
On assiste à une perte du sens de l’institution. Certes l’évocation d’un esprit de corps vous a un faux air
de nostalgie médiévale, mais on peut aussi l’envisager comme construction d’une identité collective qui
permet à tout membre de la communauté universitaire de savoir sur quoi reposent les confluences
nécessaires, qui permettent ensuite d’assurer aux débats et aux controverses un terreau culturel
commun.
L’élément de base de la déontologie universitaire est le respect de l’autre, à quoi renvoie le propre
respect que je puis avoir de moi-même.
Et la perte du sentiment d’appartenance est propice à toutes les dérives. Faute d’une dialectique
permanente entre individu et institution, le retour à la loi du plus fort n’est jamais définitivement
conjuré.
Et la troisième explication est d’ordre politique.
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%