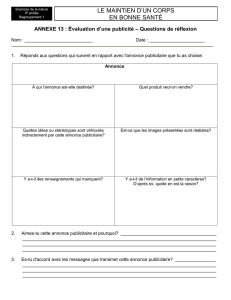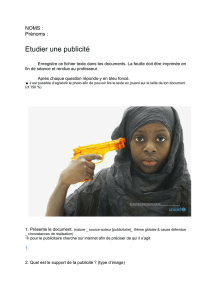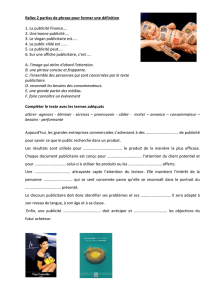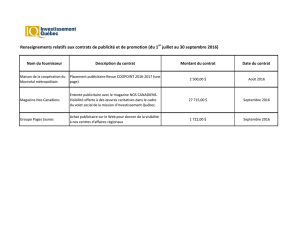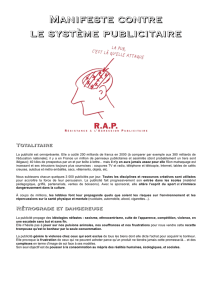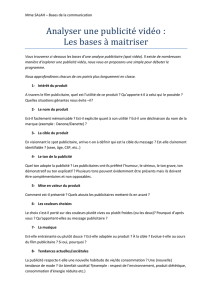Le discours répété – matrice pour le discours publicitaire

STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI, PHILOLOGIA, LII, 4, 2007
LE DISCOURS REPETE – MATRICE POUR LE DISCOURS
PUBLICITAIRE FRANÇAIS
MONICA FRUNZĂ
*
ABSTRACT. The paper treats of the role of the Utterances specific to the
«Repeated Discourse» in French Advertising Communication. The use of modified
RDU in this type of discourse (analyzed according to Quintillion’s formula
quadripartita ratio), draws the attention of the receiver to the message, aiming to
influence him and, finally, to transform him in a consumer.
Préliminaires
Afin de réaliser la présente étude, nous avons décidé de porter notre
attention sur la publicité française écrite. Parmi les moyens de communication de
masse, nous nous sommes donc limitée (d’une part, pour la commodité de la
manipulation et, d’autre part, à cause du haut degré de représentativité offert par ce
type de corpus) aux annonces parues sur le support presse-magazine. Voulant
identifier les énoncés appartenant au discours répété et leur fonctionnement dans le
discours publicitaire, nous avons puisé notre corpus dans un éventail assez large de
revues françaises, parues les dix dernières années, que nous estimons représentatives
aussi bien du point de vue du nombre de publicités véhiculées que du nombre de
cibles atteintes: Géo, Biba, Prima, Femme actuelle, Jeune et jolie, Auto-Moto,
Modes et Travaux, Elle, Elle-Décoration, Maison française, Cosmopolitan, Marie-
Claire, Paris-Match, Le Point, Le Nouvel Observateur, Art-Décoration.
En analysant le corpus publicitaire choisi, nous y avons remarqué la
présence fréquente des énoncés appartenant à ce que Coşeriu appelle discours
répété
1
: locutions figées, titres d’oeuvres littéraires ou artistiques, maximes ou
proverbes, «propos célèbres» ou bien citations proprement dites «d’auteur», etc.,
préservés dans leur forme «canonique» ou bien légèrement modifiés. Les modifications
que nous avons identifiées visent des intentions stylistiques afin de faciliter le
contact avec le destinataire par le biais d’une expérience linguistique commune.
*
Université «Al. I. Cuză» de Iaşi
1
Selon Coşeriu, dans le langage primaire (celui qui organise la réalité linguistique) il faut distinguer
entre la technique libre du discours et le discours répété «qui est beaucoup plus vaste que ne l’on
pourrait croire en général ; la parole ressemble à une sorte de peintures à collage simultané, à
savoir, elle est partiellement technique actuelle et partiellement des morceaux de parole déjà
existants et portés, pour ainsi dire, par la tradition, dans toutes ces expressions, locutions figées,
dans les proverbes, les citations, etc» [c’est notre traduction – M. F.] (Coşeriu, 1994: 55).
Provided by Diacronia.ro for IP 88.99.165.207 (2017-06-04 04:06:10 UTC)
BDD-A15406 © 2007 Editura Presa Universitară Clujeană

MONICA FRUNZĂ
186
Toujours est-il que, au terme de notre analyse, nous nous rendrons compte
que, dans le discours publicitaire, la fonction phatique
2
du langage ne traduit qu’une
étape d’un parcours plus complexe que nous qualifierons avec Stelian Dumistrăcel (cf.
Dumistrăcel, 2003) en tant que parcours séducteur et finalement manipulateur,
parcours qui exploite également les fonctions émotive et conative du langage. L’effort
de contacter le récepteur n’est donc jamais neutre, l’emploi des énoncés appartenant au
discours répété représentant aussi une modalité de l’influencer
3
.
En nous appuyant toujours sur le modèle élaboré par Stelian Dumistrăcel
pour le discours journalistique roumain, nous anticipons le fait que «du point de
vue strictement technique, l’énoncé appartenant au discours répété, auquel on
attribue le statut d’ «architexte», est actualisé en conformité avec l’une des «figures
de construction» résumées dans la formule de Quintilien quadripartita ratio, par
detractio, adiectio, immutatio et transmutatio. La mutation s’explique par la capacité
qu’ont ces «règles» de refléter les manifestations des universaux du langage»
(Dumistrăcel, op. cit.: 236).
2
Lors de la création du message, le rédacteur publicitaire peut privilégier l’un des six éléments
(identifiés par Jakobson) constituant la communication, à savoir l’émetteur, le récepteur, le
référent, le canal, le message ou le code. Six fonctions linguistiques correspondant à ce schéma
organisent la structure verbale du message:
1. La fonction expressive (émotionnelle, émotive) caractérise un message centré sur la
personnalité de l’émetteur, proposant les idées ou les sentiments de celui-ci. Elle «vise à une
expression directe de l’attitude du sujet à l’égard de ce dont il parle [et] tend à donner l’impression
d’une certaine émotion, vraie ou fausse» (Jakobson, 1978: 214).
2. La fonction conative (impérative) est centrée sur le destinataire et sera favorisée à travers un
message qui interpelle, invite, sollicite et motive celui-ci en le transformant en partenaire. Elle
«trouve son expression grammaticale la plus pure dans le vocatif et l’impératif qui, du point de vue
syntaxique, morphologique et souvent même phonologique, s’écarte des autres catégories
nominales et verbales» (idem, 216).
3. La fonction référentielle (appelée aussi cognitive, dénotative, représentationnelle), fonction
relative à ce dont on parle, sert à la «description du référent» (ibidem), en l’occurrence, l’objet du
discours publicitaire. La description ressemble à une simple information, sans commentaires ni
suggestions.
4. La fonction phatique, liée au canal, est centrée sur le désir d’ «établir, prolonger ou interrompre
la communication, à vérifier si le circuit fonctionne […], à attirer l’attention de l’interlocuteur ou à
s’assurer qu’elle ne se relâche pas» (idem, 217). Elle servira donc à établir et à maintenir le contact
avec le récepteur et peut être considérée comme la fonction de socialisation ; elle établit, vérifie,
renforce le canal de communication. Ici le contact l’emporte sur l’information.
5. La fonction poétique (impressive, esthétique) est centrée sur l’ «accent mis sur le message pour
son propre compte» (idem, 218). Elle mettra donc en valeur le message par le choix des sonorités,
assonances, doubles sens et aussi par l’emploi d’images symboliques et allégoriques.
6. La fonction métalinguistique est centrée sur le code, sur la référence du discours à soi-même
(ibidem). Quant au discours publicitaire, l’émetteur définira, expliquera, clarifiera, démontrera.
3
Selon Charaudeau (1997: 96), cette influence est possible grâce à un mouvement naturel (individuel
ou collectif) d’adhésion à des idées reçues, à «des jugements stéréotypés qui apparaissent sous
forme d’énoncés plus ou moins figés (proverbes, dictons, maximes, mais aussi tournures
idiomatiques, phraséologie ritualisée) qui circulent dans les groupes sociaux» et que l’auteur
regroupe sous le nom générique de croyance.
Provided by Diacronia.ro for IP 88.99.165.207 (2017-06-04 04:06:10 UTC)
BDD-A15406 © 2007 Editura Presa Universitară Clujeană

LE DISCOURS REPETE – MATRICE POUR LE DISCOURS PUBLICITAIRE FRANÇAIS
187
Nous avons choisi d’analyser le discours publicitaire dans la perspective de
la formule de Quintilien pour plusieurs raisons: tout d’abord, il s’agit d’une théorie
qui semble avoir gardé son actualité et son efficacité à travers le temps, chose
remarquée d’ailleurs par un groupe de poéticiens belges (J. Dubois, F. Edeline, J.
M. Klinkenberg, P. Minguet, F. Pire et H. Trinon - connus sous le nom du «Groupe
µ») qui en ont fait une application remarquable dans leur fameux ouvrage
Rhétorique générale, paru en 1970.
Par ailleurs, à ce qu’on sache, le cadre fourni par la théorie de Quintilien
n’a pas encore été utilisé pour l’analyse du discours publicitaire français. Mais, le
fait que cette formule, enrichie par le «Groupe µ» par une meilleure systématisation
et par une différentiation plus subtile (cf. Plett, 1983: 159), a montré son efficacité
dans l’analyse du discours journalistique (Dumistrăcel, 2003), nous a encouragé à
en faire l’application sur des énoncés publicitaires, d’autant plus que discours
journalistique et discours publicitaire sont deux représentations du discours
médiatique, ayant en commun au moins le même canal de communication.
1. Le modèle de Quintilien
Nous comprendrons mieux le modèle rhétorique de Quintilien si on
observe les énoncés publicitaires suivants:
A. 1. Tout connaître c’est bien / Tout comprendre c’est
mieux (RTL).
2. Le déjeuner sur l’herbe est réussi (BORDEAUX).
B. A la Fnac, vous auriez trouvé un ordinateur performant
sans y laisser votre chemise (FNAC).
C. Dans l’Espace-Réunion sur micro-ordinateur, deux souris
peuvent accoucher d’une montagne (FRANCE TELECOM).
D. 1. Je suis dans tous mes Etam (ETAM).
2. Lait, calme et volupté (GUIGOZ)
Tous les exemples susmentionnés représentent des variantes légèrement
modifiées de quelques expressions figées, proverbes, titres d’oeuvres artistiques ou
citations «d’auteur».
4
Le type de modification opéré renvoie de façon évidente aux
«figures de construction» de Quintilien. Chez lui, les figures de mots tout comme
les tropes
5
représente un écart par rapport à l’expression simple et directe afin
d’embellir le style. Le concept de «figure» porte sur un enchaînement de mots qui
4
Néanmoins, «ces titres, proverbes […] etc. peuvent [...] être vus comme des formules figées,
puisque toute manipulation ou altération nous choque» (Grunig, 1990: 118).
5
De nos jours, Olivier Reboul définit les figures comme des procédés stylistiques destinés à faire
passer le message de façon éloquente et persuasive. Il distingue les figures de mots (portant sur la
forme ou le son: la rime, l’allitération, les calembours, les jeux de mots), les figures de sens
(tropes), les figures de construction (l’inversion) et les figures de pensée (l’allégorie, l’ironie)
(1991: 35-37). «Les figures de sens, ou tropes, consistent donc à employer un terme avec une
signification qu’il n’a pas habituellement, [...]» (Reboul, 1991: 42). La plupart des critiques
distinguent trois tropes fondamentaux, la métaphore, la métonymie et la synecdoque.
Provided by Diacronia.ro for IP 88.99.165.207 (2017-06-04 04:06:10 UTC)
BDD-A15406 © 2007 Editura Presa Universitară Clujeană

MONICA FRUNZĂ
188
diffèrent de la manière d’expression ordinaire. La modification ou mutatio
représente le point de départ d’un système rhétorique dont la base forme une
quadripartita ratio justifiant des structures persuasives par les critères suivants:
- le critère de l’adjonction (adiectio) comme dans A 1, 2;
- le critère de la suppression (detractio) comme dans B;
- le critère de la permutation (transmutatio) comme dans C;
- le critère de la substitution (immutatio) comme dans D 1, 2.
Pour mieux mettre en évidence les modifications effectuées dans les
exemples choisis, nous les avons mises en évidence par des caractères gras.
L’effet persuasif ressort, d’une part, du caractère familier, rassurant parfois
ou même prestigieux des énoncés appartenant au discours répété (EDR) – ce sont
des énoncés qui, de par leur longue vie, sont solidement enracinés dans la mémoire
des récepteurs (cf. Grunig, 1990: 121) – et, par ailleurs, de la surprise que les
transformations opérées engendrent.
2. Le Groupe µ
Le modèle rhétorique du «Groupe µ» part du schéma des classes stylistiques
de Quintilien en les rebaptisant selon une terminologie propre: adjonction (adiectio),
suppression (detractio), permutation (transmutatio) et suppression-adjonction
(immutatio). Le concept fondamental de ce modèle est représenté par l’écart
linguistique qui se définit par rapport à un degré rhétorique zéro
6
. Selon eux, le degré
zéro n’est donc pas contenu dans le langage tel qu’il nous est donné: c’est une
construction de métalangage. La décomposition du signifié fait apparaître des entités
irréductibles, les sèmes. Ce dernier état de décomposition est infralinguistique,
l’analyse se déplaçant au plan sémique. Cette démarche, métalinguistique, leur a
permis de distinguer dans le discours figuré deux parties: la première appelée «base»
par opposition à une seconde qui subit des écarts rhétoriques. Alors que la base possède
la structure du syntagme, les invariants ont la structure constitutive d’un paradigme.
Les auteurs de la Rhétorique générale ont aussi adopté l’idée de la
hiérarchie des niveaux de Emile Benveniste, ce qui leur permet de considérer
toutes les figures, quel que soit le niveau de la langue, comme des «collections
d’éléments prélevés sur des répertoires préexistants». Du fait que leur théorie
repose sur les concepts opératoires (les opérations de la formule quadripartita
ratio) de Quintilien, le travail sur des collections: phonèmes, graphèmes, mots et
phrases s’impose particulièrement.
6
Plusieurs définitions sont données par les auteurs de la Rhétorique générale au concept de degré
zéro: 1. «une définition intuitive: c’est un discours «naïf» et dépourvu d’artifices, de sous-
entendus, c’est ce discours-là pour lequel «un chat est un chat»» ; 2. «Le degré zéro absolu serait
alors un discours réduit à ses sèmes essentiels [...], à savoir aux sèmes que l’on ne peut pas
supprimer sans annuler d’emblée l’entière signification du discours ; 3. «On conviendra d’appeler
degré zéro pratique les énoncés qui contiennent tous les sèmes essentiels, plus un nombre de sèmes
latéraux réduits au minimum en fonction des possibilités du vocabulaire» (Groupe µ, 1974: 44-45).
Provided by Diacronia.ro for IP 88.99.165.207 (2017-06-04 04:06:10 UTC)
BDD-A15406 © 2007 Editura Presa Universitară Clujeană

LE DISCOURS REPETE – MATRICE POUR LE DISCOURS PUBLICITAIRE FRANÇAIS
189
Les quatre collections sont ainsi désignées comme il suit: les métaplasmes sont
des figures qui agissent sur l’aspect sonore ou graphique des mots et des unités plus
petites; les métataxes représentent des figures qui agissent sur la structure de la phrase
définie, elle aussi, comme collection de syntagmes et de morphèmes, pourvue d’un
ordre et admettant la répétition; les métasémèmes sont des figures dans lesquelles un
sémème remplace un autre en modifiant la collection des sèmes nucléaires; les
métalogismes sont des figures qui modifient la valeur logique de la phrase.
Les auteurs de la Rhétorique générale appellent les transformations
métaboles, lesquelles se divisent en deux grands groupes selon qu’elles altèrent les
unités elles-mêmes ou bien leur position; elles sont donc ou substantielles ou
relationnelles. Leur idée est que ces transformations se ramènent à des adjonctions
et à des suppressions, c’est-à-dire à une augmentation ou à une diminution de
l’information. La nouvelle rhétorique fonde donc les espèces de classification sur la
forme des opérations qui se font à tous les niveaux d’articulation du langage.
Voyons maintenant comment ces transformations sont exploitées dans le
discours publicitaire.
3. EDR et créativité
Une source précieuse de créativité dans le discours publicitaire est
représentée par l’emploi ou le réemploi des énoncés appartenant au discours
répété, énoncés connus également sous le nom de phraséologismes, expressions
idiomatiques ou formules figées. Bally (cité par Bender-Berland, 2000: 176) les
appelle unités phraséologiques, les définissant comme il suit: «on dit qu’un groupe
forme une unité lorsque les mots qui le composent perdent toute signification et
que l’ensemble seul en a une; il faut en outre que cette signification soit nouvelle et
n’équivaille pas simplement à la somme des significations des éléments». Notre
emploi du terme formule figée est générique et réunit à l’instar de Grunig (1990:
118) plusieurs types d’expressions: proverbes, dictons, adages, maximes, sentences
historiques, titres, bribes de chansons, stéréotypes littéraires, formules religieuses,
etc. En ce qui concerne le terme «figée», cette notion décrit, d’une part, le fait
qu’une expression est un arrangement de mots fixé par la tradition et formant une
unité lexicale, et d’autre part, le fait qu’elle est mémorisée par les locuteurs d’une
langue. Le sens global de la formule est, comme le souligne Bally, différent des
sens de chacun des mots qui la composent. Elle est figée «cognitivement» plutôt
que syntaxiquement. Cela veut dire que les locuteurs savent que les mots
apparaissent ensemble dans telle ou telle construction et que l’utilisation de
l’expression en question est conventionnelle et partagée par la plupart d’entre eux.
Cette unité est un préconstruit, qui renvoie à une construction antérieure extérieure,
appartenant au discours répété (voir la note no. 32), par opposition à ce qui est
construit par l’énoncé, au sein de la technique libre du discours.
Provided by Diacronia.ro for IP 88.99.165.207 (2017-06-04 04:06:10 UTC)
BDD-A15406 © 2007 Editura Presa Universitară Clujeană
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
1
/
15
100%