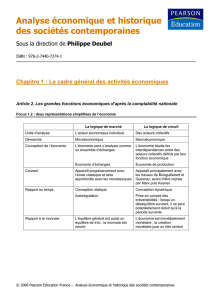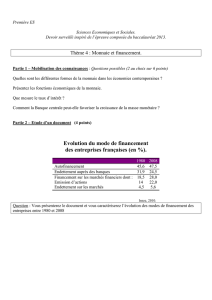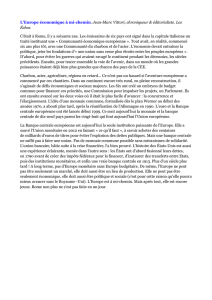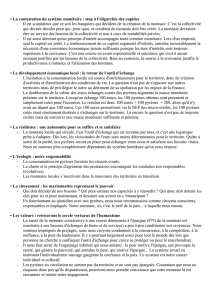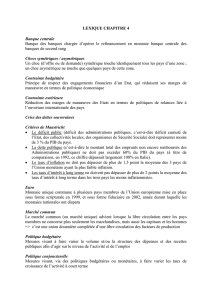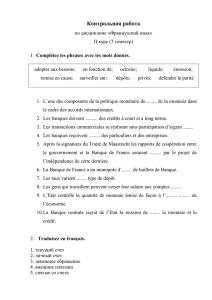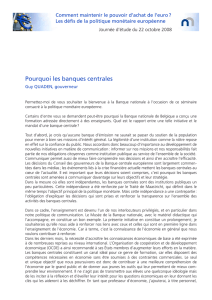La réforme monétaire - Bloc

« Tant que nous aurons un système sous lequel les moyens d'échange en
circulation sont des sous-produits de la dette privée, nous devrons souvent passer
par des moments difficiles. Le moment même où personne ne veut s'endetter est
celui où nous avons le plus besoin d'argent et donc où nous espérons le plus que
quelqu'un nous viendra en aide en s'endettant. Peu le feront, en dépit des
exhortations et incitations officielles et malgré de faibles taux d'intérêt. » [Irving
Fisher : 100% Money
1
, p. 70]
La crise générale du capitalisme néolibéral réactive les débats sur les institutions et la
politique macroéconomiques. De nombreux auteurs avaient anticipé l’impasse actuelle,
keynésiens inquiets de l’abandon des instruments de politiques économique ou
monétaristes conscients de la prolifération des bulles spéculatives. Ils se rejoignent dans une
commune consternation devant des politiques menées au jour le jour et qui se résument à
un acharnement thérapeutique pour ranimer des bulles moribondes. En ce mois d’août
2011, et sans préjuger des inévitables événements des semaines à venir, nous assistons ainsi
à de fantasmatiques projets d’euro-obligations censées prémunir les pays européens,
victimes d’une défiance générale quant à leur dette publique, du blocage ou du coût
prohibitif de leurs déficits à venir. Si un tel projet donnait lieu à une politique effective, son
effet ne saurait être que de « tirer » davantage l’endettement des pays en difficulté en
nourrissant la défiance vis-à-vis des finances des États en gagés dans les « euro-obligations »,
ou tout autre système de « garantie » de la dette des autres. La résorption des
« déséquilibres » est confiée à des plans d’ajustement structurels dont chacun convient des
conséquences déflationnistes. Les fléaux jumeaux du surendettement et de la déflation sont
tour à tour présentés comme des remèdes par des politiciens sans boussole et des
« décideurs économiques » rongés par l’addiction financière.
Les monétaristes comme les keynésiens
2
s’accorderont à diagnostiquer la source du mal
dans ces politiques qui ne reportent les conséquences qu’en aggravant les causes.
En revanche, les monétaristes attribueront cette prolifération des dettes au système
monétaire, et en particulier au crédit bancaire ex nihilo. Les keynésiens analyseront ce
dérèglement financier comme une circonstance aggravante de défaillances plus générales du
circuit productif. Pourquoi les dettes peuvent-elles s’accumuler au-delà de toute possibilité
de remboursement, poseront les monétaristes. Pourquoi ont-elles été impuissantes à
ranimer la croissance économique qui les auraient rendu supportables, se demanderont les
keynésiens.
1
Ouvrage traduit et mis en ligne par Nathanael Faibis, qui mérite amplement la gratitude et l’aide
financière du public pour son travail bénévole. Cette situation en dit long sur l’ostracisme que subissent les
idées novatrices en économie. Irving Fisher est cité avec admiration dans la plupart des ouvrages académiques
pour sa formalisation des idées monétaristes mais ignoré pour ses analyses novatrices de la déflation et de la
réforme du système financier.
2
On nous excusera de cet usage approximatif de ces désignations. Nous n’avons pas vocation à définir ici
le « vrai » monétarisme ni le « vrai » keynésianisme ; la caricature des positions est ici assumée pour
caractériser les « pôles » de la discussion.

Concernant la présente déclinaison européenne de la crise, les premiers privilégieront la
voie d’une réforme monétaire radicale ôtant aux banques la capacité de créer la monnaie ex
nihilo et interdisant la prolifération de moyens de paiements mobilisés dans la spéculation
et/ou l’inflation – approche synthétisée par Irving Fisher en 1935 sous le nom de « 100%
Money »
3
(nous parlerons généralement ici de « système de couverture intégrale », par
opposition à la couverture fractionnaire du système de monnaie bancaire que nous
connaissons).
Les keynésiens s’attacheront aux moyens de proportionner les flux monétaires aux
besoins du plein emploi et surtout de les drainer vers la production et l’emploi. Les deux
approches se rejoignent dans un certain « souverainisme » économique dans la mesure où
les réformes supposent une réorganisation des institutions économiques nationales que
seule un État souverain pourrait imposer
4
.
Leurs préconisations ne sont d’ailleurs pas totalement incompatibles, la réforme
monétaire serait alors conçue comme un élément d’une réforme plus globale facilitant le
pilotage macroéconomique.
C’est cette dernière perspective que nous développerons ci-après. Il serait dommage
que les présupposés monétaristes de la plupart des partisans du 100% Money
5
discréditent
cette perspective. L’anarchie monétaire est au cœur des difficultés de nos économies, mais
elle ne saurait être séparée de la dynamique instable des économies capitalistes. L’objet de
cet article est de cadrer le débat sur la couverture intégrale dans le cadre plus général d’une
discussion sur la régulation des économies capitalistes.
Table des matières
I. LA JUSTIFICATION DU 100% MONEY
La monnaie n’est pas un objet, mais un rapport social [A],
la construction de la confiance la multiplie selon le principe du
levier et sa mise en cause la détruit [B] ;
le système bancaire actuel repose sur lui-même sur la
multiplication instable d’une base monétaire ce qui justifie sa
réforme pour un contrôle public de la création monétaire [C].
3
Irving FISHER: 100% money.
4
D’aucuns imaginent il est vrai que « l’Europe » pourrait se substituer sur ce plan comme dans d’autres
aux États-Nations existants, mais dans les circonstances présentes cet argument revient à ajourner sine die les
réformes. Pour cette raison, « l’Europe » est depuis une trentaine d’années au moins la ligne de défense des
partisans du statu-quo.
5
Fisher a formulé clairement la proposition du 100% Money en 1935 ; bien qu’ancien cet ouvrage reste
remarquable par sa pédagogie et la pensée nuancée de l’auteur. Voir aussi Maurice ALLAIS : La crise mondiale
aujourd’hui, et sur un plan plus théorique : Économie et Intérêt, 1998, éd. Clément Juglar ; Christian GOMEZ :
« Une « vieille » idée peut-elle sauver l’économie mondiale ? » ; André-Jacques HOLBECQ : « Qu’est-ce que la
proposition « 100% monnaie » ? »

II. LES MYSTÈRES DU CIRCUIT MONÉTAIRE
Si les politiques monétaires accompagnent passivement les
bulles spéculatives ; c’est moins faute d’instrument que de
volonté de les mettre en œuvre au risque de précipiter la
récession [A],
la spéculation détourne les flux monétaires, actionne le levier
pour son propre compte et déforme l’appareil productif *B+.
Plus généralement, c’est la vitesse de circulation de la
monnaie plutôt que sa « quantité » qui témoigne des bulles et
du surendettement [C].
III. MONNAIE ET PRODUCTION
Contrairement au postulat monétariste, l’adaptation de
l’appareil productif à des conditions mouvantes entraîne une
certaine inflation, variable selon les circonstances (A).
Aucun mécanisme de marché n’aboutit à la définition
automatique d’un taux d’investissement conforme aux
objectifs de la collectivité et au plein emploi [B]
ce qui nécessite une politique budgétaire active dont la
couverture intégrale faciliterait l’application *C+.
POUR CONCLURE : UNE REFORMULATION DU PRINCIPE DE
COUVERTURE INTÉGRALE
I. LA JUSTIFICATION DU 100% MONEY
La monnaie n’est pas un objet, mais un rapport social [A], la construction de la confiance
la multiplie selon le principe du levier et sa mise en cause la détruit [B] ; le système bancaire
actuel repose sur lui-même sur la multiplication instable d’une base monétaire ce qui justifie
sa réforme pour un contrôle public de la création monétaire [C].
A. La génération spontanée de la monnaie
Toute monnaie se substitue aux valeurs d’usage qu’elle a vocation à acquérir dans le
futur. Elle constitue donc par définition une créance, et réciproquement toute créance
acquiert virtuellement un caractère monétaire, puisque sa cession équivaut à un paiement,
soit qu’elle soit restitué au débiteur (remboursement) soit qu’elle soit remise à un tiers en
paiement d’autre chose. La condition de telles opération est la convention sociale selon

laquelle la créance « monétarisée » sera reconnue par tous les opérateurs de l’économie
considérée. La monnaie est donc un crédit sur la société, un moyen de collectiviser les dettes
privées. Pour les amateurs de robinsonnades, considérons que A obtienne de B le poisson de
son prochain repas, mais ne possède dans l’immédiat rien de ce que convoite B, par exemple
un filet. Ce dernier devrait alors attendre que A se soit procuré un filet pour éteindre
l’échange, à supposer que cette circonstance se produise bien un jour.
En revanche, B peut récupérer son apport beaucoup plus vite si la créance reçue de A est
acceptée d’un tiers, soit que celui-ci l’utilise pour s’approprier une valeur disponible chez A,
soit qu’il estime pouvoir la céder à son tour à un tiers. Si une convention permet à la créance
de circuler entre les membres du groupe, elle aura complètement acquis son caractère de
monnaie : dette sociale, équivalent général.
Or la compréhension de la monnaie est généralement obscurcie par la métonymie
spontanée qui prête à la substance des choses ce qui n’est qu’un effet de leur usage. La
monnaie, croient-ils, est telle parce qu’elle a de la valeur, alors qu’en vérité c’est son
caractère de monnaie (l’acceptation par les tiers) qui lui donne de la valeur. De bons auteurs
prétendent encore, dans un souci de vulgarisation sans doute, que la valeur de l’or serait
garantie par son coût de production et que c’est ce qui en ferait une monnaie « naturelle ».
Or, s’il se peut que le coût de production de l’or lui assure une certaine valeur dans certaines
circonstance et s’il est vrai que cette propriété ai pu le désigner à certaines époques comme
support de la monnaie, c’est bien dans les opérations de paiement que s’origine la monnaie
et non dans la disposition ou non d’or.
« Il y a toujours assez d'argent pour servir à la circulation et à l'échange réciproque des
autres valeurs, lorsque ces valeurs existent réellement [...]. La marchandise intermédiaire, qui
facilite tous les échanges (la monnaie) se remplace aisément dans ces cas-là par des moyens
connus des négociants », écrivait J.B. Say, en 1803
6
pour justifier l’idée que la « rareté » de la
monnaie était une piètre explication des difficultés économiques de son époque. Et en effet
banquiers, financiers, marchands multipliaient déjà les subterfuges pour multiplier les
moyens de paiement comme le requérait l’expansion des affaires.
L’histoire monétaire se confond avec celle de générations spontanées de monnaies ou
semi-monnaies stimulées par les besoins des États ou des affaires.
B. La redécouverte permanente du levier
Une monnaie est une croyance collective, et, comme toute croyance collective, elle
s’enracine dans un mythe fondateur ; ici, il s’agit du fantasme d’une « valeur » originelle qui
suppléerait le pouvoir d’achat de la monnaie si un défaut de confiance l’effaçait soudain.
Mais cette croyance est profondément intéressée tant par l’émetteur qui se crée un droit
sur la production que par les agents qui l’acceptent et convertissent ainsi leurs actifs en
pouvoir d’achat. Le levier nait de cette trouble connivence entre le « monnayeur » et les
6
Jean-Baptiste SAY : Traité d'économie politique, Calmann-Lévy 1972, p. 137.

autres agents économiques. La croyance est d’autant plus facile qu’elle arrange tout le
monde et qu’ « ouvrir » les yeux sur la vraie nature des moyens de paiement conduirait à la
ruine de tout le monde.
Suivons un instant l’édifiante genèse de notre système de création monétaire tel que le
relate JK Galbraith
7
:
« Le 2 mai 1716, *John Law+ reçut le droit d’ouvrir une banque, qui devint
finalement la Banque royale, au capital de six millions de livres. On l’autorisait ainsi
à émettre des billets, qui furent alors utilisés par la banque pour payer les dépenses
courantes de l’État et prendre en charge la dette publique. Ces billets, en principe
librement échangeables contre des pièces, furent bien accueillis. [...]
Le grand besoin, évidemment, c’était une source de revenus en pièces qui
apporterait de quoi soutenir l’émission des billets. On y pourvut, en théorie, par la
création de la Compagnie du Mississippi (ou Compagnie d’Occident) et plus tard,
avec des privilèges commerciaux encore plus grands, de la Compagnie des Indes
chargée d’exploiter les gisements aurifères dont on présumait l’existence dans le
vaste territoire nord-américain de Louisiane [...]. Des actions de la compagnie furent
proposées au public, et la réaction fut sensationnelle. [...]
Le produit de la vente des actions de la Compagnie du Mississippi n’alla pas
financer la recherche de l’or, que l’on n’avait toujours pas découvert, mais
rembourser les dettes de l’État. Les billets sortis pour payer ces dettes revinrent
pour acheter plus d’actions. On émit donc plus d’actions, afin de satisfaire une
plus forte part de la demande intense qui faisait grimper le cours, tant des
anciennes que des nouvelles émissions, à des altitudes toujours plus
extravagantes. [...] Le montant des pièces qui soutenaient ainsi les billets fut bientôt
minuscule par rapport au volume du papier. C’était le levier, sous une forme
particulièrement miraculeuse. »
« [Aux États-Unis], stimulés par la guerre de 1812 et la nécessité d’un très large
emprunt public pour la financer, les prix montèrent. Les banques d’État, libérées du
carcan de la convertibilité obligatoire, étaient maintenant agréées avec le plus
grand laxisme. Toute localité assez grande pour avoir « une église, une taverne ou
un maréchal ferrant méritait, jugeait on, qu’on y ouvrît une banque ». Ces
banques imprimaient des billets, et d’autres entreprises plus surprenantes en
firent autant à leur imitation. « Même les barbiers et les cafetiers firent
concurrence aux banques en ce domaine... » Les actifs qui garantissaient ces billets
étaient, faut-il le préciser ? minuscules et évanescents. Le coup du levier, une fois de
plus. »
7
John Kenneth GALBRAITH : Brève histoire de l’euphorie financière, Le Seuil 1990.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
1
/
26
100%