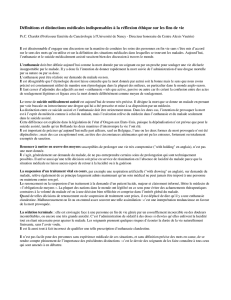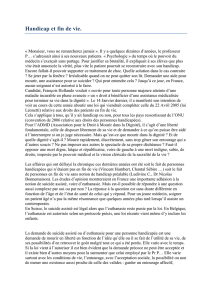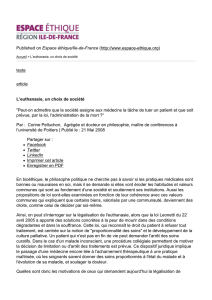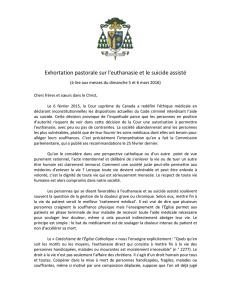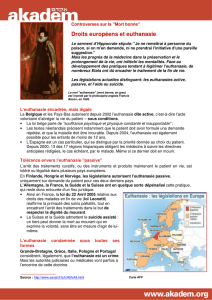La mort, un remède aux souffrances

La mort, un remède aux souffrances
CLOTILDE FREYD*
Le souhait de mettre volontairement un terme à ses jours peut être guidé par l’espoir
d’abréger ou d’éviter des souffrances, physiques et morales, ou l’agonie résultant d’une
affection grave et incurable ou d’un accident. La mort peut donc être envisagée comme un
but.
Il est alors possible que la participation d’un tiers soit rendue nécessaire. Tel est le cas
lorsque les capacités physiques d’une personne sont amoindries au point qu’elle ne soit plus
en mesure d’agir elle-même, comme l’était Vincent Humbert, ou encore lorsque la personne
souhaite, le cas échéant avant d’être véritablement plongée dans d’insupportables souffrances,
avoir les moyens d’agir préventivement ou, en tout cas, dans des conditions conformes à ses
convictions, ce que demandait Chantal Sébire.
À l’époque, ces deux cas, loin d’être isolés, ont relancé le débat sur l’euthanasie et le
suicide assisté. La première peut être définie, dans l’une de ses acceptions, comme le geste
délibéré d’un tiers provoquant directement la mort du malade. Le second s’en écarte, dans la
mesure où il s’agit d’aider le malade à se donner lui-même la mort1.
* Doctorante à l’Université de Strasbourg.
1 Étymologiquement, l’euthanasie est d’origine grecque et désigne la « bonne mort », la « mort douce » ou
encore la « façon heureuse de mourir » (« eu » : bon, doux voire paisible, et « thanatos » : une mort). Voir aussi
les travaux de F. Bacon, « Du progrès et de la promotion des savoirs » (1605), livre II, partie 3, Gallimard, 1991,
p. 150, trad. M. Le Doeuff.
Cette notion a aujourd'hui perdu son sens primitif et fait l’objet de différentes distinctions et définitions,
témoignant de la difficulté à appréhender les différentes pratiques entourant la fin de vie. Ainsi, on peut relever
une distinction classique entre euthanasie active et passive. La première peut être définie comme « l’action de
provoquer la mort des incurables pour faire cesser leurs souffrances ou leur agonie douloureuse en
administrant soit des analgésiques à doses létales, soit toute substance mortifère » et la seconde comme celle qui
« consiste à laisser mourir le malade de sa propre mort naturelle par abstention, suspension d’un traitement,
voire par un refus de réanimer ou de continuer de réanimer » (définitions reprises de B. Legros, « Sur
l’opportunité d’instituer une exception d’euthanasie en droit français », Médecine et Droit 2010, n° 100-101,
p. 26, spéc. note 3). Il est encore possible de trouver une distinction entre euthanasie directe et indirecte, cette
dernière visant à abréger la vie en soulageant la douleur. Toutefois, la distinction entre euthanasie active et
euthanasie passive est critiquée. M. Verspieren propose alors la définition suivante : « tout comportement suivi
d’effet dont l’objectif est de provoquer la mort d’une personne, pour lui éviter ainsi des souffrances »
(P. Verspieren, « L’euthanasie : une porte ouverte ? », Études janv. 1992, p. 63, cité notamment par
J.-B. Thierry, « La légistique de l’euthanasie », in La mort et le droit, B. Py (dir.), Presses universitaires de
Nancy, 2010, p. 321). Mais d’autres définitions ont pu être proposées, telles que « la mort procurée au malade
(avec ou sans son consentement), dans le but d'abréger ses souffrances » (J. Penneau, V° « Corps humain »,
Rép. civ. Dalloz, déc. 2005, spéc. n° 424), ou encore l’« usage de procédés qui permettent d’anticiper ou de
provoquer la mort, pour abréger l’agonie d’un malade incurable, ou lui épargner des souffrances extrêmes »
(V° Euthanasie, Le nouveau Petit Robert, 2007). Dans le rapport Léonetti (J. Léonetti, « Rapport fait au nom de
la mission d’information sur l’accompagnement de la fin de vie », tome I, Ass. Nat. n° 1708, 30 juin 2004),
l’euthanasie est définie comme « un acte délibéré par lequel le tiers entraîne directement la mort d’une
personne malade ».

Il faut alors savoir quelle place le droit accorde à l’autonomie personnelle2, dont on
s’aperçoit que les limites varient dans le temps et dans l’espace3. Ainsi, contrairement à
d’autres législations, la France refuse que la mort soit délibérément provoquée par un tiers ou
avec son assistance (I), la mort, même si elle est encadrée, ne pouvant être qu’attendue (II).
I. LA MORT PROVOQUEE
Certains pays admettent que la mort d’autrui puisse être provoquée (A), ce que, comme
d’autres, la France refuse (B).
A. L’admission de la provocation de la mort d’autrui
Le suicide assisté a été légalisé4 dans certains États étrangers. Par exemple, la possibilité
de s’adresser à un médecin pour se faire prescrire, à des conditions strictement définies5, une
substance mortifère est reconnue aux habitants de l’Oregon6. Précisons que la décision
d’avaler le médicament appartient au patient qui, dans l’affirmative, doit lui-même l’absorber.
Sur la notion d’euthanasie dans le langage moderne, voir par exemple (ces références ne sont pas exhaustives),
B. Legros, « Les "droits" des malades en fin de vie », thèse Lille II, Les Études Hospitalières Éditions, 1999,
n° 309 et s. Voir également, E. Dunet-Larousse, « L’euthanasie : signification et qualification au regard du droit
pénal », RD sanit. soc. 1998, p. 265 ; A. Prothais, « Accompagnement de la fin de vie et droit pénal », JCP éd. G
2004, I, 130, spéc. n° 1 et 2 ; F. Vialla, « Dérive sémantique et instrumentalisation de l’euthanasie », in La fin de
vie et l’euthanasie, Actes du colloque d’Aix-en-Provence 30 nov. - 1er déc. 2007, Les Études Hospitalières
Éditions, 2008, p. 257 et, du même auteur, « La France peut-elle avoir légalisé l’euthanasie ? », in La mort et le
la droit, op. cit., p. 389 ; B. Beignier, « Respect et protection du corps humain. La mort », JCl. Civil Code, art. 16
à 16-13, fasc. 70, 2007.
Sur la distinction entre suicide et euthanasie, citons ici les propos de B. Legros, « Sur l’opportunité d’instituer
une exception d’euthanasie en droit français », préc., spéc. p. 26, 1re col. : « L’homme, s’il veut mourir, peut se
suicider, mais il n’a pas à proprement parler un droit au suicide ; il bénéficie néanmoins d’une permission car
le suicide ne peut être ni ordonné, ni défendu. Toute personne peut donc disposer de sa propre vie, même pour y
mettre fin, mais elle ne peut pour autant demander à un tiers d’y procéder. Cette intervention d’autrui sur sa vie
est une atteinte à son intégrité physique qui s’analyse en une euthanasie ». Sur le suicide et ses conséquences ou
le régime applicable, voir par exemple F. Terré, « Du suicide en droit civil », in Mélanges Weill, Dalloz, 1983,
p. 523 ; E. Putman, « Le suicide et le droit », in La fin de vie et l’euthanasie, op. cit., p. 247 ; A. Moine, « Les
entraves légales à la volonté de mourir », in La mort et de la droit, op. cit., p. 247 ; B. Beignier, préc., spéc. n° 17
et s.
2 Sur cette question, voir notamment M. Fabre-Magnan, « Le domaine de l’autonomie personnelle,
indisponibilité du corps humain et justice sociales », D. 2008, p. 31.
3 A. Moine, préc., spéc. p. 254, note 19.
4 La légalisation « se dit (…) de la consécration par la loi soit d’une pratique jusqu’alors non réglementée, soit
même d’un comportement illicite, mais souvent déjà toléré » (V° Légalisation, « Vocabulaire juridique »,
G. Cornu (dir.), Association H. Capitant, PUF, 8e éd., 2007). La dépénalisation est l’ « opération consistant à
soustraire un agissement de la sanction du droit pénal » (V° Dépénalisation, « Vocabulaire juridique », op. cit.).
Sur ce point, voir par exemple J.-B. Thierry, préc. ; B. Legros, « L’euthanasie et le droit, état des lieux sur un
sujet médiatisé », Les Études Hospitalières Éditions, 2e éd., 2006, spéc. p. 135 et s.
5 Le patient doit formuler sa demande trois fois, dont une par écrit et plusieurs médecins doivent intervenir dans
le processus.
6 Suite à un référendum, une loi relative à la mort dans la dignité a été approuvée (Oregon Death with Dignity
Act). Cependant, ce texte n’est entré en vigueur qu’en 1997, un recours en justice ayant été déposé par les
opposants à cette loi. Par ailleurs, le 5 mars 2009 est entrée en vigueur, dans l’État de Washington, la loi « mort
dans la dignité » Initiative 1000, approuvée par référendum en novembre 2008 par près de 60 % des électeurs.

En Europe, certains États ont employé une démarche différente. Le comportement reste,
en principe, illicite et constitue encore une infraction pénale, mais il est créé un fait justificatif
spécial permettant a posteriori de ne pas condamner une personne ayant aidé une autre à
mourir à la demande de cette dernière. Telle est la démarche utilisée par les législateurs
néerlandais en 2001, belge en 20027 et luxembourgeois en 20098 au profit du seul médecin et
à certaines conditions9. Mais, à la différence du droit belge, l’assistance au suicide est
expressément envisagée dans les législations luxembourgeoise et néerlandaise.
Le droit suisse10 est un cas particulier : le fait de donner la mort à un tiers reste interdit,
mais l’assistance au suicide11 est tolérée. L’article 115 du Code pénal suisse réprime l’aide au
suicide pour des motifs « égoïstes ». Dès lors, une interprétation a contrario conduit à
considérer que celui qui fournit cette aide pour d’autres motifs12 ne tombe pas sous le coup de
la loi pénale.
Il faut que la personne soit capable de discernement au moment de l’acte final13 et qu’elle
se donne, de manière intentionnelle, elle-même la mort14. Par ailleurs, il n’y a pas de
distinction selon que l’aide au suicide est le fait d’un tiers ou d’un médecin. La situation de ce
dernier est toutefois plus délicate, en raison de considérations déontologiques15, de sorte que
cette assistance est surtout le fait des associations Exit-ADMD et Dignitas, dont la mission est
Ce texte permet aux médecins de rédiger des ordonnances de doses mortelles de médicaments pour des patients
en fin de vie (une copie de l’ordonnance devra être déposée au Ministère de la santé de l’État à des finalités
statistiques et anonymes pour créer un rapport annuel sur la manière dont la loi est utilisée).
7 Loi du 12 avr. 2001 pour les Pays-Bas et loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie pour la Belgique. En
Belgique, comme aux Pays-Bas, l’euthanasie reste punissable, la loi ayant seulement prévu un fait justificatif.
On pourrait y voir une dépénalisation (voir cependant, J.-B. Thierry, préc., spéc. p. 326 et 328). En revanche, à la
différence des Pays-Bas, l’aide au suicide n’est pas expressément envisagée.
Pour un exposé plus détaillé, voir S. Paricard, « Le médicament et la mort, propos comparatistes sur
l’euthanasie », RGDM 2009, n° 33, p. 231, spéc. p. 236 et 237 ; J.-B. Thierry, préc., spéc. p. 325 à 328. Pour une
comparaison des deux systèmes, voir par exemple, Y.-H. Leleu et G. Génicot, « L’euthanasie en Belgique et aux
Pays-Bas. Variations sur le thème de l’autodétermination », RTD Homme, 57/2004, p. 5 ; L. Gay, « Le
législateur apprenti sorcier ? Pays-Bas et Belgique face à la fin de vie », in La fin de vie et l’euthanasie, op. cit.,
p. 121.
8 Loi du 16 mars 2009, aux termes de laquelle « n’est pas sanctionnée pénalement et ne peut donner lieu à une
action civile en dommages et intérêts le fait par un médecin de répondre à une demande d’euthanasie ou
d’assistance au suicide ». Pour les conditions, voir S. Paricard, préc., spéc. p. 237.
9 À cet égard, il faut préciser que l’euthanasie est totalement médicalisée et ne se fait que par voie
médicamenteuse.
10 Voir notamment, B. Legros, « L’euthanasie et le droit, état des lieux sur un sujet médiatisé », op. cit., spéc.
pp. 132 et s ; D. Manaï, « La Suisse, le pays du "tourisme du suicide" ? », in La fin de vie et l’euthanasie,
op. cit., p. 105 ; D. Montariol, « L’assistance au suicide en Suisse, Un droit controversé », Médecine et Droit
2008, n° 91, p. 106.
11 L’assistance au suicide consiste en « l’aide qu’un tiers apporte à une personne capable de discernement qui
souhaite mettre fin à ses jours » (D. Manaï, préc., spéc. p. 106).
12 Compassion, respect de la liberté d’autrui voire indifférence…
13 Par conséquent, une demande anticipée d’aide au suicide (dans les directives anticipées) n’est pas valable
juridiquement. La question est également débattue en doctrine pour les mineurs. Cependant, une doctrine
majoritaire semble estimer qu’il suffit que la personne soit capable de discernement, majeure ou mineure, et que
l’assistance soit fournie sans but égoïste pour que l’acte ne soit pas punissable (D. Manaï, préc., spéc. p. 107).
14 En revanche, il y a homicide si le geste est le fait d’un tiers. Cette distinction présente une importance
particulière dans l’hypothèse où la personne qui souhaite mourir est en pleine possession de ses facultés mentales
mais est dans l’impossibilité physique d’accomplir l’acte. Un tiers qui effectuerait l’acte serait alors coupable
d’homicide, ce qui ne serait pas le cas dans l’hypothèse où le tiers assiste la personne en pleine possession de ses
capacités physiques car ce n’est pas lui qui effectue le geste (D. Manaï, ibid.).
15 En particulier parce que celui-ci a parallèlement le devoir de le sauver. Dès lors, si la personne qui souhaite
mourir n’est pas capable de mesurer la portée de son acte, et partant incapable de discernement, le médecin
commet un meurtre par abstention. Il a l’obligation de le réanimer (D. Manaï, ibid.).

alors de fournir le produit létal et d’accompagner, représentée par deux de leurs membres, le
malade jusqu’à ce qu’il accomplisse le geste ultime.
Toutefois, le droit de l’assistance au suicide suscite des difficultés et des voix s’élèvent
pour que cette pratique soit mieux encadrée16, d’autant plus face à l’afflux d'étrangers venant
profiter de cette tolérance, leur pays ne leur permettant pas de provoquer délibérément la
mort.
B. Le refus de la provocation de la mort d’autrui
Bien que des propositions aient été formulées en ce sens17, et ce, encore très récemment18,
le droit français n’a pas eu recours à l’ « exception d’euthanasie » et encore moins à la
légalisation de celle-ci ou du suicide assisté.
Le fait de donner la mort à autrui pour lui éviter des souffrances ou l’agonie, que ce
dernier l’ait voulu ou non, ou de l’aider en lui fournissant des substances mortifères, est
pénalement sanctionné. Mais l’euthanasie n’étant pas une notion juridique consacrée par le
droit pénal19, vont naître des difficultés de qualification des comportements que l’on retrouve
en pratique20.
Selon les cas, peut être retenue la qualification d’homicide volontaire 21 voire
involontaire22, d’empoisonnement23 ou d’administration de substances nuisibles24 ou encore
16 Pour plus de détails, voir notamment l’étude de D. Montariol, préc.
17 Diverses propositions de loi ont ainsi été formulées (voir par exemple celles du 19 décembre 2001, 15 octobre
2003 et 24 février 2004). Par ailleurs, dans son avis du 27 janvier 2000 sur « Fin de vie, arrêt de vie et
euthanasie », le Comité consultatif national d’éthique proposait de répondre à certaines demandes de suicide
assisté en termes d’ « engagement solidaire et d’exception d’euthanasie » (Avis n° 63 du 27 janv. 2000,
http://www.ccne-ethique.fr/docs/fr/avis063.pdf. Comp., l’avis n° 26 du 24 juin 1991, http://www.ccne-
ethique.fr/docs/fr/avis026.pdf). Il ne s’agissait pas de dépénaliser l’euthanasie mais de procéder, en début
d’instruction ou à l’ouverture des débats, à une appréciation au cas par cas, par une commission
interdisciplinaire, des circonstances pouvant conduire à l’arrêt de la vie. Cette proposition n’a pas eu d’écho. Sur
ce point, voir notamment l’analyse de B. Legros, « Sur l’opportunité d’instituer une exception d’euthanasie en
droit français », préc.
18 En dernier lieu, la commission des affaires sociales du Sénat a proposé une loi (il s’agissait en réalité de la
fusion de trois propositions) dont l’article 1er prévoyait que « Toute personne capable majeure, en phase avancée
ou terminale d'une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable, lui infligeant une souffrance
physique ou psychique qui ne peut être apaisée ou qu'elle juge insupportable, peut demander à bénéficier, dans
les conditions prévues au présent titre, d'une assistance médicalisée permettant, par un acte délibéré, une mort
rapide et sans douleur ». Le texte a été rejeté par le Sénat le 25 janvier 2011.
19 Le droit pénal ignore le mot et la situation d’euthanasie en tant que telle.
20 Sur la question, voir par exemple E. Dunet-Larousse, préc. ; A. Prothais, préc.
21 Art. 221-1, 221-3 et 221-4 C. pén.. Voir Cour d’assises, Bas-Rhin, 4 oct. 1985, n° 29/85 : en l’espèce, un
infirmier a donné la mort à une patiente en introduisant du chlorure de potassium dans sa perfusion. Les
poursuites ont été fondées sur la qualification de meurtre ; Cour d’assises, Paris, 1re section, 16 oct. 2003,
n° 03/0083 (affaire Christine Malèvre) : l’accusée a été condamnée en appel pour assassinat (décisions citées in
B. Legros, « L’euthanasie et le droit, état des lieux sur un sujet médiatisé », op. cit., spéc. p. 31).
22 Art. 221-6 C. pén. Voir Cass. crim., 19 févr. 1997, pourvoi n° 96-82.377, D. 1998, p. 236, note B. Legros, JCP
éd. G 1997, II, 22889, note J.-Y. Chevallier.
23 Art. 221-5 C. pén. Dans l’affaire de Saint-Astier, les poursuites ont été fondées sur la qualification
d’empoisonnement (voir notamment, B. Legros, op. cit., spéc. p. 31 et 32).
24 Art. 222-15 C. pén. Tel était le cas dans l’affaire Vincent Humbert.

celle de non-assistance à personne en péril25. La provocation au suicide est également
pénalement sanctionnée26.
En outre, ni le consentement de la victime27, ni les mobiles de l’auteur28 qui agirait par
pitié ou compassion ne sont, en principe, pris en compte au stade de la caractérisation de
l’infraction. Ils semblent toutefois exercer une influence lorsqu’il s’agit de se prononcer sur
l’opportunité des poursuites29 ou de fixer la peine30, voire même sur la qualification de
l’infraction par le biais d’une correctionnalisation judiciaire31.
Ainsi, en France, le suicide n’est pas réprimé32, mais, comme on a pu le relever en
doctrine, « la mort volontaire ne peut être qu’une mort solitaire33 ». À défaut de pouvoir être
provoquée, la mort est alors attendue.
II. LA MORT ATTENDUE
D’autres voies peuvent être empruntées pour encadrer la fin de vie en vue de garantir les
droits du malade et le principe d’autodétermination ainsi que de préserver sa dignité. Mais,
dans ce schéma, la mort n’est pas envisagée comme une fin en soi, l’intention n’étant pas de
la provoquer délibérément.
Comme d’autres pays, la France a retenu cette conception (A), laquelle apparaît conforme
à la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’homme (B).
A. Les mesures destinées à encadrer la fin de vie sans intention de
provoquer la mort
Bon nombre d’États ont, avec une portée variable selon les cas, consacré un droit au refus
ou à l’arrêt du traitement : on peut notamment citer les pays anglo-saxons34, le Québec35 ainsi
qu’une partie des États européens36. Le cas échéant, ce droit peut être accompagné du recours
25 Art. 223-6, al. 2 et 223-16 C. pén.
26 Art. 223-13 à 223-15 C. pén.
27 Cass. ch. réunies, 15 déc. 1837, S. 1838, 1, p. 5, rapp. Béranger, concl. Dupin.
28 Cass. crim., 20 août 1932, DP 1932, 1, p. 121.
29 Sur ce point, voir B. Legros, op. cit., spéc. p. 45 et 46.
30 Pour des illustrations, voir par exemple Cour d’assises, Vaucluse, 17 janv. 2003, Le Monde 19 janv. 2003 (cité
par A. Prothais, préc., spéc. n° 10) ; Cour d’assises, Maine-et-Loire, 14 juin 2006 : un homme a empoisonné sa
femme atteinte d’un cancer en phase terminale et a été acquitté ; Cour d’assises, Liège (Belgique), 5 nov. 1962,
Rev. sc. crim. 1963, p. 83 ; Cour d’assises, Bas-Rhin, 4 oct. 1985, préc. (décisions citées par B. Legros, op. cit.,
spéc. p. 37).
31 Voir A. Prothais, préc., spéc. n° 10, qui illustre son propos, notamment avec l’arrêt de la Chambre criminelle
de la Cour de cassation du 19 févr. 1997, préc. Voir aussi l’affaire Vincent Humbert (sur ce point, voir
l’explication de B. Legros, op. cit., spéc. p. 35 et 36).
32 Bien qu’il fasse l’objet de mesures dissuasives. Voir notamment, A. Moine, préc.
33 A. Moine, préc., spéc. p. 248.
34 Sur les pays anglo-saxons, voir notamment G. Nicolas, « Protection embryonnaire et euthanasie : recherche
sur les particularités anglo-saxonnes de la protection de la vie », in La fin de vie et l’euthanasie, op. cit., p. 91 ;
S. Paricard, préc., spéc. p. 238 et s.
35 E. Groffier, « Canada (Québec). - Personnes. Famille », JCl. Droit comparé, V° « Canada », fasc. 1, 1996,
spéc. n° 18. Le consentement est exigé « lorsque les soins sont inusités ou devenus inutiles ou que leurs
conséquences pourraient être intolérables pour la personne » (art. 13, al. 2 C. civ. du Québec).
36 Par exemple : Suède, Allemagne, Autriche, Espagne, Italie, Hongrie ou encore Portugal dans des cas extrêmes.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%