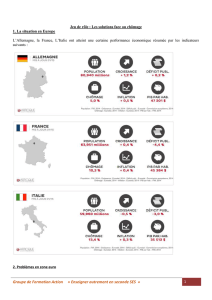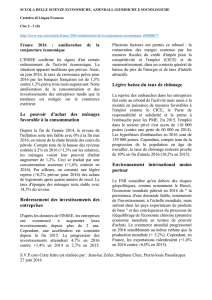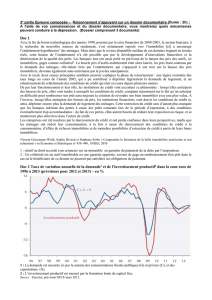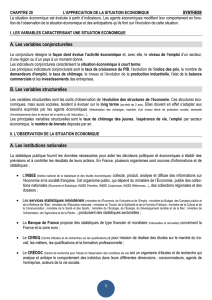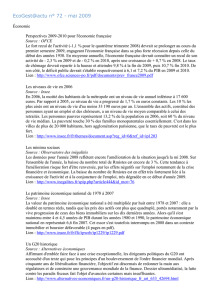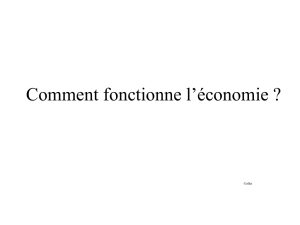Perspectives de l`économie française à l`horizon 2007

Perspectives de l’´economie fran¸caise `a l’horizon 2007
Ga¨el Dupont, Mathieu Plane, Eric Heyer
To cite this version:
Ga¨el Dupont, Mathieu Plane, Eric Heyer. Perspectives de l’´economie fran¸caise `a l’horizon 2007.
2002. <hal-01072190>
HAL Id: hal-01072190
https://hal-sciencespo.archives-ouvertes.fr/hal-01072190
Submitted on 7 Oct 2014
HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.
L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destin´ee au d´epˆot et `a la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publi´es ou non,
´emanant des ´etablissements d’enseignement et de
recherche fran¸cais ou ´etrangers, des laboratoires
publics ou priv´es.

- 178 -
PERSPECTIVES DE L’ÉCONOMIE FRANÇAISE À
L’HORIZON 2007
I. CONCEPTION GÉNÉRALE DE L’EXERCICE
Cette projection de l’économie française à l’horizon de cinq ans
- 2007 en est le terme – a été réalisée par l’Observatoire français des
conjonctures économiques (OFCE) à l’aide de son modèle de simulation de
l’économie française, e-mod.fr. Elle est de nature essentiellement macro-
économique.
Les experts se sont toutefois attaché à en tirer le maximum
d’indications sur l’évolution des finances publiques.
Si les résultats affichés pour les deux premières années (2002 et
2003) peuvent être considérés comme une prévision, les quatre années
suivantes ne décrivent pas le scénario le plus probable, mais plutôt une
extrapolation des tendances à l’œuvre jusqu’en 2001. Il s’agit d’illustrer, par
une projection à cinq ans, les questions et les choix devant lesquels se trouvent
aujourd’hui les responsables de la politique économique.
Dans le but de mettre à disposition des Sénateurs une telle
« illustration » les évolutions macroéconomiques ont délibérément un
caractère tendanciel.
Ce choix influence notamment deux catégories d’hypothèses :
- Le scénario d’environnement international à moyen terme, qui sert
de cadre à la projection de l’économie française, a été élaboré à
partir des estimations de croissance potentielle réalisée par l’OCDE
ou par le FMI pour les zones hors OCDE pour les années 2004 à
2007. Le scénario d’environnement international prolonge donc les
évolutions constatées sur le passé par une hypothèse médiane.
- Les prix des partenaires étrangers de la France évolueraient de
manière telle que la compétitivité prix de l’économie française
serait stable à partir de 2003. Une hypothèse de cette nature a
évidemment un caractère conventionnel, mais il est hasardeux d’en
bâtir une autre dans le cadre d’un exercice de moyen terme.

- 179 -
Au regard des choix opérés, il est logique que les évolutions
macroéconomiques décrites par la projection prolongent les tendances lourdes
à l’œuvre dans l’économie française.
A. UN SCÉNARIO DE CROISSANCE POTENTIELLE
Après trois années de forte croissance (3,6% en moyenne de 1998 à
2000), la France a connu un premier ralentissement en 2001 (1,8%) qui se
prolongerait en 2002 (0,9%). Pour 2003, nous faisons l’hypothèse que
l'économie française progressera de manière modérée, à des rythmes très
proches de ceux anticipés dans la zone euro. La croissance pour l’année 2003
s’établirait à 1,8 % en moyenne annuelle. Elle resterait inférieure à la
croissance potentielle, même en fin d’année. L’année 2003 verrait ainsi le
retour à une croissance molle, conséquence directe de la purge sur les
capacités de production, des incertitudes sur la politique monétaire, des
contraintes sur la politique budgétaire et d’un environnement extérieur
morose.
A moyen terme, le scénario bâti est un scénario dans lequel la
croissance de l'économie française s'établirait au niveau de son potentiel de
long terme. Cette croissance potentielle est, en moyenne sur la période 2003-
2007, de l’ordre de 2,2 % par an et ralentirait à l’horizon 2007 à 2,1 % en
conséquence d’une moindre croissance de la population active.
Concernant les finances publiques, le calage de la politique
budgétaire a donc été inspirée par la programmation pluriannuelle des finances
publiques présentée en janvier 2002 à la Commission européenne. Ce
programme n’intègre pas l’impact du ralentissement constaté depuis le début
de l’année 2001 sur les déficits des administrations publiques et les réactions
de politique économique qui pourraient en découler.
Cela se traduit par une hypothèse de stabilité de l’évolution des
dépenses publiques par rapport à leur rythme de croissance de longue période.
Celles-ci croîtraient de 1,4 % en moyenne sur la période 2003-2007, contre
1,8 % par an de 1995 à 2000.
Alors que les dépenses restent maîtrisées, les recettes fiscales induites
par la croissance permettent certes de réduire le déficit mais pas suffisamment
au regard des engagements européens.

- 180 -
B. UN SCÉNARIO ALTERNATIF DE CROISSANCE PLUS RAPIDE
L’économie française étant marquée par un taux de chômage élevé,
symptôme de ressources productives inutilisées, nous avons envisagé un
scénario de baisse franche du chômage. Afin d’enregistrer un recul du
chômage, la croissance française doit être supérieure à son potentiel de long
terme qui se situe, comme nous l'avons signalé précédemment, aux alentours
de 2,2 % par an. Dans ce scénario, nous supposons que, à partir de 2004, les
conditions seront réunies pour permettre à l'économie française de croître à un
rythme de 3 % en moyenne annuelle. Ce niveau de croissance de l'économie
française est inférieur à celui observé au cours de la période 1997-2000 où la
France a eu une croissance supérieure à son potentiel (3,6 % en moyenne
annuelle). Certes, depuis le début de l’année 2001, les économies mondiales
connaissent un ralentissement net auquel la France n’échappe pas. Le retour
vers une trajectoire de croissance plus élevée devrait demander quelques
trimestres et le ralentissement se prolongerait jusqu’à la fin de l’année 2003.
En moyenne annuelle, la croissance des années 2001, 2002 et 2003 serait de
1,3 %.
Comme l’OFCE l’a déjà exploré dans des travaux antérieurs, une
croissance supérieure à la croissance potentielle suppose deux types de
conditions :
• D’une part, une demande et une offre soutenues sont nécessaires
tant du côté des ménages (au travers de leur revenu disponible brut)
que des entreprises (au travers de leur investissement qui est une
partie de la demande et qui permet d’augmenter les capacités de
production afin de pouvoir satisfaire la demande).
• D’autre part, une évolution structurelle dans la formation de prix et
des salaires est nécessaire. Le taux de chômage n’accélérant pas
l’inflation doit se réduire afin de permettre une baisse du chômage
observé sans que des tensions inflationnistes ne se déclenchent et
compromettent le processus de croissance.
Les hypothèses de productivité étant identiques dans les deux
scénarios, les différences de performances sur le marché du travail
s'expliquent exclusivement par le différentiel de croissance.
Dans ce scénario, l’économie française rattrape ainsi son retard, avec
une croissance supérieure à son taux de croissance potentielle. L’accélération
de l’activité allège la contrainte sur les finances publiques. Alors que les
dépenses restent maîtrisées, la croissance apporte des recettes fiscales qui
viennent réduire le déficit.

- 181 -
Evolution de la capacité de financement dans le scénario à...
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
90-95
95-00
03-07
... la croissance
potentielle
-1,5
-2,9
-2,9
-2,5
-2,2
-2,0
-1,8
-4,4
-3,0
-2,2
... à 3 % -1,5
-2,9
-2,9
-2,2
-1,4
-0,8
-0,2
-4,4
-3,0
-2,1
Sources : INSEE, calculs OFCE
II. PRINCIPALES HYPOTHÈSES DE LA PROJECTION
Par convention, la projection prolonge à l’horizon du moyen terme les
prévisions à court terme (2002-2003) de taux d’intérêt et de taux de change
que l’OFCE vient de présenter1.
A. LE POLICY MIX DANS LES DIFFÉRENTES ZONES
1. Zone euro
En Europe, la politique monétaire n’est guère accommodante et la
politique budgétaire devient progressivement restrictive. Presque tous les pays
de la zone euro se lancent en effet dans des politiques d’assainissement
budgétaire en 2003, particulièrement importantes en Allemagne, au Portugal et
aux Pays-Bas. Ces mesures permettraient certes de réduire le déficit de la zone
euro de 2 à 1,8 % du PIB, mais ce choix de politique économique, similaire à
celui de la première moitié des années 1990, devrait au mieux engendrer une
croissance molle, l’impulsion budgétaire correspondante étant négative. Lors
de la dernière réunion du Conseil des gouverneurs, la BCE a laissé inchangé
son taux minimal de refinancement à 3,25 %. Pourtant, la faiblesse persistante
de l’investissement et le tassement de la consommation combinés au
ralentissement de l’inflation et à la hausse (timide) de l’euro rendent cette
position attentiste plutôt restrictive. Ce taux resterait à ce niveau jusque fin
2003.
2. Etats-Unis
Lors de son comité de politique monétaire du 24 septembre, la
Réserve fédérale a maintenu inchangé le taux des federal funds à 1,75 %.
Jusqu’à présent, le policy mix a exercé un effet contra-cyclique important, la
politique monétaire et la politique budgétaire étant expansionnistes.
1 Cf. Lettre de l’OFCE, n°225, 21 octobre 2002.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
1
/
27
100%