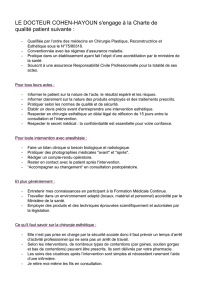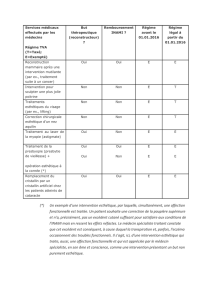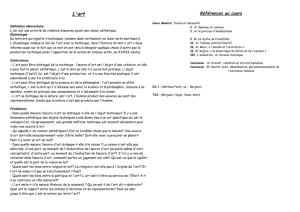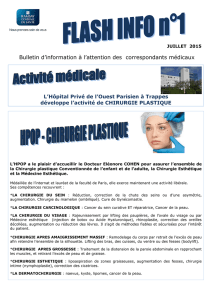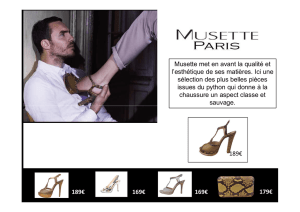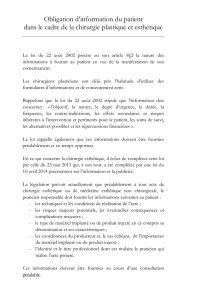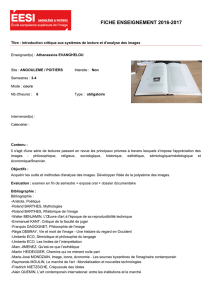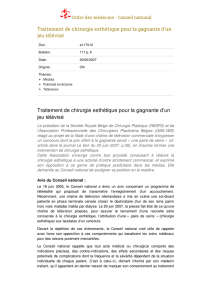Chirurgie esthétique humanitaire Humanitarian aesthetic surgery

Chirurgie esthétique humanitaire
Humanitarian aesthetic surgery
P. Knipper
25, rue de Bourgogne, 75007 Paris, France
Résumé
Faut-il qu’un visage soit détruit par une maladie tropicale destructrice pour que la profondeur de notre geste redevienne esthétiquement
correcte ? Faut-il que notre geste réparateur demeure la seule cicatrice de notre habileté, de notre humanité ? Au cours d’une mission de
chirurgie plastique dite humanitaire, pouvons-nous faire de l’esthétique ? La chirurgie esthétique peut-elle être humanitaire ? La chirurgie
esthétique humanitaire a su nous enseigner que l’esthétique est une technique au service de la fonction réparation et qu’il était inutile de
justifier l’esthétique par la reconstruction puisque l’esthétique appartient, à part entière, à cette reconstruction. Il est inutile de culpabiliser
quand notre geste technique est esthétique puisque la motivation de l’intervention ne nous appartient pas. Est-ce que le traitement d’une lèvre
fendue, chez une petite fille asiatique, est un geste réparateur ou un geste esthétique ? Vous pensez, probablement, que cela sera un geste
réparateur parce que c’est plus « porteur » ou parce que vous allez reconstruire la sangle musculaire. Cette enfant voudra, probablement, une
lèvre plus belle, plus esthétique (de toute façon, elle ignore les principes de la croissance faciale). Ce sera alors une intervention esthétique.
Mais peu importe la motivation puisque votre technique sera la même et que vous essaierez de la faire la mieux possible, voire la plus
esthétique possible. Seule, la motivation première de l’intervention permet de qualifier d’esthétique ou de plastique cette intervention, alors
que votre geste technique sera identique. Tout cela démontre que, finalement, nos définitions sont peu importantes au regard de la simple
satisfaction de notre petite asiatique qui, nous l’espérons, sera une « belle » satisfaction. En pratique, nous avons appris à ne pas faire de la
chirurgie esthétique mais à être esthétique dans notre chirurgie et, cela, même en mission humanitaire. La chirurgie esthétique opère dans la
forme et par la forme dans un état de subjectivité que seul le résultat viendra justifier. Et nous espérons que ce résultat chirurgical sera, tout
simplement, esthétiquement et humainement correct.
© 2003 Éditions scientifiques et médicales Elsevier SAS. Tous droits réservés.
Abstract
Must a face be disfigured by a terrible tropical disease, in order to make us realise that the well being of our gesture is aesthetically
acceptable? Must our reparative motivation remain the only trace of our skill and our humanity? During a plastic surgery mission, so-called
humanitarian mission, can this surgery be aesthetic? Can aesthetic surgery be humanitarian? We learnt from aesthetic surgery on humanitarian
missions, that aesthetic is only a technic to assist the reparation aspect. There is no need to justify aesthetic by reconstruction, because aesthetic
belongs, in its entirety, to reparation. There is no need either to feel guilty, when our technical gesture is aesthetic, since what really motivates
our intervention is not for us to decide. Is the reparation of the cleft lip of a little Asian girl, a reparation gesture or only an aesthetic approach?
You may think that this will be a reparation gesture, because it will be more “popular” or because you will reconstruct the muscular belt. This
child will most probably look for a more beautiful or aesthetic lip (in any case, she ignores the intricacies of facial growth principles).
Therefore, it will be an aesthetic intervention. Never mind the motivation, since your technic will be the same, and you will try to do your very
best and the most aesthetically you can. Only the very intention behind an intervention will decide whether it is an aesthetic or a plastic
intervention, whereas your technical gesture will remain the same.All this illustrates that our definitions are of a minor importance, compared
with the mere satisfaction of our little Asian girl, which, hopefully, will be a “beautiful” satisfaction. In fact, we have learnt not to do aesthetic
surgery, but to give an aesthetic approach to our surgery, even during our humanitarian missions. The form aesthetic surgery will take is very
subjective and only the final result will have the last say. Hopefully this surgical result will be aesthetically and humanly acceptable.
© 2003 Éditions scientifiques et médicales Elsevier SAS. Tous droits réservés.
Mots clés : Chirurgie plastique ; Chirurgie esthétique ; Humanitaire ; Tradipraticien
Keywords: Plastic surgery; Aesthetic surgery; Humanitarian; Traditional practitioner
Adresse e-mail : email@docteur-knipper.com (P. Knipper).
Annales de chirurgie plastique esthétique 48 (2003) 288–294
www.elsevier.com/locate/annpla
© 2003 Éditions scientifiques et médicales Elsevier SAS. Tous droits réservés.
doi:10.1016/j.anplas.2003.08.014

Le temps se vit, parfois, douloureusement dans le corps et
par le corps, dans un état de nudité qu’aucun voile ne viendra
masquer. Peut-on, tout au plus, espérer qu’un voile chirurgi-
cal saura rendre plus transparent ce visage détruit que le
monde n’ose plus regarder ? Et pourtant, cette béance faciale
offre une profondeur redoutable à nos regards pleins d’huma-
nité, à nos regards pleins d’humilité, comme si la surface des
choses ne suffisait plus à dévoiler la profondeur de nos
sentiments. Faut-il qu’un visage soit détruit par une maladie
tropicale, comme le noma, pour que la profondeur de notre
geste redevienne esthétiquement correcte ? Faut-il que notre
geste réparateur demeure la seule cicatrice de notre habileté,
de notre humanité ? La chirurgie esthétique restera-t-elle
voilée comme le visage de certaines femmes humiliées ?
L’humanitaire peut-il faire de l’esthétique ? La chirurgie
esthétique peut-elle être humanitaire ?
1. Ce que nous avons appris
En mission, nous avons appris que le concept du mot
« guérir » ne nous appartenait pas. Par exemple, sous nos
latitudes, la disparition d’un symptôme, comme la douleur,
est un élément important de la guérison. En chirurgie de la
main, le traitement d’une articulation douloureuse peut être
l’arthrodèse. Comment conceptualiser le lien qui existe entre
la disparition de la douleur et le fait de « souder » deux os. De
surcroît, la douleur reste une émotion. Comment concevoir
cette émotion ? Comment la matérialiser ? Nous observons,
immédiatement, la limite de nos définitions, la limite de nos
affirmations. Le chirurgien a réussi l’intervention puisque le
patient n’a plus mal. Le patient est guéri puisqu’il n’y a plus
de douleur, mais l’articulation est détruite. Donc, l’interven-
tion est réussie bien que l’articulation ne soit plus fonction-
nelle. Nous avons là la démonstration de la limite de notre
définition du mot « guérison » et nous en avons, tous, de très
nombreuses démonstrations.
Comme le rappelle Claudine Brelet [1], « une grande
partie des pratiques de guérissage
1
repose beaucoup plus sur
une étiologie d’ordre psychologique ou social, ou encore les
deux à la fois (comportement inadapté d’un ou de plusieurs
membres de la famille envers le malade, décès ou malchance
de la famille) qu’elle ne se fonde sur une description aussi
précise que possible des symptômes, comme le fait la méde-
cine moderne. Cela pourrait expliquer en partie le recours si
important accordé à la divination dont les meilleurs prati-
ciens possèdent une sensibilité aiguisée à autrui, une capacité
de relation fusionnelle avec leur entourage qui, de toute
évidence, s’avèrent impossibles, voire insupportables, au
sein de masses urbanisées. »
Ainsi, une autre limite réside dans l’« effet placebo ».
C’est ainsi que nous qualifions l’efficacité d’un produit sans
principe qualifié d’actif. Mais que représente véritablement
« un effet » pour un berger du sud du Niger ? Que signifie
« principe actif » pour un marchand congolais ? Encore des
définitions ? Acceptons que, sous d’autres latitudes, un « ef-
fet » puisse être un « dieu de la forêt » et qu’un principe actif
puisse être, tout simplement, l’influence d’un guérisseur ou
d’une amulette.
2. Ce que nous avons appris
La notion de « patient » reste une entité bien européenne.
En effet, le concept de « patient » fait fusionner, dans nos
contrées, l’être à sa maladie. En Afrique, par exemple, le
malade et la maladie demeurent bien distincts.
En Afrique, le malade appartient à une famille, à un
village, voire à une ethnie. Il ne sera pas atteint par hasard. Le
malade a une histoire qu’il faudra apprendre à écouter. De
plus, le malade n’est pas toujours celui que l’on voit ou que
l’on croit. Le malade que l’on vous présente n’est peut-être
que le représentant d’une famille et c’est peut-être la famille
qui est « malade ».
La maladie peut aussi appartenir à une famille ou à une
peuplade. La maladie n’est probablement pas là par hasard et
elle a son histoire. Il faudrait la comprendre mais nous
n’avons ni le temps ni les facultés pour pouvoir l’assimiler.
En effet, il y a toujours une « raison » à l’accident qui arrive
au patient ou à la maladie qui le touche. Le patient a proba-
blement traversé, à tort, le « lieu des génies » ou bien il a
mangé, toujours à tort, de la viande de perdrix. Dans certains
villages, il existe des « lieux » où il est interdit de passer à
certaines heures de la journée. Le fait de transgresser cette
règle peut expliquer l’accident ou la maladie. Certaines fa-
milles ne doivent pas manger de la viande de perdrix ou de
cochon. Transgresser la règle peut également expliquer l’ac-
cident ou la maladie. Il y a toujours une raison aux choses et
cela peut expliquer un certain « fatalisme » que l’on peut
observer dans ces pays.
Nous ne restons que des techniciens de surface, alors que
le mal peut venir des « profondeurs » de la forêt. Comment
peut-on soigner avec une simple greffe de peau le visage d’un
enfant qui est « mangé » par sa grand-mère [2]...? La mala-
die, en Afrique, n’appartient pas toujours au patient et le
malade n’est pas toujours le patient.
Il est donc souvent difficile d’opérer « la maladie » et il est
encore plus difficile, pour nous, de soigner un mal que l’on ne
voit pas. Il serait très prétentieux de croire que l’on peut
vraiment traiter par un lambeau un mal que l’on ne connaît
pas. Cependant, les familles acceptent de plus en plus les
traitements occidentaux dits modernes pour des pathologies
qu’ils « connaissent » depuis toujours. Si leur point de vue a
« évolué », nous devrions également apprendre à mieux
« voir » le patient et nous devrions essayer de soigner son
histoire autant que sa plaie. Nous devrions, surtout, témoi-
gner d’un peu plus de modestie car le flot de nos techniques
ne peut rien contre les dieux des rivières. Nous ne pouvons
rien sans l’aide de la famille, sans l’aide du chef de village ou
du tradipraticien local. On ne touche pas le corps sans l’ac-
1
Guérissage : terme mis en usage par les chercheurs en ethnomédecine.
289P. Knipper / Annales de chirurgie plastique esthétique 48 (2003) 288–294

cord. Et, ici, l’accord de la famille, du « groupe » ou du
« guérisseur », est aussi précieux que l’indication thérapeu-
tique d’une équipe occidentale. Il vaut mieux respecter notre
registre médical et laisser le tradipraticien composer ses
gammes locales. Nous sommes médecins et, en tant que tels,
nous devons agir en médecin. C’est ainsi que le patient nous
voit et c’est ainsi que l’on sera le plus efficace pour lui. Pour
traiter l’aspect plus « transparent » de la maladie, c’est le
guérisseur qui aura le vrai pouvoir et qui saura mieux appré-
hender le « zima ». Pour être efficace, le traitement devra être
pluridisciplinaire.
« Lorsqu’on prétend améliorer la santé d’un peuple —
souligne encore le Docteur P. Dorolle — il faut savoir aban-
donner les concepts de bon, mauvais, meilleur et pire, et
laisser la population libre sur le plan des idées et des concepts
culturels particuliers... Il est impossible de prétendre imposer
de l’extérieur un changement dans les concepts culturels.
Lorsqu’un tel changement est imposé, il en résulte un désé-
quilibre et une incompréhension qui mettent gravement en
danger l’œuvre entreprise [3]. » Le terme de « culture »
devrait désormais se comprendre, dans le domaine médical
comme ailleurs, comme l’ensemble des formes de croyance
et de comportement ayant reçu une sanction sociale parce
que les membres d’un groupe humain déterminé les ont
assimilées.
De surcroît, les patients font preuve d’un grand courage en
acceptant nos pratiques qui peuvent être, parfois, un peu
surprenantes voire intriguantes. En effet, imaginez la scène
que l’on peut proposer à ces enfants venant d’un petit village
lointain et qui entrent, pour la première fois, dans un bloc
opératoire. Imaginez leurs pensées quand ils voient un scia-
lytique dirigé sur eux et quand ils voient tous ces individus
déguisés en bleu s’agiter selon un rituel bien compliqué.
Imaginez leurs regards quand ils voient le chef de cette
« secte » qui leur parle dans un drôle de dialecte et, surtout,
avec un « masque » d’une tribu inconnue. Ce chef est appelé
chirurgien, mais quel est son pouvoir ?
La mise en scène de certaines thérapeutiques locales sem-
ble folklorique à nos yeux. Acceptons l’idée que les scènes
que nous leur proposons soient également originales. Mais
dans les deux cas, la mise en scène est efficace pour le
traitement et, donc, pour le patient. C’est pour cela que nous
acceptons une prise en charge des patients avec l’accord local
et avec l’aide des thérapeutiques locales. La finalité reste la
guérison du patient. Peu importe si cette guérison résulte
d’une belle greffe ou si les méchants dieux de la forêt sont
partis. Peu importe si cette guérison découle d’une « magie
de la science » ou d’une « science de la magie », comme le
rappelait si brillamment Raymond Vilain.
Rappelons, pour finir, qu’en France, la fente labiale était
encore qualifiée, et il n’y a pas si longtemps, de « bec-de-
lièvre ». Ce rapprochement vient de nos campagnes où l’on
pensait que la femme, qui avait un enfant porteur d’une fente
labiale, avait croisé un « animal maléfique »... Le dieu de la
rivière n’est pas plus ridicule que le lièvre de nos campagnes.
Il nous semble important de respecter l’influence de cet
environnement dans tout programme thérapeutique. Nous
avons appris que l’influence peut guérir [4].
3. Ce que nous avons, encore, appris
Ce sont les patients, en mission, qui nous ont appris que
l’esthétique était, pour eux, aussi importante que la fonction
ou qu’elle en faisait entièrement partie et, cela, quel que soit
le pays. Raymond Vilain nous a enseigné que « l’esthétique
était déjà la fonction » ; pourquoi la fonction ne pourrait-elle
pas être esthétique ? Pourquoi l’esthétique ne serait pas
l’objet d’une satisfaction ? Pourquoi, tout simplement, l’es-
thétique nous appartiendrait-elle ?
Au cours d’une mission, nous avons le souvenir de cette
jeune arménienne avec une séquelle importante de brûlure de
la face dorsale de la main. Il existait une grande cicatrice
hypertrophique sans réel retentissement fonctionnel. Nous
avons expliqué, avec l’aide du traducteur, qu’il ne fallait rien
faire et que, si on enlevait cette cicatrice, la peau dorsale
serait tellement tendue que la patiente ne pourrait plus fermer
la main. Notre explication était claire et recevait l’approba-
tion du traducteur et de la patiente. Le lendemain, la jeune
fille s’est présentée à la consultation. Elle voulait que nous lui
enlevions la cicatrice et elle nous expliquait qu’elle avait bien
compris notre réticence mais qu’elle préférait une main plus
jolie, même si elle ne pouvait plus la fermer.
Un autre exemple nous est apporté par la fente labiale.
Nous avons appris que la motivation réelle dans la demande
des parents qui ont un enfant porteur d’une fente labiomaxil-
laire est, principalement, d’ordre esthétique et, cela, même
dans un pays dit « en voie de développement ». Le chirurgien
est rassuré sur l’intérêt fonctionnel de son geste mais les
parents ne connaissent pas bien les limites entre le palais
primaire et le palais secondaire. Ils ont oublié les principes de
la morphogénèse des êtres, bien qu’elle soit une préoccupa-
tion ancienne de l’humanité. Ils ont oublié les principes du
développement facial. Ils savent cependant que leur fille ne
pourra pas emprunter la voie sacrée du mariage si elle garde
cette lèvre fendue.
Nous avons également pu observer une motivation esthé-
tique dans la reconstruction d’un coude chez un jeune béni-
nois qui présentait des séquelles d’un ulcère de Buruli. Géné-
ralement, les patients sont des femmes et des enfants qui
vivent dans des régions rurales à proximité de cours d’eau ou
de terrains humides. Atteignant surtout les membres, cette
affection détruit progressivement et sans douleur, la peau et
le tissu cellulaire sous-cutané, voire les tissus sous-jacents.
Au stade des séquelles, la maladie présente des zones cicatri-
cielles fibreuses, rétractées avec de nombreuses déforma-
tions associées. C’est une de ces déformations que nous
avons observée chez ce jeune béninois. Il présentait une
rétraction du coude droit avec une importante zone fibreuse
qui tapissait surtout la face antérieure. Nous avons entière-
ment libéré ce coude par une exérèse chirurgicale large. La
perte de substance a été « couverte » par un lambeau muscu-
locutané pédiculé de grand dorsal. Nous avons retrouvé une
290 P. Knipper / Annales de chirurgie plastique esthétique 48 (2003) 288–294

très bonne mobilité de ce coude et les suites opératoires ont
été simples. Nous étions assez satisfaits d’avoir rendu ce
coude fonctionnel car, avec un coude actif, ce jeune béninois
pouvait travailler au champ et, par conséquent, pourrait envi-
sager de créer une famille. Le symbole de cette intervention
était très fort pour l’équipe : nous avions rendu la fonction au
coude de ce jeune garçon et cela devait permettre la création
d’une famille. Mais le lambeau était encore un peu gros et il
n’était pas très esthétique. Nous avons expliqué au patient
que, avec le temps, ce lambeau s’affinerait. Mais comment
expliquer l’« atrophie secondaire » d’un muscle ? De plus,
l’ulcère de Buruli est indolore. Après l’intervention, le pa-
tient ressentait forcément quelques douleurs dorsales (site de
prélèvement du lambeau). Si notre intervention semblait
réussie, nous restions pour le patient légèrement maudits.
Enfin, dans le noma, la réparation de certaines mutilations
faciales garde une finalité (souvent non avouée) esthétique
bien que l’on utilise des techniques de reconstruction très
sophistiquées. Le noma, ou cancrum oris, est une gingivos-
tomatite ulcéronécrotique d’origine infectieuse qui touche,
aujourd’hui, surtout les enfants d’Afrique (the noma belt [5])
sur un terrain associant dénutrition, mauvaise hygiène buc-
codentaire et tares diverses. La mortalité a été considérable-
ment réduite par les antibiotiques et l’apport alimentaire. Au
stade de séquelles, cette terrible affection laisse d’importan-
tes destructions du visage. Nous avons le souvenir de cette
jeune togolaise, accompagnée par des religieuses du nord du
Nigeria, qui vivait seule en dehors de son village et qui était
fréquemment violée. Elle présentait des séquelles faciales
importantes de noma sous la forme d’une fente béante et
nauséabonde qui progressait de la commissure labiale
jusqu’à la région temporale. Le pouvoir sacré de la religion
étant resté vain, les religieuses décidèrent de nous la présen-
ter. Finalement, il n’y avait pas de réel retentissement biolo-
gique et physiologique hormis l’atteinte de la mastication.
Elle s’alimentait parfaitement avec une alimentation liquide
(à base de manioc) et elle ne semblait pas présenter de
carence alimentaire. Pourquoi l’avons-nous opérée ? Pour la
fonction ! Pour la reconstruction ! Nous croyons qu’elle a été
contente de pouvoir refermer un peu plus sa bouche et de
bouger, même timidement, sa mandibule. Nous croyons,
surtout, qu’elle a été heureuse de retrouver un visage qu’elle
n’aura, peut-être, plus besoin de voiler... Nous croyons que la
guérison peut aussi être l’objet de cette satisfaction.
Ces quelques expériences nous ont incités à réfléchir sur la
vraie finalité de nos missions de chirurgie en situation pré-
caire. La chirurgie plastique n’est qu’un remède dans un
champ thérapeutique très vaste. Guérison, résurrection, fonc-
tion... sont probablement les représentations de notre propre
satisfaction. Mais qu’en est-il de la disparition d’une dou-
leur ? Qu’en est-il du départ des djinns ou des dieux de la
forêt ? Qu’en est-il du mariage accepté grâce à une esthétique
retrouvée ? Qu’en est-il des viols jugulés par un visage
regagné ? La chirurgie esthétique semble être à la lisière de ce
champ thérapeutique. Mais, qui a vraiment vu la douleur ?
Qui a déjà rencontré la fonction ? Qui est le véritable guéris-
seur ? Qui peut donner la vraie définition de la guérison ? Qui
peut dire si l’esthétique est universelle ?
Si notre intervention esthétique peut apporter une quel-
conque satisfaction, ne la méprisons pas ; il y a, peut-être, une
raison insensible qui saura rendre plus sensible la simple
notion de satisfaction. Et la satisfaction c’est, déjà, notre
mission.
4. Ce que nous avons appris
Nous avons appris, dans nos missions, que « notre »
chirurgie ne pouvait pas tout résoudre. Rappelons Ambroise
Paré:«Jelepensais, Dieu l’a guéri... ». Nous ne croyons pas
que seul un lambeau puisse réparer un visage béant.
Nous doutons quand des équipes chirurgicales, au nom du
dogme de l’éthique médicale ou de leur « grande chirurgie »,
présentent leur technique comme « la » solution. Nous avons
le souvenir de ces patients, au nord du Nigeria, traités pour
des séquelles faciales de noma. Vous imaginez le retentisse-
ment psychologique, social et humain de telles mutilations.
Face à ces importantes reconstructions, certains « grands »
chirurgiens peuvent, parfois, proposer leur mépris puisqu’ils
ne savent pas toujours offrir une solution. D’autres vont
proposer des techniques de reconstruction avec divers lam-
beaux. Face à l’importance des lésions, ces chirurgiens ont
utilisé tout leur savoir faire et ils ont réussi, pour la plupart, à
« fermer » ces visages béants.
Nous avons revu ces patients plusieurs mois, voire plu-
sieurs années, après leurs interventions. D’une part, certaines
techniques employées ont souvent nécessité plusieurs temps
opératoires. D’autre part, les lambeaux utilisés ont eu un
« coût » esthétique sur le site donneur tel que l’on peut se
demander si le bénéfice a été réel pour la fonction patient. Par
exemple, nous avons vu un petit garçon dont l’orifice jugal
avait été « fermé » par un lambeau frontal et un lambeau de
muscle peaucier du cou. L’orifice était « bouché » par le
grand chirurgien mais le visage de cet enfant n’était plus un
visage, le front n’était plus un front et le cou n’était plus un
cou. Nous avons, également, le souvenir de cette jeune afri-
caine qui avait été traitée par un lambeau deltopectoral.
Impressionnés par les séquelles qu’avait laissé ce type de
lambeau chez cette jolie petite fille, nous avons demandé plus
tard au chirurgien pourquoi il avait utilisé ce type de lam-
beau. Sa réponse a été : « parce que ce lambeau marche très
bien et que l’on peut cacher la zone donneuse ». Ce chirur-
gien avait oublié qu’en Afrique il fait chaud et que les fem-
mes, en portant leur pagne, dévoilent leurs épaules et le haut
du thorax. Ces quelques exemples nous renforcent dans
l’idée que, si dans certains cas, « l’esthétique c’est déjà la
fonction », dans d’autres cas, la fonction devrait être esthéti-
que. L’esthétique d’une reconstruction faciale ne doit pas
faire oublier la fonction, mais faire une belle reconstruction
sans la fonction esthétique ne sera jamais une vraie guérison.
En mission humanitaire, comme nous le faisons dans nos
hôpitaux, la dimension esthétique devrait toujours être pré-
sente dans nos interventions réparatrices.
291P. Knipper / Annales de chirurgie plastique esthétique 48 (2003) 288–294

5. Ce que nous avons, également, appris
Pour faire des missions de chirurgie plastique dite huma-
nitaire, nous avons besoin de les financer. Bien que l’inves-
tissement personnel soit important, la recherche de fonds
reste indispensable. Dans cette quête, différents moyens exis-
tent mais tous essayent de toucher la sensibilité du donateur.
Nous avons appris que le donateur reste peu sensible à la
technique employée et qu’il est peu sensible à l’importance
d’une reconstruction. Paradoxalement, un visage reconstruit,
qui aura nécessité un très grand investissement chirurgical,
« accrochera » moins le regard du donateur comme si la
dysharmonie de la face restaurée représentait une création
inférieure, un mimétisme vain, une trahison de dame nature.
« Est beau ce qui est reconnu sans concept comme l’objet
d’une satisfaction nécessaire » [6]. Le donateur a besoin de
cette satisfaction. C’est par le moyen de la forme que l’on
pourra opérer sur lui. C’est par l’esthétique du visage recons-
truit que l’on pourra toucher son imagination au plus profond
de son intuition. C’est avec son imagination qu’il pourra
voyager dans le sourire de cet enfant guéri. Un visage se
voyage et « le » voyage, nous l’imaginons toujours beau.
C’est à travers ces visages redevenus beaux que le donateur
pourra prendre la dimension de son ambition : redonner le
sourire à des enfants, à des patients. Paradoxalement, quand
le chirurgien va en mission, il justifie toujours ses actes par
une nécessité fonctionnelle mais, pour financer ses missions,
il préfère faire sa « promotion » sur le visage des enfants...
Regardons simplement quelques noms d’organisations :
« Opération sourire », « Enfants du Monde », « Chaîne de
l’espoir », « l’hymne aux enfants », etc. L’esthétique est un
argument important du marketing humanitaire. La souf-
france d’un enfant, le visage d’un enfant se « vend » mieux
qu’une belle reconstruction abdominale comme si l’esthéti-
que retrouve, dans cette quête, son vrai sens : la sensibilité.
C’est ainsi : le donateur a besoin de voyager. S’il participe
financièrement, c’est un peu pour s’offrir un voyage, une
histoire, et l’humanitaire est un grand espace. Il faudra l’in-
former, lui donner des « news » sur l’évolution. Et le « must »
sera quand il recevra les résultats de l’intervention avec les
fameux clichés « avant–après ». Ces clichés sauront toucher
le plus profond de son humilité. C’est ainsi, l’esthétique a ses
raisons que la face violée a su nous dévoiler. C’est ainsi,
l’humanitaire a besoin d’être esthétiquement correct pour
mieux se dévoiler. Finalement, l’esthétique reste un grand
voyage pour notre intimité.
Autre paradoxe : nous retrouvons l’esthétique dans notre
quotidien et dans des domaines aussi courants qu’inconve-
nants, voire esthétiquement incorrects. Par exemple, nous
parlons d’un « beau patient » quand le malade présente une
grosse pathologie. Nous parlons d’un « beau résultat » quand
nous sommes satisfaits de nos lambeaux bien dessinés,
même si le patient ne pourra plus marcher. Nous évoquons
une « belle pathologie » quand le cortège de signes est
fortement pourvu. Nous faisons une « belle mission » quand
le nombre de cas est impressionnant. Nous pensons qu’il a eu
une « belle mort » quand le patient n’a pas souffert. Nous
insistons sur la « belle infection » quand il s’agit de la
complication d’un confrère bien aimé, etc. Nous avons appris
que le champ de l’esthétique avait des lisières que le vocable
« beau » savait parfois piétiner.
6. Ce que nous avons appris
La chirurgie esthétique opère avec toute la sensibilité du
geste plastique pour reconstruire une satisfaction. De quelle
nature est cette satisfaction ? Il ne nous appartient pas d’en
décider la définition. La simple représentation de cette satis-
faction devrait appartenir à la fonction. Finalement, la fonc-
tion n’est qu’une représentation. Par exemple, la flexion–
extension du coude est une très belle fonction. Pensez-vous
que l’agriculteur pense à sa flexion–extension quand il tra-
vaille ? Pourtant, cette fonction « inconsciente » est impor-
tante quand il est dans son champ. Cette fonction pourra
devenir « consciente » quand un traumatisme viendra blo-
quer ce coude. La perte d’une certaine mobilité rendra le
travail plus difficile. Le chirurgien plasticien « débloquera »
le coude et le rendra plus mobile par l’utilisation d’un lam-
beau, qui est une technique sophistiquée de chirurgie plasti-
que. Dans ce cas précis, nous pouvons dire que la fonction
(retrouvée) est l’objet de la satisfaction. L’action sensible du
geste a surtout été plastique en redonnant la mobilité à ce
coude.
À l’opposé, un enfant présentant un coude bloqué par une
malformation congénitale (par exemple, un stade important
d’un syndrome de Poland) peut ne pas être demandeur d’un
geste sur le coude. La fonction « flexion–extension » de ce
coude n’est pas « représentée » chez l’enfant. La demande de
satisfaction sera surtout d’ordre esthétique. La motivation
première est d’avoir un coude « normal », ce qui sous-entend
un coude plus « joli », de la même taille que l’autre... La
fonction, ici, n’est pas la motivation. Dans une forme ex-
trême de malformation congénitale, comme l’absence d’un
bras, l’enfant ne comprend pas pourquoi le chirurgien lui
impose une prothèse. C’est un peu comme si, aujourd’hui,
une équipe chirurgicale vous propose de greffer un petit bras
sur votre front en vous expliquant qu’il vous sera d’une
grande utilité pour manger. Vous pouvez imaginer votre op-
position.
Tout cela démontre l’importance de la sensibilité dans le
geste plastique et l’importance de la notion de satisfaction.
Le geste sera sensible s’il sait redonner la fonction à cette
satisfaction et cela, quelle que soit la technique employée. Le
geste restera sensible s’il sait redonner l’esthétique à cette
fonction.
7. Ce que nous avons appris
Nous avons appris, également, que la chirurgie esthétique
pouvait faire de l’humanitaire, même en France ou dans les
pays qui ne sont pas en voie de développement. Nous n’avons
292 P. Knipper / Annales de chirurgie plastique esthétique 48 (2003) 288–294
 6
6
 7
7
1
/
7
100%