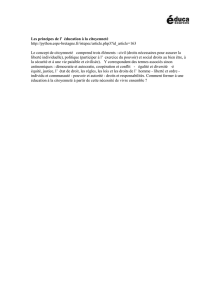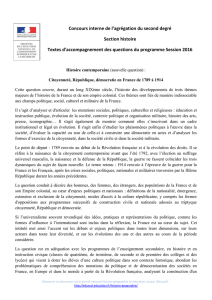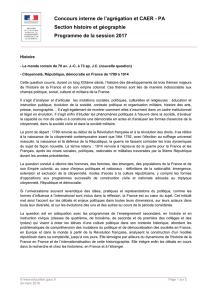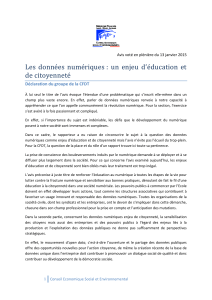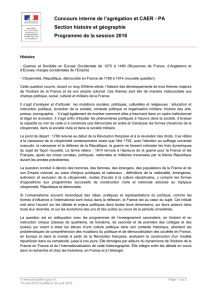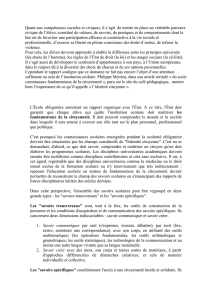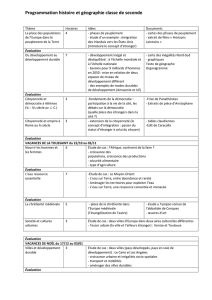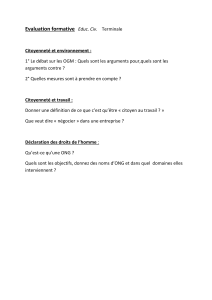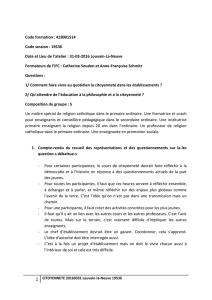CULTURE GENERALE THEME N°1 : L`INDIVIDUALISME L

CULTURE GENERALE
THEME N°1 : L’INDIVIDUALISME
L’individualisme dans la culture ancienne
L’individualisme est une problématique moderne, et en même temps une
problématique de la société occidentale contemporaine.
Il faut partir de la définition du terme. Le terme « individualisme » a été introduit dans
la langue française assez tardivement, en 1825. Le dictionnaire Robert donne de
l’individualisme la définition suivante : « Théorie ou tendance à voir dans l’individu une
valeur suprême, et ce dans 3 domaines : économique, politique et moral. ». C’est une notion
qui se place constamment en opposition avec des systèmes de pensée qui se définissent
comme l’exact contraire de l’individualisme, comme le communisme ou le collectivisme. Sur
un plan contemporain, l’individualisme est en tension avec le communautarisme.
Aux alentours des années 1825, le 1er à avoir donné une définition de l’individualisme
est Tocqueville : « L’individualisme est une expression récente qu’une idée nouvelle a fait
naître. Nos pères ne connaissaient que l’égoïsme. ». Tocqueville (1805-1859), De la
Démocratie en Amérique (1835), c’est en étudiant la démocratie américaine que Tocqueville a
conceptualisé la notion d’individualisme.
L’individualisme est défini comme une notion récente, ce qui présuppose que
l’individualisme est profondément lié au développement de la démocratie, ce qui présuppose
qu’avant il n’y avait que l’égoïsme. Il faut quand même aborder les arrières plans culturels qui
conduisent à la notion de l’individualisme au début du XIXème siècle.
Chez les grecs et les latins, on peut parler d’une notion que les historiens ont défini
comme le contraire de l’individualisme, c’est la société holiste, qui signifie que l’individu
forme un tout avec la société.
Dans La République de Platon, soumission de chaque individu à la loi commune.
Le christianisme, par la volonté de spiritualité qu’il exige, va développer une vie
intérieure, donnant une certaine forme d’autonomie à l’individualisme. La vie intérieure
orientée vers Dieu c’est le détachement de l’homme de la Cité (cf. film « Des hommes et des
Dieux »).
La création du mouvement protestant (1517 : écrits de Luther qui proclament une
critique de l’Église catholique) explique également l’individualisme. Luther dit qu’il ne faut
plus d’intermédiaire entre les hommes et Dieu. Luther ajoute que c’est à l’homme de modifier
son environnement, c'est-à-dire que l’individu doit cultiver une prospérité matérielle, et sa
richesse personnelle, individuelle, est un signe d’élection. Cela explique le fait que l’on dise
que la religion protestante est liée au capitalisme et au libéralisme. Cette idée là va fleurir en
Suisse, en Angleterre, en Allemagne et aux États-Unis. C’est là que l’on retrouve Tocqueville.

Tocqueville va aux USA pour étudier le système de prison, ce qui est un prétexte pour
étudier la démocratie. Dans son œuvre, plusieurs chapitres parlent de l’individualisme.
Avec la Réforme, se met en place une volonté d’élargir la pensée individuelle. Dans
Le Tiers livre (1546) de Rabelais, Pantagruel dit : « Il faut être le libre interprète de sa propre
entreprise. ».
Benjamin Constant a écrit un roman qui s’appelle Adolph (1816), et fait partie de ces
intellectuels qui ont à la fois une dimension politique et littéraire. Il réfléchit à la liberté
individuelle. Dans un discours de 1819, il dit : « La liberté individuelle, je le répète, voilà la
véritable liberté moderne. Les gouvernements qui partent d’une source légitime ont de moins
qu’autrefois le droit d’exercer sur les individus une suprématie arbitraire. ». Autrement dit,
Benjamin Constant prône l’individualisme moral et politique. Pour lui, l’ordre politique doit
être enraciné dans la liberté inhérente à chaque individu. Autrement dit, il fait partie de ces
penseurs politiques qui, au XIXème siècle, considèrent que l’individu doit être au centre de
toutes les décisions et que l’État doit avoir une action limitée. Bien entendu, tout ceci est lié à
la Révolution industrielle et au fait que l’économie a besoin d’initiatives privées individuelles
pour se développer.
Tocqueville, dans De la Démocratie en Amérique, va fortement nuancer ce point de
vue.
Au moment de la Révolution, Emmanuel Kant, philosophe allemand, a écrit Critiques
de la raison pure (1787), et il a écrit Critiques de la raison pratique (1788). Il considère que
l’individu doit avoir une forme d’autonomie, mais surtout il doit être responsable.
Rousseau, dans Du contrat social (1762), considère que l’individu est complètement
au service de la société, que la société est au service de l’individu, dans une harmonie idéale.
On va lui opposer le fait que les hommes ne sont pas forcément enclins à tout mettre en
commun. Lui, en réponse, va inventer la religion de l’être suprême qui consiste à apprendre à
aimer son prochain. Robespierre, avec la Terreur, va notamment reprendre les idées de
Rousseau.
Tocqueville, dans son ouvrage, montre les limites de la démocratie. En 1830, aux
États-Unis, la religion est une limite par exemple. La métaphore des anneaux de Tocqueville :
« L’aristocratie avait fait de tous les citoyens une longue chaîne qui remontait du paysan au
roi ; la démocratie brise la chaîne et met chaque anneau à part. ». Donc la démocratie a
tendance à mettre les individus à part. Le principal danger de l’individualisme dans une
démocratie c’est que l’individu ne s’intéresse qu’à lui, se replie vers une forme d’égoïsme et
néglige la question du politique et du social. Dans ce cas, la démocratie ne peut plus
fonctionner. Donc Tocqueville dit que la démocratie produit elle-même son propre poison.
Tocqueville est également un moraliste.
L’individualisme dans la culture moderne

Il y a un philosophe contemporain qui a beaucoup réfléchi à la question de
l’individualisme, c’est Emmanuel Lévinas, Totalité et infini (1974). Il fonde une partie de sa
philosophie sur la définition de l’individualisme. Il a une très belle métaphore qui est le
ravissement du visage. Il dit que « Les meurtriers ont du mal à regarder leur victime en face,
car ils sont pris par leur ravissement du visage. ».
Il fait la distinction entre 2 formes d’individualisme : « l’individualisme de l’être » et
« l’individualisme éthique ». L’individualisme de l’être est l’individualisme matérialiste :
l’individu est plongé dans la prolifération des biens matériels et dans la satisfaction
égocentrique de soi. C’est l’individualisme de l’être qui définit l’homme occidental dans sa
modernité. En revanche, l’individualisme éthique est un concept positif. Lévinas part de l’idée
que le pouvoir politique peut toujours exercer une violence. Dès lors, l’individu doit en
appeler à la vigilance de sa conscience individuelle, l’individualisme éthique étant une forme
de résistance face à l’oppression politique.
Gilles Lipovetsky, L’ère du vide (1983), Les temps hypermodernes (2004). Il se
définit comme un disciple de Tocqueville. Il est considéré comme un grand spécialiste de
l’individualisme. Il a exploré tous les champs de l’individualisme contemporain. Dans L’ère
du vide, il dénonce la désertion des valeurs, c'est-à-dire du politique, du syndicalisme.
Autrement dit, l’individu contemporain n’adhère plus. Il explique que dans les années 80, on
assiste à un surinvestissement de l’espace privé au détriment de la vie sociale et politique.
L’individu se détache de la Cité et se replie sur sa sphère personnelle. Dès lors, la société
contemporaine connaît une dérive individualiste, c'est-à-dire que l’individu contemporain met
au point des processus de dérivation de l’intérêt politique et social vers des intérêts purement
privés et exclusifs. Il donne comme exemple les films de Woody Allen.
Cet individualisme est-il forcément négatif ? Non, car ainsi il y a un épanouissement
personnel. Le plus grand philosophe français contemporain, Michel Foucault (1926-1984) a
écrit Surveiller et punir (1975). Il dit que la société moderne développe le libéralisme, mais
elle développe au bout du compte un univers disciplinaire, car les individus sont enfermés
dans des normes et sont en permanence surveillés. Il appelle ça « l’univers disciplinaire ». Dès
lors, l’individu, pour sortir de cet univers, a comme ressource sa propre fantaisie. Exemple : la
mode.
La définition de la société hypermoderne entend l’exagération. La société
hypermoderne est marquée par le royaume de la dérégulation, car tout explose (les actions
financières et boursières par exemple). On est dans une société hypermoderne, car on est dans
une société hyperbolique, c'est-à-dire une société de l’exagération. Évidemment on assiste à
un hyper-individualisme, car l’individu a toujours voulu s’adapter au rythme de la société, et
souvent par une débauche d’individualisme.
La référence littéraire de l’homme pressé : L’homme pressé (1941), Morand.
L’hyper-individualisme prend la forme du narcissisme, c’est le narcissisme
contemporain. Ce narcissisme contemporain s’appuie sur le développement de soi (yoga,
psychologie). Il y a notamment l’obsession narcissique de la santé (chirurgie esthétique,

marché et obsession de la longévité, le fait de manger sain, faire du sport). Dès lors, on
connait un surinvestissement dans l’estime de soi. De même, nous connaissons, à l’heure
actuelle, une hyper-jouissance, la jouissance étant l’un des moteurs de l’individualisme. On va
essayer de travailler cette hyper-jouissance de manière symbolique (les phénomènes de
célébrité, les traders).
Easton Ellis, American psycho (1991) : l’hyper-jouissance conduit à la délinquance.
Le carpe diem : c’est la jouissance du présent. L’individualiste veut profiter du
présent. Aujourd’hui, nous connaissons tout de même un carpe diem inquiet, car les gens sont
inquiets de l’avenir.
Cet hyper-individualisme moderne procure-t-il le bonheur ? Non, car il entraîne une
insatisfaction au quotidien, un manque de confiance en soi et le fait de ne pas penser aux
autres entraîne la solitude. Cf. Extension du domaine de la lutte (1994), Houellebecq : il décrit
la souffrance contemporaine qui vient de l’individualisme.
L’individu hypermoderne a aussi une conscience éthique, un ethos, c'est-à-dire qu’on
peut très bien être individualiste, mais se soucier des autres en même temps. Au départ, on
connaît une grande expression de la liberté, de la jouissance individuelle, mais en même
temps on a besoin d’ordre et de régulation. En fait, on cherche un nouvel équilibre.
La politique du care est issue d’une sociologue, Y. Tronto, Un monde vulnérable pour
une politique du care : il s’agit de redéfinir les frontières entre la vie publique et la vie privée.
THEME N°2 : LA FAMILLE COMME PILIER DE LA CIVILISATION
OCCIDENTALE
_ Naissance de la famille moderne (1977), Édouard Shorter, édition « Le seuil ».
_ L’enfant et la vie familiale sous l’Ancien Régime (1973), Philippe Ariès, édition « Le
seuil ».
_ La révolution de l’amour pour une spiritualité laïque (2010), Luc Ferry.
_ Le mariage d’amour a-t-il échoué ? Pascal Bruckner, édition « Grasset ».
Il faut noter l’importance des représentations littéraires et artistiques en ce domaine.
C’est la littérature qui révèle les grands traits de l’évolution familiale.
D’abord d’un point de vue littéraire, philosophique et anthropologique, la famille entre
en résonnance avec l’histoire du sentiment amoureux. Cf. thèse de « L’amour et l’Occident »
(1939), Denis Rougemont. La question qui est posée dans cette thèse est de savoir si cet
amour est un sentiment naturel ou une construction culturelle. On peut faire dériver cette
question du côté de la famille.
Des chefs d’œuvre de littérature ont présenté une vision de la famille qui a permis une
évolution.
D’un point de vue sociologique, la pièce « Le jeu de l’amour et du hasard » est le
triomphe du sentiment amoureux dans le mariage.

Shorter dit que c’est l’amour romantique qui a changé les choses en matière de famille
parce que le couple a désormais la possibilité de créer ses propres formes de tendresse et
d’affection, et puis il y a l’empathie qui entre en ligne de compte, c'est-à-dire que les conjoints
se mettent à la place de l’autre pour comprendre ses problèmes et ses souffrances. La
révolution romantique a changé les mœurs. Le choix du conjoint, à la naissance de la famille,
dépend dans une certaine mesure d’un conditionnement culturel. Au XIXème siècle, ce
conditionnement vient du romantisme. Cf. La nouvelle Héloïse, Rousseau. Dans l’ouvrage de
Shorter, on parle de « l’aventure amoureuse de l’humanité ». C’est la fonction de la littérature
de porter l’aventure amoureuse de l’humanité, pour le meilleur (cf. tous les romans d’amour)
et pour le pire (cf. la nouvelle « Aux champs », Guy de Maupassant).
En quoi la nouvelle « Aux champs » est-elle toujours actuelle ?
Il y a le jugement des enfants, le regard des enfants, vis-à-vis de leurs parents. C’est le
problème du sentiment de l’enfant. L’amour paternel ou maternel est-il acquis ou naturel ?
C’est également la problématique de l’adoption. C’est la question de l’Arche de Zoé,
novembre 2007, qui propose des adoptions contre de l’argent, mais ces orphelins n’étaient pas
orphelins. Quel est le prix de l’adoption ? Il y a surtout le capital affectif.
I. De la famille traditionnelle à la famille moderne
A. Une institution conservatrice
Le pater familias à Rome est le modèle familial qui se construit et qui constitue la
base. Cette structure, au fils des siècles, a été perçue comme un cadre de rigidité. Si cette
structure s’est inscrite durablement dans le paysage social occidental, le mariage en lui-même
n’allait pas de soi.
Ariès affirme que l’Église catholique considérait le mariage comme une concession
faite à la sexualité. Le mariage, au Moyen-âge, ne se faisait pas à l’intérieur de l’Église, mais
sur le porche de l’Église. Ariès pointe aussi du doigt le fait que les enfants du mariage, pour
l’Église catholique, étaient reçus avec une certaine méfiance parce qu’ils étaient l’œuvre de la
chair. Cette tradition perdure encore lors de la célébration actuelle du mariage catholique
puisqu’il y a ensuite un passage sur le porche. Ce modèle a suscité révolte et contestation.
Ce foyer de contestation par rapport à la famille est porté par la littérature. Cf. Les
nourritures terrestres (1895), André Gide : « Famille je vous hais ! Foyers clos ; portes
refermées ; possessions jalouses du bonheur. ». André Gide a ouvert le mouvement littéraire
de la contestation familiale. Cf. François Mauriac. Cf. Vipère au poing (1948), Hervé Bazin
(1911-1996) : c’est l’œuvre la plus marquante concernant la contestation familiale.
Durant le XXème siècle, la contestation de l’autorité familiale était si forte qu’on a mis
en place des modèles alternatifs à la famille. Ex : la création des appartements
communautaires lors de la Révolution bolchévique. Autre ex : les communautés hippies.
La famille, pendant des siècles, a été considérée comme une unité de production, elle
était ramenée à sa fonction économique. Les enfants avaient un rôle particulier, soit ils étaient
considérés comme une source de prospérité économique et ils prenaient dans ce cas le relais
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
1
/
63
100%