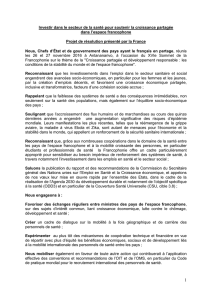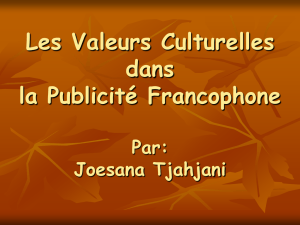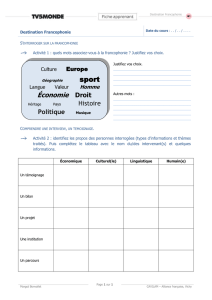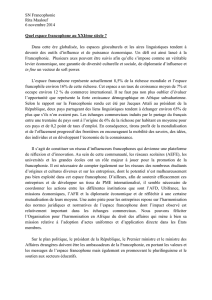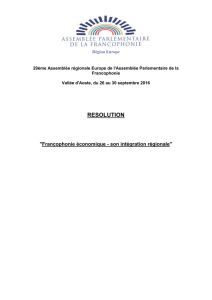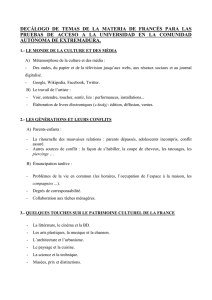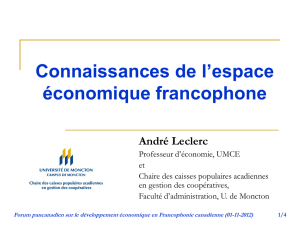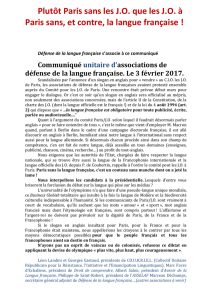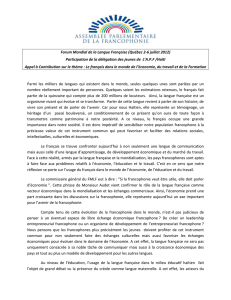La Francophonie dans la mondialisation

Les "Dix-huitièmes Entretiens" du Centre Jacques Cartier Lyon, 5 décembre 2005 Michel Guillou 1
Les "Dix-huitièmes Entretiens" du Centre Jacques Cartier - Rhône-Alpes
du 2 au 7 décembre 2005
Le combat pour la diversité culturelle
Thème 1 – Le combat pour la diversité culturelle, une des réponses au processus de
mondialisation?
La Francophonie dans la mondialisation
Michel Guillou
Directeur de l’Institut pour l’Etude de la Francophonie et de la Mondialisation (IFRAMOND)
Titulaire de la chaire Senghor de la Francophonie de l’Université Jean Moulin Lyon III.
Personne ne nie aujourd'hui que dans l'actuel contexte de "globalization", c'est à dire de
mondialisation libérale et marchande, il existe des risques majeurs d'uniformisation, de pertes de
valeurs et d'abandon de toute éthique sociale au profit d'une recherche exacerbée du gain. Chacun
sait aussi que la lutte pour la diversité culturelle a toujours fait partie du combat francophone et ce
dès le lancement du concept de Communauté francophone dans les années 50 par Léopold Sedar
Senghor et Habib Bourguiba.
Aux côtés des Etats, des coordinations, avec les enceintes et les forums internationaux de la
société civile, en collaboration avec les autres grands espaces linguistiques, la Francophonie s'est
toujours mobilisée pour la diversité culturelle. Elle a été moteur dans le refus de considérer les
biens culturels comme de simples marchandises. A l’Ile Maurice, en 1993, au cinquième Sommet
de la Francophonie, elle a pris position pour « l'exception culturelle » qui a été accordée pour dix
ans, par le GATT en 1995.
Depuis, elle confirme son engagement pour la diversité culturelle par des prises de positions
fortes lors de ses principaux rendez-vous internationaux. En juin 2001, lors de leur troisième
Conférence à Cotonou au Bénin, les ministres francophones de la culture reconnaissaient « les liens
étroits que la diversité culturelle entretient avec la dignité humaine, les libertés fondamentales et les
droits de l'Homme ».

Les "Dix-huitièmes Entretiens" du Centre Jacques Cartier Lyon, 5 décembre 2005 Michel Guillou 2
Lors du neuvième Sommet de la Francophonie à Beyrouth, au Liban, en 2002, les chefs
d'Etats et de gouvernement ont salué la déclaration de l'UNESCO sur la diversité culturelle adoptée
par la 31ème Conférence générale du 2 novembre 2001 et apporté tout leur appui au « principe
d’élaboration d'un cadre réglementaire universel » d'ici l'année 2005, terme du cycle de négociation
à l'OMC.
Ce cadre existe maintenant, il s'agit de la convention internationale sur la protection et la
promotion de la diversité des expressions culturelles adoptée le 20 octobre 2005 par la 33ème
Conférence générale de l'UNESCO par 148 voix pour, deux contre, les Etats-Unis et Israël, et
quatre absentions, l’Australie, le Nicaragua, le Honduras et le Libéria. Les Etats-Unis se sont
opposés jusqu'au dernier moment à cette adoption, afin de maintenir leur pesante hégémonie dans
le domaine des industries culturelles, notamment cinématographiques, qui sont leur principale
source de recettes d'exportation, avant les industries aéronautiques et de l'armement. Le combat
acharné mené sans succès par les Etats Unis contre cette convention illustre les différences qui
existent entre les valeurs de l'universalisme américain et celles l'universalisme francophone.
C'est une importante victoire, pour les Etats et les sociétés civiles, qui ont mené ensemble ce
combat. Un pas important vers le découplage nécessaire entre libre-échange et économie de la
culture a été réalisé. Les acquis principaux du texte ne sont négligeables : il reconnaît que les biens
et les services culturels ne sont pas des marchandises comme les autres, et ne relèvent donc pas de
la seule compétence de l'OMC, et que les Etats ont le droit d'aider financièrement leurs industries
culturelles, et de les protéger. Ne boudons pas notre plaisir.
C'est aussi une victoire de la France, et elle est perçue comme telle aux Etats-Unis et dans le
monde. Mais rappelons que c'est, à l'origine, un combat du Québec, dont la première étape fut
remportée lors des négociations de 1987-88 sur l'ALENA (Association de libre-échange nord
américain entre le Canada, les Etats-Unis et le Mexique).
Il faut regretter que le rôle de l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) et de
son Secrétaire général -le Président Abdou Diouf- ait été si peu mis en évidence. C’est tout
particulièrement le cas en France, ce qui traduit bien le peu d'intérêt que portent les élites et les
médias français à la Communauté francophone.

Les "Dix-huitièmes Entretiens" du Centre Jacques Cartier Lyon, 5 décembre 2005 Michel Guillou 3
Mais c'est une demi-victoire, car il est permis de penser que ce texte ne permettra pas à la
vingtaine de pays qui ont signé des accords commerciaux bilatéraux avec les Etats-Unis de remettre
en cause les articles portant sur la culture. Washington exercera, par ailleurs, d'énormes pressions
pour signer d'autres accords dans lesquels ils incluront la renonciation aux protections des
industries culturelles nationales.
Par ailleurs, la convention UNESCO n'a pas de valeur réellement contraignante en droit
international, et n'a pas préséance sur les autres traités, notamment celui de l'OMC, avec lequel elle
pourrait paraître en contradiction. On peut craindre aussi que l'absence d'organe de règlement des
différends ne favorise à terme l'OMC.
Enfin, cette convention, pour entrer en vigueur, doit être ratifiée par au moins trente Etats, et
on estime qu'il en faudrait beaucoup plus pour lui donner un poids réel. Les pays n'ont aucun délai
précis pour ratifier. Certains pourraient prendre des années. On peut s'attendre à ce que les Etats-
Unis pèsent de tout leur poids pour empêcher ou pour retarder au maximum la ratification. Le débat
n’est donc pas clos.
Le président Abdou Diouf a lancé un appel aux 63 membres de la Communauté
francophone pour qu'ils ratifient rapidement le texte de la convention. Il apparaîtrait naturel que ces
ratifications se fassent avant la tenue du onzième Sommet de la Francophonie à Bucarest en
septembre 2006. Le pourcentage de ratification à cette date sera tout naturellement perçu comme un
test de bonne ou de mauvaise santé pour la Francophonie. Donnant l'exemple, le Québec et le
Canada ont déjà ratifié.
La bataille de Paris à l'UNESCO acquise dans la joie n'est qu'une étape. La guerre sur le
plan juridique n'est pas gagnée. La société civile, les Etats, leurs regroupements et pour ce qui la
concerne, la Francophonie, doivent rester vigilants et mobilisés pour assurer, le « service après-
vente » de la convention.
D'autres combats doivent aussi parallèlement être menés au niveau mondial, national et
francophone. Celui de la diversité linguistique d’abord, parce que les langues, tout autant que les
cultures sont des biens communs de l'Humanité, mais aussi parce qu'il n'y a pas de diversité
culturelle pérenne possible sans diversité linguistique. Quand, dans tous les pays, au nom du
« principe d'efficacité », les enfants de la maternelle à l'université apprendront comme langue

Les "Dix-huitièmes Entretiens" du Centre Jacques Cartier Lyon, 5 décembre 2005 Michel Guillou 4
seconde une seule langue étrangère, l'anglais, quand, dans les sciences, la diplomatie, au travail,
dans l'entreprise, dans les médias, l'anglais sera devenu le véhicule commode, naturel et maîtrisé,
quelle place restera-t-il pour l'expression des cultures autres que la culture dominante? Ne faisons
pas en sorte d’être les Indiens du XXIème siècle.
Plus largement, le choix d'une mondialisation humaniste, équilibrée, diverse qui rejette tout
autant l'intégrisme que l'unilatéralisme, et l'approche impériale, doit être cohérent. Il doit engager
les Etats, leurs regroupements, les sociétés civiles, du local à l'international et dans tous les
domaines, au-delà du culturel et du linguistique. Il y a un coût, le coût de la liberté.
Une convention internationale pour la diversité culturelle, aussi contraignante, serait-elle,
n'y suffirait pas à elle seule. C'est le choix du « pluriel » sur « l'unique » qui doit être fait de haut en
bas, dans tous les secteurs de l'activité humaine, et pour les langues, celui du plurilinguisme.
Comment vouloir la diversité culturelle au niveau mondial et, par laisser-faire, faute d'une
réelle volonté politique, laisser l'anglais devenir insidieusement la seule langue étrangère du cursus
éducatif. Le choix du pluriel est un tout. Qui est plus moderne d'HEC Montréal qui dispense ses
enseignements en français, en anglais, en espagnol ou d’HEC Paris qui fait le choix du seul
anglais ?
A côté des législations linguistiques, dont la Loi 101 au Québec, est un modèle, pour
promouvoir et défendre les langues nationales, au-delà des subventions et des quotas, il faut
affirmer le besoin de politiques d’apprentissage des langues qui débouchent sur le multilinguisme,
c’est à dire sur la connaissance à égalité de deux ou plusieurs langues étrangères, autres que la
langue nationale ou locale.
Mais le combat pour la diversité culturelle ne s'arrête pas là en Francophonie. Il faut que la
Communauté francophone offre une garantie de diversité culturelle en son propre sein. Ce n’est pas
le cas, si l'on en juge par les difficultés que continuent à rencontrer les artistes pour circuler et
diffuser leurs créations du Sud au Nord, mais aussi du Sud au Sud.
Plus généralement, l'espace francophone peut-il être un espace de diversité culturelle sans
qu'existent en Francophonie des préférences de circulation pour les biens, services et produits
culturels. De plus, en Francophonie, comme ailleurs, l'écart reste considérable en terme

Les "Dix-huitièmes Entretiens" du Centre Jacques Cartier Lyon, 5 décembre 2005 Michel Guillou 5
d’équipement entre pays du Nord et pays du Sud: aucune salle de cinéma au Laos, pas d'édition
centrafricaine depuis plus de dix ans, des salles fermées depuis plus de vingt ans à Madagascar...
Dans les pays du Sud, notamment en Afrique, des difficultés récurrentes sont à l'œuvre:
étroitesse des marchés nationaux, faiblesse du pouvoir d'achat, manque de matériel et d'équipement,
manque de soutien aux Etats et d'instauration de véritables politiques culturelles, ravages de la
piraterie, etc. Quant aux pays d'Europe Centrale, ils occupent une position médiane avec néanmoins
des secteurs très sinistrés pour les plus pauvres d'entre eux.
Lors d'un débat sur la diversité culturelle, organisé à l'occasion du deuxième forum social
européen à Paris le 13 novembre 2003, Babacar Sall soulignait qu'à son sens la question de la
prééminence américaine ne signifie pas automatiquement déconstruction de la domination
européenne que connaît l’Afrique.
Ce rapide tour d’horizon amène une réponse contrastée à la question formulée d’entrée de
jeu. La Francophonie offre bien un réel espace à la diversité culturelle, mais il lui reste encore à
relever deux défis pour l’inscrire pleinement au cœur de sa politique :
- le défi de la non-marchandisation des produits culturels avec la nécessité de développer des
industries culturelles au Sud,
- le défi de la mise en valeur de toutes les composantes de la pluri-appartenance, quand il y a une
culture dominante.
En Francophonie, comme ailleurs, le maintien des cultures et de leur diversité implique
simultanément protection, dynamisme et ouverture. Cela ne peut être le cas que si ces cultures sont
portées par des sociétés fortes et développées. Voilà pourquoi la Francophonie ne peut qu’être
globale. « On a pris l’habitude de parler de culture d’un côté, d’économie de l’autre, comme si
l’économie n’était pas un des éléments prépondérants de la culture ! Domine le monde aujourd’hui,
la culture du pays le plus puissant économiquement ! Voilà pourquoi l’espace francophone sera ce
que sera son économie »1.
1 Nicéphore Soglo, Président du Bénin, cité par Lise Bacon, Vice-Première ministre du Québec, « Exposé liminaire »,
p.281, in Actes de la cinquième Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement des pays ayant le français en
partage, Grand-Baie (Maurice), 16, 17 et 18 octobre 1993, Secrétariat de la Conférence, 434p
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%