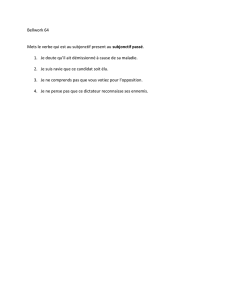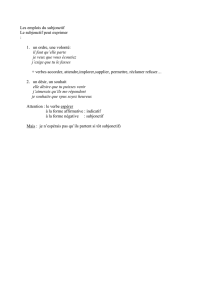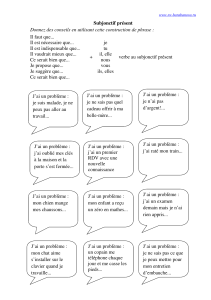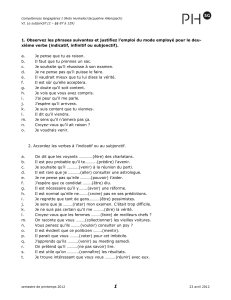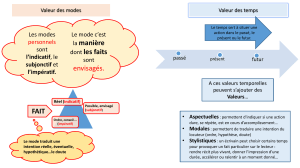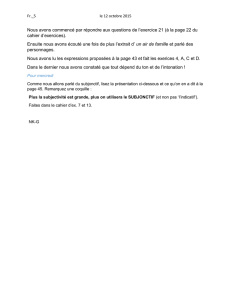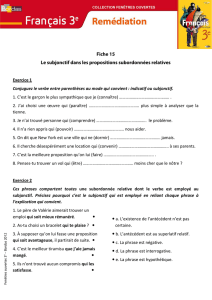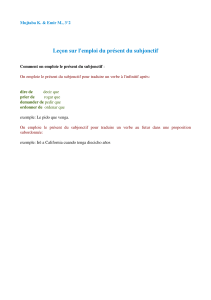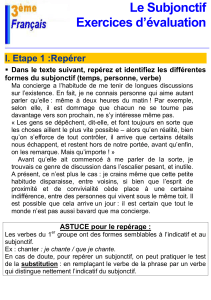ETUDE LINGUISTIQUE SUR LE SUBJONCTIF DANS FRANCAIS
publicité

ETUDE LINGUISTIQUE SUR LE SUBJONCTIF DANS FRANCAIS PARLE A WATERVILLE, MAINE BY Alexandra Todorova M.A.T. University of Plovdiv, Bulgaria, 1996 A THESIS Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Arts (in French) The Graduate School The University of Maine May, 2005 Advisory Committee: Jane S. Smith, Assistant Professor of French, Advisor Raymond Pelletier, Associate Professor of French Kathryn Slott, Associate Professor of French O 2005 Alexandra Todorova ALL Rights Reserved ETUDE LINGUISTIQUE SUR LE SUBJONCTIF DANS LE FRAlVCAIS PARLE A WATERVILLE, MAINE Par Alexandra Todorova Directeur-Conseiller: Professeur Jane Smith Rksumk du mkmoire Le but de la prksente recherche est de contribuer B l'ktude de l'emploi du subjonctif dans le fianqais franco-amkricain de la Nouvelle-Angleterre en considkrant l'influence des variables sociales et linguistiques sur le choix de mode dans un contexte de langue minoritaire. Les donnkes proviennent du projet fond6 par le profess& Smith sur l'ktude du franqais franco-amkricain. Ayant en vue que les langues orales sont plus susceptibles perdre des forrnes linpistiques nous avons tichk de trouver si le subjonctif est encore vivant dans la variation du fianqais franco-amkricain. Cette ktude est baske sur trente interviews faits entre 2002 et 2004 a Waterville, Maine, par le Professeur Smith. Les statistiques descriptives et les statistiques d'infkrence sont faits avec le programme SPSS. Les rksultats montrent que le subjonctif est encore vivant dans ce dialecte mais son emploi est lirnitk en comparaison avec le franqais standard. Les locuteurs emploient ce mode dans la moitik des " contextes subjonctifs" tandis que dans l'autre moitik le subjonctif se substitue a l'infinitif et a I'indicatif. Les Franco-Amkricains de Waterville emploient le plus souvent le subjonctif aprbs l'expression ilfatlt, aprbs certaines conjonctions et aprbs le verbe vouloir. En ce qui concerne les facteurs sociaux-l'ige, le sexe et la formation, 1'Age s'avbre un facteur significatif qui influence le choix du subjonctif: les plus BgCs tendent A l'employer plus. Cette recherche ouvre de nombreuses questions pour les ktudes futures: l'emploi et la cornparaison du subjonctif dans d'autres communautts de la NouvelleAngleterre, le rBle des facteurs sociaux dans un tchantillon plus grand, l'emploi du franqais franco-amkricain compark au franqais parlk au Qukbec et en Europe. A LINGUISTIC STUDY OF THE SUBJUIVCTIVE IN THE SPOKEN FRENCH OF WATERVILLE, MAINE By Alexandra Todorova Thesis Advisor: Professor Jane Smith An Abstract of the Thesis Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Arts (in French) May, 2005 This research contributes to the study of use of the subjunctive in FrancoAmerican French in New England, a minority language, by measuring the influence of social and linguistic variables on the choice of mood. It uses data gathered in the NSFfunded socio-linguistic investigation of Franco-American French led by Prof. Jane Smith. Knowing that spoken languages are most susceptible to losing linguistic forms, we sought to find out if the subjunctive is still alive in the Franco-American variety of the French. The present study is based on thirty interviews made between 2002 and 2004 by Professor Smith in Waterville, Maine. Descriptive and inferential statistics were run in SPSS. The results indicate that the use of the subjunctive in this dialect is still alive but limited compared to Standard French. Speakers use this mood in about half of the "subjunctive contexts." In the rest of the cases, the infinitive or the indicative is substituted for the subjunctive. The subjunctive is most often used by Franco-Americans after the expression ilfaut, some conjunctions, and the verb vouloir. With regards to the social factors--age, gender, and education, only age influences the choice of the subjunctive significantly: older speakers are more likely to use it. This research opens numerous avenues for future investigation, e.g., on the use and comparison of the subjunctive in other francophone communities in North-Eastem America, the role of the social factors within a larger sample, the use of Franco-American French compared to the spoken French in Quebec or Europe. Remerciements Je voudrais exprimer mes remerciements A ma directrice du memoire, le professeur Jane Smith, pour m'avoir guidCe et encouragee tout le long de ce travail, ainsi que pour avoir rnis A ma disposition les donnkes du projet " ~ t u d esociolinguistique du franqais franco-amkricain", subventionnk par la National Science Fondatioiz, bourse No BCS-0004039. Acknowledgments I would like to thank my advisor, Professor Jane Smith, for her guidance and encouragement during my work and also thank her for permission to use data from the project "A Sociolinguistic Investigation of the Franco-American French" funded by the National Science Foundation, grant No BCS-0004039. ... REMERCIEMENTS .......................................................................................................... 111 ... LISTE DES TABLEAUX ............................................................................................... v i i ~ LISTE DES FIGURES ....................................................................................................... x 1. HISTORIQUE .........................................................................................................1 2. MODE ..................................................................................................................... 5 2.1. Le subjonctif .................................................................................................5 2.2. Formation du subjonctif ................................................................................6 2.3. Emploi du subjonctif ..................................................................................... 8 2.4. Les polkmiques sur le subjonctif..................................................................11 3. METHODOLOGIE ................................................................................................ 17 . . 3.1. Descnptlon du corpus ..................................................................................17 3.2. Variables sociaIes-sexe, iige. niveau de formation .................................. 18 . . 3.3. Analyse quantitative..................................................................................... 20 4. ANALYSES QUALITATIVES ............................................................................ 21 4.1. Le subjonctif employ6 spontankment dans le courant de la parole dans le franqais par16 A Waterville. Maine ..................................... 21 4.1.1. Le subjonctif aprbs I'expression impersonnelle ilfaut .................................................................................22 4.1.2. Le subjonctif aprbs le verbe vouloir .....................................25 4.1.3. Le subjonctif aprks les conjonctions ...................................27 4.1.4. Les sept autres cas du subjonctif repr6sentCs dans le Tableau 4 ...............................................................28 4.1.5. ConcIusion des cas avec subjonctif ......................................29 4.2. Cas de subjonctif non rkalis6 dans les entrevues ................................30 4.2.1. Le subjonctif non r6alisk a p r b l'expression impersonnelle ilfaut .........................................................30 4.2.2. Le subjonctif non r6alisk apres le verbe de sentiment aimer .................................................................. 31 4.2.3. Le subjonctif non r6alisC apres des conjonctions ................ 32 4.2.4. Autres cas du subjonctif non rCalisC ..................................33 4.2.5. Conclusion des rksultats du subjonctif non rkalist ..............34 4.3. Le subjonctif employ6 intentionnellement dans le courant de la parole dans le frangais par16 a Waterville, Maine ............... 36 4.3.1. Conclusion des rksultats de la tiche de traduction ............50 5. SYNTHESE ........................................................................................................ 54 67) BIBLIOGRAPHIE ............................................................................................................. ANNEXE A Cas de forrnes neutres employkes dans les entrevues ................................6 5 ANNEXE B Les phrases de la tiche de traduction........................................................66 67 BIOGRAPHIE DE L'AUTEUR ....................................................................................... TABLE OF CONTENTS ... ACKNOWLEDGMENTS ................................................................................................ 111 ... LIST OF TABLES ........................................................................................................... vlii LIST OF FIGURES ................. . ......................................................................................X Chapter 1. HISTORY ..............................................................................................................1 2. THE MOOD ..................................................................................5 2.1. The Subjunctive........................................................................5 2.2. Formation of the Subjunctive .........................................................6 2.3. Use of the Subjunctive ................................................................. 8 2.4. The Debate on the Subjunctive ......................................................11 3. METHODOLOGY ......................................................................... 17 3.1. Description of the Data ...............................................................17 3.2. Social Variables .........................................................................18 3.3. Quantitative Analyses .................................................................20 4. QUALITATIVE ANALYSIS ............................................................ 21 4.1. Spontaneous Use of the Subjunctive in the Oral French of Waterville, Maine ...................................................................-21 4.1.1. Subjunctive after the Impersonal Expression ilfaut ..................22 4.1 .2 . Subjunctive after the Verb vouloir .......................................24 4.1.3. Subjunctive after Conjunctions ..........................................27 4.1.4. Seven Cases of Use of the Subjunctive Presented in 28 Table 4 ....................................................................... 4.1.5. Conclusions for the Use of the Subjunctive ............................29 4.2. Cases of Missing Subjunctive .......................................................30 4.2.1. Missing Subjunctive after the Impersonal Expression LISTE DES TABLEAUX Tableau 1 Le subjonctif apr6s I'expression ilfaut .............................................24 Tableau 2 Le subjonctif a p r h le verbe de volontk vouloir ..................................26 Tableau 3 Le subjonctif aprks les conjonctions ..............................................28 Tableau 4 Autres cas du subjonctif ............................................................29 Tableau 5 Le subjonctif non rkalis6 aprks l'expression il faut ..............................31 Tableau 6 Le subjonctif non r6alisC aprks le verbe de sentiment airner ..................32 Tableau 7 Le subjonctif non rCalis6 apr6s les conjonctions .................................33 Tableau 8 Autres cas du subjonctif non rCalis6 ..............................................34 Tableau 9 Phrase 1 A traduire I have to be there this evening 37 around 6:00........................................................................... Tableau 10 Phrase 2 A traduire You have to be there this evening 38 around 6:O............................................................................. Tableau 11 Phrase 3 2i traduire He has to be there this evening around 6:00...................................................................................................39 Tableau 12 Phrase 4 A traduire She has to be there this evening 40 arouncl6:OO........................................................................... Tableau 13 Phrase 5 B traduire You have to be there this evening around 6:00...........................................................................41 Tableau 14 Phrase 6 A traduire (To a group of people:) You have to be there this evenin around 6.40. .....................................................41 Tableau 15 Phrase 7 2i traduire (To a friend:) You have to be there this evening around 6:OO.................................................................42 Tableau 16 Phase 8 A traduire (Referring to a group of girls for a pageant) They have to he there this evening around 6:OO.................................43 Tableau 17 Phrase 9 a traduire (Referring to a group of boysfor a boy scout meeting) They have to be there this evening around 6:OO.............-44 Tableau 18 Phrase 10 ii traduire We have to do the dishes before we can go.. ............45 Tableau 19 Phrase 11 a traduire Tlze roads were so slippery we had to drive real slow.. .....................................................................46 Tableau 20 Phrase 12 a traduire (Referring to teachers when you were in school:) They didn't want us to play with a ball at recess in the school yard.. .................................................................47 Tableau 21 Phrase 13 a traduire (Referring to daughter's homework) She'll have tinze tofinish it before she goes to school tomorrow.. .........................48 Tableau 22 Phrase 14 a traduire Idorz't think they can come................................49 Tableau 23 Phrase 15 ii traduire Do you want nze to nzake n calcefor your 50 birthday? ....................................................................................................... Tableau 24 Sornmaire de tous les cas d'emploi du subjonctif dans le corpus de Waterville .........................................................................$5 LISTE DES FIGURES Figure 1 Niveau de formation des interlocuteurs .........................................-19 Figure 2 Distribution de l'ige des locuteurs ................................................19 Figure 3 Cas d'emploi du subjonctif .........................................................22 Figure 4 La frkquence d'emploi du subjonctif aprks ilfaut ...............................23 Figure 5 La frkquence d'emploi du subjonctif aprbs vouloir ..............................25 Figure 6 La fr6quence d'emploi du subjonctif aprks les conjonctions ..................27 Figure 8 Les modes et les temps employks B la place du subjonctif .....................35 Figure 9 Les modes employes dans les "contextes subjonctifs" dans la tiche de traduction ..............................................................................51 Figure 10 Les temps de l'indicatif einployCs a la place du subjonctif ......................52 Figure 11 L'emploi du subjonctif dans la tgche de traduction ..............................52 Figure 12 Le subjonctif non rCalis6 aprbs ilfaut .............................................55 Figure 13 Le subjonctif non rkalise aprks des conjonctions ................................ 56 Figure 14 Le subjonctif non rCalis6 aprks le verbe vouloir.................................56 Figure 15 Le subjonctif r6alisklnon rCalis6 dans les entrevues ............................57 1. Historique D'apres les Ctudes historiques l'irnmigration des Canadiens fran~aisaux EtatsUnis avait commence avant 1840. Dans son Ctude Immigration ofFrench Canadians to New England, 1840-1900: A geographical analysis Vicero (1 968: 89) mentionne des passages sporadiques de pionniers Canadiens franqais encore environ 1786. Le grand exode des Canadiens franqais vers le sud se situe dans une pCriode assez large, a peu prbs cent ans, de 1840 jusqu'a 1930. Se deployant aux Etats-Unis, la vague migratoire du Canada se concentre surtout en Nouvelle-Angleterre mais aussi un nombre assez considerable de Canadiens franqais se retrouve en dehors de ses frontieres dans les etats de New York et Michigan, aussi bien qu'en Floride et dans 1'Ctat de Washington. Dans le chapitre trois La Rube vers le Sud, Bruno Ramirez Ccrit "Les Canadiens franqais qui emigrent aux Etats-Unis ne proviennent pas tous du Quebec." (2003:99) D'aprks lui 8 ce mouvement de migration (1 840-1930) participent bien des Canadiens franqais de l'ontario, de I'Acadie, du Nouveau-Brunswick, de la baie de Fundy, tandis que d'autres groupes proviennent des Prairies, de Winnipeg et de Saskatchewan. Les principales regions d'accueil des migrants sont la Nouvelle-Angleterre et le Midwest (Ramirez, 2003). Le dCplacement des emigrants du Canada se projette parallblement aux Etats-Unis en suivant la direction nord-sud. Les migrants de l'est du Canada se retrouvent a l'est des Etats-Unis et ceux de l'ouest du Canada descendent A l'ouest des Etats-Unis. Ainsi les familles du nord se retrouvaient auprks de leur parent6 dkja installke au sud. Pour dCsigner ce phknombne de migration Roby (1990) emploie le terme chaine rnigratoire. Voila pourquoi suivant ce schkma les immigrants de I'ouest du Quebec se dkplacent a I'ouest de la Nouvelle-Angleterre et ceux venant de l'est du Quebec s'installent a l'est de la Nouvelle-Angleterre. Dans son livre historique Les Franco-Ame'ricairrs de la Nouvelle-Angleterre (2000) Roby Ccrit qu' "Entre 1840 a 1930, environ 900 000 personnes quittent le QuCbec pour les Etats-Unis." La cause en est 1'Cconomie moins dkveloppCe du Quebec rural et arriCrC. Deux facteurs importants favorisent l'irnrnigration des Canadiens franqais en Nouvelle-Angleterre: sa proximitk gkographique et son contexte Cconomique. Les Ctudes historiques antCrieures ainsi que les entsevues du projet Fox-Smith faites en 2002 indiquent que les Canadiens ont irnrnigrk vers le sud a la rechercher du travail. D'abord beaucoup d'entre eux ne se dkplacent que pour un travail saisonnier et plus tard retournks se sont installts en permanence avec leur famille. Le Maine est un des premiers Ctats peupiks d'un nombre considkrable d'imrnigrants canadiens a cause des industries de bois et de textile qui s'y sont dCveloppCes Cnormement pendant la deuxikme moitiC du XIX sikcle. Les immigrants canadiens dCjA Ctablis aux Etats-Unis s'identifient comrne FrancoAmhicains. Le terme Franco-AmCricain dkfini par Brault (1 979) s'attribue aux individus qui ont les caractkristiques suivantes: 1. naissance ou descendance au QuCbec ou en Acadie 2. c o m e langue maternelle franqaise 3. religion catholique 4. demicile en Nouvelle-Angleterre ou au nord de I'Etat de New York Les Franco-ArnCricains reprksentent une main-d'ceuvre importante p o u I'epanouissement de l'industrie de la Nouvelle-Angleterre en gCn6ral et du Maine en particulier. Dans beaucoup d'usines les Francos sont la majoritk prtdominante. 11 est signaler que ce groupe ethnique vivait en communautCs fermCes appelCes "Petits Canadas", situCes le plus souvent autour des usines et des fabriques. Ce mode de vivre dans des sociktks fermCes a permis aux Francos-AmCricains de garder leur langue assez longtemps. 11s ont pu crCer dans ces espaces fermCes des tcoles oc l'on enseignait en fianqais et des kglises oG l'on prechait en franqais. Etant le quart de la population du Maine, les FrancoAmkricains sont le groupe minoritaire le plus important dans 1'6tat. Des six Ctats constituant la Nouvelle-Angleterre le Maine est le deuxikme (le premier est le Massachusetts) par rapport au nombre de personnes dont la langue maternelle est le franqais <http://users.adelphia.net/-frenchcx/frcanwtv.htm>. Les dernikres recherches de Madeleine Gigukre baskes sur le recensement de 1990 montrent que les FrancoArnkricains reprksentaient 22.6% (ou 277,413 personnes) de la population du Maine <hltp://www.fawi.net/Statisticsf.html>. Une des premikres villes du Maine qui est peuplCe d'un assez grand nombre d'immigrants canadiens est Waterville. Situke dans le sud-est de l'ktat, sur la route importante de "KenizebecRoad", cette ville reprCsente une attraction pour les Canadiens. Avec l'ouverture du rnoulin de coton en 1874 et l'affluence des Canadiens frangais, Waterville s'agrandit vite et devient une ville fleurissante (Fecteau 1952). C o m e preuve de l'accroissement considkrable de ce groupe ethnique dans la ville il faut mentionner qu'en 1860 il y avait 470 Canadiens franqais, qu'en 1880 ils ttaient 1 548 et qu'en 1890 leur nombre atteignait dkjh 4 300 (Vicero 1968:289). Selon Allen (1 970), 70 % d'entre eux sont originaires de Beauce (aujourd'hui connue c o m e Beauceville) au QuCbec. D'autres proviennent des villes voisines cornme Saint-Georges ou Saint-Joseph. Aujourd'hui les Franco-AmCricains A Waterville sont au nombre de 17 096, dont 39% se declarent d'origine frangaise ou canadienne-franqaise et dont 8% parlent encore (en 2000) franqais 21 la maison (Fox et Smith, A paraltre). Comne l'ethnie portant cette langue s'appelle franco-amhicaine la langue ellememe est appelke aussi franco-amkricaine. Notamrnent ce frangais reprksente l'objet d'ktude du projet Fox-Smith. Les recherches sociolinguistiques serviront A dkterrniner comment les facteurs sociaux (age, sexe, formation etc.) influencent l'emploi de la langue d'une part et d'autre part la prksente ktude contribuera A la linguistique comparative dans l'observation des differences entre le frangais franco-amkricain et le franqais standard en Europe ou le franqais du Canada. Pour contribuer a cette recherche la prksente ktude s'adressera B une catkgorie grarnmaticale - le subjonctif. Les discussions par rapport a cette catkgorie ont fait couler beaucoup d'encre. Encore au dkbut du XXe sibcle le subjonctif reprksentait une question trks discutable A cause de sa nature instable, vague et subjective et il etait considere comme une cat6gorie morphosyntaxique de la langue qui disparait: "Au XVIe sibcle le subjonctif continue son mouvement de recule.. ." (Vogel 1919:146), "Au XVIIe sikcle le subjonctif est devenu trks rare.. . On s'attendait A ce que, avec la disparition graduelle du subjonctif, les autres formes devinssent de plus en plus gknkrales." (Vogel 1919: 147). Ayant en vue que les langues orales sont plus susceptibles ii la perte des fonnes linguistiques et Ctant donnk que jusqu'aux annkes 1950 I'instruction pour beaucoup de Franco-Arnkricains se faisait en franqais, il serait intkressant de faire l'hypothbse suivante- le subjonctif est-il disparu dans le franqais parle B Waterville? L'objectif de ce travail est d'ktudier la frkquence et les cas d'emploi du mode subjonctif dans 1e franqais oral des Franco-Amkricains de Waterville, Maine et de relever comment les variables sociales et linguistiques influencent le choix du mode. 2. Le mode Le mode est une catkgorie grammaticale qui indique la f a ~ o ndont le sujet parlant considkre le procks verbal, c'est-&dire l'attitude du sujet A l'kgard du procks. Dans le "Bon usage" de Grevisse citk par Menanteau (1986:70) "les modes expriment l'attitude prise par le sujet 2i l'kgard de 1'Cnonck; ce sont les diverses manikres dont ce sujet conqoit et prksente l'action, selon qu'elle fait l'objet d'un Cnonck pur et simple ou qu'elle est accompagnke d'une interprCtationW.Une autre citation de Menanteau qui dCfinit le subjonctif en dkfinissant en meme temps les quatre modes est celle de Brunot et Bruneau (1969: 283): "au point de vue de la penske, il faut distinguer quatre modes dont chacun apporte au concept verbal une idke modale : Indicatif : Je sors (aller dehors+ idCe d'action rkaliske); Subjonctif : Qzieje sorte ou non (aller dehors+ idke simplement considkrke par l'esprit); Conditionnel : Je sortirais hien, mais.. .(aller dehors+ idke de rkalisation douteuse); ImpCratif : Sortez (aller dehors+ idCe d'ordre)". 2.1. Le subjonctif Selon les grammaires prescriptives d'aujourd'hui 1e mode subjonctif est cette catkgorie l'aide de laquelle s'exprime des actions supposkes, douteuses ou voulues dont la rkalisation est incertaine. Le subjonctif exprime llCventualitCou l'hypothktique, il se rCf6re A des actions non rkelles et il a une valeur subjective. Le subjonctif existait encore en latin avec les memes expressions, et le franqais comme langue romane, provenant du latin, garde cette catkgorie grammaticale de nos jours. La signification du mot subjonctif provient du latin suhjunctivus qui signifie "attach6 sous.. ., subordonnC1'(Le Petit Robert, 1992). Cela veut dire que le verbe exprimant le subjonctif est rnis dans la phrase subordonnke et son emploi est provoquk par le contexte ou l'action exprimke dans la phrase principale. Le subjonctif est un mode doublement personnel car dans la phrase oh il s'emploie il y a deux personnes et deux id6es verbales. I1 y a une id6e centraIe qui exprime le proces msme, appelke idee regardke et une id6e qui exprime un jugement, une appreciation, appelCe idee regardante (Guillaume (1 97 1:191) cite dans Auger (1 990:3). C'est I'attitude subjective qui y entre en jeu: si le proces est vu par le sujet parlant cornrne rCel, dans ce cas c'est le mode indicatif qui devrait etre employ6 et si le procbs est w. cornrne irreel ou soumis ?I un jugement, c'est le mode subjonctif qui devrait etre employC. Selon Le bon usage de Grevisse (1988:649), grarnrnaire qui sert de rkfkrence de la langue prescrite 21 beaucoup de linguistes, "Le subjonctif exprime, en g6nkra1, un fait simplement envisag6 dans la penske, avec une tension plus ou moins forte des ressorts de l'iime: mode subjectif et mode du dynarnisme psychique, il s'oppose ?I I'indicatif, mode objectif et statique." 2.2. Formation du subjonctif Le subjonctif a quatre formes temporelles: subjonctif prCsent, subjonctif passk, subjonctif imparfait et subjonctif plus-que-parfait. Comrne les formes de l'imparfait et du plus-que-parfait ne sont plus employees dans la langue parlke d'aujourd'hui, ce n'est pas la peine de s'arreter sur leur formation et leur emploi. Dans le frangais parlk d'aujourd'hui ne sont employkes que les deux premibres formes et ce sont elles qui vont faire l'objet de cette ktude car la pr6sente recherche ne porte que sur la langue franco-amkricaine orale. Le subjonctif prksent se forme du radical du verbe A la 3p. pl. de l'indicatif prksent en ajoutant les terminaisons -e, es, -e, -ions,-iez, -ent: I groupe: chanter- ils chnntent (3p.pl.prbs.) - chant+e que je chnnte I1 groupe:finir- ilsfinissent (3p.pl.prks.) -Jiniss+ es que tufinisses 111groupe: kcrire- ils bcrivent (3p.pl.prks.) - e'criv+e qu'il kcrive Les verbes du troisibme groupe qui changent de radical fornle le subjonctif a la 1p.et 2p. pl. de la 1p.et 2p. pl. de I'indicatif prCsent: Venir: nous venons (Ip.pl. prb.) - ven +ions Prendre: vous prenez (Ip.pl. prks.) - pren+iez que nous venions que vous preniez Certains verbes du troisibme groupe ont des formes irrCgulihes au subjonctif: Avoir: que j'ni ..., que nous nyons ... Etre: que je sois..., que nous soyons . . . Faire: que je fusse ..., que rzousfassions ... Pouvoir: que je puisse.. ., que nous puissions ... Aller: que j'aille. .., que nous nllions... Vooi: que je veuille ..., que nous voulions ... Savoir: que je sache ..., que nous sachions ... Etc ... I1 faut noter que les formes aux lp., 2p., 3p. du singulier et 3p. du pluriel des verbes du premier groupe au prCsent de I'indicatif coincident avec les formes du subjonctif present. La meme coincidence s'observe chez les verbes du deuxihme et du troisikme groupe A la 3p. du pluriel au prCsent de l'indicatif et au subjonctif present. Sand (1981 :303) parle du syncrktisme des deux modes et elle appelle ces forrnes neutres. Je vais me servir dans mes analyses du mtme terme pour dCsigner cette coincidence qui ne permet pas de juger lequel des deux modes est employ& Le subjonctif passt se forme du subjonctif prksent des auxiliaires avoir ou Etre plus le participe pass6 du verbe conjugu6: Parler: quej'aie parle' I rkflkchi RkJkchir: que ~ L aies Partir: qu'il soit parti Dans la langue parl6e le subjonctif pr6sent est employ6 pour exprimer une action simultanke ou postkrieure par rapport h I'action dans la phrase principale. Ex: Je soulzaite qu'il soit heurezu: (id6e future). Je doute qu'il soit heureux (simultankit6). Le subjonctif pass6 est employ6 pour exprimer 11ant6riorit6vis-h-vis de l'action principale. Ex: Je doute qu'il nit kt6 Izeureux (id6e antkrieure). 2.3. Emploi du subjonctif La description du subjonctif se regroupe dans deux cas globaux: subjonctif dans une phrase indCpendante et subjonctif dans une phrase subordonnte. D'abord, dans une plzrase indkpendante le subjonctif s'emploie pour exprimer un souhait (1). Le subjonctif du verbepouvoir. suivi de l'infinitif exprime aussi un souhait (2). ( 1 ) Qu'ils soient heureux!, Vivent les vacances! (2)Puisses-tu re'ussir! Le subjonctif en fi-anqais exprime encore un ordre (3), une surprise ou une indignation (4), ou une concession (5). ( 3 ) Qzl'ils se taisent!, Qu'elles viennent tout de suite! ( 4 )Lui, qu'il sache qa! ( 5 ) Que les enfaizts viennent avec nous, soit! Meme dans le cas d'emploi du subjonctif dans une proposition indkpendante, il y a une idke regardante mais elle est implicite (sous-entendue). L'emploi du subjonctif dans une phrase dCpendante ou subordonnke est provoquC par le jugement du sujet dans la phrase principale. Cela rend le verbe subordonnk dkpendant du verbe principal. La conjonction de subordination que introduit toujours le subjonctif. ( 6 )Je voudrais qtle Pier-re vieizne ci cette riuniorz. Le verbe vouloir exprimant un souhait dans la phrase principale implique l'emploi du verbe subordonnk verzir au subjonctif. Etant un mode doublement personnel, le subjonctif se refhe aux deux sujets diffkrents dans chacune des phrases principales et subordonnkes. Si les deux sujets coincident alors c'est l'infinitif qui est employk. (7)Je voudrnis verzir ci cette rkunion. Le subjonctif peut etre utilis6 dans trois types de propositions subordonnkes: complCtive, relative et circonstancielle. On emploie le subjonctif dans une subordonnke complCtive aprks un verbe ou expression B la principale qui exprime une volontk (vozrloir, dksirer, souhaiter, prkfkrer, cominander, ordonner, demander-, insister, &fendre, interdire, empEcher, exiger, proposer, admettre, prier, supplier, refuser, pi-escrire, etc.), un doute (douter, hisiter, contester, nier, il est possible, il est peu probable, il sernhle, il se peut que), un sentiment (aimer, airner mieux, s'ktonner; se rkjouir, se plaindre, avoirpeur, cr-aindre, avoir honte, regretter plus les constructions attributives &re dksoli, Etre triste, Eti-e heurem, &re impatient, gtrefier, gtre content, etc.) ou une opinion avec les verbes penser, croire et trouver qui, a la forme n6gative ou interrogative, expriment un doute. L'emploi du subjonctif dans une phrase subordonnee relative (introduite avec un pronom relatif qui, que, donc, a ce que) exprime une qualit6 desirke qu'une personne ou un objet devrait avoir: (8) Je cherche un professeur qui sache lefianqais et I'espagnol. C'est 116ventualit6qui est exprimee mais la realisation de l'action n'est pas certaine. Le deuxikme cas d'emploi du subjonctif dans une subordonnke relative est apres les adjectifs superlatifs ou aprks les adjectifs le seul, I'unique, lepremier et le dernier dans la phrase principale. ( 9 ) C'est le meilleurfilm qtie j'aie regard&. Le troisikme type de phrases subordonnees dans lesquelles le subjonctif est employe sont les circonstancielles. D'abord elles peuvent etre des propositions circonstancielles de temps, introduites par les conjonctions avant que, en attendant que, jusqu'a ce qzl, etc. (1 0 ) J'attendt-oi jusqu'h ce qu'il vienize. La conjonction apr8s que est toujours suivi de l'indicatif. Le deuxikme type de subordonnees circonstancielles oh le subjonctif est employ6 sont les subordonnkes causales, lorsque la cause est nike, apres les locutions: non qzre, non pas que, ce n 'est pas que. ( 1 1 ) S'il ne I'a pas fait ce n'est pas qu'il soit incapable. Le subjonctif peut Ctre encore employe dans des subordonnkes circonstancielles concessives introduites par les conjonctions: bien que, quoiqtie, encore que, d'ou que, qui que etc. (12), dans des propositions subordonnkes conditionnelles introduites par les conjonctions condition que, p o ~ ~ wque, u a moiils que, potlrpeu que, s~.lppose'que, a supposer que, en cas que, au cas ou, etc.(l3), dans les propositions subordonnkes de manibre introduites par de sorte que, de maniBre que, de faqorz qzie, sans que (14). (12) I1 viendra bien qu'il soit malade. ( 1 3 ) Je viendrczi 2 condition que tu vierzizes. (14) 11 explique de telle mani8re que tout le monde puisse le comprenn're. Le subjonctif est employe encore lorsque la subordonnke prCcbde la principale (15) et aussi dans des constructions figkes sans la conjonction que (16). ( 1 5 ) Qu'il vienne, tout le moizde le snit. (16) CoCte qtre coCte. Vnille que vnille. Fais ce que ~ L dois, I advienne que pourra. Vive la Rbpublique! Sauve qui peut! Soit! Le subjonctif dans les phrases (16) a une valeur d'imperatif et son emploi n'est qu'i la troisikme personne. 2.4. Les pol6miques sur le subjonctif Si on observe les trois paragraphes preckdents on constate que la definition, la formation et I'emploi du subjonctif semblent assez syst6matiques. Pourtant le subjonctif represente une grosse difiiculte non seulement pour les etrangers apprenant le franqais mais aussi pour les locuteurs natifs. I1 est A savoir encore que le subjonctif est cette categorie de la langue franqaise "qui a fait couler beaucoup d'encre et qui, semble-t-il, n'a pas fini d'en faire couler" (Auger 1990:1). Les cas d'emploi du subjonctif sont definis et regroupCs de diffkrentes manikes dans les diffbrentes gramrnaires. L'Cvidence logique et systematique du subjonctif franqais n'est que formelle. Si on entre en profondeur pour chercher quelle est la relation entre la forme et le contenu exprimes par le subjonctif, peut-etre alors peut-on se rendre compte pourquoi cette catkgorie a toujours reprksentk "la pomme de discorde". Pour d6couvrir le probleme je vais me servir de l'exemple que Hanse (19609) donne avec la phrase (17): (17) Je doute qu'il vienne. Si nous suivons les regles de l'emploi du subjonctif, dans cette phrase il faut l'employer a cause du verbe douter dans la proposition principale (voir 2.1.2) qui exprime I'incertitude. On dit que il vienne est au subjonctif et que le subjonctif exprime l'incertitude. Le paradoxe est que le verbe au subjonctif n'exprime pas la modalit6 de doute, c'est le verbe de la principale qui l'exprime. Si on substitue le verbe douter (17) h souhaiter (1 8) dans la phrase: (1 8) Je souhaite q~l'ilvienne. (Hanse 1960) Cette fois-ci le verbe venir. est au subjonctif A cause du premier verbe qui exprime un souhait (voir 2.1.2). Donc la forme elle-meme du subjonctif (vienne) n'exprime pas le contenu de doute ou de souhait dans les exemples citkes. Le subjonctif se rkvele au niveau de la phrase. Alors, on exprime deux idCes differentes avec la meme forme. L'unique conclusion qu'on pourrait tirer des deux exemples est que l'action dans la phrase subordonn6e a une rkalisation incertaine. Mais la mCme incertitude persistera si on construit la phrase (19) avec le futur de I'indicatif: (19) Je crois qu'il vierzdru. (Hanse 1960) En effet les deux modes employks dans les phrases (1 8) et (1 9) ne se concowent pas, ils expriment la meme idCe, deux formes differentes pour un meme sens. Ainsi le choix n'est que fonnel. En linguistique deux formes peuvent Ctre vraiment diffbrentes si elles expriment une diffkrence de sens. C'est pourquoi Lyons citk par Mailhac (2000:23 1) conclut "the occurrence of vienne rather than vient in je ne crois pas qu'il vienize does not indicate any particular semantic distinction associated with the choice of the subjunctive v. the indicative: there is no choice open to the speaker in this context". Un deuxieme paradoxe reprksente le cas des verbes exprimant des sentiments et l'affirrnation que le subjonctif est le mode de l'irrkel ou de l'incertitude. Prenons l'exemple: (20) Je suis Izeureuse qu'il soit venu. Ni la phrase principale ni la phrase subordonnke ne contiennent une nuance quelconque d'incertitude, meme le subjonctif passe dans la deuxikme phrase montre que l'action est dkja accomplie. Un troisikme exemple paradoxale est le cas des expressions impersonnelles: il est possible et il est probable. Dans les grammaires prescriptives on trouve que il est possible est suivi du subjonctif, tandis que il est probable est suivi de l'indicatif. (2 1) I1 est possible qu'il vienne. (Hanse 1960) (22) I1 est probable qtl'il viendra. (Hanse 1960) MCme si la deuxikme expression contient une plus grande dose de certitude, cela ne veut pas encore dire que l'action se rkalisera. Ainsi des exemples citks jusqu'ici rkvklent un dkcalage entre les emplois du subjonctif et Ieur thkorisation. Delatour (1991:222) donne une dkfinition diffkrente "Le subjonctif ktant le mode qui exprime une apprkciation ou l'interprktation d'un fait, il s'emploie dans la subordonnke complktive lorsque la principale exprime: la volontk.. ., sentiments.. ., doute.. ." Cette definition plus rCcente rejette les paradoxes dkja mentionnks mais elle n'est pas non plus valable pour tous les cas. Dans la grammaire de Delatour (1 991 :225) par exemple on trouve une liste de cas qui doivent 6tre employks soit avec le subjonctif soit avec l'indicatif selon le sens du verbe dans la principale. Si le verbe exprime une dkclaration il est suivi de l'indicatif, s'il exprime une apprkciation il est suivi du subjonctif. (23) I1 a explique' que cette situation ne'cessitait des mesures exceptiotznelles declaration3 indicatif (Delatour 1991). (24) La gmvite' de In situation explique que le gouvernemetzt ait pris ces mesures exceptioi~tzelles. apprkciation + subjonctif (Delatour 1991) Cette distinction dans les deux phrases est embarrassante pour les apprenants ktrangers de la langue. Dans la m2me grammaire de la Sorbonne on lit "ne pas confondre" suivi d'une autre liste qui prCcise les cas oh il faut employer le subjonctif et l'indicatif. Espklw-+ inclic. Probable + indic. Paraiti-e +inclic. Souhcriter -+ suhj. Possible + subj. Sembler + subj. I1 me semble +inclic. I1 senzble Se douter + iizdic. EIeureusemeizt qzie Le fait est que + subj. Doufer + subj. + indic. + ilzdic. Etre heureztx + suhj. Le fuit que + subj. Ici on pourrait se demander si le mode exprime vraiment une subjectivitk ou si c'est le norrnativisme qui implique des rkgles artificielles? Ainsi pour Menanteau "Pour qu'il y ait unitk linguistique, il faut - on le sait - qu'il y ait commutation possible, il faut qu'il y ait, pour le locuteur, possibilitt de choix entre telle unit6 et telle autre. Si ce choix n'existe pas, si telle unitt est imposke, il va de soi que nulle valeur ne peut en etre dtgagke, qu'aucune information sptcifique ne lui est attachCeM(1986:71). Toute valeur du subjonctif franqais est d6ni6e dans les contextes oh le subjonctif est obligatoire (Bonnard 1974:4). Les grarnmairiens ont toujours essay6 de donner une valeur au subjonctif qui pourrait englober tous ses emplois. Une dbfinition qui rapproche les idkes de plusieurs auteurs c'est que le subjonctif est le mode de 11tv6nementnon-actualist, ou que ". .. le subjonctif s'emploie chaque fois que le fait relatC n'est pas entikrement actualist, ou que sa r6alitC actuelle n'est pas la visCe principale du sujet parlant." (Paul Imbs citC par Wunderli 1985-86:79). Quelque gbnkrale qu'elle soit cette valeur du subjonctif est loin d'etre englobante pour tous ses emplois. Prenons le cas des propositions concessives introduites par les conjonctions bien que, quoi que, encore que, etc.. . (voir 2.1.2) (25) I1 vienclra bien qu'il est malade (fait rtel + indicatif). (26) I1 viencirn bien qic'il soit malade (fait incertain + subjonctif). Dans les exemples (25) et (26) l'indicatif et le subjonctif ne s'opposent pas completement (rCelIirrke1 ou envisage dans la penste ou non), si l'indicatif souligne la rCalit6 du fait, le subjonctif est cependant loin de la nier. Un autre cas qui n'est pas soumis A la valeur g6nQale du subjonctif est celui des propositions substantives introduites par que et placCes en t6te de la phrase. (27) Qu'il vienne, tout le monde le sait (subjonctif). (28) Qzl'il vient, tolit le motzde le snit (indicatif). D'aprks Wunderli (1985-86:81) "Dans le cas d'oppositions de ce genre, le contraste indicatiflsubjonctif ne semble plus Stre dCfini par les termes rCalitClnon-rCalitC, mais par soulignementfnon-soulignement(de la rCalitC)." Depuis des sikles et de nos jours encore les grarnmairiens continuent discuter du subjonctif franqais. Si d'une part ils thdorisent le mode pour lui attribuer des valeurs qui justifient tous les emplois, d'autre part les linguistes soulevent des problhmes concernant les explications logiques du subjonctif ainsi que l'enseignement du subjonctif. Haillet donne ces exemples (1995: 154): (29) J'estime qu'il flit raison. (30) Il fauhait ~.dr@erque le travail soit fait. (3 1) J'espdre qu'elle vienne me voir bient6t. (32) Peut-6tre que cela soit vrai. Dans les phrases citCes le subjonctif ne peut pas etre expliquk par son opposition A l'indicatif, c'est-A-dire par l'opposition du rCel et de 1'Cventuel. Cette gkntralisation est fautive. Ainsi on constate qu'il y a des emplois qui s'expliquent gr8ce aux valeurs du subjonctif et ces cas portent la vraie valeur modale, et par contre il y en a d'autres qui ne peuvent pas etre souinis a ses valeurs et qui sont appeles subjonctif amodal (Judge et Healey 1985), ils n'existent que pour la servitude grarnrnaticale. C'est ce qui mene Poplack (citee par Mailhac 2000:232) A dire que "Le contr6le linguistique auquel a CtC soumis le franqais est alors fourni comme ttant la cause probable de cet Ctat de fait." Aussi Mailhac (2000) qui recourt a la thCorie de l'infonnation pour analyser le contenu skmantique du subjonctif, trouve-t-il que plus une unit6 linguistique est prCdite par le contexte moins elle porte de sens et inversement, un tnonct ne porte de sens que si son occurrence n'est pas complktement prCdite par le contexte. Mailhac considhre aussi que la linguistique et la grammaire ont tout Q gagner si elles abandonnent les emplois amodaux du subjonctif, c'est-a-dire les cas obligatoires cornrne: ( 33 ) Ilfaut qu 'ilfasse. oh la forrne subjonctive defasse n'apporte rien qui ne soit exprimk par il faut. 3. Methodologie 3.1. Description du corpus La prksente recherche est baste sur des donnkes relevkes du corpus Fox-Smith. Ce corpus faisant parti du projet "Recherches sociolinguistiques du franqais francoamkricain" et financk par la Nutioizal Science Fzrno'ation, englobe l'ktude du frangais dans huit comrnunautts dans la rtgion de la Nouvelle Angleterre aux Etats-Unis. L'Ctude du franqais dans les quatre villes - Van Buren, Waterville et Biddeford dans 1'Ctat du Maine et de Berlin dans l'ttat de New Hampshire fait I'objet de recherches de I'tquipe de l'Universit6 du Maine sous la direction de Jane Smith. L'Ctude du frangais dans les quatre villes - Southbridge et Gardner dans le Massachusetts, Woonsocket, Rhode Island et Bristol dans le Connecticut fait l'objet de recherches de llUniversitC a Albany sous la direction de Cynthia Fox. La prksente ttude sur l'emploi du subjonctif est baske sur trente entrevues enregistrtes entre 2002 et 2004 par le Professeur Smith i Waterville, Maine. Chacune des entrevues a une dur6e moyenne de soixante-quinze minutes ce qui fait environ 38 heures au total. Les entrevues sont enregistrkes dans les maisons des interview&. Chaque entrevue contient deux volets: le premier volet reprksente des questions et des rkponses sur des sujets concernant la culture, la langue et l'hkritage franco-amkricains, le deuxikme volet reprksente une tiche de traduction ou on a demand6 a tous les intesviewes de traduire une mCme liste de phrases anglaises. Ces deux volets de l'entrevue dkterrninent les deux groupes principaux de l'ktude du subjonctif dans cette recherche: -subjonctif employ6 spontankment (inconsciemment) dans le courant de la parole; -subjonctif employ6 intentionnellement (consciernrnent) dans le courant de la parole; 3.2. Variables sociales - sexe, Bge, niveau de formation L'objet du rassemblement des donnkes Ctait de trouver des locuteurs des deux sexes, de diffkrents hges et niven~ucdeformation. Le rapport entre les femmes et les hommes dans 1'6chantillon est kgal: quinze hommes et quinze femmes. La plupart des infosmateurs ont une formation klkmentaire ou secondaire et onze d'entre eux ont une formation post-secondaire (Figure 1). Les trente interviewis ont entre l'2ge de quarante-huit ans A quatre-vingt-dix ans. I1 n'y a que deux garqons adolescents dans le corpus 2gds de seize et dix-huit ans (Figure 2). En ce qui concerne la documentation vraisemblable de ce parler, il est necessaire de prkciser que certains locuteurs changeaient de registre de langue loss de l'entrevue, c'est-A-dire qu'ils tichaient de parler un franqais plus standard, malgrk l'annonce qu'on voulait enregistrer le franqais rkgional. Avec le terme du franqais standard nous envisageons le franqais decrit dans le "Bon usage" de Maurice Grevisse (1 988). Deux des locuteurs (WA-F-03 et WA-M-04) Figure 1 Niveau de formation des locuteurs postsecondaire 1',28% d-%r ; . .. elementaire secondaire 29,72% Figure 2 Distribution de l'iige des locuteurs avaient presque perdu leur franqais cornrne ils ne l'avaient pas pratiquk depuis leur enfance et ils avaient cornmencC A rkapprendre la langue au moment des entrevues. Les deux adolescents (WA-M-22 et WA-M-23) apprenaient le franqais A la maison avec leur pere ainsi qu'A 1'Ccole oh on leur enseignait un franqais standard. L'emploi du subjonctif par ces locuteurs ne pourrait pas Stre considkrk cornrne cent pour cent typique de la rCgion, malgrC cela j'ai pris en consideration leur manibre d'emploi des modes. Tous les informateurs sont indiques de code comrne par exemple WA-M-22, ce qui permettra le reperage des cas. L'abrkviation WA est utilisCe pour noter Waterville, M et F montrent respectivement le sexe masculin ou feminin et le nombre suit la numkration de tous les infonnateurs de cette ville. 3.3. Analyse quantitative Avec le programme Simple Concordance PI-ograi~z4.07 nous avons relevk les cas du subjonctif pour chacun des locuteurs et ils sont repartis en trois groupes: le premier groupe est le subjonctif rkalisk (voir 4.1 .), le deuxikme groupe comprend le subjonctif non rkalise (voir 4.2.) et le troisibme groupe - les formes neutres (Annexe "A"p.49), c'est-A-dire les verbes dont les formes co'incident au subjonctif present et au prksent de l'indicatif. Pour faire les statistiques descriptives et les statistiques d'infkrence, les donnkes relevkes ont CtC sournises au programme SPSS, version 12.0 pour Windows (SPSS, 2003). Pour analyser toutes les phrases contenant un subjonctif rkalisk et subjonctif non realist2 selon les critbres employCs par Poplack (1990: 16) dans son etude du franqais qukbecois Prescription, intuition et usage: le subjonctiSfmncais et In variabilitk inhkrante. Ces criteres sont: le sujet, le temps, le mode, la classe skmantique et la nature affirmative, nkgative ou interrogative du verbe de la phrase principale, la prQence du compltmenteur que, la presence de la mati6re parenthktique separant les verbes principaux et enchissks, le mode et le temps du verbe la subordonn6 et concordance des temps des verbes principal et enchissk (Tableau 1). Trois de ces criteres ne s'avkent pas significatifs car ils indiquent toujours un meme sens: la classe skmantique du verbe principal, la nature affirmative, ntgative, interrogative ou conditionnelle de la proposition principale et la concordance entre les verbes principaux et ench2ss6s. Les diffkrents emplois du subjonctif sont ins6rCs dans des tableaux stpar6s. Les cas de forrnes neutres ne sont pas traitks avec le programme SPSS et ils ne sont pas analysks puisqu'on ne peut pas juger lequel des modes est employt, le subjonctif prksent ou le present de l'indicatif. 4. Analyses qualitatives 4.1. Le subjonctif employk spontankment dans le courant de la parole Le regroupement de ces cas employCs spontankment donne les rbsultats suivants: vingt-neuf cas du subjonctif aprks l'expression impersonnel il$zut, dix-sept cas du subjonctif aprks les conjonctions: avant que (employ6 quatre fois), pour que (huit fois), jtrsqu'2 ce que (deux fois), h nzoins que (une fois), quoi que (deux fois), quatorze cas du subjonctif apres le verbe votlloir dans la phrase principale et encore sept cas groupks sous le nom "autres cas" y compris deux cas du subjonctif aprks le verbe nimer, deux cas aprks les expressions impersonnelles c'est rare et c'est difjcile, deux cas du subjonctif apses l'expression exprimant un d6sirj1ni hcite que et un cas du subjonctif dans Ia phrase independante Pas que je sache. La Figure 3 visualise la description de ces cas du subjonctif. Figure 3 Cas d'emploi du subjonctif autres cas,7 ilfaut, 29 vouloir, 14 1 conjonctions, 17 4.1.1. Le subjonctif aprks I'expression impersonnel il faut. La Figure 4 montre comment la fr6quence d'emploi du subjonctif dans la conversation libre, apres il fuzrt se rkpartit selon le nombre total des informateurs (lV=30). On constate que douze personnes ont employe le subjonctif aprks ilfuut une fois, trois personnes I'ont employ6 deux fois, une personne l'a employ6 quatre fois et ilne personne I'a employe sept fois. Si les treize des trente informateurs utilisent ilfaut, soit ils ne rkalisent pas le subjonctif apres cette expression, soit ils pr6f"erent I'utiliser avec la construction infinitive (Figure 4). Du Tableau 1 on constate onze occurrences de I'omission ~ L pronom I sujet il de I'expression impersonnelle ilfaut. Selon la grammaire du franqais standard I'emploi du pronom sujet atone avant le verbe est obligatoire. Dans six des cas le complementeur que est omis. Le verbe principalfalloir est soit au prdsent (14 fois), soit A l'imparfait (12 fois) et i l n'est au passe composd qu'une seule fois. Tous les verbes enchiisses sont au subjonctif prdsent. Figure 4 -2 FrCquence d'emploi du subjonctif apres icfazlt 0 2 4 Frequence d'emploi 6 8 Tableau 1 Le subjonctif aprks l'expression impersonnel il faut 4.1.2. Le subjonctif apres le verbe vouloir La Figure 5 montre comment la friquence d'emploi du subjonctif aprks vouloir se repartit selon le nombre des informateurs (N=30). Vingt personnes n'ont pas choisi d'employer le subjonctif apres le verbe vouloir dans la principale. Huit personnes ont employe le subjonctif une fois et deux personnes - trois fois. Friquence d'emploi du subjonctif aprks le verbe vouloir Figure 5 Mean = 0 47 Sld Dev. = 0 819 N-30 1 0 1 2 3 4 Frbquence d'ernploi du subjonctif .Dans le Tableau 2 on compte quatorze emplois du subjonctif apres le verbe vouloir. A la diffkrence du cas de il fuut (Tableau I), dans le Tableau 2 on voit que le pronom sujet de la phrase principale et de la phrase subordonnke ainsi que le complkmenteur que ne sont omis dans aucune des phrases. Tableau 2 Le subjonctif aprks le verbe vouloir (Dans le Tableau 2 le signe "0"chez M-05 indique le manque du verbe auxiliaire au passk composk.) 4.1.3. Le subjonctif aprks les conjonctions: avant que (4 fois), pour que (8 fois), jusquf2r ce que (2 fois), b moins que ( 1 fois), quoi que (2 fois). Figure 6 Frdquence d'emploi du subjonctif aprks des conjonctions Mean = 0.57 Std. Dev. = 1.305 N = 30 Frkquence d'emploi du subjonctif Selon la Figure 6 u n des interview& a r6alisC le subjonctif six fois, deux des interviewds I'ont rdalisC trois fois, cinq des interviewes I'ont realis6 une fois et vingt-deux interviewes n'ont pas choisi d'employer des constructions subjonctives ou s'ils les ont employCes ils n'ont pas rCalise le subjonctif. 28 Tableau 3 Subjonctif apres les conjonctions puisse[pb puisselpb peuves Les trois premikes colonnes du Tableau 3 ne sont pas rernplies parce que leurs critkres ne jouent pas de r61e lors de l'emploi du subjonctif aprks les conjonctions. I1 est A signaler que dans Ie mCme tableau le pronom sujet de la phrase subordonnCe n'est pas omis tandis que le que faisant parti de la conjonction est omis deux fois chez un mCme locuteur (F-06 2, F-06 3). 4.1.4. Les sept autres cas du subjonctif reprksentbs dans le Tableau 4, deux cas apparaissent aprks le verbe ninzer, deux cas a p r b les expressions impersonnelles c'est rar-e et crest drfJicile, deux cas du subjonctif aprks l'expression exprimant un dCsirjrai hcite que et un cas du subjonctif dans une phrase indkpendante Pas que je suche. Le pronom sujet de la phrase principale n'est pas ornis et le compl6menteur que non plus. Tableau 4 Autres cas du subjonctif 4.1.5. Conclusion des cas avec subjonctif L'emploi du subjonctif dans les quatre cas ne diffkre pas de son emploi en frangais standard. Ce qui s'avke une diffkrence c'est l'omission du pronom sujet de la principale aprks ilfaut (1 1 fois). Une autre diffkrence dans cette variktC du frangais c'est l'omission du complkmenteur que aprks ilfutit (5 fois) et aprks certaines conjonctions (2 fois). La rkalisation du subjonctif malgrk ces omissions rkvkle l'association forte entre le verbe falloir et le subjonctif. La figure 7 dkmontre que dans des "contextes subjonctifs" ce mode est choisi dans 54% des cas, ce qui represente B peu prhs la moitik, suggkrant donc que son emploi n'est pas stable ou qu'il ne reprbsente plus la norrne dans le parler frangais de Waterville, Maine. Dans le franqais franco-amQicain certains verbes cornme aller, itre, fuire, jouer, pouvoir peuvent etre prononcks au subjonctif soit B la manikre du franqais standard soit respectivement cornme: qz~e,j'uillt![3al], que je sois [sej'] ou [seij], queje fasse IfEz], que je joue [ j u z ] et que je puisse [plav]. Dans le Tableau 3 on observe cinq fois le verbe pouvoir prononce [plav], une fois &re [seij] et une foisfaire ,lji&z]. 4.2. Cas du subjonctif non rkalisk dans les entrevues (la conversation libre) 4.2.1. Le subjonctif non rkalis6 aprbs l'expression impersonnel ilfaut Dans le Tableau 5 le pronom sujet est ornis huit fois tandis que le coinplkmenteur que est prksent partout. Quatre fois le verbe principal est au prksent, deux fois au pass6 composC et douze fois h l'imparfait de l'indicatif. La matibre parenthktique, c'est dire le nombre de mots (ou la distance, le temps) entre le verbe principal (exigeant le subjonctif) et le verbe enchbssC (qui devrait etre au subjonctif) reprksente plus de deux mots dans les cas de M-14 et F-36. Cette distance pourrait etre la cause de la destruction de l'association subjonctive entre les verbes principal et enchbss6. Dans le corpus de Waterville le subjonctif aprbs ilfaut n'a pas CtC rCalisk dans dixhuit des cas. L'imparfait de l'indicatif s'avkre etre le substituant du subjonctif le plus employ6 (1 1 fois), moins employ6 est le prQent de l'indicatif (4 fois), l'infinitif (2 fois) et le plus-que-parfait (1 fois). Tableau 5 Le subjonctif non rkalisk aprks l'expression impersonnel ilfaut 4.2.2. Le subjonctif non rkalisC apr&sle verbe de sentiment aimer Dans le Tableau G le pronom sujet est prksent partout. Le verbe principal est au conditionnel prCsent six fois et une fois B l'imparfait de l'indicatif. Dans tous les exemples la matiere parenthktique consiste en un ou deux mots B l'exception du premier (F-01) ou il y a quatre mots qui skparent le verbe principal de llenchissC (donc inn mere ellc) et encore dans le meme exemple le complCmenteur que est omis. VoilB deux raisons possibles pour lesquelles le subjonctif ne se rkalise pas. Dans les conversations libres le subjonctif n'a pas kt6 realise aprks le verbe aimer sept fois. De nouveau le substituant le plus frkquent est l'imparfait de l'indicatif, lequel se realise trois fois. Le prksent de l'indicatif et le conditionnel prksent se substituent au subjonctif deux fois. Tableau 6 Le subjonctif non realis6 aprks le verbe de sentiment aimer 4.2.3. Le subjonctif non rkalise apres les conjonctions Dans tous les cas du Tableau 7 le complkmenteur que est prksent partout et il fait partie de la conjonction meme. Si le "que" est omis de certaines des conjonctions subjonctives, on obtient une prkposition qui de sa part entraine l'emploi de l'infinitif. Dans le premier exemple du Tableau 7 le sujet de la subordonnee est ornis et apres cela nous trouvons l'emploi de l'infinitif. Dans tout le tableau la matikre parenthktique consiste en un ou deux mots ce qui ne semble pas une "grande distance" pour couper l'association entre les deux verbes, principal et ench5ssk. Apres les conjonctions pour que, avant que, jusque le terrzps qtle (equivalent en franqais standard jusqu'au teinps que), ci moins que, quoi que le subjonctif ne se rkalise pas quinze fois. A la diffkrence des deux cas prkckdents oh le substituant le plus frkquent est l'imparfait, ici le substituant le plus frkquent est le pr6sent de l'indicatif (sept fois) aprks quoi se rangent l'imparfait (cinq fois), le conditionnel prksent, le pass6 composk et l'infinitif (une fois chacun). Tableau 7 Le subjonctif non rtalis6 aprks les conjonctions 4.2.4. Autres cas de subjonctif non rkalisk Le Tableau 8 reunit 18 divers cas du subjonctif non realis6 aprks les verbes vouloir (deux fois), penser B la forme n6gative (quatre fois), croire 5 la forme nCgative (une fois), les expressions c'est possible (trois fois), c'est rare (une fois), 6tre content (deux fois), avoirpezrr (deux fois) et l'adjectif superlatif le/la seul/e (trois fois). Le compl6menteur que est omis dans deux des exemples et le pronom sujet est prCsent partout. Le verbe principal est au prksent quatorze fois et quatre fois A l'imparfait. Dans tous les exemples la matikre parenthktique consiste en un ou deux mots, sauf l'exemple de F-30 qui est de trois mots. Dans les "autres cas", avec un taux de sept occurrences l'imparfait de l'indicatif est le substituant le plus frkquent, suivi du fitur proche (six fois), du prksent (trois fois), du conditionnel prksent et de I'infinitif (une fois). Tableau 8. Autres cas de subjonctif non rkalisk 4.2.5. Conclusion des rksultats du subjonctif non rkalisC De tous les dix-huit cas de subjonctif non rkalisk aprks iffnut, le pronom personnel est ornis huit fois, ce qui reprksente presque la moitik. Comme dans l'autre moiti6 des cas le pronom il est prksent, on exclut la possibilitC que ce pronom influence le choix du subjonctif. Des d e w autres critkres, le complementeur que est omis trois fois et la matiere parenthetique consiste en plus de deux mots dans trois des exemples. La description des critkres qui s'averent Ctre diffkrents dans les tableaux ne representent pas des chiffres consid6rables pour conclure qu'ils entrent en jeu pour la non rkalisation du subjonctif. La Figure 8 r6sume les modes et les temps employes a la place du subjonctif. L'imparfait de I'indicatif se substitue le plus souvent au subjonctif au taux de 44%. Figure 8 Modes et temps employCs A la place du subjonctif plus-quefutur proche, parfait, 1, 2% pass6 r cornpos&. 1, 6,10% '\ conditonnel, 4, 7% '\ 2% infinitif, 4, 7% ----- ,.ILL irnparfait, 2G8 44% present, 16, 28% Avec les donnkes des Tableaux de 1 a 23 nous avons fait faire des statistiques corrClatives mais aucun des resultats n'a montrk des valeurs significatives. Nous avons test6 les correlations suivantes: sexe-emploi du subjonctif, formation-emploi du subjonctif et ige-emploi du subjonctif. Les tests utilises sont le T-Test, Mann-Whitney U test et Crossrabs. Le resultat de la Pearson corr6lation entre I'ige et l'emploi du subjonctif dans les entrevues est marginalement significative (R=.3 1, p<.095 ayant en vue que marginalement significatif atteint .lo) et elle montre aussi que les interlocuteurs les plus igks emploient le mode plus souvent. Cela peut &re dQ au fait que les locuteurs plus hgks allaient aux Ccoles catholiques oh on enseignait la grammaire. 4.3. Le subjonctif employ6 intentionnellement dans le courant de la parole dans le franqais par16 h Waterville, Maine. Nous prksentons ici les rQultats de l'emploi du subjonctif dans la deuxibme partie des entrevues qui est la tdche de traduction. Les tableaux de 9 h 23 dkmontrent les traductions de chacune des 15 phrases qui ont un "contexte subjonctif". Le Tableau 9 illustre le total des dix critbres qui pourraient jouer un r6le dans le choix du mode: sujet, verbe, temps et mode de la phrase principale, complkmenteur qzie, matikre parenthktique, forme verbale, temps et mode de la phrase subordonnke. Les deux criteres, la nature skmantique du verbe (volontk, souhait, ordre,etc.. .) et le statut verbal (affirmation, nkgation, interrogation) de la principale montrent une meme valeur dans chacune des colonnes (voir Tableau 9) tandis que le critkre de la modalit6 lexicale (d'autres mots dans la phrase qui renforcent l'idke subjonctive) n'apparait nu1 part. Donc, les trois derniers critkres ne portent aucune information sur les analyses du choix du mode et les tableaux 10-23 ne les incluent pas. 37 Tableau 9 Phrase 1 a traduire: I have to be there this evening around 6:OO. Ccessite Ccessite Tableau 10 Phrase a traduire: 2. He has to be there this evening around 6:OO. Le dCcalage dans les pronoms des phrases h traduire (de l'anglais) et les pronoms dans les phrases traduites est dO au changelnent que les interlocuteurs eux-memes apparaissent au moment de la traduction. Tableau 11 Phrase i traduire: 3. She has to be there this evening around 6:OO. Tableau 12 Phrases a traduire: 4. You have to be there this evening around 6:OO. Tableau 13 Phrase A traduire: 5. You hnve to be there this everzing around 6.00. Tableau 14 Phrase A traduire: 6. (To a friend:) You hnve to be there this evening around 6:00. Dans le Tableau 14 la forme du pronom nous ne correspond pas a la personne de la forme verbale arrive (F-04). Arrive montre 1p.sg. ou 3p.sg. du prksent, alors qu'il devrait Ztre la 1p.pl. - nous arrivons. En plus le pronom demande dans la phrase a traduire de l'anglais en franqais est vous mais l'interviewk l'a traduit par nous. La forme sois du verbe &re (M-14) indique lp. ou 2p.sg. lorsque selon le franqais standard elle devrait Ztre a la 2p.pl soyez. Tableau 15 Phrase A traduire: 7. (To a group ofpeople) You have to be there this evening around 6.00. Tableau 16 Phrase a traduire: 8. (Referring to a group of girls for a pageant) They have to be there this evening around 6:OO. F-28 elles devraient F-31 il faut F-3 2 faut F-33 i l but Ctre 18 prblind qu' prblind prdslind qu' elles[il] vous elles soient[swag] soyez soient inf. subjlprts sub.j/pl.ts subjlpres La forme vient (F-04) marque la 3p.sg. du prksent mais selon le sujet, lesfllles, elle devrait etre a la 3p.pl. viennent qui est la f o m e commune de l'indicatif prksent et du subjonctif prksent. A la place du pronom impersonnel il de l'expression il faut deux interlocuteurs (M-18, M-19) ont employ6 elle au singulier et un interlocuteur (M-23) elles au pluriel. Selon le franqais standard le verbefalloir est impersonnel et il n'existe qu'h la 3p.sg. avec le pronom impersonnel il. M-16 a traduit la phrase par l'imperatif sois la ce qui est l'unique cas parmi les donnees de Waterville. Tableau 17 Phrase A traduire: 9. (Referring to a group ofboysfor a boy scout meeting) They have to be there this evening around 6:00. F-04 emploie la forme vierzt A la 3p sg. alors que le sujet est au pluriel et la fonne verbale devrait etre A la 3p.pl. viennent. Dans le Tableau 18, F-36 emploie la fonne ait pu lqqui est l'unique cas du subjonctif pass6 dans le corpus de Waterville. Le subjonctif pass6 montre une action qui a eu lieu avant l'action exprimke dans la principale. Les deux "Xuentre les deux barres verticales signifient un mot de deux syllabes dont la prononciation est incomprehensible. Tableau 19 Phrase A traduire: I I. [The roads were so slippery] we had to drive real slow. Dans le Tableau 20 il y a cinq formes neutres qui ne permettent pas de juger lequel des modes est employ6, le subjonctif ou l'indicatif. F-04 emploie le pass6 compos6 de vouloir sans utiliser l'auxiliaire avoir. Tableau 21 Phrase h traduire: 13. (Referring to daughter's homework) [She'll have time tofinish it] before she goes to school tomorrow. M-02 emploie le pronom il parce qu'on lui avait demand6 de traduire avec le pronom masculin He'll have time to... Tableau 22 Phrase a traduire: 14. I don 't think they can come. Tableau 23 Phrase A traduire: 15. Do you want me to malce a cake for your birthday? 4.3.1. Conclusion des rksultats de la t8che de traduction Pour relever et traiter les donnCes de la tiiche de traduction nous nous sornrnes servi des deux programmes SCP et SPSS (voir 3.3). Le nombre des interview& qui ont fait la traduction est 29. Le maximum de phrases traduites de l'anglais en franqais qui contiennent le subjonctif dans cet Cchantillon pourrait &re 435 (29 personnes X 15 phrases) mais ce que nous avons relevC des interviews reprCsente 240 phrases. La difference entre les deux sommes est due soit au fait que les interlocuteurs n'etaient pas disponibles assez longtemps pour leur poser toutes les questions, soit au fait qu'ils Cprouvaient des difficultes traduire et ils refusaient de le faire. Des 240 phrases, 132 ou 56 % des propositions subjonctives sont traduites par le subjonctif, 73 sont traduites par une construction infinitive, 3 1 sont traduites par I'indicatif, une phrase - par I'impCratif et trois phrases - par des formes verbales neutres dont on ne peut juger lequel des modes, subjonctif ou indicatif, est employe (Figure 9). Figure 9 Modes employes dans les "contextes subjonctifs" dans la tgche de traduction neutres, 3, indicatif, 31, 1% 13% impkratif, I , 0% \ infinitif, 73, 30% subjonctif, 132,56% Dans les phrases traduites en frangais le pronom sujet est omis 14 fois ce qui est atteste seulement dans l'expression ilfaul. Six fois I'expression il faut est prononcde comme elle faut quand il s'agit d'un groupe de femmes. Le compldmenteur que est omis cinq fois. Les formes homophones de la troisihme personne du singulier et du pluriel du verbe 6tre au subjonctif, qu'il soit et qu'ils soient dans la tiiche de traduction se retrouvent dix fois comme [swai'], quatre fois comme [swag] et huit fois comme [seiJ] et le verbe essayer est parfois prononck [as~ij].Dans les traductions, lorsque le mode indicatif se substitue au mode subjonctif, le plus souvent c'est le prisent qui s'emploie (28 fois), suivi de I'imparfait (8 fois), du futur proche (2 fois) et du futur simple (1 fois). La Figure 10 resume les temps de I'indicatif employes ii la place du subjonctif. Figure 10 Temps de I'indicatif employes 6 la place du subjonctif Futur proche., 2, 5% Futur simple, 1, resent, 28, 71% Figure 11 Emploi du subjonctif dans la tdche de traduction ne pas penser, 19,14% I vouloir , 22, 17% ilfaut, r avant que, 12, 9% - 79,60% Le plus grand nombre de cas d'emploi du subjonctif dans la tiiche de traduction est aprks ilfaut (79 fois), suivi de la conjonction avant que (12 fois), le verbe vouloir (22 fois) et le verbe penser A la forme nkgative ( 1 9 fois) (Figure 1 1). Dans la tdche de traduction on retrouve 15 fois impossibles d'employer le subjonctif. La valeur moyenne d'emploi du subjonctif est de 5.21 fois ou 34.7%. Alors, deux groupes peuvent &re distingues, l'un qui I'emploie beaucoup et I'autre qui I'emploie moins. Le premier groupe de 17 personnes emploie le subjonctif 7.88 fois ou 52.5% en moyenne. Le deuxieme groupe de 12 personnes l'emploie 1.58 fois ou 10.6% en moyenne. Dans notre Cchantillon les rksultats des phrases traduites en franqais et offrant un "contexte subjonctif' montrent que, dans 56% des cas les locuteurs choisissent le subjonctif et que dans 43% ils ne le choisissent pas. Ainsi peut-on dire que le subjonctif est une forrne bien vivante dans ce parler mais qu'elle alterne souvent avec l'indicatif ou I'infinitif. Les donnCes de la tiche de traduction ont CtC sournises aux tests suivants: T-Test, Mann- Whitney U test, Crosstnbs et Pearson Correlation. La corr6lation entre l'iige et l'emploi du subjonctif est significatif (R=.41, p<.026, N=29) et il montre que les plus Bgks emploient le mode le plus souvent. La relation entre l'usage du subjonctif et le sexe, dans la tiiche de traduction faite avec le t-test est non significative (t=.76) mais quand m6me elle fait voir que les fernmes emploient le mode plus que les hornmes. La relation entre Ifusagedu subjonctif et la formation, faite aussi avec le t-test est non significative (t=-1.05) mais elle montre que les interlocuteurs avec une forrnation secondaire et post-secondaire emploient plus le subjonctif. 4.4. Synthbse Les objectifs de ce travail Ctaient d'ktudier la frCquence et les cas d'emploi du mode subjonctif dans le franqais oral des Franco-AmCricains de Waterville, Maine et de relever comment les variables sociales et linguistiques influencent le choix du mode. Aprks avoir trait6 et Ctudik les donnees de noh-e Cchantillon nous pouvons conclure que dans une conversation spontanke les cas d'emploi du subjonctif dans la rkgion en question sont le plus souvent aprbs l'expression impersonnelle iIfaut (29 fois), aprbs certaines conjonctions (17 fois) et aprbs le verbe vouloir (14 fois). Moins souvent le subjonctif est enregistre apres le verbe airner (2 fois), aprbs les expressions c'est difficile (2 fois) etj'ai hcite que (2 fois) ce qui veut dire que ces "contextes subjonctifs" sont employ6s rarement et non que le subjonctif est rarement rkalis6 dans ces contextes. Le tableau 24 rksume tous les cas du subjonctif rCalisk et non rkalisC de notre Cchantillon de Waterville. Tableau 24 Sornmaire de tous les cas d'emploi du subjonctif dans le corpus de Waterville Etre content - Avoir peur - C'est d@cile - 2 Le/la seul/e - 3 J'ai hbte que 2 - Figure 14 Le subjonctif non rCalise apres le verbe vouloir subjonctif non realisC, 2, 13% realist!, 14, 87% Pour revenir A notre hypoth&se,c'est-a-dire de savoir si le subjonctif est disparu dans ce parler, les donnCs indiquent qu'il est une forme bien vivante mais une forme qui dans la moiti6 des cas alterne avec I'indicatif. Figure 15 Subjonctif r6alisUnon rCalisC dans les entrevues a subjonctif non realisC, 58, , .,.. , 46% subjonctif realise, 67, 54% Les cas de subjonctif rCalisC dans le parler de Waterville se conforment selon les rkgles du franqais standard (voir 2.3). Une diffkrence entre la structure subjonctive du franqais de rCfkrence et celui du fran~aisfranco-amCricain en question est l'omission du pronom personnel il de l'expression ilfaut, l'ornission du compl6menteur que dans certains cas et la prononciation diffkrente de quelques formes subjonctives quej'aille [3al], quej e sois [sef], [seij] ou [swaf], quej e fasse $,cz], quej e joue [juz] et quej e puisse [psv]. 11 est a signaler que l'omission de il et de que est attestke comrne dans le franqais par16 europken ainsi que dans le franqais parlk dans la ville de Qukbec (Auger 1990). Une recherche plus approfondie et comparative pourrait Cclaircir la question et perrnettre de connaitre les facteurs qui influencent llClision de il et de que dans le frangais franco-amkrcain. En ce qui concerne l'influence des facteurs sociaux - la formation, l'iige et le sexe (voir 3.2.)- sur le choix du mode dans le corpus de Waterville, on constate que seulement l'iige est un facteur qui influence le choix du subjonctif. Dans notre khantillon les interlocuteurs les plus iiges emploient le subjonctif le plus. Nous n'avons pas trouvC de rksultats significatifs pour l'influence des deux autres facteurs, la formation et le sexe, sur le choix du mode ce qui pourrait etre dQ au nombre relativement bas des interviews. Vkrifier si les deux facteurs, la formation et le sexe, n'influencent pas le choix du subjonctif pourrait faire l'objet d'une autre ttude d'un plus grand kchantillon. I1 est evident d'apres nos rksultats que certains verbes principaux cornrnefalloir et vouloir s'associent etroitement avec le subjonctif alors que d'autres verbes tels quepenser et croire sont tres peu utilisks avec le subjonctif. Poplack (1990:24) prCsente les memes rksultats pour le franqais canadien. Dans notre kchantillon apres la structure impersonnelle c'est possible, nous avons attest6 seulement I'usage de I'indicatif tandis qutAuger (1990:50) a trouvC dans le franqais europeen une variation de I'indicatif et du subjonctif. Mais cornrne nos occurrences de cette expression se limitent a trois, nous ne pouvons pas en tirer des conclusions. Cette Ctude de base sur l'emploi du subjonctif dans le franqais par16 A Waterville, est importante parce qu'elle contribue A 1'Ctude du franqais en Nouvelle-Angleterre et ouvre la porte a de nombreuses recherches futures: l'emploi du subjonctif dans les autres cornrnunaut6s francophones qui font partie du corpus Fox-Smith; le r81e des facteurs sociaux sur le choix du mode, d'abord dans chacune des comrnunautes et ensuite au total; la comparaison des cas d'emploi du subjonctif du franqais franco-amCricain et du franqais qu6bCcois ainsi que du franqais par16 europken. Bibliographie Allen, James Paul. 1970. Catholics in Maine: a social geography. Syracuse, NY: Syracuse University dissertation. Auger, Julie. 1990. Les structures impersonnelles et l'alternance des modes en subordonnke dans le franqais par16 de Qukbec. Canada:Centre international de recherche en amknagement linguistique. Bonnard, Henri. 1974. Le franqais moderne 42. 72-89. Brault, Gerard. 1979. Le franqais en Nouvelle-Angleterre. Le fianqais hors de France, ed. by Albert Valdman,75-9 1. Paris: Champion. Cohen, Marcel. 1965. Le subjonctif en fianqais contemporain. SociCtC d'kdition d'enseignement supCrieur, Paris. 23 1. Delatour, Y. and Jennepin D., LCon-Dufour M., Matt16 A., Teyssier B. 1991.Grammaire du franqais. Cours de la civilisation franqaise de la Sorbonne. Paris: Hachette. Fecteau, Albert C. 1951. The French Canadian Community of Waterville, Maine. Master's Thesis, St. Michael's College. Fox, Cynthia A. and Smith Jane S. A paraitre. La situation du franqais franco-amkricain: aspects linguistique et sociolinguistique. Le frangais en AmCrique du Nord: Ctat prCsent, ed. by Albert Valdman, Julie Auger and Deborah Piston-Hatlen. QuCbec: Les Presses de 1'UniversitC Laval. Grevisse, Maurice. 1988. Le Bon Usage: g r a m a i r e frangaise. Paris: Duculot. Haillet, Pierre P. 1995. Le sens du subjonctif. Revue de lfACLA 17. 153-165. Hanse, Joseph. 1960. La valeur modale du subjonctif. Bruxelles: Palais des AcadCmies. Harmer, L. C. 1963. La variCtC et le subjonctif. Le franqais moderne 3 1. 262-268. Judge, A, and Healey, F. G. 1985. A Reference Grammar of Modem French. London: Edward Arnold. Lyons, J. 1968. Introduction to Theoretical Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press. 3 12. Mailhac, J.-P. 2000. Sens, choix et subjonctif. Journal of French Language Studies 10. 229-244. Menanteau, Didier. 1986. Le mode verbal, classe grammaticale. La Linguistique 22.6980. Poplack, Shana. 1990. Prescription, intuition et usage: le subjonctif franqais et la variabilite inhkrante. Langage et sociktk 54. 5-33. Ramirez, Bruno. 2003. (avec la collaboration d'Yves Otis). La Ruke vers le Sud. Migration du Canada vers les Etats-Unis 1840-1930. Montrkal: Boreal. 97- 130 Robert, Paul. 1992. Le Petit Robert 1. Dictionnaire alphabbtique et analogique de la langue franqaise. Paris. Le Robert. Roby, Yves. 1990. Les Franco-AmCricains de la Nouvelle-Angleterre. REves et rCalitCs. Sillkry: Editions du Septentrion. Sand, Jorgen U. 1981. Le Subjonctif en franqais oral. Actes du VIII congrks des romanistes scandinaves. Odense: Odense University Press 303-3 13. Smith, Jane, and Fox, Cynthia. 2000. Project description. Collaborative Research: A Sociolinguistic Investigation of Franco-American French, funded by the National Science Foundation (BCS-0004039 and BCS-0003942). SPSS (2003). SPSS Rel. 12.0 for Windows. Chicago, IL: SPSS, Inc. Vicero, Ralph D. 1986. Immigration of French-Canadians to New England, 1840-1900: A Geographical Analysis. Thbse de doctorat inkdit, University of Wisconsin. Wunderli, Peter. 1985-86. Maurice Grevisse et le subjonctif. Travaux de linguistique 12/13. 75-93. Annexe "A" 1 . Cas de fonnes neutres employbes dans les entrevues (1). . .ils aimaient rnieux qu'ils leurparlent anglais (WA-F-01) (2) ...0 \il\ faudrait /que/ qu 'on continue A developper quoi-est-ce-que [ k ~ s kc'est ] qu'on a commence avec les ((Bavards>> (WA-F-01) (3) . . .puis la il faut qu 'il la coule il l'arnene en haut ensuite pour lXXl le sirop en houx (WA-F-06) (4) . ..il faut-quej e trouve (WA-M-05) (5) . . .les enfants ils voulaient pas 0 \que\ les parents parlent franqais (WA-F-07) (6) .. . ma grand-mkre avait l'intention que chacun de ses gargons devienne pr&tre(WAM-09) (7) .. .pis j'avais aucune idCe ce que c'Ctait mais avant-qu 'or1 pt-ononce par exemple quand j'ai eu un mot posle aucune idCe ce que c'etait qa P 0 E circonflexe L (WA-M-09) (8) . . . 0 \il\ fallait qu 'ils enseigrzent en anglais (WA-M-09) (9) ... elle voulait plus que j'envoie ga fait je l'ai toujours mais c'est fini (WA-F-l O) (1 0) . . . est-ce-que vous voulez que vos petits-enfants apprennent le frangais ii l'ecole (WA-F- 10) (1 1) .. . les femmes il faillait[hle] qu'ils se cackent en arrikre des machines pour changer leur linge pour mettre du linge du travail (WA-M-1 I) (12) .. .il fallait[fule] que jepense que Da~nasquec'est pas /gal ga doit etre Damascus (WA-F- 10) (1 3) . . .0 \il\ faut qu 'ils se sentent A l'aise(WA-M-l l) (14) bien il faut 0 \que\ j 'y pense maintenant (WA-M- 12) (1 5 ) . . . 0 \il\ fallait qu 'il retourrze (WA-M-12) (1 6) .. . il fallait que /je m'enl je m'en force (WA-M-12) (17) 0 \il\ comprend la moitiC je lui parle toujours en frangais pour qu'il s'en rappelle mais il n'y a pas de frangais par la ga fait qu'il l'oublie (WA-F-15) (1 8) . . . 0 \il\ fallait /nous/ 0 \il\ fallait qu' Ion parlel onpnrle anglais dans 1'Ccole (WAM- 18) (1 9) .. . que j'y allais y trouver je savais pas assez d'anglais puis ils me disaient 0 \il\ faut que tu commences /en/ dans le bas so /j'ai/ j'ai appris un peu mais.. . (WA-F-19) (20) . .. il faut que tu me demandes si tu comprends pas ...(WA-M-20) (2 1) . . . il insistait que ses enfants apprennent le franqais.. . (WA-M-20) (22) . . . Ij'ai ditl je me suis dit il faudrait vraiment que je trouve qa (WA-M-20) (23) c' est possible que qa va continuer mais /on voudrait quel on voudrait que qn continue des changements il faudrait que Ca conzrtzence aujourd'hui (WA-M-20) (24) . . . je suis supportive de ces choses la alors je voulais Iqu'ils qu'ilsl qu 'ils essayent (WA-M-24) (25) ... c'ktait la seule langue qu'on enseignait sauf le latin il y avaient le latin et /le grec/ le grec /etait/ ktait facultatif il fallait je crois que la plupart des gens il fallait qu' ils suivent il fallait qu 'ils suivent au moins deux ans de latin et au moins deux ans de franqais ( WA-M-09) (26) . . . mais moi je peux pas dire bon il faut qu'ils appreiznent il faut qu'elles apprennent la langue pour qu'elles soient franco-americaines elles le sont franco-amkricaines Iavecl avec ou sans la langue (WA-M-09) (27) . . . il faut qu'onparle anglais you know (WA-M-16) (28) on aimerait bien qu 'ils appreiznent le franqais h l'kcole (WA-F-06) (29) . . .disons il peut se passer un couple [kup~l]de semaines Iquel que jeparlepas du tout .. .(WA-M-09) 2. Cas de formes neutres employke dans les t2ches de traduction (1) ils ne voulaient pas qu'on joue avec la balle dans la terrain de jeu (WA-M-02) (3) il faut qu 'elle arrive i six heures (WA-F-04) (4) il faut qu 'on lave les vaisselles avant 0 \de\ partir (WA-F-04) (5) ils voulaient pas qu'on joue ...le soir apr8s la noirceur (WA-F-08) (6) ils ne voulaient pas qzi'on joue dehors quand il faisait noir (WA-M-09) (7) ils ne voulaient pas qu'on joue [VF : 3us] dehors lap/ aprks la noirceur (WA-M-11) (8) je pense pas qu'ils peuvent venir (WA-F-15) ( 9 ) ils voulaient pas qu'on joue deHors dans la noirceur (WA-M-16) (10) ils ne voulaient qu 'onjoue deHors aprks que c'Ctait noir (WA-M-23) (1 1) il faut laver [lav] la vaisselle avant de /parti- de par-/ partir (WA-M-14) Annexe "B" Les phrases de la tdche de traduction 1 . I have to be there this evening around 6:00. 2. He has to be there this evening around 6:OO. 3. She has to be there this evening around 6:OO. 4. You have to be there this evening around 6.00. 5. Yoti have to be there this evening around 6:OO. 6. (To a friend:) You have to be there this evening around 6.00. 7. (To a group ofpeople:) You have to be there this evening around 6:OO. 8. (Referring to a group of girls for a pageant) They have to be there this evening around 6:OO. 9. (Referring to a group of boys for a boy scout meeting) They have to be there this evening around 6:OO. 10. We have to do the dishes before we can go. I I . [ n e roads were so slippery] we had to drive real slow. 12. (Referring to teachers when you were in school:) They didn 't want 21s to play with a ball at recess in the school yard. 13. (Referring to daughter's homework:) [She'll have time topnish it] before she goes to school tomorrow. 14. I don't think they can come. 15. Do you want me to make a cakefor your birthday? BIOGRAPHY OF THE AUTHOR Alexandra Todorova was born in 1970 in Bulgaria. She graduated from the French Language School in Plovdiv, Bulgaria in 1989, and a Master's degree in French and Bulgarian Philology at Plovdiv University. Alexandra has taught French in schools in Bulgaria and Maine. At present she resides with her family in Orono, Maine.