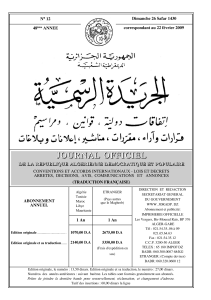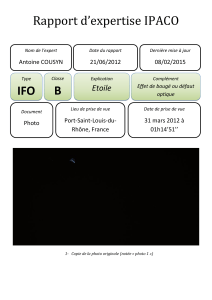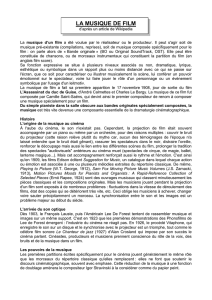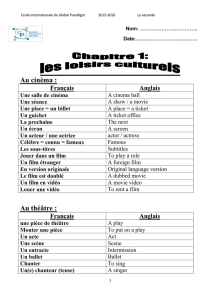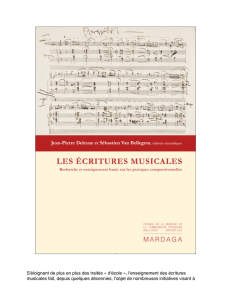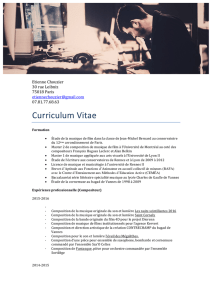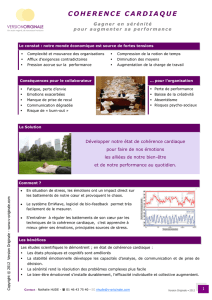Pour en finir définitivement avec Hans Zimmer

Pour en finir définitivement
avec Hans Zimmer
Qu’est-ce qui fait une bande originale notable au cinéma ? Il
n’est pas ici question de musique de comédie musicale, ni de
bande-son, mais de la pure création musicale, composée pour un
film donné et accompagnant celui-ci. Question corollaire :
desquelles nous souvenons-nous ? Quand nous nous tournons vers
nos mémoires juvéniles, à peine expérimentées, en ressortent
les classiques, c’est-à-dire les violons de Psychose, ceux des
Dents de la mer, le thème de Star Wars, celui d’Harry Potter,
la musique d’Inception.
La conception commune de la bande originale d’aujourd’hui
serait dans nos esprits celle de cuivres majestueux, de
violons nombreux surtout, de chœurs donnant au spectateur
l’envie de pleurer, de mourir, les deux peut-être, débordé par
ce trop-plein symphonique.
Le problème est celui-ci : la musique épique s’est imposée

comme la seule musique de film démocratisée indépendamment du
film, en témoigne le nombre vertigineux d’écoutes, tous médias
confondus, des titres des compositeurs les plus populaires
aujourd’hui – John Williams, Alexandre Desplat, Hans Zimmer,
Danny Elfman et autres.
La plupart des œuvres semblent se fondre en un modèle, les
compositeurs se confondre – et il est dommage que toute
étincelle de tension dramatique soit à chaque fois soutenue,
dans les productions grand public actuelles, par la musique
façon Pirates des Caraïbes. Toute grosse production qui se
respecte devra inclure son lot de musique de bande-annonce,
larmoyante, tonitruante, au fond bien plate, rapidement
lassante.
Certes la composition originale est au service du film et le
soutient ; la musique se subordonne à l’histoire, et s’adresse
autant au conscient qu’à l’inconscient (visionner tout film
d’horreur sans le moindre son le rend risible).
Une douche, des violons, et Herrmann transforma la musique de
film
La musique donnera à la scène une teinte, que notre cerveau

accepte sans forcément faire l’effort de rendre l’effort
perceptible – nous acceptons ce qui nous est présenté, son et
image liés. Elle en est destinée à devenir plus utile que
belle, du moins pour une impression directe et première, et
des clichés musicaux se sont, assez logiquement, largement
répandus. Se poser la question de l’intérêt de se démarquer et
créer quand l’on s’adresse à un inconscient primitif n’est
même pas légitime.
Le problème est que la bande originale de films populaires
modernes, donc les plus représentés médiatiquement, fut
reléguée à ce modèle très particulier : gros violons, gros
cors, pour de grosses larmes.
Et cette musique fonctionne encore à défaut de surprendre,
parce que l’homme est faible, que des génies l’ayant bien
compris ont découvert comment l’émouvoir à moindre frais –
donc le faire payer.
Ce qui est contre-ambitieux, et disons-le, artistiquement
inacceptable, comme l’éternelle variation autour d’une figure
imposée, à l’encontre de la création musicale réelle. Le
spectateur a une responsabilité, celle de prendre conscience
qu’une bande originale peut surprendre, dérouter, exister en
tant que telle, plutôt que d’imposer à l’infini le schéma
violons tristes / scène triste, cuivres ascendants / scène
pleine d’espoir, piano pensif / héros introspectif.

La bromance de Nino Rota et Federico Fellini
Parce que la bande originale telle qu’elle est répandue et
écoutée aujourd’hui n’a naturellement pas toujours existé. La
question fut longtemps de savoir si le film devait illustrer
directement l’image.
Une des premières bandes originales de l’histoire du cinéma
fut composée par Saint-Saëns pour L’Assassinat du duc de
Guise, 1908. Auparavant des morceaux antérieurs étaient
recomposés, mis bout à bout pour l’occasion et réarrangés.
Dans les années 1920, Erik Satie, Arthur Honegger, Darius
Milhaud, créateurs de « musique savante » donc, écrivent pour
l’écran comme ils composent traditionnellement.
Gottfried Huppertz, quand il voudra s’attaquer aux cinq heures
du diptyque des Nibelungen de Fritz Lang (il composera en 1927
la partition de Metropolis), ne peut que ressentir l’influence
du grand Wagner, qui faisait peser sur toute sa descendance
musicale L’Anneau du Nibelung, sa gigantesque fresque
légendaire de quatre opéras composée sur vingt-cinq ans.
Il compose malgré tout une partition originale, pourtant
remplacée durant les projections françaises et américaines par
des thèmes de l’opéra de Wagner ; Lang, qui vouait une
profonde aversion à celui-ci, ne jurait pour son film que par
Huppertz, ne s’étant inspiré au détriment de la Tétralogie

romantique que de la légende germano-nordique – ce sera la
première bande originale commercialisée de l’histoire.
Le cinéma devient parlant en 1927, les années 1930 apportent
le classicisme hollywoodien et ses compositeurs héritiers du
romantisme de Wagner toujours, Brahms et Strauss. Max Steiner
(King Kong), Franz Waxman (La Fiancée de Frankenstein), Erich
Wolfgang Korngold (Les Aventures de Robin des Bois), souvent
fuyant le nazisme, arrivent à Hollywood fort de leur héritage
romantique et fixent l’utilisation du leitmotiv et du
développement de ses échos.
Ennio Morricone et Sergio Leone
L’écriture de la musique devient thématique. La musique
d’après-guerre se modernise et tend à s’élargir à l’instar des
genres qu’elle tient à porter – elle se déconstruit, davantage
atonale, moins évidente. La musique se fait plus ciblée, et
les influences se rénovent entre Stravinsky, Bartók et
Schönberg. À partir de 1950, les genres musicaux de la bande
originale s’ouvrent : le jazz de Bernstein, d’Alex North, et
ensuite le rock, la pop, la funk blaxploitation, la disco, le
hip-hop, l’électro. La bande originale suit les tendances
musicales et pousse le champ des expérimentations dans
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
1
/
11
100%