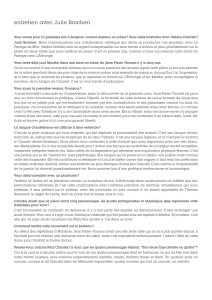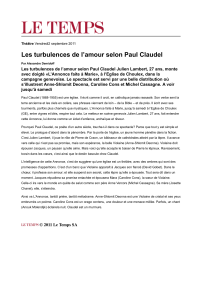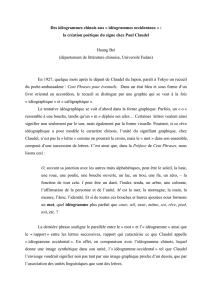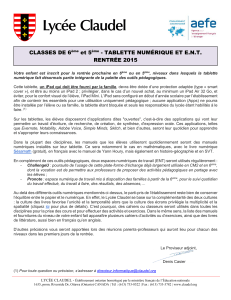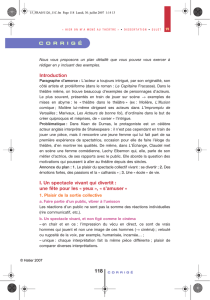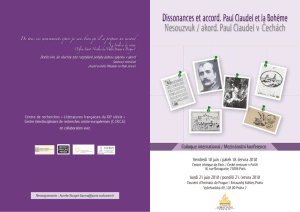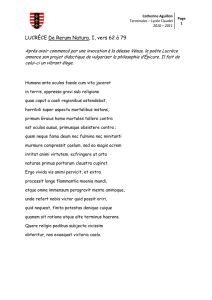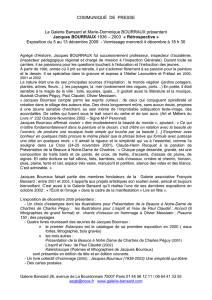Dossier pédagogique L`Echange

1
L’ÉCHANGE
1reversion (1893)
Grand Théâtre
du 12 novembre au 14 décembre 2008
du mercredi au samedi à 20h30, les mardis à 19h30 et les dimanches à 15h30
texte Paul Claudel
mise en scène Yves Beaunesne
collaboration artistique Marion Bernède
assistants mise en scène Augustin Debiesse et Caroline Lavoinne
scénographie Damien Caille-Perret
costumes Patrice Cauchetier
lumière Joël Hourbeigt
création son Christophe Séchet
coiffures et maquillages Catherine Saint-Sever
production Compagnie de La Chose Incertaine – Yves Beaunesne, Théâtre de la Place de Liège (Belgique), Scène Watteau de Nogent-sur-Marne, Maison de la culture de Nevers
et de la Nièvre, Bonlieu – Scène nationale d’Annecy, Maison de la culture de Bourges, le Parvis – Scène nationale de Tarbes, L’apostrophe – Scène nationale de Cergy-Pontoise
et du Val-d’Oise, Théâtre national de Marseille – La Criée.
Avec la participation du Centre des arts scéniques de Belgique.
Avec le soutien du département du Val-de-Marne, de la DRAC Île de France.
Le texte de L’Échange est disponible aux Éditions Gallimard, coll. « Folio », no911, Paris, 1977 (2007).
Le spectacle a été créé en décembre 2007 au Théâtre de la Place à Liège.
Service pédagogique Anne Boisson tél. 01 44 62 52 69 – [email protected]
Marie-Julie Pagès tél. 01 44 62 52 53 – [email protected]
L’ÉCHANGE
1re version (1893)
Grand Théâtre
du 12 novembre au 14 décembre 2008
du mercredi au samedi à 20h30, les mardis à 19h30 et les dimanches à 15h30
texte Paul Claudel
mise en scène Yves Beaunesne
collaboration artistique Marion Bernède
assistants mise en scène Augustin Debiesse et Caroline Lavoinne
scénographie Damien Caille-Perret
costumes Patrice Cauchetier
lumière Joël Hourbeigt
création son Christophe Séchet
coiffures et maquillages Catherine Saint-Sever
production Compagnie de La Chose Incertaine – Yves Beaunesne, Théâtre de la Place de Liège (Belgique), Scène Watteau de Nogent-sur-Marne, Maison de la culture de Nevers
et de la Nièvre, Bonlieu – Scène nationale d’Annecy, Maison de la culture de Bourges, le Parvis – Scène nationale de Tarbes, L’apostrophe – Scène nationale de Cergy-Pontoise
et du Val-d’Oise, Théâtre national de Marseille – La Criée.
Avec la participation du Centre des arts scéniques de Belgique.
Avec le soutien du département du Val-de-Marne, de la DRAC Île de France.
Le texte de L’Échange est disponible aux Éditions Gallimard, coll. « Folio », no911, Paris, 1977 (2007).
Le spectacle a été créé en décembre 2007 au Théâtre de la Place à Liège.
Service pédagogique Anne Boisson tél. 01 44 62 52 69 – [email protected]
Marie-Julie Pagès tél. 01 44 62 52 53 – [email protected]
1

2
avec
Nathalie Richard Lechy Elbernon
Alain Libolt Thomas Pollock Nageoire
Jérémie Lippmann Louis Laine
Julie Nathan Marthe
2
avec
Nathalie Richard Lechy Elbernon
Alain Libolt Thomas Pollock Nageoire
Jérémie Lippmann Louis Laine
Julie Nathan Marthe

3
Sommaire
Documents réunis par la Compagnie de la Chose Incertaine – Yves Beaunesne
I. L’ÉCHANGE DANS L’ŒUVRE DE CLAUDEL p.6
II. LE DRAME DE L’EXIL, extrait de Paul Claudel, Lettre à Gignoux, 1914 p.7
III. LA FABLE DE L’ÉCHANGE p.8
IV. IL Y A DEUX HOMMES EN MOI, extrait de Paul Claudel, Programme du Théâtre des Mathurins, 1939 p.9
V. NUIT DE PLEIN JOUR, texte d’Yves Beaunesne p.10
VI. EXTRAIT DE L’ÉCHANGE, extrait de l’Acte I p.11
VII. ENTRETIEN AVEC YVES BEAUNESNE, propos recueillis par Pascale Alexandre p.13
Une révolution dans l’art théâtral
Actuel, universel ?
Un auteur populaire
Déployer une espérance
Claudel et Rimbaud
Une violence intérieure
Au passage du siècle
VIII. VERS D’EXIL, poème de Paul Claudel, 1898 p.28
IX. CLAUDEL AUX ÉTATS-UNIS, texte de Pascale Alexandre-Bergues p.29
X. UNE ÉTENDUE D’HUMANITÉ HOMOGÈNE COMME LA MER, Paul Claudel p.34
extrait de « Un poème de Saint-John Perse », 1948
XI. LE THÈME DE L’ÉCHANGE, Paul Claudel, extrait d’entretiens avec Jean Amrouche, p.35
« Mémoires improvisés », 1954
XII. QUATRE PERSONNAGES INEXTRICABLES,Paul Claudel, p.38
extrait d’entretiens avec Jean Amrouche, « Mémoires improvisés », 1954
3
Sommaire
Documents réunis par la Compagnie de la Chose Incertaine – Yves Beaunesne
I. L’ÉCHANGE DANS L’ŒUVRE DE CLAUDEL p.6
II. LE DRAME DE L’EXIL, extrait de Paul Claudel, Lettre à Gignoux, 1914 p.7
III. LA FABLE DE L’ÉCHANGE p.8
IV. IL Y A DEUX HOMMES EN MOI, extrait de Paul Claudel, Programme du Théâtre des Mathurins, 1939 p.9
V. NUIT DE PLEIN JOUR, texte d’Yves Beaunesne p.10
VI. EXTRAIT DE L’ÉCHANGE, extrait de l’Acte I p.11
VII. ENTRETIEN AVEC YVES BEAUNESNE, propos recueillis par Pascale Alexandre p.13
Une révolution dans l’art théâtral
Actuel, universel ?
Un auteur populaire
Déployer une espérance
Claudel et Rimbaud
Une violence intérieure
Au passage du siècle
VIII. VERS D’EXIL, poème de Paul Claudel, 1898 p.28
IX. CLAUDEL AUX ÉTATS-UNIS, texte de Pascale Alexandre-Bergues p.29
X. UNE ÉTENDUE D’HUMANITÉ HOMOGÈNE COMME LA MER, Paul Claudel p.34
extrait de « Un poème de Saint-John Perse », 1948
XI. LE THÈME DE L’ÉCHANGE, Paul Claudel, extrait d’entretiens avec Jean Amrouche, p.35
« Mémoires improvisés », 1954
XII. QUATRE PERSONNAGES INEXTRICABLES,Paul Claudel, p.38
extrait d’entretiens avec Jean Amrouche, « Mémoires improvisés », 1954

4
XIII. VERS, RYTHME, MUSIQUE, fragments de textes de Paul Claudel p.40
XIV. ARCHIPEL CLAUDEL, fragments d’entretiens avec Paul Claudel, à partir d’archives de l’INA p.43
(cinq émissions de France Culture, juillet 2005)
Archipel 1 : Les racines d’un écrivain
Archipel 2 : Les pères, les pairs et les impairs
Archipel 3 : Diction et théâtre
Archipel 4 : Parcours religieux
Archipel 5 : Le théâtre
XV. BIOGRAPHIE SÉLECTIVE DE PAUL CLAUDEL (1868-1955) p.49
XVI. BIBLIOGRAPHIE DE PAUL CLAUDEL p.54
XVII. L’ÉQUIPE ARTISTIQUE p.58
Yves Beaunesne, metteur en scène
Les comédiens :
Nathalie Richard
Alain Libolt
Jérémie Lippmann
Julie Nathan
ANNEXES p.61
Notes au fil du texte, établies par Augustin Debiesse
Parabole d’Animus et d’Anima, Paul Claudel, extrait de « Réflexions et propositions sur le vers français », janvier 1925
Parabole de l’Intendant infidèle, Évangile selon Luc, 16 : 1-13
Ma conversion, Paul Claudel, extrait de « Contacts et circonstances », 1913.
4
XIII. VERS, RYTHME, MUSIQUE, fragments de textes de Paul Claudel p.40
XIV. ARCHIPEL CLAUDEL, fragments d’entretiens avec Paul Claudel, à partir d’archives de l’INA p.43
(cinq émissions de France Culture, juillet 2005)
Archipel 1 : Les racines d’un écrivain
Archipel 2 : Les pères, les pairs et les impairs
Archipel 3 : Diction et théâtre
Archipel 4 : Parcours religieux
Archipel 5 : Le théâtre
XV. BIOGRAPHIE SÉLECTIVE DE PAUL CLAUDEL (1868-1955) p.49
XVI. BIBLIOGRAPHIE DE PAUL CLAUDEL p.54
XVII. L’ÉQUIPE ARTISTIQUE p.58
Yves Beaunesne, metteur en scène
Les comédiens :
Nathalie Richard
Alain Libolt
Jérémie Lippmann
Julie Nathan
ANNEXES p.61
Notes au fil du texte, établies par Augustin Debiesse
Parabole d’Animus et d’Anima, Paul Claudel, extrait de « Réflexions et propositions sur le vers français », janvier 1925
Parabole de l’Intendant infidèle, Évangile selon Luc, 16 : 1-13
Ma conversion, Paul Claudel, extrait de « Contacts et circonstances », 1913.

5
Regret des bras épais et jeunes d’herbe pure !
Rimbaud, Mémoire (été 1872), 4estrophe
Au reste, je ne puis parler de Rimbaud avec sang-froid. Il a eu une telle influence sur moi sous tous les rapports
que je me sens par l’esprit et les instincts poétiques lié à lui par des communications si secrètes et si intimes
qu’il me semble faire partie de moi-même…
Paul Claudel
Lettre à Maurice Pottecher, Shanghai, 26 février 1896,
Cahiers Paul Claudel, no1, Éditions Gallimard, Paris, 1959
5
Regret des bras épais et jeunes d’herbe pure !
Rimbaud, Mémoire (été 1872), 4estrophe
Au reste, je ne puis parler de Rimbaud avec sang-froid. Il a eu une telle influence sur moi sous tous les rapports
que je me sens par l’esprit et les instincts poétiques lié à lui par des communications si secrètes et si intimes
qu’il me semble faire partie de moi-même…
Paul Claudel
Lettre à Maurice Pottecher, Shanghai, 26 février 1896,
Cahiers Paul Claudel, no1, Éditions Gallimard, Paris, 1959
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
1
/
73
100%