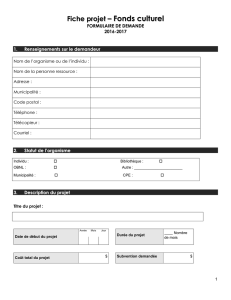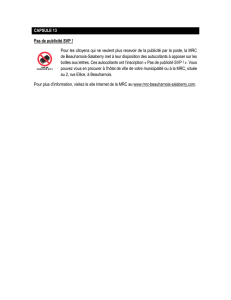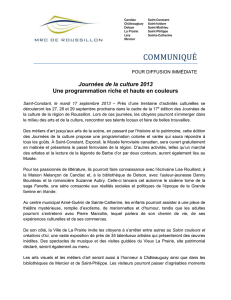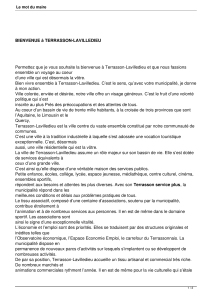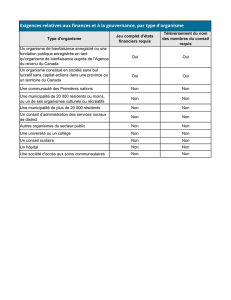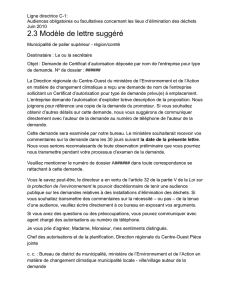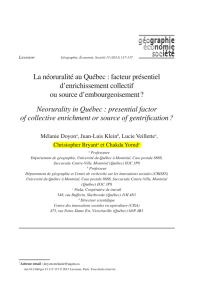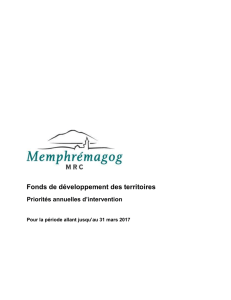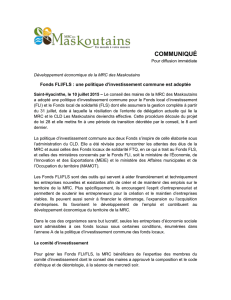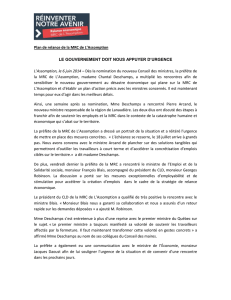mes commentaires

1
Commentaires sur l’article :
« La néoruralité au Québec : facteur présentiel d’enrichissement collectif
ou source d’embourgeoisement » (le cas de St-Mathieu-de-Rioux) ?
Doyon, Klein, Veillette, Bryant et Yorn
Géographie, Économie, Société 15 (2013) 117-137
1
Bernard Vachon, Ph. D.
Professeur retraité du département de géographie de l’UQAM
Spécialiste en développement local et régional
Développement rural et gouvernance territoriale
2
La décision de commenter cet article a été motivée par cinq raisons :
1. Ce que le auteurs présentent comme le portrait de la néoruralité à Saint-Mathieu-de-
Rioux, le profil socioéconomique dominant des néoruraux de cette communautés ainsi
que les impacts négatifs de la néoruralité sur le dynamisme économique, la cohésion
sociale et l’attractivité de cette petite municipalité rurale, laisse le résident informé et
1
Épreuves de l’article telles que transmises par Juan-Luis Klein le 19 décembre 2013. « C'est une version
finale à 99,9%. » J-L.K.
2
Je suis résident de Saint-Mathieu-de-Rioux depuis 1979. De 1979 à 1989, avec mon épouse et nos trois
fils, nous avons mis sur pied un élevage ovin comprenant 125 brebis. Nous accomplissions toutes les tâches
agricoles liées à cet élevage : entretien des pâturages et de la machinerie, production du fourrage, gestion
du troupeau, mise en marché des agneaux, etc. Parallèlement, j’étais impliqué sans la vie sociale de la
communauté : président de la coopérative agricole, membre du conseil d’administration pour la relance de
la scierie, entraîneur d’une équipe de hockey, candidat à la mairie (1987), fondateur du Comité
d’aménagement et de la qualité de vie de St-Mathieu (qui a notamment préparé et rédigé bénévolement le
premier règlement de zonage, de lotissement et de construction de la municipalité, dont les orientations et
les prescriptions ont été reconnues avant-gardistes par le ministère des Affaires municipales. Ce règlement
qui créait entre autres une zone verte à des fins de conservation et d’activités récréotouristiques et une zone
de ceinture bleue autour des lacs, a été revu plus tard par la municipalité et la MRC et certaines dispositions
ont été modifiées. La rive sud du petit lac St-Mathieu a été exclue de la zone agricole permanente pour fin
de construction domiciliaire et ce n’est qu’au printemps 2013 que le conseil municipal a adopté un nouveau
règlement de zonage, de lotissement et de construction contenant des normes plus sévères en matière de
lotissement et de construction autour des lacs et en bordure des rivières). Ce comité composé de jeunes
agriculteurs, d’artisans des rangs et de résidents du village a eu plusieurs réalisations marquantes : tracé
d’un circuit de vélo de montagne et courses régionales annuelles, reconstruction des 9 croix de chemin et
cérémonies de bénédiction sur deux week-ends consécutifs, exposition d’articles religieux anciens, course
de « boîtes à savon », fêtes de Noël pour les enfants, soirées musicales, petits concerts, repas
communautaires, etc. De 1989 à 2000 le temps passé à St-Mathieu a été limité aux longs week-ends et aux
vacances d’été. Depuis mon départ à la retraite de l’UQAM (2000), nous vivons, mon épouse et moi, entre
six et huit mois par année à notre ferme, Chantemerle, incluant des participations à diverses activités de la
communauté. Durant toutes ces années (35 ans), notre ferme a été un véritable laboratoire à ciel ouvert
d’observation et d’analyse de la transformation économique et sociale d’une petite communauté rurale
d’une région périphérique du Québec. J’ai organisé plusieurs stages en développement local de 6 à 10 jours
pour des étudiants de niveaux bac et maîtrise. Ils logeaient alors dans des familles de la municipalité et
prenaient des repas chez moi.

2
l’observateur averti interloqués. La surprise n’est pas moins grande à la lecture des
derniers paragraphes alors que les auteurs déclarent : « nous constatons une tendance
à l’embourgeoisement villageois. »
Deux explications possibles : 1. le questionnement posé à la fois comme base de l’étude
et hypothèse de recherche, n’aurait pas été suivi d’une démarche d’analyse adéquate,
ce qui aurait conduit à des erreurs de lecture et d’interprétation des faits que
confirmeraient les principaux constats et conclusions de l’article; 2. le contenu de
l’article, suite à un processus de simplification des auteurs, aurait pris une distance par
rapport aux authentiques résultats de la recherche, optant pour des constats et des
conclusions « déjà dans la plume des auteurs ».
Le questionnement des auteurs :
« L’arrivée de néoruraux avec des revenus plus élevés que ceux de la population
résidente renforce-t-elle la collectivité ? Contribue-t-elle à sa croissance économique
et à la création d’emplois ? Permet-elle d’améliorer les conditions de vie des
résidents ? Pourrait-elle constituer une stratégie de développement territorial
durable ? Ou, plutôt, n’est-elle pas une cause d’embourgeoisement (gentrification)
provoquant des conflits sociaux et la dégradation des conditions de vie d’une partie
de la population ? Voilà les questions auxquelles ce texte (article) vise à répondre à
travers l’étude d’une municipalité rurale qui n’est pas sous influence
métropolitaine. »
3
2. La lecture de cet article peut porter à penser que la recherche qui a conduit aux
constats et aux conclusions énoncés n’avait pas les ressources appropriées pour couvrir
et analyser adéquatement la réalité complexe du phénomène de la néoruralité en cours
à Saint-Mathieu-de-Rioux depuis le milieu des années 70, parallèlement à
l’effondrement de l’économie traditionnelle. Or, cet article s’appuie sur deux documents
étoffés : 1. Un rapport de recherche de Solidarité rurale du Québec (SRC) portant sur le
même sujet avec comme cas d’analyse St-Mathieu-de-Rioux, Saint-Alexis-de-Monts et
Val-David, signé par les mêmes auteurs
4
; 2. le Mémoire de maîtrise de Lucie Veillette
3
Doyon, M., Klein, J-L. Veillette, L, Bryant, C. et Yorn, C.; « La néoruralité au Québec : facteur présentiel
d’enrichissement collectif ou source d’embourgeoisement » (le cas de St-Mathieu-de-Rioux) ?
Géographie, Économie, Société 15 (2013), p.120.
4
Chakda Yorn (SRQ), Lucie Veillette (SRQ), Christopher Bryant (UdeM), Juan-Luis Klein (UQAM), Mélanie
Doyon; « Étude de cas sur la néoruralité et les transformations des collectivités rurales » (Val-David, Saint-
Alexis-des-Monts, Saint-Mathieu-de-Rioux), SRQ, juin 2008, 66 p. Yorn et Veillette ont eu un rôle majeur
dans la réalisation de cette étude car ils étaient alors respectivement chargé de projet et agente de
recherche à Solidarité rurale. http://www.ruralite.qc.ca/fichiers/dossiers/Rapport_neoruralite_0.pdf

3
(parmi les cinq auteurs de l’article)
5
qui reprend et approfondit la thématique de
recherche de Solidarité rurale du Québec sur la néoruralité. Ces deux documents sont
nettement plus rigoureux et nuancés dans leurs observations et conclusions que
l’article, et à aucun moment ils n’évoquent « une tendance à l’embourgeoisement »
pour le cas de Saint-Mathieu.
3. Le processus d’ « embourgeoisement villageois » qui semble être présent dans la MRC
de Brôme-Missisquoi comme l’ont démontré les travaux de la chercheure Myriam
Simard du Centre Urbanisation, Culture et Société de l’INRS
6
, est présenté dans l’article
comme hypothèse de recherche dans le cas de Saint-Mathieu-de-Rioux et comme
principale conclusion, sans toutefois que celle-ci soit fondée sur un argumentaire
considérant tous les aspects de la néoruralité de Saint-Mathieu. Plusieurs facettes, et
non les moindres, de la néoruralité de Saint-Mathieu et la spécificité de celle-ci n’ont
pas été traitées, laissant toute la place à d’autres aspects –par ailleurs amplifiés–, pour
confirmer l’hypothèse de départ. C’est un raccourci qui ne joue pas en faveur d’un texte
qui s’affiche comme scientifique.
4. La principale conclusion de cette étude sur le phénomène de la néoruralité à Saint-
Mathieu-de-Rioux, soit « une tendance à l’embourgeoisement villageois », porte une
charge de représentations négatives, voire péjoratives, dont les auteurs ne semblent
pas avoir mesuré pleinement la portée en la décrétant et en l’appliquant implicitement
à l’ensemble du territoire de la municipalité, sans distinction des trois grands secteurs
du territoire qui comportent pourtant de significatives différences en termes
d’occupation humaine, de caractéristiques socioéconomiques des résidents et
d’affectation des sols (le pourtour du grand lac, le village et les rang 3, 4 et 5).
5. Plutôt de laisser passer la chose sous silence j’ai choisi de réagir, non seulement par
souci de rectifier les faits -les dommages auront malheureusement déjà été causés
auprès de certains publics-, mais pour exprimer ma déception au regard d’une
publication universitaire qui aurait dû conduire à un exposé juste de la réalité (bien que
simplifié) par la prise en compte de la complexité et des multiples visages qui
singularisent la néoruralité de Saint-Mathieu et l’impact de celle-ci sur l’évolution de la
petite communauté.
5
Veillette L., 2011, Néoruralité et dynamisation présentielle des territoires ruraux : trois études de cas au
Québec, Mémoire de maîtrise, Département de géographie, Université du Québec à Montréal, 170 p.
Voir pour le texte intégral: http://www.archipel.uqam.ca/3910/1/M12007.pdf
6
http://www.neoruraux.ucs.inrs.ca/terrainsetude.html

4
Des observations couvrant un plus large éventail des facettes de la néoruralité de Saint-
Mathieu et des conclusions nuancées, auraient contribué à une meilleure
compréhension et évaluation d’une réalité de plus en plus présente dans les
communautés rurales du Québec, dont les effets doivent être correctement identifiés et
mesurés puisque qu’ils sont de nature à guider les décisions des autorités locales en
matière d’aménagement et de développement du territoire. En outre, cet article aurait
pu procurer une grille objective de réflexion sur les avantages socioéconomiques réels
et le potentiel d’effets positifs et négatifs susceptibles d’être considérés dans
l’élaboration d’une vision, d’une stratégie et d’une démarche d’aménagement et de
développement local pour Saint-Mathieu. Plutôt de se commettre dans une conclusion
hasardeuse (ce que ne font ni le rapport de recherche de SRQ, ni le Mémoire de maîtrise
de Lucie Veillette à la source de cet article), les signataires de l’article n’auraient-ils pas
mieux fait d’assurer une valeur de référence à leur production, faisant ainsi œuvre
pédagogique ?
La néoruralité et ses néoruraux constituent une force de reconquête et de
recomposition économique et sociale des territoires ruraux, en lien étroit avec la trame
globale d’occupation du territoire (réseau urbain et espaces ruraux en relation
d’interdépendance et de complémentarité), qui n’est pas sans rapport avec l’évolution
de la structure économique et de la logique de localisation des familles, des travailleurs
et des entités de production que vient modifier le facteur de mobilité accrue. Du fait de
la grande diversité des situations dans l’expression du mouvement de néoruralité,
encore peu étudié au Québec, les contributions à la compréhension de ce phénomène
et de ses impacts ne doivent-elle pas coller au plus près des réalités locales en évitant le
piège des généralisations ?
Des conclusions importées de situations vécues ailleurs
Les constats et les principales conclusions de l’article contenus dans les deux
paragraphes qui suivent, soulèvent à la fois étonnement et interrogations chez ceux qui
connaissent bien la situation de Saint-Mathieu :
« En fait, la néoruralité qu’on observe aujourd’hui à Saint-Mathieu-de-Rioux
s’apparente davantage à un embourgeoisement villageois plutôt qu’à un nouveau
dynamisme économique consécutif de la présence de nouvelles populations. » (…)
« Nous avons en effet pu constater dans le village étudié une augmentation de la
population due à l’arrivée de néoruraux, essentiellement retraités, en plus d’une
appréciation du commerce local et de la valeur des résidences. Mais nous avons

5
vu aussi que cela a des effets potentiellement négatifs, sur l’environnement et sur
la cohésion sociale. En fait, nous constatons davantage une tendance à
l’embourgeoisement villageois. » (…)
« Pour que l’économie résidentielle représente une véritable alternative et crée
réellement une économie locale, la présence de nouvelles populations ne doit pas
porter atteinte à l’attractivité du lieu ni à la capacité des anciens résidents de
bénéficier de l’enrichissement créé par la nouvelle population. Or, c’est ce qui se
produit actuellement à Saint-Mathieu-de-Rioux. » (…)
« Nous pouvons donc conclure du cas analysé que l’attrait des nouvelles
populations à plus haut revenu doit se combiner avec la reconversion de
l’économie locale permettant la création d’emplois locaux et aussi l’intégration
sociale. »
Les conclusions qui portent sur « l’embourgeoisement villageois » de la communauté de
St-Mathieu et sur les effets « négatifs sur la cohésion sociale » sont des conclusions qui
véhiculent ce qui est devenu, malheureusement, un lieu commun, un raccourci issu de
recherches exploratoires récentes, construit à partir d’une réalité qui existe ailleurs, que
l’on pose comme base d’explication au cas de Saint-Mathieu. La démarche scientifique
ne doit-elle pas se méfier des transferts hâtifs de résultats d’études obtenus dans des
contextes spécifiques ?
7
L’occasion était belle pourtant d’enrichir ce nouveau champ de
connaissance d’une démarche d’analyse et d’une méthodologie qui auraient tenu
compte des spécificités territoriales et socioéconomiques de Saint-Mathieu pouvant
conduire à des constats et conclusions inédites (ce que font les deux recherches
précitées, notamment le Mémoire de Lucie Veillette, mais non l’article).
Des faits à rectifier :
1. Si l’augmentation de la population de St-Mathieu est due principalement à l’arrivée
de néoruraux, ces derniers sont loin d’être « essentiellement des retraités à haut
7
La chercheure Myriam Simard de l’INRS qui a constaté, dans le cadre de ses travaux sur la néoruralité de
la MRC de Brôme-Missisquoi, des signes de ce qui a été identifié comme des manifestations de
« l’embourgeoisement rural », invite toutefois à la prudence à l’égard d’une conclusion générale qui irait
dans ce sens, alors qu’elle présentait une communication avec sa collègue Laurie Guimond, à un colloque
international: Laurie Guimond et Myriam Simard; Néoruralité et embourgeoisement des campagnes
québécoises : un regard nuancé. Colloque de l’Association de science régionale de langue française.
Rimouski, 25 août 2008 (http://www.neoruraux.ucs.inrs.ca/PDF/Guimond.pdf).
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
1
/
23
100%