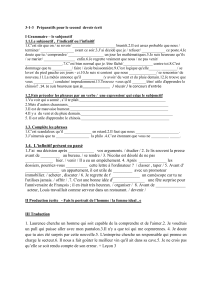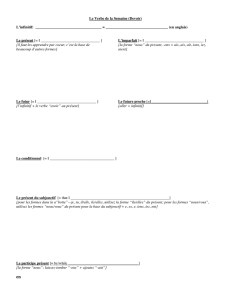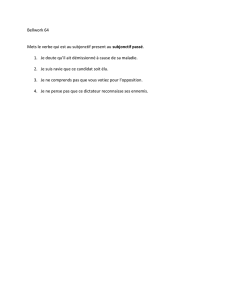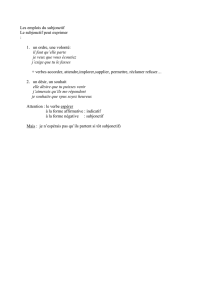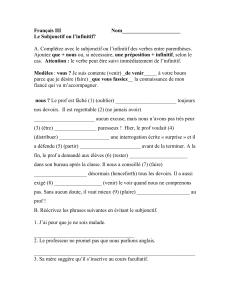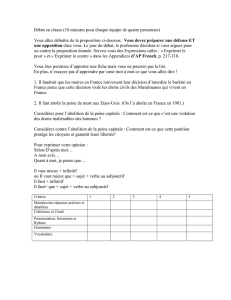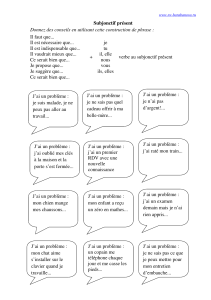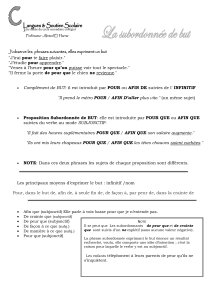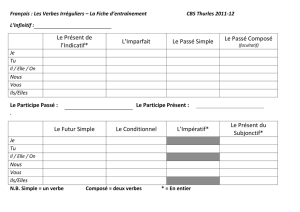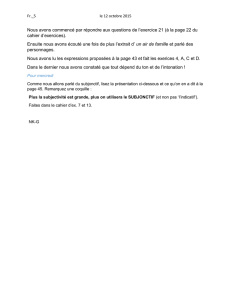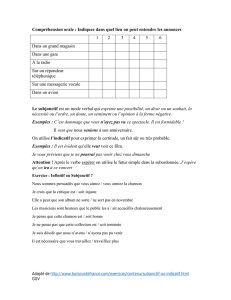L`axe chronothétique et l`axe chronogénétique dans l

STUDIA UBB PHILOLOGIA, LX, 4, 2015, p. 123 - 136
(RECOMMENDED CITATION)
L’AXE CHRONOTHÉTIQUE ET L’AXE CHRONOGÉNÉTIQUE
DANS L’ACTUALISATION DE L’HYPOTHÈSE EN FRANÇAIS
ET EN ESPAGNOL. ÉTUDE APPLIQUÉE À « CANDIDE »
DE VOLTAIRE
PILAR SARAZÁ CRUZ1
ABSTRACT. The Chronothetic and the Chronogenetic Axes in Hypothesis
Actualisation in French and Spanish. Applied Study to Voltaire’s "Candide".
The application of the theories guillaumiennes to "Candide" in this work, compar
the French text with the translation in Spanish, and it is founded on the fact that
the expression of the hypothesis in both language materializes of different form
and that it uses verbal booths that are not always coincidental. In fact, the French
subjunctive is great less used that the spanish hypothesis. In french should have
expressed by the indicative times.
Key words: Linguistics. Translation. Systematic of the language. Voltaire, ”Candide”
REZUMAT. Axa cronotetică și axa cronogenetică în actualizarea ipotezei în
franceză și în spaniolă. Aplicarea teoriilor lui Guillaume la Candide de Voltaire,
pe care o prezentăm în acest articol, comparând textul francez cu traducerea în
spaniolă, își găsește temeiul în faptul că expresia ipotezei se materializează diferit
în cele două limbi și face apel la diferite resurse verbale ce nu sunt întotdeauna
coincidente. În fapt, conjunctivul francez este mult mai puțin utilizat decât
conjunctivul spaniol, fapt ce permite ca ipoteza să fie exprimată în franceză prin
timpuri ale indicativului.
Cuvinte cheie : lingvistică, traducere, sistematica limbajului, interpretare, Voltaire,
„Candide”
1 Maître de Conférences. Université de Cordoue. UER Traduction et Interprétation. Thèse de
Doctorat : « Arquitectónica del tiempo en « À la Recherche du temps perdu de Marcel Proust”.
Recherche : Linguistique psychomécanique. Marcel Proust. Phonétique française. Français
fonctionnel pour l’enseignement de la langue française aux adultes universitaires. E-mail :
pilarsaraza@hotmail.com
Provided by Diacronia.ro for IP 88.99.165.207 (2017-06-04 00:59:41 UTC)
BDD-A23018 © 2015 Editura Presa Universitară Clujeană

PILAR SARAZÁ CRUZ
124
Dans les travaux sur la Psychomécanique du Langage, à notre avis, on doit
toujours partir des sources guillaumiennes pour ne pas trop s’éloigner du but
principal que nous nous proposons : la diffusion des théories de Gustave
Guillaume :
« … la pensée, construisant la langue, inscrit son action constructive entre des
limites - qu’elle se donne selon le problème à résoudre - et, entre ces limites, se donne
la liberté d’un mouvement dans les deux sens, dans l’axe chronothétique et dans l’axe
chronogénétique »2
(Leçon 13 Fev. 1948 (Série C) p. 105)
Nous allons observer comment dans l’actualisation de l’hypothèse, on
s’approche parfois de l’univers temps, parfois de l’univers espace, suivant l’emploi
de différentes formes verbales qui peuvent exprimer des fait probables, possibles
ou certains.
A cet égard, et pour l’analyse des différents temps ou modes, nous établissons,
dans notre étude, une échelle qui part de l’observation du fonctionnement de
l’infinitif, du futur et du conditionnel. Tous trois comportent dans leur propre
constitution une charge d’hypothèse par suite de la présence du –r- .
Puis, nous étudions le subjonctif porteur de deux chronotypes, à cause du
mouvement du temps dans les deux sens, ascendant et descendant. Ensuite, nous
observons l’usage de l’indicatif imparfait employé avec une valeur hypothétique
qui substitue, dans certains cas, l’imparfait du subjonctif ou même le conditionnel
simple.
En tout cas nous faisons une analyse au niveau de la langue en puissance
et en même temps nous étudions les exemples au niveau du discours, en comparant
l’expression de l’hypothèse et en français et en espagnol - à travers l’observation
du fonctionnement des temps verbaux dans l’œuvre de Voltaire “Candide”.
Ce choix répond à des raisons différentes. D’une part, nous avons travaillé
l’œuvre avec nos étudiants, puis il s’agit d’un chef-d’œuvre magnifique, superlatif,
philosophique, ironique et amusant et finalement il montre un état de la langue
française à mi-chemin entre le français actuel et l’ancien français, ce qui peut nous
aider à bien comprendre, la disparition du mode subjonctif et le remplacement de
ses formes par d’autres formes de l’indicatif et même par des modes nominaux.3
En outre, la philosophie de Candide établit un certain type de causalité:
“…il n’y a jamais d’effets sans cause…”.
2 Pour les citations des Leçons nous signalons la date et la page du volume : Leçons de
linguistique de Gustave Guillaume 1948-49B. Les Presses de l’université de Laval-Québec.
Klincsieck-Paris, 1971
3 VOLTAIRE : Romans et contes (préface de Roland Barthes). Coll. Folio. Gallimard, 1972.
VOLTAIRE : Cádido-Zadig. Biblioteca de bolsillo. Madrid. EDAF, 1.971
Provided by Diacronia.ro for IP 88.99.165.207 (2017-06-04 00:59:41 UTC)
BDD-A23018 © 2015 Editura Presa Universitară Clujeană

L’AXE CHRONOTHÉTIQUE ET L’AXE CHRONOGÉNÉTIQUE DANS L’ACTUALISATION DE L’HYPOTHÈSE
125
Cela peut être comparé, dans un certain sens, avec les théories de
psychomécanique du langage selon lesquelles, la chronologie de raison impose
“un avant” et un “après”, établissant des limites entre lesquelles, la pensée se
donne la liberté d’un mouvement dans les deux sens.
Nous aimons Voltaire parce qu’il représente la défense de la raison. Il a
toujours lutté par une cause juste et naturelle et contre la corruption et la bêtise.
Finalement on peut approcher Guillaume de Voltaire en ce qu’il conçoit
l’univers d’une manière géométrique : “Dieu a crée le monde comme un géomètre,
non comme un père…”
Pour Guillaume l’idée du temps est expliquée à l’aide de l’idée de l’espace.
Pour l’analyse de l’actualisation de l’hypothèse, au niveau de la langue, nous
partons du schéma suivant de Gustave Guillaume, différenciant l’axe chronothétique
de l’axe chronogénétique.
(Leçons 1939S, p. 233)
Le français moderne a conservé la construction subjonctive quand il s’agit
de l’aspect composé, et l’a éliminée quand il s’agit de l’aspect simple. L’aspect
composé présente comme verbe un auxiliaire, c’est-à-dire un verbe qui reste par
subduction, au-dessous de son sens plein, au-dessous de lui-même. Il se produit
ainsi que le mouvement subductif vient s’ajouter au mouvement hypothétique.
En résumé, dans le français moderne, pour ce qui est des propositions
hypothétiques, les choses se présentent comme suit :
Provided by Diacronia.ro for IP 88.99.165.207 (2017-06-04 00:59:41 UTC)
BDD-A23018 © 2015 Editura Presa Universitară Clujeană

PILAR SARAZÁ CRUZ
126
1.- Si je pouvais, je partirais
2.- Si je l’avais fait, j’aurais réussi
3.- Si je l’eusse fait, j’eusse réussi (Ibid.)
Quand paraît la construction indicative si je le pouvais, je partirais, c’est
que l’hypothèse se laisse porter à l’actualité et le mode indicatif devient possible.
Ce type de construction n’est pas possible en espagnol. L’imparfait du mode
indicatif n’a pas la capacité d’exprimer l’hypothèse. Il faut dans ce cas employer
l’imparfait du subjonctif : « Si pudiera, me iría ».
INFINITIF – FUTUR - CONDITIONNEL
Le mode infinitif latin, situé tout au fond de la perspective modale, exprime une
interruption de la chronogénèse aussi précoce qu’il est possible : la coupe transversale
qui intercepte le développement de la chronogénèse survient tout à fait au début de
celle-ci, avant qu’elle n’ait produit les résultats qu’il faut attendre de sa progression.
(1944a, P139)
L’image verbale in posse, représentée par l’infinitif, est celle du verbe qui
n’a fait aucune dépense de lui-même, qui constitue un possible non encore entré
dans le réel ; l’image verbale in fieri, représentée par le participe présent, constitue
un état plus avancé de réalisation : le verbe est perçu en partie accompli et en
partie inaccompli; quant à l’image verbale in esse, représentée par le participe
passé, elle est l’expression d’un verbe accompli en totalité et qui a fait la dépense
entière de la puissance qu’il contient. Le participe passé est, pourrait-on dire, la
forme morte du verbe. La superposition de ces trois formes dans la chronothèse
initiale du français peut être figurée comme suit :
Provided by Diacronia.ro for IP 88.99.165.207 (2017-06-04 00:59:41 UTC)
BDD-A23018 © 2015 Editura Presa Universitară Clujeană

L’AXE CHRONOTHÉTIQUE ET L’AXE CHRONOGÉNÉTIQUE DANS L’ACTUALISATION DE L’HYPOTHÈSE
127
(L.1944A, p. 149)
L’infinitif représente la moindre représentation de l’idée de l’image temps :
« J’espère bien la voir… » (154)4
« Espero verla… » (38)
Dans cet exemple, il n’y a ni marque de personne ni de temps, mais on
peut parler d’une certaine actualisation d’un fait qui se présente hypothétique,
puisque l’idée est inscrite dans une possibilité, renforcé par le modificateur
« bien ». On ne sait pas quand, mais on peut observer une certaine limite où
Candide aura « bien » l’occasion de voir son aimée.
Par contre dans d’autres exemples, on présente l’infinitif comme une
forme ouverte et décadente qui représente une sorte d’infinitude dans l’espace et
le temps :
« …y a-t-il rien de plus sot que vouloir porter continuellement un fardeau qu’on veut
toujours jeter para terre… ? d’avoir horreur à son être et de tenir à son être ? » (167)
« Hay cosa mas necia que empeñarse en cargar continuamente con un fardo que
uno puede arrojar cuando quiera, tener horror de la propia existencia y querer
existir… ? (55)
4 Nous indiquons le numéro de page des éditions citées de Candide
Provided by Diacronia.ro for IP 88.99.165.207 (2017-06-04 00:59:41 UTC)
BDD-A23018 © 2015 Editura Presa Universitară Clujeană
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
1
/
14
100%