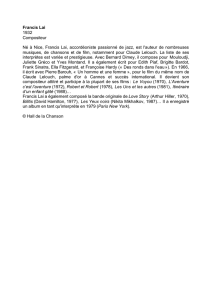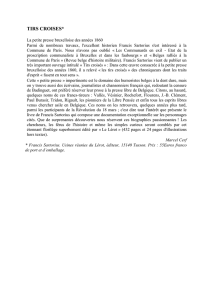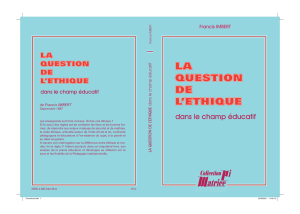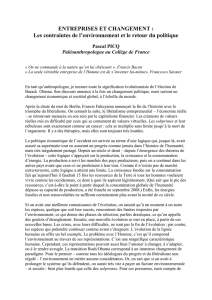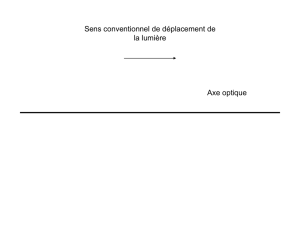Frank Drogoul, LE MYTHE DES STRUCTURES

Le mythe des structures
« désaliénantes »*
Frank Drogoul
Paris
Face à ce qui se passe actuellement à Paris, l’attachement des psychothérapeutes
institutionnels au décloisonnement entre l’intra et l’extra-hospitalier et en leur sein entre les
différentes structures du collectif aurait permis que, devant le miroir aux alouettes des “lits
parisiens”, soit immédiatement perçus les projets sous-jacents du démantèlement de la
psychiatrie de secteur.
C’est pourquoi cette réflexion, qui date de dix ans, nous apparaît comme actuelle. Elle illustre
en effet les écueils du cloisonnement sectoriel autant dans la conception des rares clubs qui
existent, ou ont existé à Paris, que dans celle des structures “alternatives” à l’hospitalisation.
Nous finirons par une illustration clinique, Francis.
club thérapeutique et intra-hospitalier
Le club, comme opérateur d'une quotidienneté, n'est qu'un moyen et non un but institutionnel.
Dans les cures individuelles, il permet d'organiser ces "espaces de jeu" où vont pouvoir surgir
les problématiques fantasmatiques des patients, et donc aider au travail thérapeutique. Quant à
son effet sur le collectif, il conduit à une réflexion de chacun sur sa fonction, son rôle et son
statut. Instituant la Loi de l'échange, il implique et nécessite la libre circulation. Cette dernière
est possible pour les soignants, de plus en plus pour les soignés, au niveau réglementaire.
Mais nous travaillons au niveau des fantasmes. Et ces derniers brisent en éclats les
rationalisations — dans un précédent travail nous avons analysé comment un mode
d'organisation du travail libéré de la hiérarchie et des horaires stéréotypés découpant l'espace
en pavillons distincts et le temps en équipes elles aussi distinctes, place les soignants dans une
nouvelle position face à l'intériorisation surmoïque, donc face à la castration.
Dans la situation actuelle, force est de constater que la mise en place d'une "distinctivité"
institutionnelle — c'est-à-dire de lieux variés gérant la quotidienneté —, est vite rendue
impossible si le collectif dans son ensemble ne met pas le cloisonnement en question. La
rigidité administrative et le respect des traditions généralement mis en avant, ont obligé les
thérapeutes à admettre que l'on peut, par devoir, traiter les malades mentaux dans une
structure lourde, ségrégative et donc aliénante.
Accepter de s'occuper de patients psychotiques, accepter d'occuper une fonction de psychiatre
public comporte des devoirs. C'est déjà une juste récompense de pouvoir constater qu'à travers
ceux-ci, l'aide apportée aux malades mentaux est considérable. Mais cela ne doit pas endormir
la vigilance devant les possibilités réelles qu'offre la structure hospitalière et de secteur.
Si l'équipe élude les problèmes qui se posent pourtant naturellement aux nouveaux venus, rien
ne sera là pour commencer à les résoudre.

Il existe une dialectique dans le changement, imprévisible tant que l'on ne s'y est pas engagé.
Choisir des courts-circuits institutionnels pour gagner du temps et de l'énergie comporte les
risques de confondre les choix circonstanciels avec une théorie globale.
L'hôpital choisi dans notre étude est particulièrement favorisé pour permettre la mise en place
d'un nouveau fonctionnement « Post-Esquirolien » : il se situe pour ainsi dire
géographiquement au centre du secteur que les équipes psychiatriques ont à prendre en
charge, l'administration ne s'oppose pas aux innovations d'horaires différents malgré sa
préférence naturelle pour l'encadrement par équipes distinctes (un des services les a adoptées)
et elle a accepté, lorsque cela lui fut demandé, d'allouer un budget pour une association à but
non lucratif régi par la loi de 19O1 (le club du service fonctionne depuis six ans, deux autres
s'organisent).
Nous pouvons donc dire que si rien ne change, c'est que les thérapeutes n'en ressentent pas le
besoin.
A force de "pouvoir" fonctionner dans un cadre classique, chaque pavillon a organisé un
mode de travail particulier. Chacun affirme avoir admis l'introduction du club thérapeutique
dans l'enceinte du service ; mais une chose est certaine : personne n'a modifié son mode de
fonctionnement, n'a changé les horaires des réunions de synthèse lorsque celles-ci
chevauchent celles du club, aucune concertation n'a pu mettre en place un minimum de
simultanéité organisationnelle afin de libérer des moments horaires pour ce dernier.
Jamais en six ans, depuis la création de cet élément fondamental de la psychothérapie
institutionnelle la modulation des horaires n'a été discutée en réunion des médecins. Donc
jamais ne fut abordé ce problème en réunion de synthèse des différents pavillons.
Le club a été défini sur le même registre : on lui a trouvé cent cinquante mètres carrés entre
deux unités du service, on y a détaché une équipe de quatre puis neuf membres, qui bientôt
devint également l’équipe de l’hôpital de jour. Un psychologue et un médecin y furent
engagés.
Mais plus grave, nous semble-t-il, est la théorisation qui émerge de l'isolement du lieu et de
l'équipe-club. C'est ici que les choix pratiques immédiats, non seulement retardent le travail
en profondeur nécessaire à une transformation des habitudes de soins, mais deviennent même
la source d'une "néo-théorisation" interne regrettable.
Le club devient l'endroit où le patient « prépare sa sortie » ; avec l'hôpital de jour il « occupe
l'intervalle entre la ville et l'hôpital psychiatrique ». Ainsi théorise-t-on la dialectique entre le
dehors et le dedans : le club est le « dehors dans le dedans de l’hôpital psychiatrique », ce qui
entraîne une position très particulière quant aux projets qui s'y décident — « Un jour il y a un
bon projet, F.S. qui le propose ne le soutient pas. On fait une partie du projet sans lui. Mais ça
ne tient pas ou ça dure, lentement, jusqu'à ce qu'un autre reprenne le relais. Mais à F.S., qu'est
ce que cela lui a apporté ? On ne le sait pas. Si on le savait, ce ne serait plus le club, ce serait
le dedans. Le dehors du club pour être tel nécessité de rester en dehors du diagnostic, du
pronostic et du numéro de Sécurité Sociale ».
Le problème tient dans le fait que la pathologie de F.S. consiste précisément en une
impossibilité à mener ses projets jusqu'au bout. Si personne ne l'accompagne lors de ceux-ci,
parce que ses thérapeutes ne savent que très peu ce dont il retourne dans ce club, et que

l'équipe du club — extérieure aux décisions thérapeutiques —, a pris l'habitude de voir les
patients s'inscrire dans une activité puis disparaître et de trouver la chose normale, comment
peut-on éviter à F.S. de retomber sans cesse dans le piège de sa maladie ?
Un tel club se présente donc comme une super-ergothérapie, vitrine pour les visiteurs, les
étudiants venant aux séminaires analytiques qui ont lieu dans l'amphithéâtre de l'étage
inférieur, symbole des progrès du désaliénisme.
Mais coincé et figé entre différents pavillons qui insistent pour garder leur "liberté"
individuelle, il ne peut en aucun cas tenir le rôle que les théoriciens institutionnels voulaient
lui donner : créer des lieux d'échanges et de parole et traiter l'aliénation institutionnelle.
A la limite, ce club, par son isolement, peut devenir une structure dangereuse pour certains
patients car il crée des lieux d'inscription symbolique, alors que les thérapeutes ne sont pas
dans la possibilité de gérer l'angoisse psychotique que cette inscription peut déclencher.
Brigitte part tenir sa permanence au bar de neuf heures à dix heures trente. Souvent elle quitte
le pavillon détendue et revient dans un état d'agitation et d'agressivité extrême. Parfois, seul
l'enfermement arrive à la maintenir et l'améliore sur le plan clinique. Les tentations sont alors
grandes de considérer que le club la déstabilise. De même, dans ses périodes
d'oppositionnisme, elle crie ses grands dieux que jamais plus il ne sera question pour elle de
se faire exploiter à travailler bénévolement au bar. Si à ces moments là, elle sent ses
thérapeutes indifférents ou même soulagés (« le club ne lui réussit pas »), rien ne la poussera à
y retourner. C'est ainsi que certains patients restent hospitalisés pendant des mois sans mettre
une fois le pied dans ce lieu communautaire.
Chez certains, l'interdiction de sortir, même au club, peut être une prescription qui dépasse
largement les mesures prises contre les évasions : diversifier les lieux de parole serait
dangereux pour nombreux psychotiques ; leur vie serait en danger s'ils se perdaient dans trop
d'activités et les rencontres non maîtrisées qu’on peut y faire. D’autres, par contre, les
névrosés, ne doivent en aucun cas s’y rendre parce que leur pathologie y trouverait un théâtre
trop complaisant. Une phrase telle que « ce patient ne doit pas rester en institution, il ne faut
donc pas qu'il commence à s'incruster au club », peut être juste dans certains cas où
l’hospitalisme devient, par exemple, symptôme phobique, procurant trop de bénéfices
secondaires. Mais lorsqu'elle est répétée, pour des dizaines de patients qui pour la plupart
rechutent plusieurs fois dans l'année, elle dépasse de loin le cas individuel au sujet duquel elle
émerge. Elle entre tout simplement dans un énoncé stéréotypé qui veut ignorer et nier
l'importance de la vie quotidienne en institution.
D'un côté une décision arbitraire : « L'institutionnel ne m'intéresse pas », de l'autre un effet
pratique de ce désintérêt : de nombreux patients n'ont pas à s'investir dans cette circulation. Et
en conséquence de tout cela un fait : le désir de leur thérapeute se situant ailleurs, les patients
végètent sans autre inscription que leurs séances de thérapie et le service se remplit de
"chroniques" âgés et sédimentés.
Un tel club est relégué dans la rubrique socio-occupationnelle, on s'y adresse comme ailleurs
on s'adresse à l'ergothérapie. Mais une salle d'ergothérapie est intégrée aux pavillons, alors
que ce lieu ne fait que coexister sans véritable osmose avec le reste du service, ce qui en
exclut ceux des patients qui en auraient le plus besoin pour lutter contre leur apragmatisme.

Pour ceux qui s'y rendent, il reste un lieu de rencontre, de circulation, donc par nature un lieu
de transfert, effectivement dangereux s'il n'est pas pris en charge par l'équipe soignante, risque
conséquent à son statut d'extra-territorialité.
Les structures intermédiaires
Nous pouvons faire les mêmes critiques des structures dites intermédiaires dont les
organisateurs vantent les succès.
Ces dernières (foyer, appartements associatifs ou thérapeutiques, hôpitaux de jour, certains
C.A.T.) sont en permanence présentées comme un lieu intermédiaire, « transitionnel » —
combien ce terme de Winnicott est galvaudé — entre l’hôpital et le chez soi.
On y reprend sans le savoir les principes des premiers aliénistes : s’appuyer sur la partie saine
de l’individu malade pour l’aider à renoncer à sa folie.
On demande aux patients un projet, les structures intermédiaires se vivant comme transitoires
par principe, afin de favoriser le passage d'un espace "surprotecteur", l'hôpital, à un espace
personnel, autonome.
Sur ces bases, les succès sont nombreux, car l'accueil y est en effet plus souple, moins
« aliénant ». Les équipes sont généralement plus jeunes, motivées, ayant souvent choisi de
travailler là pour fuir la routine asilaire. En contrepartie, les équipes de l'intrahospitalier les
soupçonnent d'avoir choisi ces affectations par commodité d'horaire et par fuite de la
psychiatrie "lourde".
Pour permettre à ces structures d'être un lieu de transition moins médicalisé par rapport
auquel les patients vont et viennent selon leur degré d’autonomie, un effort quasi constant est
fait pour se démarquer de l’hôpital.
Ce n'est pas la présence quasi muette de la surveillante ou d'un médecin de l'extrahospitalier
aux réunions de synthèse des pavillons, qui compensera cette non institutionnalisation des
échanges entre les différentes structures.
Il faut néanmoins remarquer que les théories issues de ces lieux concernent une pathologie
mentale "triée" même si chaque foyer à "son" psychotique lourd.
Certains patients — nous pensons encore à Brigitte — ne peuvent sans risque sauter sans
transition, sinon des entretiens préliminaires, dans cet inconnu, cet autre lieu qu'est un foyer
de secteur. On peut considérer que sa maladie est telle que le travail doit continuer dans
l'intrahospitalier. Mais dans ce cas, elle risque, comme de nombreux autres, de ne jamais
pouvoir constituer une candidature raisonnable, alors que l'instauration de passerelles, grâce
au club, éviterait de la confronter à ces deuils multiples occasionnés par les sorties, à ces
passages de seuils trop déstructurants pour elle.
La politique des foyers
L. Dreyfus et ses collaborateurs distinguaient en 1968, à partir d'une expérience de cinq ans,
la notion d'hospitalisation « partielle », opposée à la notion d'hospitalisation « totale »
(référence probable à Goffman) définie comme un dispositif soignant qui, par son caractère,

« se fait trop enveloppant et risque de gêner l'émancipation de certains malades, comme un
arbre dont la branche maîtresse porteuse d’un nid serait trop éloignée des autre branches,
empêchant ainsi le volettement précoce des oisillons. »
Il définit ainsi deux critères favorables pour cette prise en charge partielle. Premièrement, elle
a pour fonction d'être transitoire : « L’aggravation ou la persistance de l’inadaptabilité dont
l’essentiel se traduit par l’impossibilité de faire résider le malade à l’extérieur du foyer (...)
même si l’implantation professionnelle semble valable et durable, est considérée comme un
échec, dans la mesure où la vocation du foyer est avant tout celle d'un tremplin. »
Deuxièmement, pour mener à bien ce projet, « il semble que les petites dimensions et le
caractère humain de l'institution permettent plus facilement à des solutions humaines de s'y
dégager. »
Le projet est donc « d'être disponible, juste ce qu'il faut, et laisser l'émancipation vers la
rupture se produire. »
Les projets initiaux des foyers de secteur sont régulièrement de ce type : pas de prise en
charge supérieure à six mois, à un an. La réalité de la psychose leur fait souvent changer de
pratique...
La politique des hôpitaux de jour
J.M. Valette peut être considéré comme représentatif du courant qui anime actuellement les
thérapeutes des hôpitaux de jour, lieux qu'il présente ainsi :
« De par son découpage spatio-temporel, l'hôpital de jour va d'emblée poser le problème de la
séparation : il s'agit de se séparer tous les soirs du lundi au jeudi pour se retrouver le
lendemain matin et de se séparer le vendredi soir pour se retrouver le lundi matin. La scansion
du temps qui semble la spécificité de l'hôpital de jour pose quotidiennement le problème de la
séparation jusqu’au jour de la sortie qui constitue de fait une séparation réelle. »
Le grand risque des hôpitaux de jour est selon l’auteur la chronicité, celle la même que l’asile
sécréterait ; c’est pour cette raison qu’il craint « que si l’on n’y prend pas garde, l’hôpital de
jour institution apparue lors de la deuxième moitié du XXème siècle dans les zones urbaines,
soit la transposition actuelle des asiles de la France rurale du XIXème siècle adaptée aux
normes socioculturelles de notre époque. Ainsi se pérenniserait un état de chronicité dans le
fonctionnement des structures de soins psychiatriques. »
Selon lui, la chronicité pourrait alors provenir des soignants — incapables de maîtriser la
durée de l'hospitalisation de jour et transformer ainsi la position du patient « d'invité à l'aise »
en celle de « parasite » — autant que des soignés, incapables de sortir, soit parce que
l'institution devient « trop bonne », soit parce que la structure s'isole creusant ainsi « le fossé
au fond duquel elle sera enterrée tôt ou tard ».
Mais qu'en est-il de cet isolement ? Il résulte d'un choix des soignants qui craignent par
principe la contamination par la chronicité hospitalière. Il leur faut donc, en compensation,
entretenir une noria d'admissions et de sorties qui privilégie le couple départ-remplacement
sur le « suivi » thérapeutique. L'isolement redouté finit par être réel, l’organe l’emporte sur la
fonction, l’état des lieux importe plus que ceux qui les traversent.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%