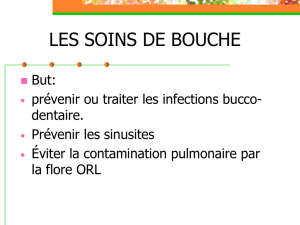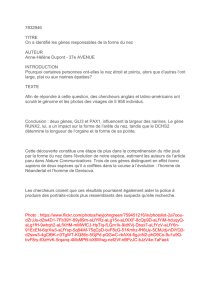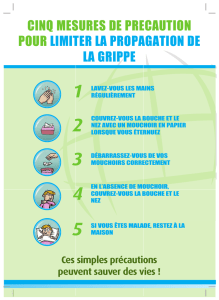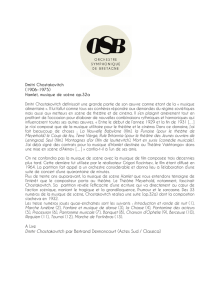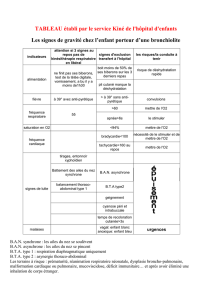Les Notes - Amis du Festival d`Aix

Les
Notes
Les
Notes
des
Amis
du
festival
d’art
lyrique
d’Aix
en
Provence
04
A la n juin dernier, les Amis du Festival ont eu le
bonheur de recevoir Teresa Berganza dont on connaît
l’attachement à Aix-en-Provence et la dèle amitié pour
notre association. A cette occasion, nous avons réalisé avec
elle un entretien que nous sommes heureux de publier
dans ce numéro.
M. Bernard Foccroulle nous réunit le 9 décembre à 18h
au Musée des Tapisseries (Palais de l'ancien Archevêché,
Place des Martyrs de la Resistance à Aix-en-Provence). Il
nous présentera le beau programme 2011 du Festival, ce
sera aussi une occasion de dialogue entre les Amis et le
Festival dans l’esprit du partenariat que nous développons
ensemble. Nous espérons vous y rencontrer nombreux.
Pour ce numéro, nous avons décidé de nous concentrer
sur une remarquable nouvelle production du Festival
2011 : Le Nez de Chostakovitch. Christine Prost a rédigé
un article sur la pièce de Gogol et son adaptation lyrique
et Alain Perroux un article sur la mise en scène de
William Kentridge telle qu’il a pu la voir en mars 2010 au
Metropolitan Opera de New York en avant première de la
production d’Aix.
Enn, vous connaissez notre préoccupation constante:
satisfaire les attentes de nos adhérents en matière
d’activités culturelles. Anne Dussol, responsable de ce
secteur, nous présente le programme à venir jusqu’à n
juin 2011.
Bonne lecture et à bientôt,
Henri Madelénat
Président
Décembre
2010
É
Édito
...
Bonjour Teresa, dans Capriccio la question est posée :
« Prima la musica - dopo le parole ou prima le parole - dopo la musica», quelle est votre
réponse à cee question ?
Il n’y a pas de réponse tranchée,
je suis une musicienne au service
de l’interprétation, c’est le privi-
lège du chanteur de dire un texte,
la musique et la parole forment
un tout à l’opéra.
E
Entretien Photo Serge Mercier/La Provence
Entretien avec TERESA BERGANZA

Par quel chemin du destin êtes-vous devenu chanteuse ?
Je suis née dans une famille heureuse malgré les
guerres dont je garde un souvenir horrible. Mon
père avait appris la musique à l’école. Grâce à un
héritage de ma mère, on a acheté un piano dont
jouait mon père. Très jeune j’ai entendu de la mu-
sique de Wagner, de Puccini et des chants popu-
laires. Mon père s’est aperçu que j’avais une oreille formidable. Il
m’a appris à jouer du piano. Il était très dur avec moi. A l’universi-
té, je suis entrée au conservatoire, j’y ai étudié le solfège pendant
quatre ans, le piano pendant huit ans et l’orgue pendant quatre
ans. J’étais la lle la plus heureuse du monde, je passais toute la
journée à faire de la musique. On me disait toujours : pourquoi tu
ne chantes pas? Je suis donc allée voir le professeur Lola Rodri-
guès Aragon, elle avait été l’élève d’Elisabeth Schumann. Je me
souviens, il y avait des voix meilleures que la mienne. Le profes-
seur m’a conseillé de consulter un médecin qui m’a d’abord impo-
sé 15 jours de silence et m’a appris à respirer. Le professeur m’a fait
chanter de la musique ancienne, Monteverdi, Scarlatti, Vivaldi. J’ai
continué à pratiquer beaucoup d’exercices de gymnastique respi-
ratoire. J’étais évidemment aidée par ma grande connaissance de
la musique. Le chant a pris ainsi le dessus sur le piano pour lequel
j’étais douée. D’ailleurs, j’aurais aimé jouer du violoncelle qui re-
produit un son si près de la voix humaine et qui est un instrument
si sensuel, mais, je n’ai pas eu le temps, ce sera pour une autre vie !
Pourriez-vous nous raconter les débuts de votre carrière de chanteuse ?
J’ai accompagné mon professeur au concours de chant de Tou-
louse, c’était en 55, c’était aussi par hasard car elle voulait pré-
senter une autre chanteuse. Peter Diamant du LSO et Liese Asko-
nas de Covent Garden m’ont remarquée. Peu de temps après, j’ai
participé au congrès des jeunesses musicales à Madrid, j’ai été
la meilleure dans des mélodies espagnoles. Ada Finzi, Manager
artistique, m’a ainsi remarquée et m’a fait venir à Milan. Il y avait
à cette époque une formidable équipe autour d’Ada : Mirella Freni,
Luigi Alva, Fiorenza Cassotto, Nicolas Ghiaurov, Graziella Sciutti,
Claudio Abbado, Alexis Weissenberg ; Giulini a aussi travaillé
avec elle. Ada Finzi m’a proposé de jouer dans le Comte Ory à la
Scala. J’ai accepté, mais, comme vous le savez, la Scala ouvre tard
en saison, nous sommes en 57. Entre-temps Gabriel Dussurget
avait aussi entendu parler de moi et m’a invitée à Aix pour inter-
préter le rôle de Dorabella. C’est comme cela que ma carrière de
chanteuse internationale a commencé. En peu de mois, tout s’est
cristallisé. Ada Finzi et Gabriel Dussurget étaient des formidables
découvreurs de talents, ils connaissaient les jeunes, ils croyaient
en eux. Voyez-vous, je n’ai jamais anticipé ma réussite, je ne me
suis jamais dit : je vais être une grande chanteuse. C’est le destin.
C’est aussi beaucoup de travail, n’est-ce pas ? Teresa, à votre tour vous vous
intéressez aux jeunes chanteurs, vous passez du temps à les former, quels
conseils leur donnez-vous ?
Evidemment il faut des aptitudes, mais ensuite il faut beaucoup tra-
vailler, énormément. J’ai passé des nuits à déchirer des partitions.
Il faut rester humble. J’ai toujours été animée par la passion de la
musique et une obsession ne m’a jamais quittée : conserver ma voix.
Je n’ai pas accepté n’importe quel rôle, j’ai refusé le rôle de Violetta
dans La Traviata par exemple. Et, enn, il faut croire en son étoile et
ne pas oublier que la voix est l’expression de l’âme.
Vous avez décidé d’écrire vos mémoires, où en êtes vous ?
Mon métier, c’est la musique, mais j’aime écrire, j’ai écrit toute ma vie.
Je vais commencer à écrire mes mémoires. Je voudrais écrire un livre
amusant, le livre d’une femme qui a eu le privilège d’être musicienne.
Merci Teresa.
©Paul Meissonnier
Entretien réalisé par Henri Madelénat
Photo Serge Mercier/La Provence
Campra, de Aix à Versailles
Le premier colloque international sur André Campra, organisé par le Centre
de Musique Baroque de Versailles (CMBV) s’est tenu à Aix-en-Provence les
7 et 8 octobre derniers, il s’est ensuite poursuivi à Versailles.
Ces journées ont permis de mettre en lumière la personnalité exception-
nelle du compositeur aixois et son rôle déterminant dans le renouveau
musical qu’a connu la France de la n du règne de Louis XIV jusqu’à celui
de Louis XV.
Un très beau concert a été donné le 7 octobre aux Oblats par l’ensemble
Parnassie du Marais (Monique Zanetti, Sylvie Moquet, Sabine Weill et
Brigitte Tramier) qui a permis à un public averti (parmi lesquels Bernard
Foccroulle, Hervé Burckel de Tell, Directeur Général du CMBV, Catherine
Cessac, Directeur de la recherche du CMBV et les participants au colloque)
d’apprécier l’exceptionnelle qualité de la production aixoise de musique
baroque.
Nous avons eu le privilège, et aussi la charge, d’organiser ces journées ai-
xoises qui ont bénécié du soutien déterminant de la Mairie et du Festival.
Merci à tous les Amis qui ont participé à cette opération, merci pour l’excel-
lent accueil réservé par ceux d’entre nous qui ont logé des participants.
R
Rappels

De Gogol à Chostakovitch.
L’étrange histoire d’un Nez baladeur
Le Nez de Dimitri Chostakovitch (créé à Leningrad le 18 Juin 1930) est, au
même titre que Le Château de Barbe-bleue de Béla Bartok, (Budapest, Mai
1918), Wozzeck d’Alban Berg, (Berlin, Décembre 1925), ou La Maison des
morts de Leos Janacek (Brno, Avril 1930) l’un des opéras majeurs de l’entre-
deux guerres, et particulièrement représentatif de l’eervescence novatrice
de l’avant-garde russe, juste avant qu’elle ne soit réprimée par le stalinisme.
La nouvelle de Gogol à laquelle Chostakovitch emprunte son
sujet date des années 1834-35. Résumons-la brièvement :
Premier chapitre : au matin du 25 Mars, le barbier Ivan Iakovlevitch
trouve dans son pain ... un nez ! Harcelé par sa femme pour s’en débarrasser
au plus vite, il court le jeter dans la Neva, mais est appréhendé par le Gen-
darme du Quartier... « Mais la suite de l’aventure se perd dans un brouillard
si épais que personne n’a jamais pu le percer », écrit alors Gogol. Le lecteur
n’est donc pas informé de ce que devient le barbier, et est invité à passer
sans explications au...
Deuxième chapitre : Ce nez appartient en fait au petit fonctionnaire Pla-
ton Kouzmitch Kovalev, qui se réveille privé de son appendice nasal. Catas-
trophé, il met tout en œuvre pour le retrouver, et, à sa grande stupéfaction,
rencontre celui-ci métamorphosé en un personnage de ère apparence,
pour le moins Conseiller d’Etat, priant dans la cathédrale Notre-Dame de
Kazan. Abordant avec embarras ce personnage haut placé (que Gogol ne
désigne que par son attribut : Le Nez ), il lui demande timidement de bien
vouloir reprendre sa place normale, mais, avec un calme méprisant, son
interlocuteur refuse de chercher à comprendre la situation et prote d’un
instant d’inattention de Kovalev pour s’échapper et disparaître.
Cette première humiliation n’est que le prélude à une série de
déconvenues ou de rebuades blessantes : le chef de la police est absent,
l’employé du journal auquel il s’adresse pour publier une petite annonce se
moque de sa requête et refuse tout service, ... Profondément déprimé, il
rentre chez lui et s’abandonne à la détresse : « Pourquoi un tel malheur?(...)
Sans nez, un homme n’est plus qu’un être hybride (...) juste bon à jeter par la
fenêtre ! ».
C’est alors qu’il reçoit la visite du Gendarme du quartier : on a
arrêté le Nez au moment où il se disposait à prendre la diligence de Riga,
le haut personnage est redevenu alors le nez normal de son propriétaire, et
l’ocier de police le lui rapporte. Ivre de joie, Kovalev lui donne la récom-
pense attendue, et essaie son nez...qui ne se recolle pas ! Le docteur appelé
d’urgence se déclare impuissant. Kovalev est désespéré . Comment expli-
quer ce nouveau phénomène ? Peut-être est-il dû aux sortilèges déployés
par une certaine Madame Podotchine pour le contraindre à épouser sa
lle. Il lui écrit une lettre accusatrice, à laquelle elle répond de manière très
conciliante. Ce qui le convainc sur le champ qu’elle n’est pas coupable, mais
le laisse toujours aussi désemparé...et sans nez.
Pendant ce temps, cette singulière aventure est en train de faire
le tour de la capitale. Ignorant que le Nez a été retrouvé, la foule se préci-
pite partout où l’on dit l’avoir aperçu...« Mais de nouveau l’aventure se perd
dans un brouillard si épais que personne n’a jamais pu le percer». Pour la
seconde fois, Gogol laisse ici le lecteur en suspens, et l’invite à passer sans
plus d’explications au...
Troisième chapitre : au matin du 7 Avril, Kovalev s’aperçoit avec stupé-
faction que son nez est inexplicablement et indubitablement revenu à sa
place habituelle. Il s’assure auprès du barbier de la solidité de la restitution,
et tout joyeux, s’en va parader sur la perspective Nevski, comme si rien ne
s’était passé.
Trois chapitres, donc : le chapitre central, développé, étant enca-
dré de deux chapitres beaucoup plus brefs, tels un prologue et un épilogue.
Le ton est ironique et détaché, l’observation d’une lucidité redoutable,
l’intention satirique évidente, mais aucune piste n’est donnée au lecteur
sur le sens à donner à cette histoire insensée.
L’absurdité manifeste de la nouvelle, avouée de manière provo-
cante, ainsi que sa structure lacunaire appellent cependant une interpré-
tation. La plus courante y voit une satire féroce de l’administration et une
peinture sans concessions de la médiocrité de la société russe sous Nicolas
1°, masquées par l’invraisemblance de la donnée centrale et le comique
aché. Chostakovitch adopte de toute évidence cette interprétation. Il
garde pratiquement intacte la trame de la nouvelle, et utilise une grande
partie du texte littéralement, se contentant de transformer en dialogue ce
qui relève du récit, mais il en élargit la perspective sur deux plans : celui de
la critique sociale, et celui de la peinture du personnage principal.
Le « Major » Kovalev, médiocre fonctionnaire obsédé de recon-
naissance sociale, « pauvre type » arrogant, prétentieux et ridicule chez
Gogol, devient dans l’opéra un anti-héros, pitoyable, certes, mais par mo-
ments touchant, tellement il est désarmé par la question angoissante à
laquelle il se trouve brutalement confronté : « Pourquoi cette mutilation qui
me rend étranger à moi-même et nié par la société ? » Chostakovitch, maître
du sarcasme et de l’humour en musique, adopte alors un ton inhabituel. Le
lyrisme dramatique avec lequel il exprime le désespoir de Kovalev accuse le
côté tragique de la situation, suscite la compassion, et ouvre une perspec-
tive plus large sur le sens profond de la nouvelle de Gogol. Sous le couvert
de l’ absurde, est posé un problème existentiel : celui de notre identité .
Par ailleurs, la critique sociale prend chez Chostakovitch une
coloration clairement politique et contemporaine. Celle-ci est particuliè-
rement sensible dans le tableau sur lequel s’ouvre le 3° acte, une grande
scène inventée prenant prétexte de l’épisode de l’arrestation du Nez - arres-
tation qui, dans la nouvelle, n’est que très brièvement mentionnée. Il y met
D
Dossier
le Nez
© William Kentridge
Rappels

en scène autour de la diligence qui doit partir pour Riga une galerie de per-
sonnages très typés, en un délé d’ instantanés quasi cinématographiques
sur la toile de fond des échanges paresseux et stupides des policiers. La
palme de la caricature est ici réservée à leur chef, le Gendarme du quar-
tier, auquel Chostakovitch attribue une voix de ténor extrêmement aiguë,
presque un fausset. Tyrannique et sadique, il incarne de façon mi-comique,
mi-terriante l’oppression menaçante des années 1920 en Russie – en fait,
la notion même d’oppression. L’accumulation progressive des personnages
est rendue musicalement par une succession de brefs épisodes contrastés,
associée à la croissance de l’hystérie collective qui aboutit à la capture du
Nez. L’évocation de la folie capable de transformer une foule en meute
sanguinaire n’est certes pas sans rapports non plus avec l’époque. Mais la
dimension que lui donne Chostakovitch la hausse au niveau de symbole
universel.
Chacun des personnages est caractérisé avec une netteté de
traits que met en valeur l’extrême variété des registres expressifs. Tous les
types de vocalité s’y mélangent, du parlé au chant virtuose, de l’expansion
lyrique à l’énonciation mécanique, jusqu’à intégrer les bruits les plus tri-
viaux de la vie quotidienne (rires, ronements, onomatopées, injures).
En étroite symbiose avec la vocalité, l’orchestre amplie l’impact
émotionnel que revendique le compositeur. Il y a dans l’écriture du Nez
une vitalité, une énergie, une exubérance qui ne sont pas seulement dus
à sa jeunesse (il a 22 ans lorsqu’il termine son opéra), mais à la conscience
d’appartenir à une génération d’artistes d’avant-garde aux racines d’un
modernisme prometteur. Modernisme hélas radicalement battu en brèche
en Russie soviétique, ce dont Chostakovitch eut particulièrement à sourir
tout au long de sa carrière.
La modernité du Nez tient en tout premier lieu à la conception
du théâtre lyrique qui lui est propre. Au débat séculaire sur la prééminence
de la « musica » ou de la « poesia » dans l’opéra, il ajoute un troisième
terme : texte, musique et action scénique sont envisagés par lui comme
trois entités devant s’interpénétrer de manière indissociable. Conception
prophétique de l’interdisciplinarité des arts que cultive avec prédilection
notre époque...
Cette modernité tient également à l’introduction, au cœur de
l’action dramatique, d’ épisodes purement orchestraux, à première vue in-
congrus, qui dévoilent leur nécessité lorsqu’on observe leur écriture et leur
place dans le déroulement de l’oeuvre. Le plus frappant de ces épisodes
est un « Interlude pour percussions seules », extrêmement audacieux pour
l’époque, qui cache derrière l’impression de chaos qu’il dégage, une écri-
ture on ne peut plus sévère et rigoureuse. Il est situé dans l’action très exac-
tement au même point que le premier « blanc » introduit par Gogol dans la
conduite de son récit, et assume la même fonction de distanciation et de
déstabilisation. Belle trouvaille d’analogie musicale d’un procédé littéraire.
L’alternance rapide de scènes comiques, satiriques, terriantes
ou tragiques, intimistes ou collectives, traversée d’épisodes orchestraux
qui soulignent la situation dramatique imprime à l’opéra un rythme sou-
tenu qui occulte sa durée, relativement longue (près de 2 heures, sans
entracte).
Par ailleurs, la nature « bigarrée » du récit donne à Chostako-
vitch l’occasion d’exploiter en tous sens une imagination musicale qui
semble sans limites, puisant à des sources multiples. Chœurs religieux,
polyphonies à voix d’hommes, ballade populaire, monologues lyriques
dans l’esprit du grand opéra russe, pastiches humoristiques d’éléments
opératiques traditionnels, s’insèrent dans la trame de dialogues proches
de la langue parlée, à mi-chemin entre diction théâtrale et chant. Tout cela
accompagné, souligné ou contredit par les innombrables jeux de sonorités
d’un orchestre parfaitement maîtrisé.
Se souciant peu de la diculté des conditions de réalisation
de l’époque, il n’hésite pas à multiplier les lieux, à en situer deux simulta-
nément sur la scène, ou à imaginer un dialogue entre la salle et la scène.
Cette diculté n’en est plus une à l’heure des technologies contempo-
raines, et quiconque connaît l’art de William Kentridge ne sera pas sur-
pris qu’il ait trouvé dans Le Nez un terrain d’élection pour son imagination
créatrice.
Comme le nez au milieu de la gure
Il faut imaginer un collage comparable à ceux des grands plasticiens mo-
dernes ou contemporains, les Braque, les Picasso, les Schwitters… A la
diérence près que ce collage mesure plusieurs mètres de haut et qu’il se
déploie dans les trois dimensions d’une scène de théâtre ! Pour aborder
Le Nez de Chostakovitch, William Kentridge n’a rien renié de son identité
propre, celle d’un artiste d’aujourd’hui qui est à la fois un génial touche-
à-tout et un véritable auteur bâtisssant une œuvre cohérente en abordant
un ensemble restreint de thèmes et de motifs qu’il remet sans cesse sur
le métier et qu’il revisite sans relâche à travers des techniques diérentes.
Pour cet artiste sud-africain qui pratique avec le même bonheur le des-
sin, la vidéo, l’animation, la sculpture, l’installation et la performance, le
choix d’aborder Le Nez de Chostakovitch n’est pas innocent. La mise au ban
de l’individu, Kentridge l’a vue de près. Il fait certes partie de la minorité
blanche de son pays, mais il ne cesse d’interroger la question de l’altérité et
de l’existence humaine dans un environnement oppressif. A l’opéra, il a déjà
abordé aux rivages du Retour d’Ulysse de Monteverdi et de La Flûte enchan-
tée de Mozart dont il a donné une relecture méditative, s’interrogeant sur
la face sombre des Lumières du XVIIIe siècle et sur le colonialisme (ce spec-
tacle a été présenté au Festival d’Aix-en-Provence en 2009). Dans l’opéra de
Chostakovitch, Kentridge met en scène avec humour une gure d’altérité
inquiétante, car émanant du sujet lui-même : dans son spectacle, le nez
apparaît comme un double inversé de Kovaliov, sa part d’ombre. Il accuse
d’ailleurs une ressemblance frappante avec le propre nez de Kentridge, qui
injecte souvent une part autobiographique dans ses œuvres. En somme, je
est un nez qui est un autre !
L’appendice nasal devient dès lors un motif omniprésent dans les vidéos
projetées sur le collage démentiel qui tient lieu de scénographie, mêlant
coupures de journaux, à-plats de couleurs et décors en relief (un pont, un
appartement de deux étages, etc.). Ce nez que l’on voit jouer du piano
dans des images d’archives, chevaucher un er destrier ou danser en tutu
apparaît bientôt comme le «ça» au sens freudien du terme, soit l’élément
refoulé qui vous bondit à la gure… après s’en être détaché ! Il peut
symboliser l’identité profonde d’un compositeur condamné à dissimuler
ses pensées pour survivre dans l’URRS de Staline. Il peut signier aussi la
part insolente, instinctive et indomptable d’un artiste comme Kentridge,
propre à glisser des sous-textes subversifs dans les œuvres apparemment
les plus inoensives. Il n’en reste pas moins le protagoniste d’une soirée
d’opéra qui ne ressemble à aucune autre, et qui s’apparente à une gigan-
tesque installation aussi démente que séduisante.
LES NOTES N°4 - Décembre 2010
Les Notes sont éditées par L'association des Amis du Festival d'Art Lyrique d'Aix-en-Provence - Hôtel de Gaillard-d'Agoult,
24, place des Martyrs-de-la-Résistance, 13100 Aix-en-Provence. Tél. 04 88 19 93 53 - info@amisdufestival-aix.org - Site internet : http://www.amisdufestival-aix.org. Directeur de la publication : Henri Madelénat.
Comité de rédaction : Anne Dussol, Madeleine-Marie Fajon, Chistine Prost, Elisabeth Rallo Ditche. Conception graphique ALYEN. Impression Papergraf.
Christine Prost
Alain Perroux
1
/
4
100%