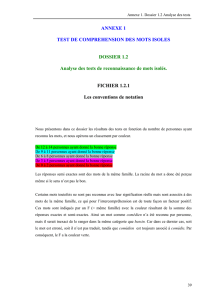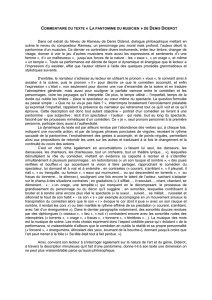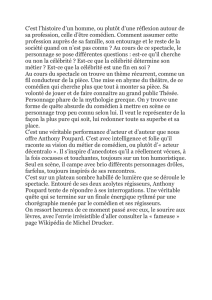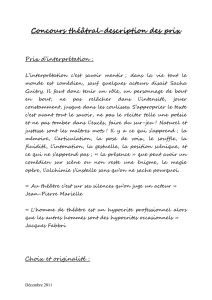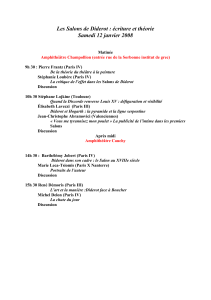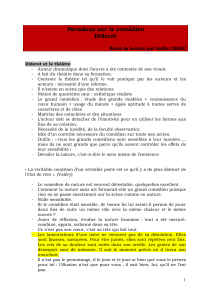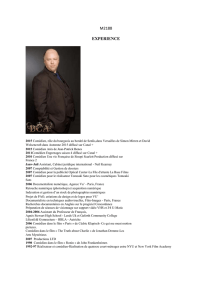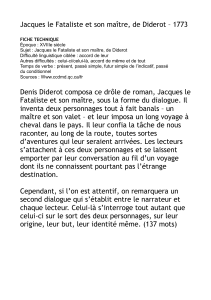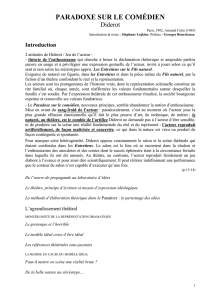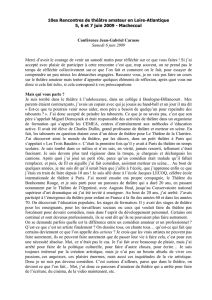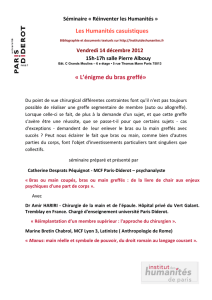dossier pdf

Le Centre Transfrontalier de Création Théâtrale
Mouscron-Tourcoing,
la Compagnie Chotteau et le Centre Culturel Mouscronnois
présentent
La Comédie du Paradoxe
Divertissement proposé aux publics français et belges
Adaptation et mise en scène de Jean-Marc CHOTTEAU
D’après « Le Paradoxe du Comédien » de Denis DIDEROT
DOSSIER PEDAGOGIQUE
Par Maud PIONTEK


■ Diderot en son temps
Né à Langres en 1713, Diderot est d’abord destiné à la prêtrise
par son oncle chanoine : à treize ans, il est tonsuré et vit chez les Jésuites.
Mais bien vite, Diderot décide de s’enfuir à Paris pour y poursuivre des
études de droit. Sa famille lui a coupé les vivres, et il mène alors une vie
de bohème et se marie même avec une marchande de lingerie... Dans les
salons, il rencontre Condillac, Rousseau, Grimm, d’Alembert. Il se lance
dans les lettres, et écrit notamment Lettre sur les aveugles à l’usage de
ceux qui voient, texte dans lequel il veut comprendre le monde original
dans lequel vivent les aveugles, et où il en profite pour affirmer la
relativité de la métaphysique, de la morale et par conséquent… du
pouvoir. Ce matérialisme à toute épreuve vaut à Diderot d’être enfermé
au fort de Vincennes en 1749.
Pourtant, Diderot n’abandonnera pas ses projets littéraires et
philosophiques, et poursuivra avec d’Alembert la tâche écrasante de
regrouper une somme d’articles sur l’art, la science, la philosophie etc.
réunis dans l’Encyclopédie. Dès lors, Diderot n’aura de cesse de lutter
pour une plus grande liberté d’expression. Dans cette optique, la forme
dialoguée permet de créer le mouvement de pensée nécessaire à la
dénonciation ironique de certains préjugés, et, à la manière de Socrate,
Diderot l’utilise pour multiplier les points de vue au sein même de son
argumentation. Le théâtre devient une solution pour expérimenter une
distance par rapport aux opinions communes, montrées dans toutes leurs
contradictions.

■ Un théâtre de la raison
Diderot a écrit quelques pièces de théâtre qui n’ont pas eu un
grand succès, comme Le fils naturel (1757) et Le père de famille (1758).
L’ambition moralisante du philosophe y est trop attachée, et ne permet
pas au spectateur de prendre du plaisir à ces intrigues. Ses pièces sont
surchargées de propositions scéniques et d’éloges de la vertu, indigestes
pour le spectateur. Il s’agit d’un théâtre d’essais, un théâtre où s’exprime
les raisons d’aimer le théâtre et de s’en méfier, bref, un théâtre qui
rationalise notre expérience de spectateur… au risque de l’ennuyer !
Toujours est-il que Diderot est l’inventeur du drame, intermédiaire entre
tragédie et comédie, et proposant au théâtre des personnages bourgeois.
Si son « drame bourgeois » reste classique en bien des points (la règle des
trois unités, la vraisemblance), il veut néanmoins une peinture plus fine et
réaliste de la réalité sociale, et tend à engager le propos théâtral dans une
formation morale et politique de l’individu. De plus, Diderot s’efforce de
souligner la plasticité de l’œuvre dramatique, c’est-à-dire ses aspects
spectaculaires –notamment la pantomime (que nous appellerions
aujourd’hui les « indications scéniques ») – qui exige du comédien (et
éventuellement d’un tiers qui « organise » le spectacle) une totale
maîtrise du sens de ce qu’il joue et par conséquent, de soi. En fait,
Diderot ébauche ce qui deviendra la « direction d’acteurs » et la mise en
scène.
Les commentaires sur les pièces et les écrits théoriques de Diderot
confirment l’importance de sa réflexion pour l’histoire du théâtre, et
d’ailleurs, les metteurs en scène actuels s’intéressent plus souvent à ces
essais qu’aux pièces proprement dites : les Entretiens sur Le fils naturel
(1757) le Discours sur la poésie dramatique (1758), et enfin le Paradoxe
sur le comédien (1778), ainsi que la Lettre sur les aveugles (1749),
Jacques le fataliste (1765-73), Le neveu de Rameau (1762-77), font
souvent l’objet d’adaptations théâtrales.

■ La question du comédien
Dans les trois premiers textes, Diderot explique les ambitions et
les limites du genre théâtral. Il s’interroge sur le statut du comédien, aussi
bien artistique que politique : quelle est la place du comédien dans la
société ? Faut-il la redéfinir et donner au spectacle une influence positive
sur les moeurs ? (« je regrette que l’on se fasse comédien « par plaisir »
et jamais par goût pour la vertu, par le désir d’être utile dans la société
et de servir son pays ou sa famille »)
1
; le comédien est-il toujours maître
de lui ? (« vous n’êtes jamais le personnage, vous le jouez ») ; quel est
son rapport au personnage qu’il interprète ? Comment travaille-t-il pour
donner l’illusion d’être un autre ? (« les gestes de son désespoir sont de
mémoire et ont été préparés devant une glace »).
Un questionnement qui touche parfois plus à la psychologie du
comédien qu’à sa technique d’interprétation : le comédien est-il un être
sincère ? (« derrière votre personnage, il n’y a personne. Votre masque
vous rassure » ; « l’envie est bien pire entre vous qu’entre quiconque »),
par quelles motivations intimes est-il poussé à se montrer sur scène sous
une identité imaginée ? (« ce qui vous amène à ce métier, c’est le défaut
d’éducation, la misère et le libertinage »), peut-on dresser un portrait
ressemblant du comédien ? (« je dis simplement que dans le monde,
lorsque vous n’êtes pas bouffons, je vous trouve polis, caustiques et
froids, fastueux, dissipés, dissipateurs, intéressés... »). Les réponses de
Diderot ne sont pas toujours élogieuses envers les comédiens, et pourtant,
cette forme d’injustice est l’effet d’une rage qui voudrait donner au
théâtre une fonction capitale dans la société : « c’est qu’une troupe de
comédiens n’a pas les honneurs, les moyens, les récompenses qu’elle
mériterait dans une nation où l’on attacherait une réelle importance à la
fonction de parler aux hommes pour être instruits, corrigés, amusés ». La
volonté de Diderot est révolutionnaire : elle contredit les censures de
l’époque, et annonce le mouvement de décentralisation de notre siècle,
grâce auquel le théâtre est entré dans le domaine public.
Ces questions contiennent en filigrane une réflexion sur la mise en
scène (scénographie, direction de comédiens etc.) qui inspirera tout le
théâtre moderne de Stanislavski à Brecht, d’Antoine à Copeau. En
dégageant un ordre rigoureux nécessaire à la pratique du théâtre, Diderot
inaugure l’exigence moderne d’un vrai « métier » de comédien, et par
conséquent d’écoles où l’on pourrait les former.
1
Toutes les citations sont tirées du Paradoxe sur le comédien, et ont été reprises telles
quelles dans La comédie du paradoxe.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
1
/
20
100%