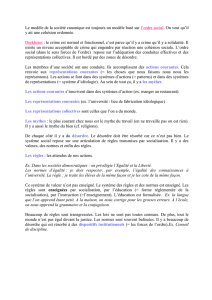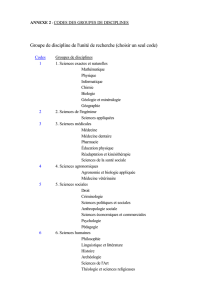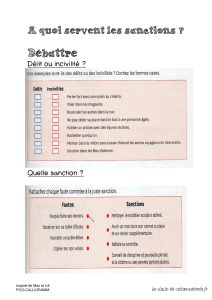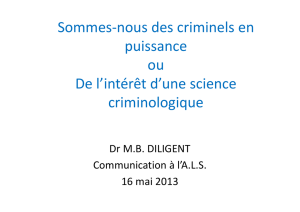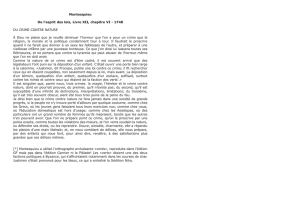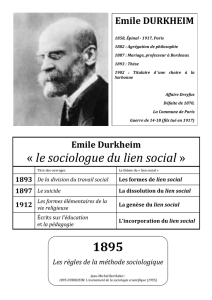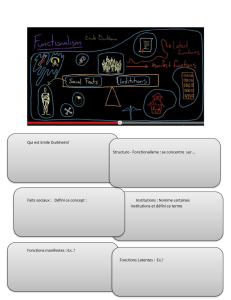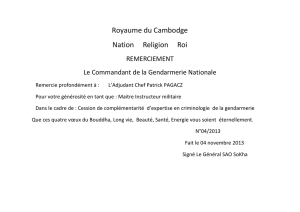Version intégrale PDF - Esprit critique

2
AVANT-PROPOS. LA CRIMINOLOGIE, UNE SCIENCE INTERDITE EN FRANCE ? Alain Bauer, professeur au
Conservatoire national des Arts et Métiers, (chaire de criminologie).
EDITORIAL.
LE « CRIME » EXISTE-T-IL ? AUTOPSIE D’UNE DISPARITION. Sylvie Chiousse et Lucien Oulahbib.
LE CRIME COMME INJUSTICE, POLITEIA ET KRIMEIN, Lucien Oulahbib, Université de Lyon III.
LA SANCTION COMME FAIT MORAL, CONTRIBUTION A L’ETUDE DU « KRIMEIN », Lucien Oulahbib,
Université de Lyon III.
La recherche sur la police : point sur les évolutions en histoire moderne, Audrey Rosania
Doctorante, Laboratoire TELEMME, MMSH Aix-en-Provence.
PARADOXES AMERICAINS, AUTODEFENSE ET HOMICIDES, Maurice Cusson, École de criminologie,
Centre international de criminologie comparée - Université de Montréal.
LA DÉLINQUANCE SÉRIELLE : UNE RECHERCHE INADAPTÉE DE LIEN SOCIAL, Erwan Dieu Criminologue
(Master de criminologie, Université de Liège & Olivier Sorel Docteur en psychologie
(Doctorat de psychologie cognitivo-développementale, Université de Tours).
ADOLESCENT DELINQUANT : RUPTURE ET INCERTITUDE DU PROJET PERSONNEL, Khadidja Mokeddem
Chercheure, Crasc, Oran.
DÉMOCRATIE ET CYBERSÉMOCRATIE ET CYBERESPACE: RÉINVENTION OU CONTESTATION DE LA VIOLENCE
LÉGITIME? Nicolas Ténèze, docteur en Science Politique, vacataire d'enseignement à
l’Université Toulouse Capitole.
LEGITIMATION SOCIALE ET INTERIORISATION DE LA DOMINATION, Caroline Guibet Lafaye chargée de
recherches 1e classe au Centre Maurice Halbwachs (CNRS – EHESS – ENS), habilitée à
diriger des recherches.
LE MYTHE POLITIQUE DE LA CONSPIRATION DANS L’IMAGINAIRE PANISLAMISTE TUNISIEN, Hajer (Ben
Yahia) Zarrouk assistante universitaire en image et publicité, Université de Gabès, Institut
supérieur des arts et métiers de Gabès.
LES ENFANTS NES DANS LES MAQUIS TERRORISTES EN ALGERIE, Salah-Eddine ABBASS, Doctorant à
l'École des hautes études en sciences sociales (EHESS), chercheur associé groupe erta-
tcrg.org.
DE QUELQUES OUVRAGES QUEBECOIS EN CRIMINOLOGIE, Nicolas DESURMONT, consultant en
criminologie l’Université Laval.

3
-
-
Alain Bauer
Professeur de criminologie au Conservatoire national des Arts et Métiers – CNAM, New York
et Beijing.
Emile DURKHEIM, Les règles de la méthode sociologique (1895), PUF, Quadrige, 1981 :
« […] Nous constatons l’existence d’un certain nombre d’actes qui présentent tous ce
caractère extérieur que, une fois accomplis, ils déterminent de la part de la société cette
réaction particulière qu’on nomme la peine. Nous en faisons un groupe sui generis, auquel
nous imposons une rubrique commune ; nous appelons crime tout acte puni et nous faisons
du crime ainsi défini l’objet d’une science spéciale, la criminologie. »
En 1956, à la tribune de l'UNESCO, Jean Pinatel tentait encore de convaincre de l'utilité
d'enseigner la criminologie. Ce n'était pas la première fois que la vieille Sorbonne résistait au
changement. Elle refusa les langues étrangères sous François 1er, les sciences et techniques,
l'économie et la gestion jusqu'à la Révolution française et la création du Conservatoire
national des Arts et Métiers, la science politique, le journalisme, les sciences de
l'environnement ou la climatologie. Même le droit pénal, qui s'en souvient peu, dut batailler.
Il existe des sciences et des disciplines au-delà du Droit canon et de la médecine (sans
autopsie). Il est juste difficile de se résoudre à admettre que son univers est plus large qu'un
antique monopole.
Il existe deux débats sur la question criminologique. Le premier sur son existence. Le
deuxième sur le projet de création d’une section du Conseil national des Universités en
charge de la gestion de la carrière des criminologues exerçant aujourd’hui dans une semi
clandestinité.
Il n'est pas difficile de démontrer que des crimes sont commis et qu’en général ils le sont par
des criminels. Et qu’ils font des victimes. Laurent Mucchielli a aussi démontré l'existence de
la criminologie en dirigeant une histoire de la criminologie française qui, on le suppose,
repose sur un contenu et n'est pas composé que de pages vierges. Sociologues (longtemps

4
ignorés de l'université), juristes, psychologues et psychiatres, reconnaissent tous un besoin
de connaissance et de formation sur les questions criminelles.
Caractère pluridisciplinaire et inexistence institutionnelle.
Des dizaines de formations ont été identifiées, après enquête, par la mission composée des
professeurs Villerbu, Dieu, Le Gueut, Senon, Cario, herzog-Evans et du directeur de
recherches au CNRS Tournier, dont les statuts académiques ne sont contestés par personne.
Les enseignants ou les étudiants concernés devraient donc continuer à être des sans papiers
de l'université ? Parce que la criminologie dispose d'un relais puissant par les médias qui
peuplent leurs programmes d'émissions sur des experts qui devraient limiter leur existence
aux dimensions du petit écran? Pourtant, chaque rapport parlementaire sur la récidive, la
folie homicide, la violence, se termine sempiternellement par une demande de plus
d'expertise, de formation, de connaissance. Il suffit de constater ce que la tragédie de
Toulouse a provoqué en termes de demande d'explication. Le crime terroriste, qui n'est
qu'un aspect de la criminalité, pourrait il se traiter sans criminologues ?
La réalité depuis longtemps a tranché la question de savoir si le crime devait être
scientifiquement étudié.
Ainsi, malgré tout, la criminologie française reste encore une discipline scientifique
paradoxale, la légitimité de son existence académique et sociale cohabitant avec une
carence de réalité institutionnelle. Le phénomène criminel est pourtant aujourd’hui devenu
un axe de questionnement dans le débat public et un enjeu pour de nombreux
professionnels du champ sanitaire, juridique et social.
Depuis son émergence à la fin du dix-neuvième siècle, à la jonction de quatre disciplines
reconnues sur un plan universitaire (médecine, droit, sociologie et psychologie), la
criminologie est demeurée, dans les faits, une annexe du droit pénal, pour qui elle se réduit
aux « sciences criminelles ».
En dépit de lʼexistence de compétences reconnues et de la production régulière de
recherches et de savoirs sur le phénomène criminel, le champ scientifique français se trouve,
contrairement à d’autres pays occidentaux (comme le Canada, la Belgique ou l’Italie),
dépourvu d’une authentique criminologie, c’est-à-dire d’une communauté scientifique
institutionnelle se rattachant formellement à un objet d'étude commun : le comportement
criminel, les formes de criminalité, les victimes de la criminalité, les instances de régulation
sociale et les réponses à la criminalité.
Bien quʼaspirant à une identité propre, cette criminologie, qui sʼest institutionnalisée en
dehors du système universitaire, demeure une discipline « annexe » et éclatée, aux contours
imprécis et au carrefour de plusieurs spécialisations plus ou moins développées et
reconnues en lʼabsence, il est vrai, dʼune criminologie instituée, fédératrice et unitaire
(psychiatrie criminelle, médecine légale, criminalistique, police technique et scientifique,
psychologie criminelle, démographie criminelle, sociologie criminelle, pénologie,
victimologie, sciences pénitentiaires, sociologie de la police, politiques publiques de
sécurité…).
Cette fragmentation disciplinaire a pour effet de ne saisir le phénomène criminel quʼà
travers le prisme des disciplines ayant investi lʼobjet criminel, ce qui a pour effet de produire
des savoirs morcelés difficilement mis en relation.
Lʼinexistence de la criminologie était consacrée et entretenue par lʼabsence de section du

5
Conseil national des universités, ce qui lui interdit le recrutement dʼenseignants-chercheurs
titulaires (professeurs et maîtres de conférences) et contractuels (allocataires-moniteurs et
ATER), donc la mise en place de diplômes spécifiques au niveau de la licence, du master et
du doctorat. Dans lʼenseignement universitaire, la criminologie nʼexiste que de manière
accessoire, voire anecdotique, sous la forme, pour lʼessentiel, dʼenseignements épars, de
diplômes dʼuniversités et de rares spécialisations dans quelques mastères juridiques.
Cette situation se retrouve également au niveau du CNRS, avec, là aussi, lʼinexistence dʼune
section de « criminologie », ce qui a pour conséquence lʼabsence de centres et dʼ équipes de
recherche disposant de criminologues titulaires.
Le caractère pluridisciplinaire de la criminologie explique en partie cette inexistence
institutionnelle, les disciplines établies, si elles tolèrent plus ou moins quelques incursions
de leurs membres dans le champ criminologique, ayant plutôt tendance à se replier sur leur
espace scientifique et professionnel propre. Quant aux universitaires et chercheurs français,
en dépit de leur investissement sur le champ criminel, ils ne peuvent revendiquer le titre de
« criminologue » dans la mesure où la structuration universitaire a fait dʼeux des juristes
(éventuellement « pénalistes »), des sociologues, des politologues ou encore des
psychologues et des médecins psychiatres.
La criminologie française nʼexiste donc que de manière incidente et dérobée : dʼune part,
avec des recherches effectuées sous la bannière dʼautres disciplines ; dʼautre part, avec des
travaux conduits par des « criminologues » plus ou moins autodidactes (en lʼabsence de
validation universitaire). La communauté des chercheurs français en criminologie existe
donc plus sous la forme dʼun collège invisible dʼindividualités (plus ou moins marginalisées
par rapport à leur discipline dʼappartenance) que sous celle dʼune communauté scientifique
légitime.
Fonctionnant à la manière dʼune « auberge espagnole », la criminologie française dispose
dʼune association professionnelle (Association française de Criminologie), mais dont
lʼactivité, faute de moyens, sʼavère quelque peu confidentielle. Il nʼy a guère quʼune poignée
de chercheurs français pour participer aux activités des principales sociétés européennes et
internationales de criminologie (notamment lʼAssociation internationale des criminologues
de langue française, la Société européenne de criminologie et la Société internationale de
criminologie).
La constitution et le développement dʼune criminologie française suppose donc la mise en
place dʼun outil de référence ayant pour dessein dʼaccueillir les nombreux spécialistes de
ces questions, sur un plan interne comme international, au centre des préoccupations
sociales. Il sʼagira également dʼafficher clairement la capacité de la criminologie à apporter
des réponses concrètes aux principales questions que se pose la société française, mais aussi
à contribuer à lʼinsertion professionnelle des étudiants en répondant aux besoins des
collectivités publiques, organismes et entreprises en matière de professionnels des
questions de criminalité, de prévention et de sécurité.
Une vocation nouvelle pour la criminologie : principes et perspectives
Telle quʼenseignée aujourdʼhui en France, non comme discipline, mais comme « spécialité »,
la criminologie mobilise trop souvent encore son attention sur les déviances dʼindividus pris
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
 151
151
 152
152
 153
153
 154
154
 155
155
 156
156
 157
157
 158
158
 159
159
 160
160
 161
161
 162
162
 163
163
 164
164
 165
165
 166
166
 167
167
 168
168
 169
169
 170
170
 171
171
 172
172
 173
173
 174
174
 175
175
 176
176
 177
177
 178
178
 179
179
 180
180
 181
181
 182
182
 183
183
 184
184
 185
185
 186
186
 187
187
 188
188
 189
189
 190
190
 191
191
 192
192
 193
193
 194
194
 195
195
 196
196
 197
197
 198
198
 199
199
 200
200
 201
201
 202
202
 203
203
 204
204
 205
205
1
/
205
100%