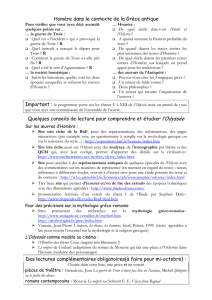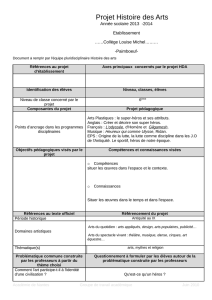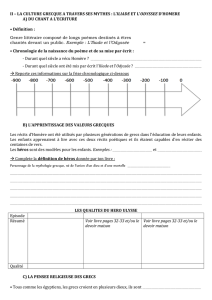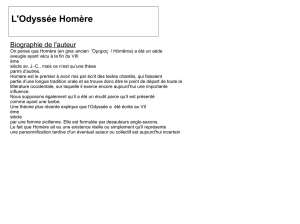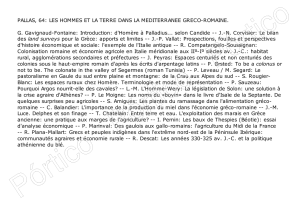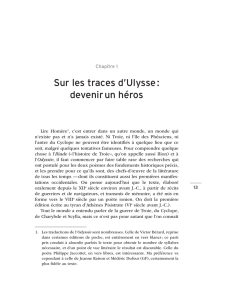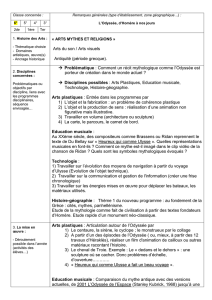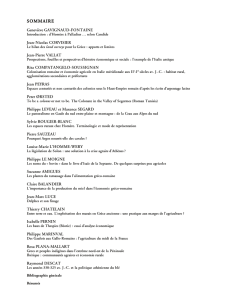Format PDF - Noesis

Noesis
1 | 1997
Phenomenologica - Hellenica
La muse, l’aède et le héros
Jacqueline Assaël
Édition électronique
URL : http://noesis.revues.org/1421
ISSN : 1773-0228
Éditeur
Centre de recherche d'histoire des idées
Édition imprimée
Date de publication : 15 mars 1997
Pagination : 109-169
ISSN : 1275-7691
Référence électronique
Jacqueline Assaël, « La muse, l’aède et le héros », Noesis [En ligne], 1 | 1997, mis en ligne le 02 mars
2009, consulté le 25 novembre 2016. URL : http://noesis.revues.org/1421
Ce document est un fac-similé de l'édition imprimée.
© Tous droits réservés

LA MUSE, l'AÈDE ET LE HÉROS
Jacqueline ASSAËL
I. L'INSPIRATION DIVINE
Pétition du problème
Les épopées homériques commencent par un appel à la
Muse. Cet indice notamment pourrait faire supposer que le
chant est inspiré à l'interprète ou à l'auteur de ces amples
compositions par une voix divine. Platon indique d'ailleurs
que l'idée selon laquelle l'aède ou le poète s'expriment et
travaillent en état d'extase représente une ancienne croyance
pour les Grecs
(παλαιòς
μυθος)1. Toutefois, certains
modernes ont quelque difficulté à admettre qu'une forme de
possession ait pu animer les poètes archaïques.
En fait, la question est controversée. M. I. Finley par
exemple est prêt à accorder son crédit au témoignage
qu'apporte l'aède Phémios, dans Y Odyssée: Je n'ai pas eu de
maître!
en toutes poésies, c'est un dieu qui m'inspire! « pour
le poète et son auditoire », juge-t-il, « le sens en était
littéral. »2 Toutefois, pour prendre en considération les
déclarations d'un personnage qui s'exprime ainsi au style
direct, sans doute faut-il définir une méthode d'interprétation
ou découvrir d'autres éléments qui corroborent les propos de
l'aède.
Or, les perspectives de l'histoire littéraire sont brouillées.
En effet, d'un côté, Jacqueline de Romilly dessine une
Ce témoignage éclaire les modernes sur la mentalité grecque, même si
le μυθος auquel Platon fait référence n'apparaît en fait à travers aucun texte
connu. Le philosophe parle de μανία poétique. Il compare la situation du
poète inspiré et celle de la Pythie qui délivre la parole des dieux. Pour lui, "le
poète n'est plus maître de son esprit". Cf. Lois, IV, 719 c et Ion, 533 d et sqq.
2 Référence à
Odyssée,
XXII, 347-348. M. I. Finley, Le
monde
d'Ulysse,
Paris,
Maspero, (1969), 1978, (trad. fr. de C. Vernant-Blanc et M. Alexandre
de
The World
of
Odysseus,
The Viking Press Inc. Publishers, New York, 1954
et 1977) p. 49.
109
Noésis n°l

évolution des processus de création qui confirme l'opinion de
M. I. Finley: selon elle, en effet, le temps des poètes inspirés,
à l'époque de l'épopée et du lyrisme, a bel et bien précédé celui
des techniciens, au sens étymologique du terme, maîtres,
créateurs et calculateurs conscients de leurs effets qui, en une
période rationaliste, ont même favorisé l'élaboration du style
rhétorique et artificiel d'un sophiste comme Gorgias3. Mais en
un autre sens, à travers la théorie platonicienne portant sur
l'inspiration poétique, P. Vicaire discerne l'influence d'un
courant de pensée dionysiaque qui s'impose à Athènes, en
particulier grâce au développement du théâtre. Pour lui, donc,
cette conception de la littérature n'existe pas en Grèce et n'a
pas de fondement avant le Vème siècle4.
Cette prise de position a été majoritairement défendue.
L'autorité de E. R. Dodds, tout spécialement, l'a solidement
établie et elle
s'est
largement répandue comme une vérité
certaine: « Dans la tradition épique, on nous représente le
poète recevant des Muses une connaissance supranormale;
mais il ne tombe pas en extase; il n'est pas possédé par
elles.
»5 La question consiste donc à savoir si le poète est par
nature un être différent des autres, doué d'un sens qui lui
permet, en toute circonstance et dans une normalité
"Pindare est, pour un temps, le dernier des inspirés. (...) La tragédie,
elle,
dépendra toute du talent humain. " ("Gorgias et le pouvoir de la poésie",
Journal of Hellenic Studies, 93, 1973, p. 160).
"Il faut sans doute discerner, dans l'importance donnée à la transe
poétique, par des penseurs de la fin du cinquième et de la première moitié du
quatrième siècle avant notre ère, une influence ou un contre-coup de certaines
croyances propres à la religion de Dionysos. " "Les Grecs et le mystère de
l'inspiration poétique", Bulletin de l'Association Guillaume Budé, 1, 1963, p.
75.
Les Grecs et l'irrationnel, Paris, (éd. Montaigne, 1965), Flammarion,
coll. Champs, 1977, (trad. fr. de The Greeks and the Irrational, University of
California Press, Berkeley, U. S. A., 1959), p. 89. Cette opinion a été reprise
par des commentateurs du texte d'Homère, cf. A. Heubeck, S. West, J. B.
Hainsworth, A Commentary on Homer's Odyssey, I, Oxford Clarendon Press,
(1988),
1991, p. 350; la référence faite à Dodds apparaît aussi dans des revues
de vulgarisation, cf. M. Montana, Les muses et l'inspiration
poétique, Ο
ΛΤΧΝΟΣ,
Bulletin de l'Association Connaissance Hellénique,
34,
1988, p. 15-16.
110 Noésis n°l

extraordinaire, d'exprimer un savoir inaccessible pour le
commun des mortels, ou bien si une révélation ne lui parvient
que de manière exceptionnelle et dans un état de trouble de la
personnalité.
Sans doute faut-il définir la notion de possession divine.
L'image d'un poète emporté par la fureur frénétique d'une
danse incontrôlée n'est guère envisageable évidemment, si elle
est appliquée aux poètes archaïques. Elle rebute les critiques
modernes, effarouchés par la représentation caricaturale que
Platon propose dans Ion, en comparant l'attitude du poète à
celle des Corybantes agités par le délire d'un culte asiatique6.
Mais ce rapprochement est finalement plus pertinent
lorsqu'avec un humour moins
agressif,
le philosophe évoque
l'exaltation de Socrate, animé par les Lois d'Athènes qu'il
incarne, l'espace d'une prosopopée: « Voilà, sache-le bien,
mon très cher Criton, ce que moi, je crois entendre, comme les
initiés aux mystères des Corybantes croient entendre des flûtes;
oui,
le son de ces paroles bourdonne en moi et m'empêche de
rien entendre d'autre »
(και
εν
έμοι
αΰτη
ή
ήχή
τούτων)7.
A ce moment, Socrate est habité,
d'une certaine manière.
Les phénomènes de possession et leur degré sont divers.
Certes, l'inspiration poétique ne provoque pas de désordres
physiques très caractérisés, chez les aèdes homériques,
toutefois, il est hasardeux d'affirmer comme le fait P. Vicaire:
« nous pouvons constater, objectivement, que l'idée de
"possession" divine est absente d'Homère »8. En effet, dans
les épopées, rares sont les propos théoriques ou critiques qui
éclairent sur la vocation de l'aède ou sur la nature de son
activité créatrice et sur son état psychique, cependant, dans
l'Iliade et dans l'Odyssée, par certains aspects, le personnage
de l'aède est très proche de celui du devin et sa connaissance
est considérée comme une science divine. En eux-mêmes, ces
rapports ne suffisent certes pas à démontrer que l'artiste
homérique est animé d'un transport poétique. En effet, à
l'époque archaïque, les professionnels de la mantique
6 Ion, 533 c.
7 Criton, 54 d.
8 Loc. cit., p. 73.
111
Noésis n°l

procèdent souvent selon des méthodes rassises, sinon très
rationnelles9. Mais si l'origine du chant est présentée comme
une voix extérieure à l'aède, il est nécessaire d'étudier
comment, et à quel point, l'être humain assimile cette parole
qui lui est communiquée.
*
**
La figure de l'aède inspiré
Les méthodes comparatistes permettent de percevoir les
similitudes qui, à l'origine, ont été établies entre la fonction
d'interprète religieux et celle de chantre inspiré, dans diverses
traditions indo-européennes. Dans les hymnes védiques, en
effet, la déesse Vâc, la Voix, se glorifie d'accorder sa faveur à
deux types de médiateurs que G. Dumézil définit ainsi: « ce
sont les hommes sacrés comme elle-même, les prêtres. Au
cours de longues études en effet, elle leur donne puissance
d'action (ugrám) et puissance de pensée (sumedhram). Elle en
distingue deux types: le brahmán et le rsi l'un plus lié aux
formules et aux gestes immuables du culte, l'autre ouvert à la
création poétique, à peu près “l'officiant” et le “voyant” (ou
“l'inspiré”) ».10 Vac patronne donc les deux catégories de
Toute une tendance de la critique minimise la part d'irrationalité qui
marque toute expérience divinatoire chez les Grecs. Ainsi, P. Amandry
a-t-il
tenté de montrer que le délire de la Pythie était sans doute plus atténué qu'il ne
paraît (Cf. La mantique apollinienne à Delphes. Essai sur le fonctionnement de
l'oracle, Paris, de Boccard, 1950, p. 23, 47, 66-77; contra R. Flacelière,
Devins et oracles grecs, Paris, 1965, P. U. F., p. 71). De son côté, M. Casevitz
évoque "la divination grecque traditionnelle, pleine de sens" (Les devins
des tragiques, CGITA, 4, 1988, p. 129. Cf. aussi p. 115: "Considérant les
premières attestations du mot μάντις, chez Homère et chez les poètes
archaïques, on a pu voir que le devin μάντις apparaissait comme un homme de
savoir, (...) sans pour autant apparaître en transes" et Mantis: le vrai
sens,
R. E. G., 105, Janvier- Juin 1992, p.
1-18).
Voir aussi sa bibliographie
sur la question, qui est ici annexe.
Apollon sonore et autres essais. Esquisse de mythologie, Paris,
Gallimard, 1982, p. 18. Cf. RV X 125, 5: "C'est moi, de moi-même, qui
prononce ce qui est goûté des dieux et des hommes. Celui que
j'aime,
celui-là,
112 Noésis n°l
9 Toute une tendance de la critique minimise la part d'irrationalité qui
marque toute expérience divinatoire chez les Grecs. Ainsi, P. Amandry
a-t-il
tenté de montrer que le délire de la Pythie était sans doute plus atténué qu'il ne
paraît (Cf. La mantique apollinienne à Delphes. Essai sur le fonctionnement de
l'oracle, Paris, de Boccard, 1950, p. 23, 47, 66-77; contra R. Flacelière,
Devins et oracles grecs, Paris, 1965, P. U. F., p. 71). De son côté, M. Casevitz
évoque "la divination grecque traditionnelle, pleine de sens" (Les devins
des tragiques, CGITA, 4, 1988, p. 129. Cf. aussi p. 115: "Considérant les
premières attestations du mot
μαντις,
chez Homère et chez les poètes
archaïques, on a pu voir que le devin uctvriç apparaissait comme un homme de
savoir, (...) sans pour autant apparaître en transes" et Mantis: le vrai
sens,
R. E. G., 105, Janvier- Juin 1992, p.
1-18).
Voir aussi sa bibliographie
sur la question, qui est ici annexe.
10 Apollon sonore et autres essais. Esquisse de mythologie, Paris,
Gallimard, 1982, p. 18. Cf. RV X 125, 5: "C'est moi, de moi-même, qui
prononce ce qui est goûté des dieux et des hommes. Celui que
j'aime,
celui-là,
112 Noésis n°l
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
1
/
60
100%