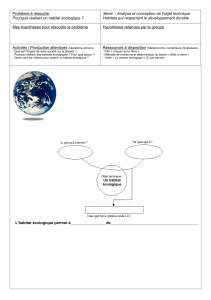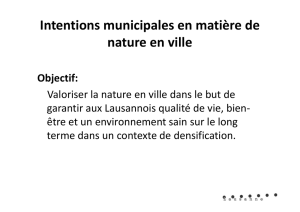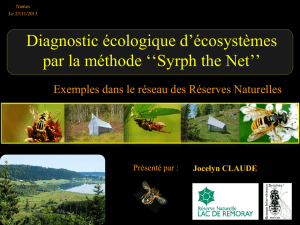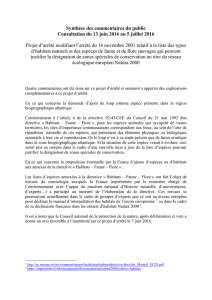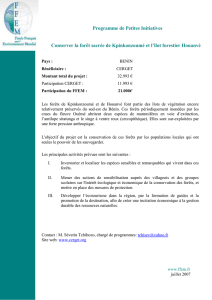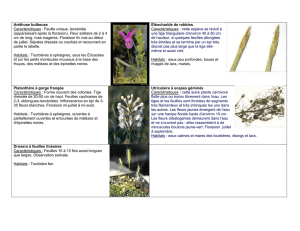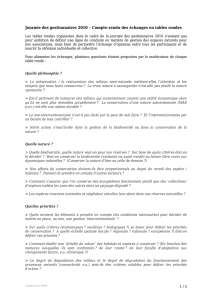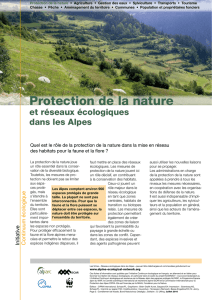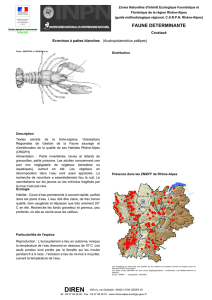le patrimoine naturel et écologique du parc naturel

LE PATRIMOINE NATUREL ET ÉCOLOGIQUE
DU
PARC NATUREL HAUTES FAGNES-EIFEL

3
TABLE DES MATIÈRES
LES CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 4
Le Relief 4
La Géologie 4
La Pédologie 5
Le Climat 6
L’Hydrologie 6
LES CARACTÉRISTIQUES ÉCOLOGIQUES 7
La Structure écologique principale 8
Les biotopes présents 9
Les milieux terrestres non agricoles : les milieux tourbeux et les landes 9
Les habitats forestiers 10
Les habitats agricoles et mégaphorbiaies rivulaires 12
Les habitats des eaux courantes 13
Les éléments de liaison 13
La Faune indigène au sein du Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel 15
Les espèces invasives 16
Les plantes terrestres invasives 16
Les plantes aquatiques invasives 16
La faune invasive 16
Les outils de protection de la biodiversité 17
Le réseau Natura 2000 17
Les réserves naturelles domaniales et agréées 18
Les réserves naturelles forestières 18
Les zones humides d’importance internationale – zones RAMSAR 19
Les sites de grand intérêt biologique (SGIB) 19
Les arbres et haies remarquables 19
Le Code forestier 20
Les plans et conventions en faveur de la biodiversité 20
Analyse AFOM 22
Si aujourd’hui nous vous présentons ce document, c’est pour une raison bien précise. Actuellement,
nous renouvelons notre plan de gestion et son programme d’actions pour les dix prochaines années.
Or, depuis la création du Parc naturel de nombreux éléments ont évolué : les missions propres aux
parcs naturels, le contexte socio-économique, les villages, l’état des habitats naturels, la législa-
tion… Le nouveau programme d’actions du Parc doit s’ancrer dans cette nouvelle réalité pour
continuer à préserver durablement son cadre de vie exceptionnel.
C’est pourquoi, dans un premier temps, nous avons recherché, rassemblé, synthétisé les prin-
cipales données caractérisant le territoire. Ce travail a pour objectif de prendre un cliché ins-
tantané, an de mettre en évidence les points forts à protéger et à développer, et de déceler les
menaces et les faiblesses à lever pour le futur. Nous avons passé au crible les aspects suivants :
Les caractéristiques naturelles : à quoi ressemble le Parc, quelles sont la faune et la ore qu’on
y rencontre ?
Paysages et aménagement du territoire : quels sont les paysages caractéristiques et quelles inuences
l’homme et ses activités ont eues sur ces paysages ? Quelle est l’organisation spatiale du territoire (bâti, mobi-
lité, énergie,…)?
Développement rural : quelles sont les activités humaines du Parc ? Comment se portent l’agriculture, la sylviculture, le
tourisme, la vie culturelle et associative, … ?
Nous vous présentons ici le résumé de cette étude non exhaustive.
Si s’adapter au contexte est nécessaire, s’adapter aux personnes l’est autant ! Chacun est concerné d’une manière ou
d’une autre par cet espace : habitants, agriculteurs, enseignants, touristes, commerçants, entrepreneurs, … et vos connais-
sances concrètes et quotidiennes du territoire complèteront certainement notre analyse plus théorique. Vos avis, vos points
de vue nous permettront de construire un programme cohérent et adapté au territoire.
En somme, nous vous invitons à prendre part à la construction du Parc naturel de demain. Ne soyez pas effrayés par
l’aspect quelque peu formel de ce document. Notre volonté est de partager ces informations avec ceux qui le souhaitent.
La lecture de ces documents n’est pas indispensable pour donner votre avis.
Concrètement, vous pouvez ajouter votre pierre à l’édice de plusieurs manières :
Participer aux rencontres et donner directement votre avis (le 30/05, le 13/06 ou le 20/06) ;
Répondre aux questionnaires disponibles en ligne ou sur demande (www.botrange.be);
Nous contacter par téléphone (080/440390), par mail ([email protected]) ou nous rencontrer à la Maison
du Parc.
Les parcs naturels ont des missions définies,
comment les atteindre dans
le monde d’aujourd’hui ?

4
LES CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
Les caractéristiques physiques d’un territoire déterminent largement la nature des habitats naturels et l’usage que l’homme
a pu en faire. Ce chapitre détaille les caractéristiques physiques propres au territoire du Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel.
Le Relief
Hérité de l’érosion quaternaire, le relief du Parc naturel est
divisé en trois grandes parties :
• Le Haut Plateau à climat rigoureux (> 600 m). C’est
dans ce plateau que prennent naissance de nombreux
cours d’eau dont une partie alimentera les lacs de la Gi-
leppe et d’Eupen (Vesdre, Helle, Soor, Gileppe, Hoegne
et Rur).
• Le Haut Plateau (< 600 m) : Cette partie comprend
les villages les plus élevés de Belgique (Elsenborn,
Mürringen, …), ainsi que des prairies et des pâtures
humides (zones agricoles défavorisées), et les lacs de
Butgenbach et de Robertville.
• Les zones de fortes pentes de la vallée de l’Our.
La Géologie
L’Ardenne et l’Eifel appartiennent au Massif Schisteux Rhé-
nan.
Dans sa partie Sud, le Parc est essentiellement constitué de
roches datant du Dévonien.
Dans la partie Nord, on retrouve principalement des roches
datant du Cambrien.
La Pédologie
Le sol est un élément essentiel à prendre en compte pour toutes considéra-
tions, suggestions, recommandations, relatives à une gestion harmonieuse du
territoire du Parc naturel.
A l’échelle du parc, les sols peuvent être subdivisés en 4
types, par ordre décroissant d’importance :
• Les sols caillouteux à charge de schistes et
de grès (50% du territoire). Ces sols se concen-
trent principalement dans la vallée de l’Our et dans
l’avant-pays fagnard. Ce sont des sols peu favorables
à l’agriculture de par leur charge caillouteuse. On re-
trouve principalement des forêts et quelques prairies
sur ce type de sol.
• Les sols limono-caillouteux, assez sec (25%) :
Ces sols se retrouvent principalement dans la zone
correspondant au relief du Haut-Plateau (< 600m) et
peuvent être qualiés de bons sols. On y trouve 45%
de forêts et la majorité des prairies ou prés de fauches
du Parc naturel (41%).
• Les sols limoneux peu caillouteux et majori-
tairement humides (8%) : Ces sols se trouvent prin-
cipalement dans l’avant-pays fagnard et le plateau
des Hautes-Fagnes. On retrouve majoritairement des
forêts et quelques prairies sur ce type de sols.
• Les sols tourbeux (6%) : Il s’agit de sols sur
lesquels on retrouve des végétations non productives
(dont des habitats naturels rares et menacés, comme
les tourbières) et des plantations de résineux.
5

6
Le Climat
Par sa position élevée et son relief, le plateau des Hautes-Fagnes est une région naturelle très différente des autres régions
du pays. Les Hautes-Fagnes sont abondamment arrosées ou baignées dans les brumes et les brouillards.
Les précipitations moyennes avoisinent les 1400 mm par an avec des pics pouvant aller jusqu’ à 1700 mm. En comparai-
son, Spa-Malchamps qui se trouve aux portes des Fagnes ne reçoit que 1127 mm par an et Uccle, 835 mm. Ce contraste
régional se révèle dans toutes les composantes climatiques.
Avec une température moyenne annuelle comprise entre 6 et 7 °C, le plateau des Hautes-Fagnes est le relief le plus froid
de Belgique. Cette température est de plus de 3 degrés inférieure à la température moyenne relevée à Uccle (10.4 °C).
La saison de végétation est aussi beaucoup plus courte que dans d’autres régions. Le climat rigoureux de cette région,
avec ses fortes précipitations, ses hivers longs et froids et une température moyenne basse, a permis le développement
d’habitats naturels et le maintien de nombreuses espèces végétales, boréo-montagnardes et atlantiques très rares.
Au nord et au sud du Haut-Plateau, l’abaissement du relief est progressif ; la hauteur des pluies diminue jusqu’à 1000 mm
dans les régions d’Eupen et de Saint-Vith. Le climat y est moins rude, les jours de brouillard moins fréquents et le ciel plus
clair, surtout dans la vallée de l’Our.
L’Hydrologie
Le Parc naturel est parcouru par de nombreux cours d’eau : au total, 1705 km de cours d’eau non navigables.
Il est découpé par deux districts hydrographiques : la partie nord appartient au district hydrographique de la Meuse, la partie
sud appartient au district hydrographique du Rhin.
Quatre bassins hydrographiques découpent le territoire
du Parc naturel :
• Le bassin hydrographique de la Moselle avec l’Our et ses
principaux afuents, la Braunlauf, l’Ulf, le Kolvenderbach
et le Medemderbach.
• Le bassin hydrographique de la Vesdre avec ses princi-
paux afuents dans le Parc naturel, la Gileppe, la Soor, la
Helle et la Getz,
• Le bassin hydrographique de la Meuse aval avec la Rur
et ses principaux afuents, l’Olef et la Schwalm,
• Le bassin hydrographique de l’Amblève avec la Warche
et ses afuents,
LES CARACTÉRISTIQUES ÉCOLOGIQUES
Le Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel renferme une richesse biologique exceptionnelle, tant au niveau de la faune, de la
ore que des biotopes.
Un grand nombre de projets et d’initiatives ont été menés sur le territoire du Parc naturel an de protéger et de sauvegarder
ces richesses naturelles et paysagères.
Citons, entre autres, le projet Life « Hautes Fagnes » qui a permis de restaurer près de 2800 ha de landes et de tourbières,
le projet Interreg « Contrat Rivière Our », qui a permis de rétablir un continuum écologique dans le cours principal de l’Our,
les actions entreprises par les PCDN d’Amblève, de Burg-Reuland et d’Eupen, la mise sous statut de nombreuses réserves
naturelles ou la désignation des sites Natura 2000, les actions entreprises par les contrats rivières et bien d’autres encore.
Néanmoins, malgré les nombreux efforts entrepris pour protéger et préserver notre patrimoine naturel, de multiples me-
naces persistent.
Une menace majeure est la fragmentation de l’habitat (les habitats sont de plus en plus petits et déconnectés les uns
des autres). Causée par l’urbanisation galopante, le développement des infrastructures routières et ferroviaires, les pra-
tiques agricoles et sylvicoles intensives, la fragmentation de l’habitat provoque l’isolement des populations d’espèces.
Ces dernières, privées de corridors naturels, doivent renoncer aux déplacements nécessaires à leur survie et nissent par
s’éteindre. En préservant et en renforçant le réseau écologique sur le territoire, il est possible de lutter directement contre
cette menace de fragmentation.
La pollution des sols et des cours d’eau, le changement climatique ainsi que l‘introduction d’espèces exotiques contribuent
également à cette érosion de la biodiversité. Au-delà du maillage vert (les espaces verts ou naturels, reliés entre eux par
des haies, rivières ou autres), la qualité de l’environnement est donc indispensable à la survie des organismes et à leur
reproduction.
Le présent chapitre est consacré à la description du patrimoine naturel et écologique du Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel.
Les nombreux cours d’eau, les étendues de landes et de tourbières, la présence d’étendues fores-
tières et de fonds de vallées humides, d’arbres et de haies remarquables, d’espèces rares et mena-
cées à l’échelon national, voire européen, sont autant de caractéristiques qui confèrent au Parc
naturel un patrimoine naturel unique.
7

8
La Structure écologique principale
La Structure écologique Principale (SEP) a pour but de rassembler, dans un contour cohérent, l’ensemble des zones du
territoire ayant un intérêt biologique actuel ou potentiel.
La SEP se compose de trois zones types :
• Les Zones centrales (ZC), où la conservation de la nature est pri-
oritaire. Ces zones offrent des habitats écologiquement intéressants,
plus ou moins bien conservés, ou abritent des noyaux de populations
ou des espèces rares ou menacées.
• Les Zones de Liaison ou éléments du maillage écologique
(ZL). Elles permettent la dispersion de la ore et le déplacement de
la faune sauvage entre les zones centrales (par exemple : les haies,
les mares, etc.).
• Les Zones de Développement (ZD) sont de moindre valeur
écologique du fait des activités humaines. Elles servent en quelque
sorte de zone « tampon », protégeant les zones centrales et les liai-
sons des inuences extérieures potentiellement nuisibles. La conser-
vation de la nature doit y être favorisée.
Néanmoins, seuls 41 % de la SEP sont actuellement carto-
graphiés.
Il reste donc un important travail de cartographie à réaliser
sur le territoire du Parc.
La classication de chacun de ces habitats en zones cen-
trales, zones de développement ou éléments de liaison de-
vrait être réalisée pour tout le territoire du Parc.
Au sein du Parc naturel, la structure éco-
logique principale (Natura 2000, SGIB)
s’étend sur 25.820 ha et couvre ainsi 35 %
du territoire.
Les biotopes présents
Le territoire du Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel renferme une richesse biologique exceptionnelle.
Etant donné les lacunes importantes au niveau de la cartographie, il est impossible de présenter de manière cartogra-
phique une répartition précise des différents biotopes sur le territoire du Parc naturel.
Nous nous limiterons donc à citer les biotopes présents sur le territoire présentant, dans le contexte régional, un intérêt
biologique important ou une étendue importante.
Parmi les nombreux biotopes d’intérêts présents sur le territoire du Parc, on trouvera notamment :
Les milieux terrestres non agricoles : les milieux tourbeux et les landes
Jadis, ces milieux ont eu leur importance dans l’économie locale (fournissant litière, fourrage, combustible). Aujourd’hui,
ces sites ne sont plus exploités et se concentrent principalement dans des sites protégés ou dans les camps militaires.
Toutefois, il existe encore certaines stations isolées et dispersées dans la matrice agricole ou forestière et dans ou au voi-
sinage de carrières.
►Les milieux tourbeux
Sur le territoire du Parc naturel on retrouve principalement:
• des tourbières hautes légèrement bombées qui
s’étalent sur près de 150 ha, dans la Fagne Wallonne, à
Cléfaye, au Misten et au Rurhof.
L’intérêt des tourbières hautes
des Hautes-Fagnes est exceptionnel. Il s’agit
en effet, avec celles plus restreintes du plateau
des Tailles, pratiquement du seul milieu encore
proche de l’état naturel en Belgique.
• des tourbières hautes dégradées envahies de moli-
nie dans les stades les plus dégradés, présentes prin-
cipalement sur le Haut-Plateau (plus de 1.000 ha !) mais
également rencontrées dans les fonds de vallées du
Parc naturel.
• des tourbières basses ou bas-marais qui par opposi-
tion aux tourbières hautes sont toujours en contact avec
la nappe phréatique et que l’on rencontre dans les dé-
pressions, sur les pentes, là où la couche de tourbe est
peu épaisse (max 80 cm).
Ces biotopes sont principalement menacés par le manque de connectivité entre les
habitats, les pollutions atmosphériques ou les pollutions du sol, les mesures de ges-
tion inadaptées, le reboisement, les activités liées à la sylviculture et l’envahissement
par les espèces exotiques.
9
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
1
/
13
100%