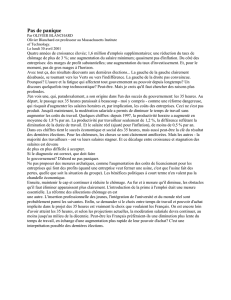La déréglementation des marchés du travail a-t

La déréglementation des marchés du travail a-t-elle eu des effets sur l’emploi ?
Avec l’explosion du nombre de chômeurs dans la plupart des pays de l’OCDE, à partir de la
crise des années 1970, les politiques liées à l’emploi deviennent une question centrale pour chaque
gouvernement. Ainsi, dans les années 1980, c’est dans le sens de la déréglementation que
s’engagent de nombreux pays. Cette déréglementation peut prendre différentes formes :
flexibilisation et individualisation des salaires, allègement des procédures de licenciement,
développement d’emplois atypiques. Autant de mesures visant à réduire le coût du travail pesant
sur les taux de marge des entreprises. Pourtant, alors que le taux de chômage reste élevé pour de
nombreux pays, on peut s’interroger sur les effets sur l’emploi de telles mesures. En quoi la
déréglementation est-elle devenue dans le contexte actuel un outil indispensable de la lutte contre
le chômage ? Dans quelle mesure permet-elle une baisse du chômage, notamment des moins
qualifiés ? Si la relation est imparfaite, où trouve-t-on ses limites ? Nous verrons donc en quoi la
déréglementation s’est affirmée comme indispensable pour lutter contre le chômage et nous
mesurerons ses effets. Nous verrons ensuite en quoi ces effets positifs restent nécessairement
limités, limites révélant alors les effets négatifs voire pervers de ces mesures.
Dans un contexte de concurrence accrue et de croissance ralentie, la déréglementation est
un outil efficace dans la lutte contre le chômage, notamment celui des moins qualifiés.
Avec la fin des 30 glorieuses, le contexte économique change, appelant alors à un autre
fonctionnement du marché du travail. Les années 1970 voient en effet la régulation fordiste entrer
en crise. Les 30 glorieuses étaient alors marquées par un faible chômage, des hausses de salaires
régulières nourries par les gains de productivité et négociées collectivement. Avec la crise, les gains
de productivité s’essoufflent tandis que les hausses de salaires se poursuivent, pesant ainsi sur les
taux de marge des entreprises alors incitées à élever leurs prix. Parallèlement, on ne peut plus
compter sur une relance monétaire pour faire baisser le chômage, la relation de Phillips se perd dans
l’inflation. En outre, on assiste à la montée progressive de la concurrence internationale dans le
contexte de mondialisation. Les NPIA s’affirment peu à peu comme de redoutables concurrents dans
le secteur des produits manufacturés à faible valeur ajoutée, production intensive en travail non
qualifié. Ainsi ce sont les travailleurs exposés, pour reprendre une distinction établie par P.N. Giraud,
qui sont le plus durement touchés par cette nouvelle concurrence. Ils ne possèdent pas les
qualifications des compétitifs, ce sont les premiers touchés par les délocalisations. Ils sont en outre
les premiers touchés par le progrès technique qui s’affirme donc comme biaisé. Ainsi face à un
bouleversement des conditions de la concurrence, au ralentissement des la croissance, la
déréglementation s’est peu à peu imposée pour réduire le coût du travail, renouer avec
l’investissement, la croissance et l’emploi.
De telles mesures trouvent leur justification théorique dans les théories classiques et néo-
classiques. Dans ces théories, le marché du travail est un marché comme les autres, les quantités
(l’emploi) doivent s’ajuster par les prix (les salaires) pour conduire à l’équilibre (le plein-emploi ou le
chômage naturel). Le chômage apparait comme volontaire ou lié à des rigidités qui empêchent la
flexibilité des salaires devant mener à l’équilibre. En rétablissant ou en renforçant les forces

régulatrices du marché, en réduisant les charges sociales et fiscales, en abaissant le salaire
minimum, le chômage doit se réduire. Ainsi, il s’agit dans le cadre d’une politique de l’offre de
desserrer les contraintes pesant sur les entreprises pour abaisser le coût du travail. Leurs marges
rétablies, les entreprises dégagent les moyens pour financer leurs investissements et relancer l’offre.
La baisse du coût du travail réduit en outre l’opportunité d’une substitution du capital au travail. La
déréglementation permet aussi à la firme d’être plus réactive face aux aléas de la conjoncture. Grâce
aux emplois atypiques notamment, elle va pouvoir adapter la quantité de travail à sa production,
évitant ainsi les surcoûts. Cette flexibilisation est particulièrement importante pour les PME, plus
fragiles.
Alors que les économistes de l’offre et le patronat défendent la déréglementation, de
nombreux pays adoptent des mesures en ce sens. La Grande-Bretagne en est l’exemple le plus
marquant : l’arrivée de Margaret Thatcher au pouvoir conduit à l’affaiblissement des syndicats et à
des mesures de libéralisation du marché du travail (suppression du closed shop). Aux Etats-Unis,
Ronald Reagan ne revalorise pas le salaire minimum, ce qui le maintient, compte tenu de l’inflation,
à un niveau très bas. Le faible chômage américain est souvent expliqué par la flexibilité de son
marché du travail et la faiblesse des charges pesant sur les entreprises. Le Danemark a également
fait baisser sensiblement son taux de chômage grâce à la flex-sécurité, modèle dans lequel les
contraintes sur le licenciement ont été allégées. Réciproquement, les forts de taux de chômage dans
certains pays d’Europe continentale sont expliqués par de trop fortes réglementations. La France a
suivi – de manière modérée – la voie de la déréglementation à partir du milieu des années 1980
avec la désindexation des salaires sur les prix, la suppression de l’autorisation administrative de
licenciement, la montée des emplois atypiques et l’allègement des charges sur les bas salaires.
Malgré ces mesures, le marché du travail français reste très réglementé, notamment au niveau de
l’embauche et du licenciement, du temps de travail (loi des 35 heures), et le code du travail est
particulièrement contraignant, avec notamment des effets de seuils (10 salariés pour les délégués du
personnel ; 50 salariés pour les délégués syndicaux). On peut établir une corrélation avec un
chômage endémique et de longue durée en France. L’OCDE a souvent mis l’accent sur la
déréglementation pour restaurer le plein emploi. De plus, si on peut critiquer les conséquences
sociales de la déréglementation, le choc social lié au chômage apparait comme supérieur à celui créé
par une précarisation de l’emploi.
La déréglementation des marchés du travail semble donc avoir un effet positif sur l’emploi,
cependant, la relation est loin d’être parfaite.
Les effets positifs de la déréglementation restent limités. Elle se heurte à des contraintes
et peut même se révéler inefficace.
Les mesures de déréglementation des marchés du travail se heurtent d’abord au
fonctionnement même de ces marchés sur lesquels on constate des rigidités empêchant la flexibilité
des salaires. Les agents sont en effet amenés à limiter cette flexibilité par un comportement
rationnel. Par la théorie du salaire d’efficience, Akerlof montre que l’entreprise peut avoir intérêt à
offrir un salaire supérieur au salaire d’équilibre. En situation d’asymétrie d’information, avec un
risque d’aléa moral, l’entreprise cherche à inciter les travailleurs à être productifs, à s’investir dans
leur travail ou encore à attirer et garder les meilleurs éléments. Elle n’abaissera pas les salaires si la

conjoncture se dégrade de peur de les perdre et de les mettre à la disposition de la concurrence. En
outre, dans le cadre de la théorie insiders/outsiders, on peut aussi mesurer le pouvoir qu’ont les
insiders sur la fixation des salaires. Si l’embauche se traduit nécessairement par un coût, ce coût est
accentué par les insiders qui craignent la concurrence des outsiders, prêts à être moins bien payés.
Ainsi, une baisse du coût du travail destinée à lutter contre le chômage des jeunes, par exemple,
verra les vieux insiders réagir de façon à accroitre les coûts d’entrée et donc désinciter à l’embauche.
C’est cependant à travers l’analyse keynésienne du chômage qu’on trouve la critique la plus forte
des mesures de déréglementation.
Pour Keynes, le chômage est volontaire et il n’existe pas de marché du travail dans la mesure
où le salaire est fixé dans le cadre de négociations collectives. Les entreprises déterminent en outre
leur niveau de production indépendamment du nombre d’emplois à distribuer : la production
dépend de la demande effective et non pas du niveau des salaires. Que les salaires soient élevés ou
pas, si les entreprises ont des anticipations pessimistes sur le niveau de la demande future, elles ne
relanceront pas leur production. Keynes met ainsi en avant le rôle de la demande et du revenu. Le
salaire est un revenu nourrissant une demande et non un simple coût. Pour relancer l’activité et
donc l’emploi, il s’agit donc de relancer la demande ce qui ne peut passer par une baisse des salaires.
La diminution du salaire minimum ne fait qu’aggraver la situation et ôte du pouvoir d’achat à une
population possédant une forte propension marginale à consommer. Keynes s’oppose ainsi à Rueff,
Pigou et autres néoclassiques dans son analyse de la crise de 1929. Les keynésiens avancent comme
argument empirique le fait que pendant les 30 glorieuses le plein emploi existait parallèlement à une
forte réglementation. Plus récemment, dans le cadre de la théorie du déséquilibre, Malinvaud et
Benassy affirment l’existence d’un chômage classique lié à des contraintes pesant sur l’offre et d’un
chômage keynésien lié à une insuffisance de la demande et contre lequel la déréglementation ne
peut rien. La déréglementation n’aura pas non plus d’effet sur le chômage d’inadéquation du à des
qualifications obsolètes ou inadaptées, ni sur le chômage d’hystérèse.
La déréglementation constitue-t-elle alors une fausse solution ? Les études économétriques
sont en effet partagées sur la question. Une étude menée aux Etats-Unis sur les effets d’une
diminution du salaire minimum sur l’emploi a ainsi étonné par ses résultats allant à l’encontre de la
logique libérale : on a alors parlé du paradoxe des fast-foods. Parallèlement, si le taux de chômage
anglais a pu être inferieur à certaines périodes au taux de chômage français ou allemand, il faut
souligner les effets pervers de la politique de déréglementation menée par M. Thatcher. Avec une
baisse des bas salaires, elle a aussi désincité à la substitution capital/travail menant à une réduction
de l’investissement, obérant à long terme la compétitivité et la croissance. Une forte précarité et
des salaires faibles n’incitent pas les salaires à des efforts de productivité. De même, aux Etats-Unis,
de nombreux emplois restent précaires, mal payés comme l’atteste l’importance des working poors
et du double emploi. Et si les Etats-Unis ont vu leur taux de chômage baisser pendant les années
1980, la politique budgétaire expansionniste y a joué un rôle important.
Tout autant que des rigidités du marché du travail, le niveau de l’emploi dépend du couple
croissance/productivité (relation d’Okun). Ainsi, il s’agit, au-delà de la flexibilité quantitative externe,
de développer une flexibilité qualitative exploitant les ressources des travailleurs. Sur le long terme,
il faut construire une compétitivité qui doit s’attacher à la qualité et pas seulement au coût.
1
/
3
100%