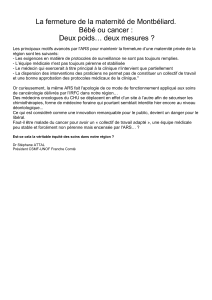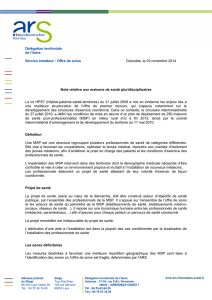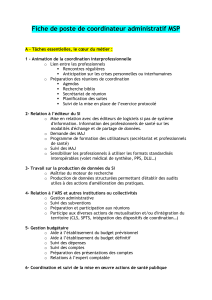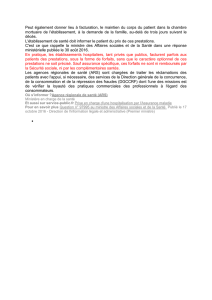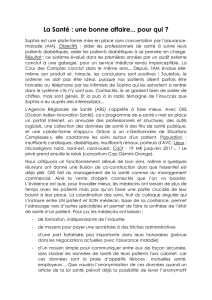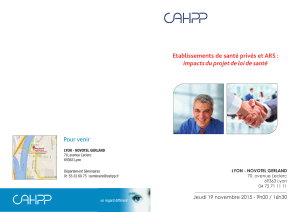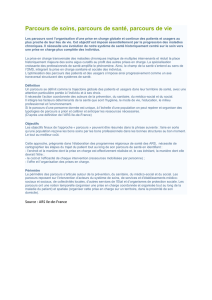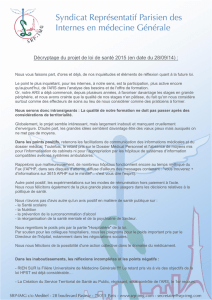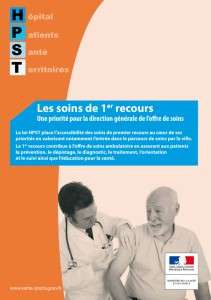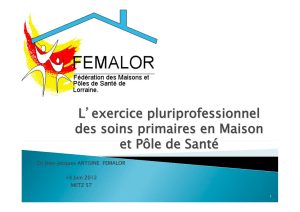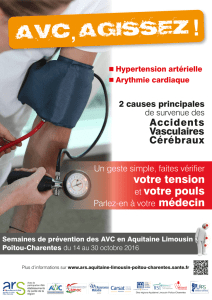Télécharger - (GCS) e

PROJET RÉGIONAL
DE SANTÉ
DE PICARDIE
2012-2017
RAPPORT
D’ÉVALUATION
INTERMÉDIAIRE décembre 2015

2 | RAPPORT D’ÉVALUATION INTERMÉDIAIRE DU PRS | ARS DE PICARDIE | 2015
sommaire
INTRODUCTION �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3
SYNTHESE ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6
SCHÉMA RÉGIONAL DE PRÉVENTION ������������������������������������������������������������������� 8
Thème : La nutrition
Action : La convention ARS, DRAAF et Rectorat sur le programme de prévention de la
nutrition du primaire au lycée
SCHÉMA RÉGIONAL DE PRÉVENTION - VAGUSAN ��������������������������������������14
Thème : Veille sanitaire et préparation aux situations exceptionnelles : animation du
réseau des acteurs de santé
Action : Signalement et réponse aux alertes sanitaires et situations exceptionnelles
SCHÉMA RÉGIONAL D’ORGANISATION DES SOINS - SROS
VOLET HOSPITALIER ���������������������������������������������������������������������������������������������������������21
Thème : Prise en charge en urgence des patients victimes d’AVC
Action : Organisation de la prise en charge en urgence : comment coordonner les acteurs
pour structurer le parcours du patient ?
Thème : Prise en charge en Chirurgie Ambulatoire avec ISIPAD 2 ������������������������������������������27
Action : Coordination des acteurs entre la ville et l’hôpital pour favoriser le
développement de la chirurgie ambulatoire
SROS - VOLET AMBULATOIRE �������������������������������������������������������������������������������������33
Thème : les réseaux de santé
Action : la politique publique conduite en termes de réseaux de santé : impact sur les
professionnels de santé et les patients
Thème : l’exercice regroupé et coordonné : les MSP ��������������������������������������������������������������������37
Action : la politique publique conduite en matière de MSP : impact sur les professionnels
de santé et les patients
SCHÉMA RÉGIONAL D’ORGANISATION MÉDICO-SOCIALE
SROMS ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������43
Thème : Coordination des acteurs sur le handicap psychique
Action : Charte de partenariat entre le Centre Hospitalier Intercommunal de Clermont et
les établissements médico-sociaux
PROGRAMME RÉGIONAL D’ACCÈS À LA PRÉCARITÉ
ET AUX SOINS - PRAPS �����������������������������������������������������������������������������������������������������48
Thème : Accès aux droits
Action 1 : Mise en place d’outils dans le cadre de la déclinaison de l’objectif 1 du PRAPS :
« Favoriser l’accès aux droits pour éviter la renonciation aux soins »
Thème : La convention ARS/DRJSCS sur l’axe de la prévention et l’accès aux soins des plus
démunis �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������54
Action 2 : Actions communes ARS, DRJSCS, DDCS pour la mise en œuvre du PRAPS
PROGRAMME RÉGIONAL DE TÉLÉMÉDECINE �����������������������������������������������58
Thème : Télémédecine
Action : Développement de la téléradiologie au bénéce des Services d’Accueil
des Urgences de la région (H 24)
DOCUMENT DE POLITIQUE TRANSVERSALE
SUR LES ADDICTIONS ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 65
Thème : Prise en charge des addictions chez les jeunes
Action 1 : Coordination régionale et territoriale par l’animatrice territoriale addiction
Thème : Prise en charge des addictions chez les jeunes �������������������������������������������������������������70
Action 2 : Conventions pluriannuelles ARS-Le Mail et ARS-ANPAA sur l’axe jeunes
GLOSSAIRE ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������75

RAPPORT D’ÉVALUATION INTERMÉDIAIRE DU PRS | ARS DE PICARDIE | 2015 | 3
introduction
REMERCIEMENTS
L’ARS remercie les acteurs associés à cette
évaluation dans le cadre des entretiens et focus
groupe : établissements de santé et médico-so-
ciaux, associations, institutions, collectivités
locales, professionnels de santé... Leurs contri-
butions ont permis de recueillir des points de
vue variés et enrichissants.
L’ARS adresse également ses remerciements
aux membres du comité de pilotage, composé
des pilotes des actions évaluées et de membres
représentant la Conférence Régionale de Santé
et de l’Autonomie1, pour le suivi des travaux
d’évaluation et leur contribution tant technique
que méthodologique.
POURQUOI UNE ÉVALUATION
INTERMÉDIAIRE : CONTEXTE,
OBJECTIFS
La loi Hôpital Patients Santé et Territoires de
2009 et son décret d’application de 2010 intro-
duisent l’obligation de suivi et d’évaluation de
la mise en œuvre du Projet Régional de Santé
(PRS). Celui-ci dénit, pour cinq ans, les objec-
tifs de l’ARS liés à ses domaines de compétences
(prévention, sanitaire et médico-social) et les
mesures à mettre en œuvre pour les atteindre.
L’évaluation nale du PRS sera réalisée en 2017.
Pour analyser les premiers résultats de
certaines actions, une évaluation intermédiaire,
prévue dans le PRS 2012-2017, a été réalisée
sur l’année 2015. Elle ne consiste pas à évaluer
l’ensemble du PRS mais cible des thèmes priori-
taires en Picardie.
L’évaluation est utile pour répondre aux enjeux
suivants :
• Donner plus de visibilité aux actions menées
dans le cadre du PRS,
• Associer/ mobiliser différents acteurs et
parties prenantes (décideurs, professionnels,
usagers...) à la dénition et à la mise en œuvre
de la politique régionale de santé dans une
perspective d’évolution,
• Mieux connaître les stratégies d’action ef-
caces, dans une optique d’amélioration et de
diffusion des bonnes pratiques,
• Réajuster et prioriser les objectifs et les
actions (poursuite ou arrêt de l’action,
déploiement...) pour le prochain PRS.
CHAMP DE L’ÉVALUATION
Le thème central de l’évaluation est la coordination des acteurs,
l conducteur de chaque action évaluée.
La coordination se traduit par un dispositif ou une forme d’or-
ganisation qui permet « d’avoir une approche pluri dimensionnelle
des problématiques (il faut considérer l’individu dans sa globalité) et
par conséquent pluri professionnelle (pour traiter les problèmes des
patients, il devient nécessaire de collaborer entre professionnels de
santé, du médico-social, de la prévention...)».2
Produit de rapports de force et d’alliances, de mobilisation d’ac-
teurs aux intérêts parfois divergents, la coordination doit être
regardée comme «un processus d’interaction sans cesse renou-
velé, constamment en train de se faire et se défaire » : « Coor-
donner dans une organisation, c’est, au sein de celle-ci, répartir
les ressources et les tâches, harmoniser les actes et orchestrer les
activités »3.
Il existe trois niveaux de coordination, pris en compte dans
l’évaluation4:
1/ Celui du patient, avec l’entourage et tous les professionnels
en charge des soins et de son accompagnement. C’est le niveau
opérationnel.
2/ Celui de la structure ou du dispositif de prise en charge (tous
les établissements et services sanitaires et médico-sociaux,
ainsi que les entités en charge de l’accueil, de l’information, de la
coordination, de l’évaluation des besoins des personnes).
3/ Celui des décideurs et/ou nanceurs du système de santé,
qu’il soit local (ville, département ou région) ou national. C’est
le niveau institutionnel.
Une absence ou insufsance de coordination peut entraîner des
difcultés:
• de prise en charge pour la population (allongement des délais,
accès aux soins...).
• d’orientation et de suivi des patients pour les professionnels de
santé (orientation vers un professionnel inadéquat, manque de
communication entre professionnels...)
• de planication des actions et de maîtrise des dépenses publiques
pour les institutions (redondance des actions...).
L’amélioration de la coordination est ainsi nécessaire pour un meil-
leur accompagnement et une meilleure prise en charge de la popu-
lation. La multiplicité d’acteurs et de partenaires avec lesquels
travaille l’ARS nécessite d’analyser les interactions an d’organiser
au mieux les prises de décision et les modalités de mise en œuvre
des actions.
1 Membres des collèges des « usagers des services de santé ou médico-sociaux », des « offreurs de santé », des « acteurs de la prévention et de l’éducation
pour la santé » et des « collectivités territoriales ».
2 Nathalie Blanchard, « Du réseau à la coordination gérontologique : un nouveau paradigme pour le secteur médico-social », Retraite et société, 2004.
3 Alsène et Pichault, « La coordination au sein des organisations : éléments de recadrage conceptuel », Gérer et comprendre, 2007
4 Marie Aline Bloch, Léonic Hénaut, Jean Claude Sardas, Sébastien Gand, « La coordination dans le champ sanitaire et médico-social. Enjeux
organisationnels et dynamiques professionnelles », 2011.

4 | RAPPORT D’ÉVALUATION INTERMÉDIAIRE DU PRS | ARS DE PICARDIE | 2015
Ainsi, les éléments analysés pour cette évaluation sont
(cf. schéma ci-contre):
• les outils et dispositifs de coordination mis en place par
les institutions et les acteurs opérationnels : convention,
groupe de travail, charte, guide ressource, che de liaison,
comité de suivi...,
• la cohérence entre les actions et les orientations des
acteurs,
• les modalités de mise en œuvre des actions.
Les actions évaluées ont été choisies par l’ARS en fonction
de leur caractère prioritaire et de leur état d’avancement :
soit dans une phase de démarrage, soit d’expérimentation,
ou mises en place depuis plusieurs années.
Thèmes et actions évalués
Coordination informelle
Relations interpersonnelles
Communication souvent orale
Coordination formalisée
Elaboration d’un langage commun
entre les institutions
Mise en place d’outils de coordination en interne
et en direction des partenaires
Coordination institutionnalisée
Mise en place de dispositifs “cadre”
(convention, charte, ...).
1
2
3
DOCUMENT DU PRS THÈME ACTION
Schéma Régional d’Organisation des
Soins (SROS) - Volet Ambulatoire
Maison de Santé
Pluriprofessionnelle
La politique publique conduite en termes de MSP:
impact sur les professionnels de santé et les patients
SROS-Volet Ambulatoire Réseaux de santé
La politique publique conduite en termes de réseaux
de santé: impact sur les professionnels de santé
(médecins généralistes) et les patients
SROS- Volet Hospitalisation Accident Vasculaire
Cérébral (AVC)
Organisation de la prise en charge en urgence (en
passant par le centre 15 ou le Service d’Accueil des
Urgences- SAU)
SROS – Volet Hospitalisation Chirurgie ambulatoire
Coordination des acteurs hôpital ville pour favoriser
le développement de la chirurgie ambulatoire dans le
cadre d’ISIPAD 2
Schéma Régional d’Organisation
Médico-Sociale (SROMS) Handicap psychique
Charte de partenariat entre le Centre Hospitalier
Interdépartemental de Clermont et les
Etablissements et Services Médico-Sociaux (ESMS)
Schéma Régional de Prévention
(SRP)- Volet relatif à la Veille, l’Alerte
et la Gestion des Urgences Sanitaires
(Vagusan)
Veille sanitaire Coordination des acteurs dans le signalement et la
réponse aux alertes sanitaires
SRP - Volet Prévention et Promotion
de la Santé Nutrition
La convention ARS/Direction Régionale de
l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt
(DRAAF)/Rectorat sur le programme de prévention
de la nutrition du primaire au lycée
Document de Politique Transversale
sur les addictions
Addictions chez les
jeunes (prévention)
Conventions pluriannuelles ARS- Le Mail –
Association Nationale de Prévention en Alcoologie
et Addictologie (ANPAA) sur l’axe jeunes
Coordination territoriale et régionale par
l’animatrice territoriale addiction
Programme Régional de
Télémédecine Télémédecine Développement de la télé radiologie au bénéce des
Services d’Accueil et d’Urgence de la région (H 24)
Programme Régional d’Accès à la
Prévention et aux Soins (PRAPS) Accès aux droits
Mise en place d’outils dans le cadre de la déclinaison
de l’objectif 1 du PRAPS «Favoriser l’accès aux
droits pour éviter la renonciation aux soins»
PRAPS
La convention ARS/
DRJSCS sur l’axe de la
prévention et l’accès aux
soins des plus démunis
Actions communes ARS, Direction Régionale de
la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale
(DRJSCS), Direction Départementale de la Cohésion
Sociale (DDCS) de la Somme pour la mise en œuvre
du PRAPS

RAPPORT D’ÉVALUATION INTERMÉDIAIRE DU PRS | ARS DE PICARDIE | 2015 | 5
Méthodes d’enquêtes utilisées pour l’évaluation des douze actions
MÉTHODOLOGIE UTILISÉE
L’évaluation intermédiaire a été réalisée par l’ARS (Direction du pilotage- Cellule stratégie).
Compte tenu de la spécicité du thème évalué (la coordination), qui est difcilement mesurable et quantiable,
les méthodes d’enquêteutilisées pour toutes les actions ont été davantage qualitatives. Elles sont particulièrement
appropriées pour obtenir des données sur ce qui est fait, la façon dont les acteurs se coordonnent, identier les leviers
et freins et les pistes d’amélioration et de déploiement des actions.
L’enquête de terraina donc été réalisée principalement grâce à des entretiens individuels et collectifs et des focus
groupe. Deux questionnaires, qui comprenaient aussi des questions ouvertes, ont été envoyés aux médecins généra-
listes pour l’évaluation des réseaux de santé et des MSP.
Les résultats sont anonymes� Seules les structures auxquelles les interviewés appartiennent sont citées.
Certains éléments communiqués par les acteurs rencontrés, étant hors du champ de l’évaluation, n’ont pas été pris
en compte dans ce rapport�
Entretiens* Focus groupe** Questionnaires Observation***
Nutrition 9 3
Accès aux droits 11 5
Convention ARS DRJSCS 3
Veille sanitaire 4
Réseaux de santé 1
MSP 11 2 1
Chirurgie
ambulatoire 3 2
AVC 5
Télémédecine 6 2
Handicap
psychique 70 0
Addiction Animatrice territoriale 4 0 0
Addiction Anpaa-Mail 5 2 1
TOTAL 64 12 2 9
* Individuels et collectifs
**Le focus groupe est un entretien de groupe (de 6 à 12 personnes)
*** Lors de groupes de travail, comités de pilotage et ateliers concernés par l’action, l’observation a complété les données recueillies dans les
enquêtes pour analyser la répartition des pouvoirs entre les acteurs, les interactions, les pratiques concrètes….
Limites méthodologiques
Les personnes consultées ne sont pas représenta-
tives de l’ensemble des personnes concernées par
l’action. Ainsi, certains constats ont fait l’objet de re-
formulations pour tenir compte de cette limite. Ce-
pendant, l’analyse des entretiens, même en nombre
limité, permet de mettre en évidence des éléments
communs ou divergents, riches d’enseignement.
Suites de l’évaluation
L’ARS s’est attachée à mentionner toutes les pistes d’amé-
lioration formulées par les acteurs interviewés. Cepen-
dant, elles ne pourront pas être nécessairement toutes
développées. La faisabilité des recommandations sera ainsi
étudiée par l’ARS, en concertation avec ses partenaires, en
fonction de critères prédénis en commun. Elles pourront
ensuite être priorisées et assorties de solutions concrètes
pour les appliquer. Il est à noter que l’évaluation intermé-
diaire pourra enrichir le cas échéant l’évaluation nale du
PRS en 2017.
introduction
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
1
/
76
100%