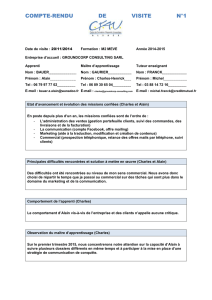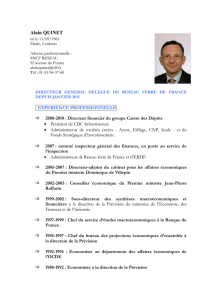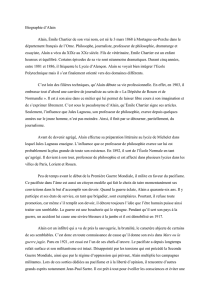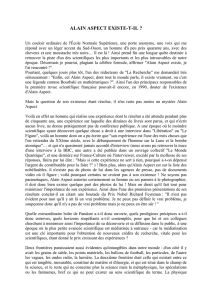l`archipel fortuné

L'ARCHIPEL FORTUNÉ
Par Lucien Fabre
NRF, septembre 1952, pp.204-230
L'honneur de compter parmi les anciens élèves d'Alain est la chose du monde la mieux
partagée, car le nombre de ceux qui y prétendent dépasse prodigieusement ce qu'un calcul
raisonnable permet d'envisager. Comme si à côté de l'espèce véritable il s'en était développé une
autre qui se reproduise par scissiparité.
Je n'ai pas été, je le confesse, dans la classe d'Alain et je confesse aussi en avoir éprouvé,
lorsque je l'eus connu, un étrange regret comme d'un bonheur manqué. Mais lui-même m'en
consola : « Ne déplorez rien, me dit-il, cela vaut mieux ainsi. Beaucoup de mes anciens élèves
me témoignent une sympathie que je leur rends bien, certes, mais il n'en est pas un qui ne
continue à me regarder malgré lui avec les yeux du disciple ; et moi-même je ne puis malgré moi
les considérer autrement qu'en professeur. Cela permet l'affection, mais empêche l'amitié
véritable. Car l'amitié a une essence propre que les souvenirs de cette sorte vicient absolument.
Quant à nous deux, nos souvenirs communs sont d'autre nature et d'ailleurs plus anciens
puisqu'ils ont vingt-cinq siècles. Notre amitié n'en est que meilleure. »
Je pensai qu'il avait raison, car je ne l'ai jamais vu se tromper en matière de psychologie
affective. Il était lui-même un ami très sûr, direct bien que d'une pudeur et d'une discrétion
parfaites - et d'une inépuisable générosité qui ne marchandait jamais les seuls biens qu'il
possédât : les richesses intérieures ; et je pense que je n'étonnerai aucun de ceux qui l'ont bien
connu en assurant que sous une écorce de rudesse voulue il défendait le coeur le plus tendre.
Ce ne fut pas le hasard qui nous présenta l'un à l'autre, mais un désir partagé. J'avais lu et
goûté ses Propos qui, après tant d'années, n'ont pas encore perdu leur parfum d'originalité et qui
paraissaient d'une saveur si exquise, d'une étrangeté sans pareille dans le conformisme de
l'après-guerre ; et lui, il avait entendu dire - et il me l'a souvent rappelé oralement et par écrit
comme une chose surprenante et d'heureux augure - que la Jeune Parque « fut connue dans les
brasseries par les récitations de Lucien Fabre et de Léon-Paul Fargue ». Il ajoutait toujours qu'il
admirait « ces belles mémoires, ayant pris dans Platon la haine des penseurs sans mémoire,
paniers percés et pleins d'oubli ».
Mais ce qui dominait en l'occurrence, c'était pour lui la certitude que la poésie ne mourrait
pas, « même sous l'empire de Mars », puisqu'elle suscitait de tels enthousiasmes ; or il aimait
avant tout la poésie où il voyait l'essence même de l'esprit. Le Paris des Lettres n'est pas un si
grand village que ne s'y retrouvent enfin ceux qui le désirent fort ; et les hommes d'une certaine
sorte y ont des compagnons qui s'entremettent pour les réunir. Le parti pris de poésie dont
nous étions animés l'un et l'autre eut tôt fait de nous des amis.
Ajoutons-y ce qu'il nommait les souvenirs de vingt-cinq siècles, ainsi que je le rappelais plus haut.
Car il se trouva que nous communiâmes en Platon dès notre première rencontre. Comme notre
hôtesse avait rejeté sur la fatalité - ou la divinité - les responsabilités de la guerre, Alain
s'exclama : « Trop facile ! Dieu est innocent, c'est Platon qui l'a dit - ou plutôt, Er l'Arménien,
quatrième livre de la République », complétai-je en souriant. Je récitai le passage en vieux français,
ce qui, et c'était bien naturel, abasourdit l'assistance, Alain le premier ; et il fallut s'expliquer.
Tout venait d'un bouquin qu'un enfant fureteur avait pêché entre cent autres au fouillis du

galetas paternel : les Dialogues dans l'antique traduction de Loys le Roy ; et les mythes, soulignés
en rouge par un bienfaisant aïeul oublié et retourné depuis des siècles à la poussière, avaient été
ainsi mon premier livre de lecture, grâce à un bienveillant hasard. Voilà notre philosophe aux
anges. Il s »écria : « Un hasard ! un hasard ! Ah ! mais non ! Je reconnais bien là notre Platon.
C'est bien de lui, cela ! Il a voulu vous avoir et, naturellement, il vous a eu, avec ses mythes : la
fable est entrée et le reste a suivi, n'est-ce pas ? » J'acquiesçai. Oui, les mythes m'avaient donné
l'appétit de lire le reste, tout le reste, à mesure que m'en apparaissait l'intelligibilité. Alain était
radieux. Vraiment comme un enfant : j'ai vu là l'enthousiasme pur, l'admiration, la ferveur de
l'homme des idées à l'égard du père des Idées. Nous nous amusâmes à dénombrer, à retrouver, à
évoquer les mythes platoniciens. Tous, je pense ou, du moins, presque tous y passèrent : ceux
de Protagoras, des cigales, de Theutès, de Gygès et du Politique, ceux des trois races d'hommes,
d'Aristophane, de la naissance d'Eros et de l'Atlantide... sans parler de l'allégorie des tonneaux
ni de celle de la caverne ni de la prosopopée des lois. Nous eûmes en même temps la nostalgie
de ce siècle et de ces lieux qu'évoquaient ces textes fameux. On imagina la palestre proche de la
fontaine de Panope, le vieux Socrate du dème d'Alopèce, accompagné de Critias et de
Charmide et de leur jeune parent Platon. Et de souvenirs en souvenirs, il fallut bien en venir à
nous découvrir tous deux également soumis au même joug léger et doré, vassaux heureux et
familiers du même grand seigneur. « Mais vous le plus ancien, dit Alain, puisque vous le
connûtes à peine sevré ! Avantage extraordinaire : la philosophie, comme les langues étrangères
et le jeu des échecs devrait s'assimiler avec le lait ; ceux-là, les rares qui ont eu la chance de le
faire, y sont les plus heureux ! Oui, les plus heureux et cela s'explique. Car quand je dis la
philosophie, il est bien entendu que je veux dire l'état d'esprit philosophique ou plus
simplement l'état philosophique : et pourquoi ne dirions-nous pas hardiment l'état d'homme ?
Or l'état d'homme postule le bonheur et la philosophie n'est que la recherche du bonheur. Je
dirais bien du vrai bonheur, suivant la vieille habitude du langage, mais j'ai horreur des
pléonasmes ! »
Ces pensées étaient fortes et de nature et parce qu'elles me prenaient par mon faible ; et elles
me ravissaient. Nous sortîmes ensemble dans la nuit, déjà amis. Il m'enviait d'avoir parcouru la
Grèce en tous sens et se montrait avide de détails comme le jeune Anacharsis. Tout d'un coup,
il s'écria en riant comme nous passions sous un lampadaire : « Et voilà que nous parlons de
Phidias, du divin Platon et de Salamine et de Marathon sous l'oeil clignotant des bleus becs de
gaz ! » Et de s'inquiéter aussitôt de savoir si Valéry, qu'il ne connaissait pas encore, aimait
Verlaine et s'il l'avait rencontré.
Je l'assurai que Valéry goûtait le génie de Verlaine encore qu'il y déplorât parfois cette sorte de
sensiblerie excessive qui est propre aux vieux pochards ; il ne l'avait vu qu'une fois dans sa vie :
c'était chez l'éditeur Léon Vannier ; et tout autour des comptoirs de cet honorable commerçant,
le poète poursuivait M. Anatole France à coups de pied au bas des reins. L'occasion de cette
justice distributive était le caricatural Choulette du Lys rouge en qui Verlaine s'était reconnu.
Alain me demanda si les coups de pied n'étaient pas une vision, poétique certes, et grandiose,
mais résolument hyperbolique. Je répondis qu'ils n'étaient qu'euphoniquement occultes et
n'avaient rien de métaphorique, Valéry y engageait sa parole et il était homme d'honneur. « Je
croyais que France savait mieux assurer ses derrières, conclut le philosophe avec humour. Mais
je ne le plains pas. Ce n'était qu'un bedeau sans générosité. Il n'était pas brave parce qu'il n'était
pas bon. Bon et brave étaient le même mot autrefois. Et généreux veut dire l'un et l'autre.
Descartes nous le rappelle opportunément. »
Nous étions sur le pont Royal qui n'était pas éclairé et le ciel resplendissait d'étoiles. Je dis à
mi-voix pour moi-même : « Nox sideribus illustrata... » Alain s'arrêta : « Que c'est beau ! Je

connais ça ! Où est-ce ? - Dans Tacite... C'est la nuit sur la mer, la nuit de l'assassinat manqué
d'Agrippine par les sicaires de Néron. » Il leva la tête : « Attendez... oui... Je me rappelle. » Nous
nous félicitâmes d'aimer tous les deux Tacite. Nous reconstituâmes la phrase et tout à coup il
me demanda de lui réciter l'invocation aux astres de la Jeune Parque : « Volontiers, lui dis-je, mais
il faut la prendre depuis le début pour lui donner tout son sens. - Bien sûr ! - Depuis le début :
Tout puissants étrangers... - Non. Le vrai début de l'invocation, c'est celui du poème lui-même : Qui
pleure là... car elle y est déjà contenue en puissance. »
Quand j'eus terminé sur le je me
sentis connue encore plus que blessée, il dit avec cette brusquerie où
il entrait comme une espèce de timidité défensive : « Admirable poème ! Oui, admirable en tous
points. Comment cela peut-il être fait ? - Avec de la patience, de la volonté et du hasard,
prétend Valéry. - Valéry s'amuse, grommela-t-il. - Question de vocabulaire, de définition,
répliquai-je conciliant : la patience peut être longue et s'appeler le génie. » Il s'arrêta, me
regarda : « Est-ce que je me trompe ? J'ai l'impression que nous sommes en train de devenir des
amis d'enfance. - Sans doute, répondis-je, la poésie n'est-elle pas un état d'enfance ? - Vous
voulez dire : de fraîcheur ? - Mieux que cela : d'antéperception : l'état de Monet ou de Van
Gogh qui voient des taches solaires et les peignent comme ils les ont senties avant d'en avoir
perçu le concret qu'elles recouvrent ; nous, au contraire, nous y percevrions les meules ou les
moissons qu'ils n'ont pas attendu d'y percevoir. - Oui, vous avez raison. Mais cela s'applique-t-il
à Valéry ? - Bien sûr ; mais au second degré ; comme votre raisonnement du bâton brisé
s'applique à Descartes. »
Nous nous quittâmes là-dessus non sans nous promettre de nous revoir. C'était une époque
heureuse ; enfin, je veux dire plus heureuse que la présente, car on y pouvait tenir table ouverte
sans être milliardaire et j'eus désormais régulièrement chez moi le philosophe avec deux
commensaux qu'il connut bientôt et qu'il en vint à préférer à tous autres, mes meilleurs amis :
Valéry et Fargue.
*
En me retournant maintenant pour considérer les moments dominants d'une vie déjà longue,
passablement aventureuse et souvent fort aventurée, ces heures passées autour d'une table avec
ces trois aînés, les trois hommes que j'ai certainement le plus aimés, m'apparaissent sans
conteste parmi les plus éblouissantes de toutes. Je ne crois pas qu'il existe une seule question
sur laquelle nous pussions nous dire tous les quatre absolument d'accord au sens précis du mot,
c'est-à-dire superposer nos convictions dans cette pleine coïncidence qui définit l'égalité des
figures géométriques. Les positions où chacun se retrouvait parfaitement établi et retranché
après l'orage de la discussion étaient toutes distinctes l'une de l'autre et même
étymologiquement isolées, mais quand on s'astreignait à faire le point de ces îles, on les
découvrait fort voisines et presque confondues dans un même archipel que le voisinage
délicieux où nous y vivions fit enfin nommer par Alain l'Archipel Fortuné.
L'entretien, faut-il le dire, était sans contrainte d'aucune sorte. Chacun savait d'avance que les
propos seraient joyeux et profitables et qu'il en resterait à chacun ce que Rabelais appelait la
moelle et Valéry l'amande. Mais il ne serait venu à aucun de nous l'idée saugrenue d'instituer un
débat sur un thème donné comme dans les entretiens du genre Pontigny alors fort à la mode ni
de préparer hypocritement une de ces improvisations chères aux salonnards de l'époque. La
bonne humeur qui va avec le génie créateur ne manquait pas, car ces trois compagnons étaient
de vrais créateurs ; et généreux - au sens de génésiques - comme le père Hugo. Sans retenue
d'ailleurs ; au point que le cher Alain, trop longtemps redingoté de kantisme, de professorat et
de radicalisme se trouvait au début assez gêné. Je le vis rougir un jour sur une phrase de Léon-

Paul Fargue et il me dit ensuite sa réprobation ; il en voulait un peu à l'auteur de Vulturne pour
ses gaudrioles, moins au père de la Jeune Parque. « Valéry est salé, me dit-il, Fargue est salace. »
Mais il se reprit vite. Il eut tôt fait de voir qu'il n'y avait dans ces éclats ni vice ni dévergondage,
seulement un débordement de puissances joyeuses. Un jour, parlant d'Alfred de Musset, Valéry
déclara : « Cette gaieté si mâle et si profonde que lorsqu'on vient d'en rire on devrait en pleurer
est une absurdité. C'est une formule de post coitum, une apparente vérité d'homme qui
passagèrement n'est plus un homme. Je ne sais pas si je me ferai exactement comprendre en la
traitant de couillonnade. » « C'est vrai ! » s'écria Alain avec une brusquerie étonnante et comme
illuminée. Fargue qui flairait son vin selon ses rites coutumiers en encensant du nez vers les
quatre points cardinaux souligna la surprise de tous : « Vous revenez de loin, Alain ! » Quelques
jours après, rappelant l'incident, il me dit : « Drôle de type, cet Alain ! Costaud, viril en diable,
tendre honteux, porté sur la bagatelle... et rougissant ! Rougissant, as-tu idée de ça !... » Il
réfléchit profondément, conclut de cet air grave du plongeur qui a exploré le noir des choses :
« Et avec cette magnifique tête ! Quand il hennit, il a l'air d'un pénis de cheval ! »
Fargue était trop satisfait de son mot pour ne pas le répéter à Valéry qui trouva la
ressemblance aussi indiscutable qu'incompréhensible et même inconcevable et en rit beaucoup.
Mais il hasarda cependant une hypothèse : « Si le cheval était Pégase se ruant sur la muse, car le
poète monte Pégase, mais Pégase, qui montera-t-il ? »
Les propos, comme on le voit, étaient parfois relevés, mais la matière en un autre sens, ne
l'était pas moins. Et on convint que peu d'hommes savaient comme ce philosophe connaître,
aimer et honorer la poésie. L'idée que le passage dialectique dans Hegel se faisait toujours par
un mouvement poétique, idée qu'Alain aimait parce qu'elle le comblait, le rassurait et le
justifiait, nous avait paru tellement naturelle le jour où il l'avait exprimée que nous nous étions
regardés avec un étonnement qui ne lui échappa pas : « Voilà bien les poètes ! » dit-il, non sans
un soupçon de rancoeur. Or il n'était pas susceptible ni rancunier, du moins avec nous, et il
savait que nous l'aimions bien. Il fallait donc que quelque chose nous eût échappé ; quoi ? Alain
parti, nous unîmes nos lumières, mais en vain. Qu'un passage de dialectique créatrice se fît
toujours par un mouvement poétique continuait à nous paraître évident. Valéry en revenait à
son thème favori du poïein créateur et Fargue à sa division classique entre les indigènes de
Pouasie et de Papouasie. « Alain est de Papouasie, mais aime les Pouètes. C'est un Montaigu
amoureux d'une Capulet. Mais Roméo et Juliette ne se comprendront tout à fait bien entre eux
qu'une fois morts. »
C'était injuste. Non seulement Alain comprenait parfaitement la poésie, mais il manifestait
dans sa révérence aux poètes une sincérité et un élan qui touchaient. J'en eus la preuve le jour
où, à force de patience et de ménagements, j'obtins de lui l'explication de l'incident hégélien.
Elle était simple. Il s'était senti humilié d'avoir découvert l'Amérique devant des Américains,
certes, mais plus encore de s'être en même temps imaginé, et paradoxalement, qu'il faisait de la
poésie essentielle sinon formelle en philosophant ; il s'était aperçu ou avait cru s'apercevoir
devant l'attitude de nos deux amis qu'entre le mouvement poétique, impulsion, qui était son lot,
et la poésie proprement dite, réalisation achevée, qui était le leur, ils ne voyaient aucune
commune mesure, mais la même disparité de nature qu'entre un hippocampe et un cheval. Il
ajouta avec une modestie attendrissante chez ce grand esprit que, tout bien considéré, ils
avaient raison : « C'est bien de poïein qu'il s'agit. Ce sont eux les gens du poïein, les poètes, les
artisans véritables de la chose ; et les artisans ont toujours raison. »
Je discutai avec lui de ces scrupules, assez ému ; et, ses propres textes en main, je parvins à le
convaincre qu'il se mettait à tort, lui seul et de lui-même à l'écart. Les deux poètes discrètement
prévenus et morigénés surent par des « Nous autres » prononcés à propos et qui l'englobaient

sans ostentation, l'agréger de nouveau à l'archipel. Il reprit confiance et m'en sut un gré qui
affermit et développa notre amitié. Il fut si bien guéri que, peu de temps après, il m'adressait
quelques textes avec un billet d'une triomphante brièveté : « Mon cher poète, voici des abrégés de
poèmes qui vous donneront à penser. Bien amicalement, Alain. » On les retrouvera dans les Saisons de
l'Esprit. Je les lus à nos deux amis. Les Cloches avec son début étonnant : « La cloche est une
invention parfaite comme sont le violon, la faux, le chat... » et sa fin non moins frappante : « (ce
frère) qui rirait de nous peut-être s'il nous voyait appliqués à ne pas croire que la Vierge existe et
que les cloches voyagent dans le ciel : Ne pas croire, dirait-il, mais c'est donc que vous le croyez ? » ; le
Cormoran : « Quand le brassage d'équinoxe traîne sa rumeur de plage en plage et le long de
l'estuaire, on retrouve la nature sans l'homme et les pas de la création ; chaque chose se tourne
alors selon les autres et la nécessité de chaque forme se montre. La houle attaque le banc de
sable ; on croirait qu'elle va le reculer ou le diminuer ou l'aplanir ; mais c'est qu'on n'a pas bien
remarqué le moment où la vague porteuse de sable dépose son fardeau ; c'est justement sur ce
dos rond où elle est ralentie, où elle s'aplatit, où elle rampe... Sur cet ordre restauré, sur cet
ordre sauvage paraît le cormoran, qui est une sorte de pélican, que vous voyez une fois nageant
comme un cygne noir à gros bec, une autre fois s'élevant en l'air appuyé sur ses ailes coudées et
ramant contre le vent. Est-il croyable que cette forme soit autre chose qu'un pli noir de la
nature comme sont vagues et nuages, et seulement un peu plus durable ?... Je voudrais exercer
un mouvement aussi pur et aussi vrai que ce vol d'oiseau. Car il ne se trompe pas d'un fil d'air.
Si je pensais comme tu voles, ô cormoran ! » ; les Dieux agrestes : « Un chemin ; la haie aux
mûres ; les ornières, marque de l'homme et mesure de l'invariable charrette... » ; ce furent les
trois qui remportèrent la palme et, à la première rencontre, les poètes en firent grand
compliment au philosophe qui ne s'y attendait pas et fut heureux.
*
Ainsi se resserraient nos liens avec cet homme exquis, cet esprit sans pareil, cet ami
incomparable. Lors de nos premières réunions, c'est lui qui se retirait d'abord, Valéry partait
ensuite, Fargue ne partait jamais ; il était chez lui partout, comme de juste, ce privilège lui étant
bien dû ; mais plus particulièrement chez moi (moins toutefois, je crois, que chez André
Beucler). Il traînait dans l'appartement, lisotait, rêvassait, téléphonait, somnolait dans un fauteuil
et, vers le soir, s'établissait solidement sur un divan pour y passer la nuit ; au matin, il n'était
plus là, il avait levé le camp sur le minuit.
Mais il était parti en esprit beaucoup plus tôt, presque en même temps que Valéry. Quand
Alain prit l'habitude de demeurer après le poète, Léon-Paul ne nous gêna guère ; il feignait un
désintéressement total à l'égard de ce et de ceux qui nous occupaient : les thèses et les
personnes de Spinoza, Descartes, Hamelin, Jules Lagneau et de quelques autres originaux du
même genre qu'il nommait des olibrius. Je voulus le forcer à rester avec nous et lâchai Alain sur
des romanciers et des poètes, Baudelaire, Mallarmé, Balzac, Stendhal, surtout Dickens dont il
parlait mieux que personne. Mais après quelques boutades, Fargue, allumant une black-cat,
s'évadait vers le téléphone pour y gourmander des « roucoulantes » tout en gardant un oeil
oblique sur Alain : « Je suis bien chez la duchesse de... ? » ; ou il rentrait dans les rêves éveillés
de son monde imaginaire, sur le divan. Ce fut un de ces jours qu'après s'être plaint des femmes
du demi-monde, il conclut : « Depuis, j'ai connu, hélas ! les femmes du monde... » Il l'imprima
plus tard et la phrase eut le succès que son originalité lui méritait. Mais ce jour-là, dans sa verte
nouveauté, elle ne parut pas faire la moindre impression sur Alain ; c'est qu'il les connaissait
depuis son enfance, lui, les femmes du monde : la duchesse de Maufrigneuse et Mme de
Mortsauf, la duchesse de Sanseverina et Mme de Rénal ; les vraies ; celles dont se servent Balzac
et Stendhal « pour soulever le monde, comme il disait, ce monde qui sans cela est inerte et
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
1
/
13
100%