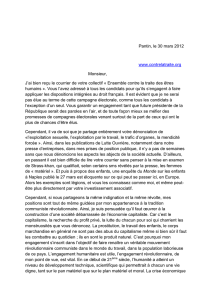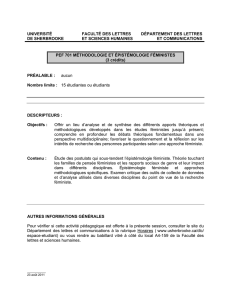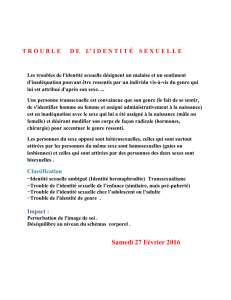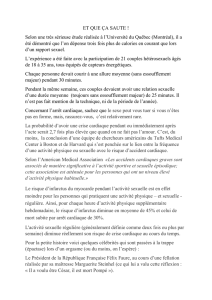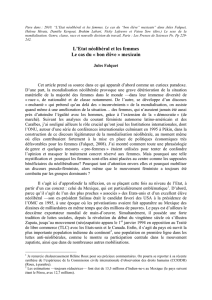Trois questions aux mouvements sociaux “progressistes” Apports de

Paru en français dans Nouvelles Questions Féministes, Vol. 24, n°3-2005. pp 18-35
Trois questions aux mouvements sociaux “progressistes”
Apports de la théorie féministe à l’analyse des mouvements sociaux
Jules Falquet1
C’est à la fois comme sociologue féministe et comme sympathisante ou militante de
différents mouvements sociaux des deux côtés de l’Atlantique, que je voudrais partager les
réflexions suivantes, ébauchées dans plusieurs travaux précédents sur différents
mouvements sociaux réputés particulièrement “progressistes”.
Du côté des mouvements assez classiquement “redistributifs”, pour reprendre la
distinction établie notamment par Nancy Fraser (1997), j’interrogerai trois mouvements
particulièrement significatifs par leur massivité, leur durée (plus de vingt ans) et leur fort
écho international. La guérilla du Front Farabundo Marti de Libération Nationale (FMLN),
au Salvador, a cristallisé l’un des principaux projet révolutionnaire et anti-impérialiste
latino-américain des années 80. Le mouvement zapatiste, autour de l’Armée Zapatiste de
Libération Nationale (EZLN), au Mexique, a joué un grand rôle dans le déclenchement de
l’actuelle résistance à la mondialisation néolibérale. Enfin, le Mouvement des Sans terre
(MST), au Brésil, constitue une référence de lutte paysanne pour la terre et fait également
partie des piliers de la lutte contre le néolibéralisme. Ces trois mouvements se basent sur
une analyse globale du système et luttent pour des changements profonds, qu’autrefois on
appellait révolutionnaires. Ils combattent très officiellement le capitalisme, l’un d’entre eux
dénonce le racisme dont les populations indiennes font l’objet (l’EZLN). En revanche, face
au sexisme, aucun de ces mouvements n’a réussi à dépasser les déclarations de principes.
Or, personne ne semble s’en inquiéter : ni les militant-e-s, ni les sociologues (ni les autres
intellectuel-le-s militant-e-s ou non) ne sont parvenu-e-s jusqu’à aujourd’hui à analyser
sérieusement et systématiquement cet état de fait, qui représente pourtant une contradiction
de taille pour ces mouvements emblématiques d’une transformation sociale radicale.
Pourtant, les instruments d’analyse existent. Ils ont été forgés dans la pratique même
d’autres mouvements sociaux, notamment dans les mouvements féministes, puis polis au
cours des années jusqu’à devenir théorie féministe, sociologie, science politique, économie,
anthropologie. Ils permettent notamment de poser les deux questions de la division sexuelle
du travail et du type de structures familiales sur lesquelles ces mouvements s’appuient et
1 Je remercie chaleureusement Ochy Curiel pour les longues discussions que nous avons eues sur les
questions de l’idendité et pour ses précieux commentaires sur ce travail.
Une première version de ce travail a été présentée lors du Vème congrès d’anthropologie du Mercosur, réalisé
en novembre 2003 à l’Université Fédérale de Santa Catarina, Florianópolis, Brésil.

qu’ils proposent dans leur projet de société, et de ce qu’il en ressort pour les femmes,
comme nous le verrons dans les deux premières parties de cet article.
Nous interrogerons ensuite l’autre versant des mouvements progressistes, qui
possède des dimensions “identitaires” et “culturelles” plus que “redistributives”. En effet, le
mouvement des femmes et des féministes noires et les mouvements mixtes (indiens ou
noirs) de lutte contre le racisme en Amérique latine et dans les Caraïbes, dans leur mise en
avant de “cultures” et d’ “identités” particulières, négligent souvent la question des rapports
sociaux de sexes. De leur côté, les mouvements féministes et lesbiens des deux côtés de
l’Atlantique apportent une importante réflexion critique, justement, sur la culture, mais
cette réflexion n’est pas toujours exempte de racisme ou d’ethnocentrisme. Cette troisième
question de “quelle “culture” est mise en avant” par les différents mouvements sociaux est
d’autant plus brûlante qu’aujourd’hui, migrations et mondialisation bouleversent nos
horizons et nous confrontent d’un côté, à un impérialisme culturel toujours plus brutal, et de
l’autre, à un “différentialisme” particulièrement pervers, qui tous deux s’opposent à l’espoir
de partager et d’hybrider “par le bas” le meilleur de nos différents héritages.
1. Division sexuelle du travail et processus de production d’une révolution
A. Analyses classiques de la participation des Salvadoriennes
Organisation marxiste-léniniste fortement influencée par la Théologie de la
libération, le FMLN, né au Salvador en 1980, fédérait un projet révolutionnaire national.
De ce fait, il offre non seulement les caractéristiques “optimales” d’un mouvement social
(forte participation, grande portée sociale, longue durée), mais présente en plus un mode
d’organisation bien plus “dense” que la plupart des mouvements sociaux et un projet
beaucoup plus défini : la prise du pouvoir central de l’Etat et la mise en place d’une
alternative sociale pour l’ensemble de la population. Mais son caractère révolutionnaire et
la longue guerre civile (12 ans) qu’il a entraînée ont brouillé la réflexion. En effet,
comment analyser sereinement un mouvement porteur d’espoirs aussi globaux, surtout
quand la brutalité exceptionnelle de la guerre et de la répression forçait en quelque sorte,
sinon la sympathie, du moins le respect ?
Or, ce sont précisément le caractère révolutionnaire du projet du FMLN et les
sacrifices qui ont été faits pour cet idéal, qui justifient que les militant-e-s luttent de
l’intérieur pour une réelle adéquation entre le discours et la pratique. Et c’est aussi ce qui
autorise —oblige?— les analystes à exercer toute leur lucidité dans leur réflexion sur ce
type de mouvements. Je reprendrai ici les principaux éléments d’une réflexion que j’ai
menée sur la “division sexuelle du travail révolutionnaire” (Falquet, 2003).
La participation des femmes au projet révolutionnaire était considérable : un tiers
des forces directement politico-militaires (guérillères) et souvent la majorité dans les
organisations civiles. Cette forte participation n’avait rien de “naturel” : les femmes ont
d’abord dû lutter pour gagner le “droit” de participer, surtout les femmes d’origine rurale et
populaire, puis pour rendre visible cette participation. Leur présence et leur engagement ont

ensuite été mis en avant pour gagner la sympathie de l’opinion publique nationale et
internationale, et présentés comme une avancée sociale et politique, une victoire, une
transformation objective de la situation des femmes —le reste étant censé advenir avec
l’achèvement de la révolution. Cette ligne d’analyse a dominé pendant de nombreuses
années, appuyée sur les intérêts du FMLN et la sensibilité marxiste classique. Tous les
témoignages de l’époque, publiés avec l’imprimatur du FMLN, soulignaient cette
participation comme une avancée et l’importance de forger une “Femme nouvelle” en
même temps que l’ “Homme nouveau”, le guérillero héroïque et rédempteur sur qui repose
la révolution (Alegría, Flakoll, 1987 ; Carter, Loeb, 1989 ; Guirola de Herrera, 1983 ;
Thomson, 1986).
Il faut attendre pratiquement la fin de la guerre pour trouver des analyses différentes
et un tant soit peu critiques, produites collectivement au sein du mouvement féministe qui
se développe alors avec vigueur. Le groupe des Mujeres por la Dignidad y la Vida, parmi
lesquelles on compte beaucoup d’ex - combattantes, se lance dans une analyse du vécu des
femmes pendant la guerre. Elles travaillent notamment sur les implications du fait que les
ex - guérillères ont dû laisser leurs enfants pour participer à la révolution (MDV, 1993),
tout en réalisant un processus de thérapie collective plus large entre ex - guérillères avec
l’aide de psychologues féministes. Il en sort une publication, “La douleur invisible de la
guerre”, qui montre comment, pendant toute la guerre, les femmes ont dû assumer le travail
de deuil et de soutien émotionnel aux tiers, et comment simultanément elles ont dû se faire
“fortes” et “dures” pour pouvoir survivre sur les fronts de guerre et face à la répression
(Garaízabal, Vásquez, 1994).
Mais une fois énoncé que les femmes ont accédé à de “nouveaux rôles” ou à de
“nouvelles identités” pendant la guerre, aucune de ces analyses —marxistes classiques ou
plus féministes— ne permet de comprendre ce qu’il advient de ces “nouvelles identités”
une fois la guerre terminée et moins encore pourquoi les rapports sociaux de sexes ont
finalement si peu changé malgré douze ans de guerre et vingt ans de processus
révolutionnaire (MDV, 1995; Navas Turcios, 1995).
B. Apports de la sociologie féministe : analyse de la division sexuelle du travail
révolutionnaire
Pour trouver une explication plus satisfaisante, il fallait “désacraliser” le processus
révolutionnaire et ôter à la guerre son halo de période exceptionnelle, pour leur appliquer
les outils sociologiques développés pour les temps de paix. Sans vouloir trivialiser la lutte
des révolutionnaires salvadoriennes, qui mérite le plus grand respect, il faut reconnaître que
le processus révolutionnaire salvadorien ne fut pas seulement une geste héroïque, mais un
long, patient, complexe et contradictoire processus de construction organisationnelle et
politique (de réseaux d’approvisionnement, de persuasion idéologique, etc). En d’autres
termes, un travail de production d’un processus révolutionnaire : c’est donc ainsi qu’on
doit l’analyser.

A l’intersection de l’anthropologie, de la sociologie et de la théorie féministe, le
concept de division sexuelle du travail nous fournit un outil particulièrement important pour
cela. La sociologue du travail française Danièle Kergoat la définit comme “la forme de
division du travail social qui découle des rapports sociaux de sexes, historiquement et
socialement modulée. Elle a pour caractéristique l’assignation prioritaire des hommes à la
sphère productive et des femmes à la sphère reproductive, ainsi que, simultanément, la
captation par les hommes des fonctions possédant une forte valeur sociale ajoutée
(politiques, religieuses, militaires, etc).” (Kergoat, 2000). La division sexuelle du travail “a
deux principes organisateurs : le principe de séparation (il y a des travaux d’hommes et
des travaux de femmes) et le principe hiérarchique (un travail d’homme “vaut” plus qu’un
travail de femme).” (idem).
Quand on observe avec cet outil le procesus révolutionnaire salvadorien, et en
particulier le fonctionnement du FMLN, on voit mieux à quel point la division sexuelle du
travail des temps de paix a été reconduite, quasi intacte, dans les fronts de guerre et au sein
des organisations révolutionnaires.
Par rapport au type de travail réalisé selon le sexe et aux conditions de travail, on
observe de nombreuses ressemblances. On constate d’abord une ségrégation de la plupart
des femmes dans un nombre réduit d’activités : cuisine2, santé, communication et
éducation. Comme dans la vie civile, les femmes occupèrent majoritairement des positions
subordonnées, tandis que les hommes étaient généralement leurs supérieurs. Hommes et
femmes accomplirent des tâches monotones et parcellisées, mais pour ce qui est du travail
dangereux, contrairement à ce que l’on pourrait penser, les femmes n’étaient pas en reste,
notamment dans la fabrication de mines “maison” et le renseignement. De plus, alors
qu’elle étaient en situation d’égal danger, elles avaient moins accès aux armes, ce qui leur
imposait une plus grande vulnérabilité. Par ailleurs, les femmes étaient en situation de plus
grande précarité que les hommes : leur incorporation était plus difficile et souvent plus
partielle (jalousie du mari, enfants à nourrir), lorsqu’elles interrompaient leur participation
(pour cause de maternité plus ou moins volontaire), elles perdaient souvent leur rang
militaire et leurs “contrats” furent toujours moins clairs que ceux de leurs camarades
masculins (leur appartenance à l’organisation étant souvent “privatisée” par le biais des
liens familiaux ou amoureux qui les unissait aux guérilleros). Finalement, les femmes
durent aussi affronter le harcèlement sexuel, la violence et le viol exercés par leurs
camarades et supérieurs (MDV, 1995).
Pour ce qui est de la reconnaissance et de la rétribution de leur travail
révolutionnaire, les ressemblances sont aussi frappantes. Les qualifications des femmes
n’étaient pas reconnues comme telles, mais vues comme des “dons naturels” (savoir
cuisiner ou prendre soin des blessés). Quand des femmes commençaient à occuper certaines
fonctions, ces fonctions perdaient de la valeur (quand une femme était nommée chef de
front, le parti commençait souvent à accorder moins d’attention à ce front), tandis que
quand une tâche devenait plus technique, elle avait tendance à se masculiniser (quand les
organisations devinrent non seulement politiques mais militaires, plus aucune femme ne fut
nommée commandante). Comme dans la vie civile, le travail réalisé par des femmes fut
2 29% des démobilisées affirment que leur activité pendant la guerre était : “cuisinière” (Falquet, 2003)

rendu invisible ou minimisé. Parfois, il n’était même pas considéré comme du travail (ni les
heures passées auprès des hamacs des malades, ni les sacs à dos cousus nuitamment, ni la
“douleur invisible” du deuil évoquée plus haut, ni le plaisir sexuel et l’appui émotionnel
qu’elles fournirent à leurs compagnons, parfois sans aucune réciprocité). Les rétributions,
matérielles et symboliques, reflétèrent la faible reconnaissance de leur travail : les femmes
reçurent moins de promotions que les hommes, furent moins souvent reconnues et honorées
comme héroïnes et reçurent moins d’appui de leur organisation pour se réinsérer dans la vie
civile après la guerre (notamment dans leurs “retrouvailles” avec leurs enfants, pour l’accès
à la terre et à des crédits, tout comme elles obtinrent moins de sièges à l’assemblée
nationale). Non seulement les femmes ne furent guère rétribuées pour leur participation,
mais bien souvent ce furent elles qui financèrent la guerre : de très nombreuses
organisations civiles de femmes apportaient volontairement (et d’autres fois sans le savoir)
leurs ressources et leurs budgets au FMLN (MDV, 1993 b).
Troisième point : la majeure partie des femmes ont été des travailleuses de la
révolution marginalisées par rapport à leurs compagnons. Il leur était généralement exigé
de “concilier” travail révolutionnaire et responsabilités familiales —ce que l’on demanda à
très peu d’hommes. Des efforts furent réalisés pour décharger les mères des soins aux
enfants, mais ils furent globalement insuffisants et souvent “privatisés” dans le sens où les
enfants étaient placés à la charge des mères des combattantes. Personne ne songea à les
soulager systématiquement les femmes des soins aux personnes âgées ou aux infirmes.
Elles durent souvent choisir entre leur relation amoureuse ou matrimoniale et leur
développement politique à mesure qu’elles occupaient de plus grandes responsabilités : au
contraire des dirigeants masculins, beaucoup de femmes commandantes vécurent très
seules (Harnecker, 1994)3. Par ailleurs, elles furent moins protégées face aux “risques du
métier” —or, la répression et la torture étaient éminemment sexués et l’armée s’acharna à
dessein sur les femmes. Si davantage d’hommes que de femmes perdirent la vie dans la
lutte, symétriquement ce sont majoritairement des femmes qui se retrouvèrent veuves ou
orphelines, à charge de familles traumatisées et sans ressources. Simultanément, ce furent
majoritairement des femmes (mères, épouses et filles), qui furent chargées du travail d’aide
aux personnes emprisonnées, de recherche des disparu-e-s et de lutte pour les droits de la
personne, dans ce qu’on pourrait, ici encore, qualifier de “privatisation” de ce travail.
Bien sûr, il faudrait développer bien davantage cet exemple salvadorien, en
rappellant notamment que la situation des femmes et des hommes variait énormémement
selon leurs origines de classe. Cependant, on voit qu’une analyse en termes de division
sexuelle du travail permet de comprendre “l’incompréhensible” : si la situation des femmes
salvadoriennes a si peu évolué, c’est bien parce que le mouvement social qui prétendait la
transformer, était basé sur le maintien de rapports sociaux de sexes très traditionnels, et plus
particulièrement sur une division sexuelle du travail on ne peut plus classique.
2. L’oppression des femmes dans la famille : un impensé pour beaucoup de
mouvements sociaux
3 Pour autant que nous le sachions, les relations lesbiennes, extrêmement tabou, ne constituèrent pas une
alternative pour les militantes du FMLN.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
1
/
17
100%