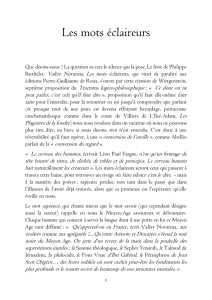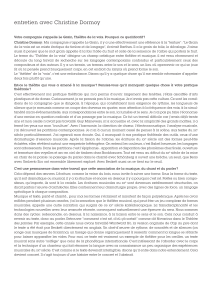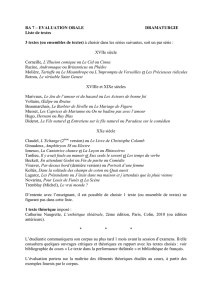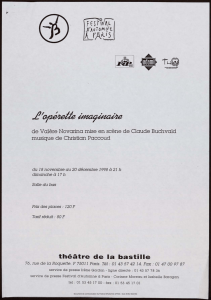Valère Novarina

SOMMAIRE N°176 DÉCEMBRE 2014
VALÈRE NOVARINA
DENIS GUÉNOUN
Avant-propos 3
OLIVIER DUBOUCLEZ ET ALISON JAMES
Valère Novarina : une poétique théologique. Introduction 5
VALÈRE NOVARINA
« Une sphère infinie dont le centre est partout, la circonférence nulle
part. » Entretien réalisé par Olivier Dubouclez 11
AMADOR VEGA
Valère Novarina : une théologie de la brèche 26
CHRISTINE RAMAT
La théomania comique de Valère Novarina 37
NATHALIE DUPONT
Valère Novarina – opus incertum 47
LEIGH ALLEN
Le rituel de la (s)cène dans quelques pièces de Valère Novarina 57
FLORE GARCIN-MARROU
La mise en scène de l’état de grâce dans le théâtre de Valère Novarina
67
ISABELLE BARBÉRIS
Histrions novariniens : performer dans l’absence de dieu 77
ÉVELYNE GROSSMAN
Artovarina : un théâtre résurrectionnel 88
JOHN IRELAND
Terreur et théologie : Paulhan, Scarry, Novarina 97
ALISON JAMES
Distension et dispersion : temporalités dans le théâtre de V. Novarina 108
OLIVIER DUBOUCLEZ
Comment finir ou la prière faite au théâtre (Novarina et Augustin) 119
NOTE DE LECTURE
“Litterature_176” (Col. : RevueLitterature) — 2014/11/17 — 11:13 — page 1 — #1
✐
✐
✐
✐
✐
✐
✐
✐

VALÈRE NOVARINA
NUMÉROS À PARAÎTRE
Baudelaire – Écrire en contrepoint – Aristote
NUMÉROS DÉJÀ PARUS
133. DANTE L’ART ET LA MÉMOIRE
134. GEORGE SAND, « LE GÉNIE NARRATIF »
135. FRACTURES, LIGATURES
136. MONTRER N’EST PAS DIRE
137. LA SINGULARITÉ D’ÉCRIRE – AUX XVIe-XVIIIeSIÈCLES
138. THÉÂTRE : LE RETOUR DU TEXTE ?
139. MARGES
140. ANALYSE DU DISCOURS ET SOCIOCRITIQUE
141. CHARLES DU BOS
142. LA DIFFÉRENCE SEXUELLE EN TOUS GENRES
143. FIGURATIONS
144. ET LA CRITIQUE AMÉRICAINE ?
145. L’EMBLÈME LITTÉRAIRE : THÉORIES ET PRATIQUES
146. ALBERT THIBAUDET
147. L’ESPACE DU SIGNE
148. LE MOYEN ÂGE CONTEMPORAIN. PERSPECTIVES CRITIQUES
149. LA RHÉTORIQUE ET LES AUTRES
150. YVES BONNEFOY. TRADUCTION ET CRITIQUE POÉTIQUE
151. FICTIONS CONTEMPORAINES
152. GEORGES BATAILLE ÉCRIVAIN
153. NARRATIONS
154. PASSAGES. ÉCRITURES FRANCOPHONES, THÉORIES POSTCOLONIALES
155. SÉPARATION, RÉPARATION
156. EFFACEMENT DE LA POÉSIE ?
157. EMPREINTE, THÉÂTRALITÉS
158. NERVAL
159. ÉCRIRE L’HISTOIRE
160. LA LITTÉRATURE EXPOSÉE
161. JEAN STAROBINSKI
162. VOIX PLURIELLES
163. RECHERCHES SÉMIOTIQUES
164. JEAN-PIERRE RICHARD
166. USAGE DU DOCUMENT EN LITTÉRATURE. PRODUCTION, APPROPRIATION,
INTERPRÉTATION
167. SAMUEL BECKETT
168. ARTS DE LECTURE
169. LUMIÈRES DU BIZARRE. BIZARRE ET BIZARRERIE AU XVIIIeSIÈCLE
170. ROGER CAILLOIS
171. DIDEROT ET LE ROMAN
172. VALÉRY, EN THÉORIE
173. TOURS ET RETOURS
174. ÉDOUARD GLISSANT. LA PENSÉE DU DÉTOUR
175. ARTIFICES DE MÉMOIRE
2
LITTÉRATURE
N° 176 – DÉCEMBRE 2014
“Litterature_176” (Col. : RevueLitterature) — 2014/11/17 — 11:13 — page 2 — #2
✐
✐
✐
✐
✐
✐
✐
✐

DENIS GUÉNOUN, UNIVERSITÉ PARIS-SORBONNE, PARIS IV
Avant-propos
Dans l’œuvre de Valère Novarina, il est possible de distinguer deux
grands groupes de livres – distinction non exhaustive. D’une part, les écrits
poétiques et dramatiques, plus ou moins conçus en vue d’une présentation
théâtrale (avec toute la singularité du théâtre novarinien). D’autre part,
des ouvrages théoriques, plutôt pensés comme essais, qui n’appellent pas
directement la mise en scène (même si certains l’ont provoquée). Division
dont Novarina use lui-même en parlant de son travail. Mais il apparaît vite
que le clivage n’est pas net. D’abord, les propos de théorie sont puissamment
poétiques, et plus d’une fois dramatisés. Novarina théorise en poète, et
ce n’est pas affaire de présentation : l’énonciation des thèses, leurs liens,
leur sémantique comme leur syntaxe, au bout du compte toute l’activité de
penser s’y trouvent impliqués. Et par ailleurs, le théâtre de Novarina est
théorique de bout en bout. Tout ce qu’il manigance pour la scène peut être
lu comme jeu de propositions réflexives. En de multiples sens : parce que
cela regorge d’énoncés spéculatifs, généraux ou particuliers, d’affirmations
philosophiques. Et aussi parce que l’œuvre scénique s’avance dans une sorte
de second degré – ce qui ne la prive pas d’une force élémentaire –, proposant
une pensée en action et en espace, mais qui se voit toujours faire, et s’évalue,
se commente, faisant rarement entrer un personnage sans considérer qu’il
entre, ne livrant une action quelconque que dans l’annonce, l’interprétation,
la pensée du mode dans lequel elle se livre. Donc, poésie dramatique et
poème théorique sont tressés l’un dans l’autre, il n’est pas facile de les
démêler.
C’est une des raisons qui rendent l’activité théologique de Novarina
si singulière. Elle s’énonce, comme toute théorie dans cette œuvre, sur
un mode lyrique, ou anti-lyrique, souvent jetée dans le feu du jeu. De
sorte qu’il est difficile de démêler la théo- ou christo- logies novariniennes
de la vie de ses créatures étranges, qui la donnent à entendre par leur
incorporation multiple. Novarina pense le divin, et le rapport au divin, sur
le mode du poème en travail. On pourrait plaider que le vocable Dieu ne
peut s’y entendre que poétiquement : faute de ce transport poétique, le
mot est imprononçable, essentiellement inaudible (ce qui est une thèse).
Cela ne renvoie pas le terme, ni ce qu’il évoque, au statut d’image ou de
métaphore : les métaphores novariniennes sont toujours saisies (au sens
culinaire) dans une cuisante littéralité. Poétiques, à ce titre. Et par là très
fidèles à l’héritage du discours biblique – entre autres. L’action qui s’y
expose, même profane, même laïque, engage toujours un drame de la vie, au
rticle on line
rticle on line
3
LITTÉRATURE
N° 176 – DÉCEMBRE 2014
“Litterature_176” (Col. : RevueLitterature) — 2014/11/17 — 11:13 — page 3 — #3
✐
✐
✐
✐
✐
✐
✐
✐

VALÈRE NOVARINA
sens mystique qu’assume tout vivant : la vie n’est dramatique que comme
épreuve spirituelle. Et cela se concentre dans la théorie, que pour cette
œuvre on osera dire cruciale, du comique. Le programme novarinien s’est
très tôt exposé comme fusion du comique et de la sainteté. De Funès en est
l’emblème. On peut s’émerveiller, tout de même. Que le comique soit saint,
c’est déjà bien beau. Mais que la sainteté s’avance toujours comme cocasse,
c’est le meilleur de l’athéologie novarinienne.
Ce pourquoi l’effraction théologique est, dans ces livres, si roborative :
pour la pensée en général, et pour le transcendant. Elle fragmente toute
l’œuvre en éclats – de lumière, et de rire.
4
LITTÉRATURE
N° 176 – DÉCEMBRE 2014
“Litterature_176” (Col. : RevueLitterature) — 2014/11/17 — 11:13 — page 4 — #4
✐
✐
✐
✐
✐
✐
✐
✐

OLIVIER DUBOUCLEZ ET ALISON JAMES
Valère Novarina :
une poétique théologique.
Introduction
« La théologie et la poésie peuvent être dites une seule et même chose,
ayant un seul objet, et je dis même plus que la théologie n’est autre chose
qu’une poésie de Dieu. Car qu’est-ce d’autre qu’une fiction poétique, dans
l’Écriture, que de dire du Christ qu’il est lion, agneau, ver de terre, ou
encore dragon, ou encore pierre, ou encore bien d’autres choses, dont la
liste serait beaucoup trop longue ? »
BOCCACE, Petit traité en l’honneur de Dante1.
Si Valère Novarina est un auteur incontournable dans le paysage
littéraire contemporain, c’est autant par la jubilation que suscite son écriture
résolument inventive que par sa capacité à nous faire nous interroger sur
l’essence de la littérature et, plus largement encore, sur les voies de la
création artistique. Cet « effet de profondeur » est partout sensible dans son
œuvre : pas une scène qui n’invite à questionner la définition du drame et
de la représentation ; pas une phrase qui ne nous emporte aux limites du
langage et ne mettent en exergue le « drame de la parole ». Rappelons que si
le dramaturge s’emploie à renverser la célèbre proposition de Wittgenstein
en affirmant que « ce dont on ne peut parler, c’est cela qu’il faut dire »
(TP, P. 169), il s’avance en réalité dans le chemin tracé par le philosophe
autrichien, celui d’un langage devenu « mystique », qui ne dit plus mais qui
« montre », qui n’est plus une simple image des choses mais une tentative
pour porter plus loin la pulsion expressive, au-delà des limites ordinaires
de la signification. En ce sens, la passion de Valère Novarina pour les
théologiens du haut Moyen Âge ou pour des penseurs dont les noms étranges
brillent comme autant de joyaux, ne relève pas d’une curiosité d’antiquaire.
Elle est la manifestation d’une authentique attraction pour le nouveau et
l’insolite
2
: de même qu’il existe chez les artistes de l’Art brut des ressources
1.
Cité et commenté par C. Ginzburg (« Mythe. Distance et mensonge » in À distance. Neuf
essais sur le point de vue en histoire, trad. P.-A. Fabre, Paris, Gallimard, 1998, p. 48).
2.
Voir, plus généralement, la manière dont la littérature médiévale resurgit dans le contemporain
ainsi qu’il a été démontré dans un volume collectif récent (Nathalie Koble et Mireille Séguy
[dir.], Passé présent. Le Moyen Âge dans les fictions contemporaines, Paris, Éditions Rue d’Ulm,
2009).
rticle on line
rticle on line
5
LITTÉRATURE
N° 176 – DÉCEMBRE 2014
“Litterature_176” (Col. : RevueLitterature) — 2014/11/17 — 11:13 — page 5 — #5
✐
✐
✐
✐
✐
✐
✐
✐
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
1
/
144
100%