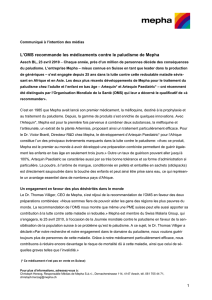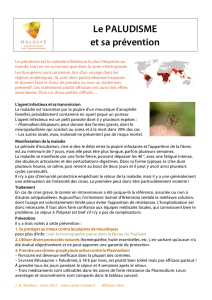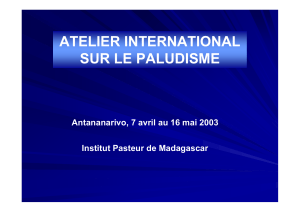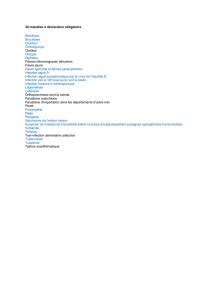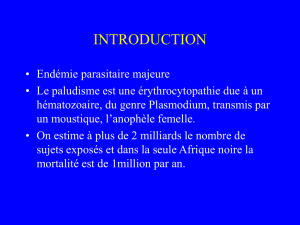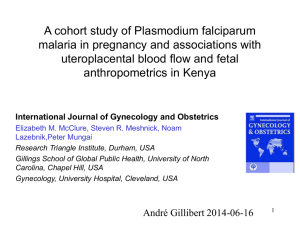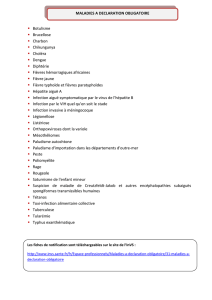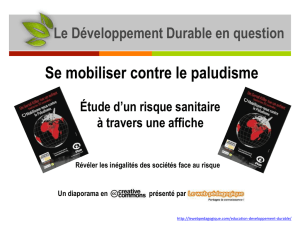Le paludisme simple en 2012 : grands classiques et nouveautés

O. Bouchaud
La Lettre de l’Infectiologue • Tome XXVII - n° 6 - novembre-décembre 2012 | 227
DOSSIER THÉMATIQUE
Le paludisme simple
en 2012 : grands classiques
et nouveautés
Uncomplicated malaria in 2012: from classical to new data
O. Bouchaud*, L. Pull**, J.-Y. Siriez**
* Service des maladies infectieuses
et tropicales, hôpital Avicenne et
uni versité Paris-XIII, Bobigny.
** Service des urgences, hôpital
pédiatrique Robert-Debré, Paris.
E
n 2010, selon l’Organisation mondiale de la
santé (OMS), 90 % des 216 millions de cas
estimés et les 655 000 décès sont survenus
en Afrique subsaharienne, principalement chez les
enfants de moins de 5 ans. Même si ces données ne
laissent aucun doute sur le fait que le paludisme
reste une endémie majeure dans le monde tropical,
les efforts des 10 dernières années (amélioration
de l’accès au diagnostic, généralisation des tests
rapides, diffusion des bithérapies contenant un
dérivé de l’artémisinine ayant de plus un effet sur
la chaîne de transmission, distribution large de
moustiquaires imprégnées d’insecticides, intensi-
fication de la lutte antivectorielle, etc.) ont permis
d’obtenir un recul significatif du paludisme dans
le monde (1).
Du fait de ses liens historiques avec l’Afrique subsa-
harienne, la France, avec 3 500 à 4 000 cas estimés
annuels, reste le pays industrialisé le plus concerné
par le paludisme d’importation, notamment en
Île-de-France, avec près des trois quarts des cas
survenant chez des migrants africains ayant passé
des vacances (souvent prolongées) dans leur pays
d’origine.
Si le principe général de la prise en charge du palu-
disme n’a pas évolué, des nouveautés sont apparues
ces dernières années dans 2 domaines : le diagnostic,
avec l’identification d’une nouvelle espèce (Plasmo-
dium knowlesi) et l’apparition des tests de diagnostic
rapide (TDR), et le traitement, avec en traitement
curatif l’émergence en première ligne des bithérapies
de type artémisinine (ACT [Artemisinin Combined
Therapy]) et, en prévention, la tendance à une réduc-
tion des indications de chimioprophylaxie pour les
séjours à faible risque.
Évoquer et diagnostiquer
un paludisme
Même si l’Afrique subsaharienne est de très loin la
principale source de paludisme d’importation en
France, toute fièvre au retour de zone tropicale, quel
que soit le contexte, les préventions et les précau-
tions prises, ou la saison (piège du syndrome fébrile
en saison grippale), doit déclencher le réflexe “palu-
disme” et faire demander en urgence un frottis-goutte
épaisse dont le résultat doit être disponible dans les
2 heures (2). La fièvre palustre évolue par pics (écla-
tement des schizontes dans le cycle érythrocytaire) et
peut donc être absente lors de l’examen. Une absence
totale de fièvre est possible, mais rare, et se voit essen-
tiellement chez des migrants encore immunisés. La
grande majorité des accès palustres surviennent dans
les 2 à 3 semaines suivant le retour, mais des émer-
gences sont possibles plus tardivement, voire plusieurs
années après, pour les espèces autres que Plasmodium
falciparum, qui sont cependant beaucoup plus rares.
À côté de la fièvre s’insérant dans un tableau pseudo-
grippal ou de rhinopharyngite chez l’enfant, les autres
signes cardinaux sont : céphalées, frissons et signes
digestifs (diarrhée, nausées, vomissements, etc.).
Chez l’enfant, les signes digestifs peuvent être au
devant du tableau (piège de la gastroentérite fébrile
prise à tort pour une turista). Au-delà de ces signes
d’appel, l’interrogatoire, étape capitale du diagnostic,
doit identifier la durée d’évolution des symptômes
et la prise d’antimalariques, que ce soit en autotrai-
tement (risque de faussement négativer le frottis-
goutte épaisse) ou du fait de la chimioprophylaxie
(dont la prise, même annoncée comme régulière
par le patient, ne doit pas faire rejeter le diagnostic).

228 | La Lettre de l’Infectiologue • Tome XXVII - n° 6 - novembre-décembre 2012
Points forts
»
Le paludisme d’importation, fréquent chez les migrants, survient le plus souvent chez des voyageurs
revenant d’Afrique subsaharienne et qui n’ont pas été soumis à une prophylaxie adéquate.
»
La fièvre, irrégulière, est le symptôme d’alerte de référence. Elle impose la réalisation systématique
d’un frottis-goutte épaisse en urgence.
»
Les tests rapides qui ont révolutionné le diagnostic en zone d’endémie restent une technique d’appoint
en France et ne doivent pas se substituer au diagnostic de référence (frottis-goutte épaisse).
»
Le traitement fait maintenant appel aux bithérapies, en privilégiant celles contenant un dérivé de
l’artémisinine (pour leur rapidité d’action et leur bonne tolérance).
»
Pour les séjours touristiques classiques en Asie et en Amérique du Sud, la chimioprophylaxie n’est en
général plus nécessaire (le risque de paludisme est très faible).
Mots-clés
Paludisme
Migrants
Tests de diagnostic
rapide
Artéméther-
luméfantrine
Dihydroartémisinine-
pipéraquine
Highlights
»
Imported malaria, frequent
in immigrants Visiting Friends
and Relatives (VFR), mainly
occurs in travellers returning
from sub-Saharan Africa and
having not taken adequate
prophylaxis.
»
Fever, with an irregular
course, remains the main
alert sign. A systematic thin/
thick blood films for parasites
diagnosis must be performed
immediately.
»
Rapid diagnostic tests, of
great use in endemic areas,
have a secondary role in
France, microscopic examina-
tion remaining the reference
diagnostic test.
»
Artemisinin-based combined
therapies are now the gold
standard treatment (rapidly
efficient and well tolerated).
»
For “classical” touristic
journeys in Asia and South
America, chemoprophylaxis
may be avoided due to a very
low risk of malaria.
Keywords
Malaria
Visiting friends and relatives
Rapid diagnostic tests
Artemether-lumefantrine
Dihydroartemisinine-
piperaquine
P. knowlesi, découvert récemment (car longtemps
confondu avec Plasmodium malariae) comme patho-
gène chez l’homme, donne un tableau palustre clas-
sique, mais qui peut évoluer en une forme grave et
mortelle comme avec P. falciparum. Parasite très
inféodé à l’Asie du Sud-Est (Bornéo notamment), les
formes cliniques importées sont en fait très rares.
La chloroquine est efficace, comme pour les autres
espèces sauf P. falciparum (3).
L’examen clinique est en règle générale peu contri-
butif. La classique splénomégalie est en fait peu
fréquente dans le paludisme de primo-invasion de
l’adulte et de l’enfant (4, 5). Cet examen clinique doit
être cependant attentif pour détecter précocement
les signes d’alerte précurseurs des signes de gravité
avérés (cf. article “Paludisme grave d’importation”) :
subictère, coloration foncée des urines, tendance à
la somnolence, etc.
Le bilan biologique standard permet d’identifier des
éléments diagnostiques présomptifs. La présence
d’une thrombopénie (très fréquente chez l’adulte et
signe d’alerte si elle est très marquée ; plus rare chez
l’enfant), d’une hémoglobine déjà un peu abaissée (a
fortiori basse) et l’absence d’hyperleucocytose sont
très évocatrices. Une cytolyse hépatique minime
est possible.
La confirmation biologique sera apportée par le
classique frottis sanguin-goutte épaisse, qui reste
la méthode de référence (2). Le frottis consiste à
étaler sur une lame une goutte de sang et à recher-
cher au microscope, après coloration, les parasites
à l’intérieur des hématies, l’expression du résultat
se faisant en comptant les hématies parasitées
(expression en pourcentage). Il peut être mis en
défaut (faux négatif) lorsque la parasitémie est faible,
ce qui justifie la goutte épaisse, dont la sensibilité
est meilleure (mais l’identification de l’espèce est
plus difficile). Si une parasitémie élevée (> 2 % et, a
fortiori, > 4 %) est un signe d’alerte imposant l’hos-
pitalisation, sa présence isolée (sans autre signe de
gravité) n’a généralement pas de caractère péjoratif,
tout particulièrement chez l’enfant.
La nouveauté est l’apparition des TDR, qui doivent
cependant rester des méthodes d’appoint. Ils
mettent en évidence dans le sang des protéines
spécifiques de Plasmodium sp. permettant de diffé-
rencier P. falciparum des autres espèces : antigène
HRP-2 (Histidine Rich Protein-2), spécifique de
P. falciparum, pLDH (lacticodéshydrogénase pan-
malarique) et aldolase. Leur sensibilité est supérieure
à 95 % en ce qui concerne P. falciparum, mais elle
est moins bonne pour les autres espèces. Des faux
positifs (interaction avec le facteur rhumatoïde) et
des faux négatifs (moins de 100 parasites par micro-
litre de sang, mutation/délétion du gène codant
pour l’antigène HRP-2) ont été rapportés (6, 7). Par
ailleurs, l’antigène HRP-2 peut rester positif chez un
patient correctement traité plus de 30 jours après
la guérison (risque de retraiter un paludisme guéri
si réapparition d’une fièvre due à une autre cause)
[8]. Une étude récente a démontré un bénéfice
semi-quantitatif, puisqu’un test rapide associant
la détection de HRP-2 à l’absence d’aldolase était
associé à une parasitémie inférieure à 1 % (9). Enfin,
les TDR ne permettent pas de quantifier la parasi-
témie, paramètre important pour orienter la prise
en charge.
L’amplification génique (PCR) permet de détecter de
très faibles parasitémies, de quantifier l’ADN plas-
modial et de rechercher des marqueurs nucléaires
de résistance aux antipaludiques. Cette méthode
onéreuse nécessite un circuit sécurisé et n’est pas
réalisée en pratique courante, sauf dans quelques
laboratoires spécialisés, au Centre national de
référence du paludisme ou dans le cadre de la
recherche (10).
On rappelle par ailleurs que la sérologie “paludisme”
n’a aucun intérêt dans le diagnostic d’un paludisme
aigu et ne doit pas être utilisée dans ce cadre.
Traiter un accès palustre simple
d’importation (figure 1)
Une fois le diagnostic confirmé, le traitement doit
être mis en œuvre rapidement dans l’accès simple
et en urgence dans l’accès grave.
Dans les situations où un paludisme est probable
(retour de zone à risque + présomption clinique et
biologique) mais sans confirmation parasitologique,
il est légitime d’évoquer un paludisme “décapité” (par
une chimioprophylaxie inadaptée, un autotraitement
insuffisamment efficace ou chez les migrants dont la
prémunition résiduelle limite la parasitémie). Il est

P. ovale, vivax, malariae, knowlesi
Chloroquine
P. falciparum
Recherche de signes de gravité
– Troubles de la conscience (même minimes), convulsions
– Choc, acidose métabolique
– Œdème pulmonaire, syndrome de détresse respiratoire
– Syndrome hémorragique
– Hémoglobinurie
– Hémoglobine ≤ 7 g/dl, créatininémie ≥ 265 µmol/l, glycémie ≤ 2,2 mmol/l
– Ictère clinique ou bilirubine totale ≥ 50 µmol/l
– Parasitémie ≥ 4 %
NON
NON
Vomissements ?
Hospitalisation ou traitement en ambulatoire ?
– Aucun signe de gravité ; pas de troubles digestifs (vomissements ++)
– Patient adulte et suivi possible, diagnostic parasitologique fiable
– Absence de facteurs de risque de mauvaise observance
– Absence de facteur de risque associé (enfant, grossesse, patient âgé, pathologie associée – notamment
cardiaque, splénectomie, isolement, etc.)
– Proximité d’un hôpital
– Disponibilité immédiate de l’antipaludique prescrit (pharmacie ou service d’urgences)
– Hémoglobine > 10 g/dl ; plaquettes > 50 000/mm3 ; créatinine < 150 µmol/l ; parasitémie < 2 %
Si tous les critères sont vérifiés Si 1 seul critère non vérifié,
traitement ambulatoire possible hospitalisation nécessaire
• Atovaquone-proguanil
• Artéméther-luméfantrine
• Dihydroartémisinine-pipéraquine*
• En 2e ligne : quinine orale ou méfloquine
Modalités :
voir tableau
Dès amélioration
Suivi avec frottis-goutte épaisse à J3, J7 et J28
OUI
Avis du réanimateur
Hospitalisation
Artésunate ou quinine i.v.
OUI
Hospitalisation
Quinine i.v.
Figure 1. Conduite thérapeutique à tenir devant un accès palustre d’importation.
La Lettre de l’Infectiologue • Tome XXVII - n° 6 - novembre-décembre 2012 | 229
DOSSIER THÉMATIQUE
alors nécessaire de répéter le dépistage parasitolo-
gique (une seule parasitémie négative n’élimine pas le
diagnostic) et de suivre la règle empirique qui postule
qu’il faut réaliser 3 frottis-goutte épaisse avant d’éli-
miner un paludisme. Lorsque l’hospitalisation n’est
pas possible et que le retour du patient n’est pas
certain, l’alternative est de donner un traitement
curatif présomptif complet (“dans le doute, on traite”).
Hospitalisation ou traitement
ambulatoire ?
Après avoir vérifié soigneusement l’absence de tout
critère de gravité, la question de l’hospitalisation
ou du traitement ambulatoire se pose. Les critères
autorisant une prise en charge ambulatoire sont
indiqués sur la figure 1. Si l’un des critères manque,

230 | La Lettre de l’Infectiologue • Tome XXVII - n° 6 - novembre-décembre 2012
Le paludisme simple en2012 : grands classiques etnouveautés
DOSSIER THÉMATIQUE
Paludisme
l’hospitalisation est alors recommandée (2). Chez
l’enfant, si la conférence de consensus recommande
l’hospitalisation dans tous les cas, certains centres
spécialisés organisent une prise en charge ambulatoire
en l’absence de critère de gravité et de vomissement,
à condition que l’état général de l’enfant soit conservé
et que les parents soient fiables (2). Les attitudes euro-
péennes par rapport à l’hospitalisation dans l’accès
simple sont très variables. La tendance est plutôt à la
recommandation de l’hospitalisation ; certains pays,
comme l’Allemagne, et surtout le Royaume-Uni, la
recommandent systématiquement pendant au moins
24 heures, d’autres (Espagne, Italie, Suisse, Pays-Bas,
etc.) reconnaissent, comme en France, des situations
où elle n’est pas nécessaire (11). C’est l’état clinique et
le contexte, plus que l’espèce, qui sera déterminant :
en effet, les espèces sans potentiel évolutif sévère
(Plasmodium vivax – mais des formes sévères sont
maintenant reconnues –, Plasmodium ovale, P. mala-
riae) peuvent donner des accès à la symptomatologie
bruyante justifiant l’hospitalisation.
Traitement de l’accès simple
à P. falciparum de l’adulte
Depuis la diffusion, dans les années 1980, de la résis-
tance de P. falciparum à la chloroquine et l’apparition
de multirésistances, l’utilisation de la chloroquine
n’est plus possible dans la grande majorité des cas.
Les avantages et les inconvénients des 5 principaux
médicaments utilisables (atovaquone-proguanil,
artéméther-luméfantrine, dihydroartémisinine-pipé-
raquine, quinine, méfloquine) sont indiqués dans
le tableau, ainsi que leurs modalités d’utilisation.
La nouveauté depuis la conférence de consensus de
2007 est le passage en deuxième ligne des antimala-
riques classiques (c’est-à-dire qu’ils ne doivent être
utilisés qu’en cas de contre-indication aux médica-
ments de première ligne) que sont la quinine et la
méfloquine (pour des raisons de tolérance et non
d’efficacité) [2]. Les antipaludiques de première ligne
sont maintenant au nombre de 3 : l’atovaquone-
proguanil, l’artéméther-luméfantrine et le tout
Tableau. Critères de choix et principales modalités d’utilisation des antipaludiques dans le traitement curatif du paludisme
simple d’importation à P. falciparum de l’adulte*.
Pour Contre Posologie
1re ligne (consensus paludisme 2007)
Atovaquone + proguanil
(Malarone®)
– Traitement court/
posologie simple
– Bonne tolérance
générale
– Vomissements – Relative
lenteur d’action – Nécessité
de prise avec des aliments –
Absorption faible si prise en
dehors d’un repas
– 4 comprimés en 1 prise
à renouveler 2 fois à 24 h
d’intervalle au cours d’un repas
(soit 12comprimés au total sur
48 h)
Artéméther-luméfantrine
(Riamet®)
En réserve hospitalière, dis-
pensation aux particuliers
– Rapidité d’efficacité
– Bonne tolérance
– Posologie un peu complexe
– Nécessité de prise
avec des aliments
– 4 comprimés en 1 prise à H0,
H8, H24, H36, H48 et H60, avec
prise alimentaire ou boisson avec
corps gras
Dihydroartémisinine-pipé-
raquine** (Eurartesim®)
– Rapidité d’efficacité
– Bonne tolérance
– Traitement court/
posologie simple
– Allongement de QTc
(contre-indication si situation
à risque d’allongement de
QTc)
– 3 comprimés en 1 prise/j, à jeun,
pendant 3 jours consécutifs à 24 h
d’intervalle
2e ligne
Quinine
– Quinimax®
comprimé à 500 et125mg
– Quinine Lafran®
comprimé à 500
et 250 mg
– Possible si grossesse – Tolérance***
– Traitement long
– 8mg/kg × 3/j pour 7jours sans
dépasser 2 g/j (= 1 comprimé à
500 mg × 3/j
chez l’adulte de poids moyen ;
– i.v. si vomissements (même
posologie)
Méfloquine
(Lariam®)
comprimé à 250 mg
– Traitement court – Tolérance**** 25mg/kg en 3prises espacées
de 8h. En pratique, chez l’adulte :
3comprimés, puis 2comprimés
(puis 1comprimé si > 60kg)
*L’halofantrine est encore disponible, mais, en raison d’une toxicité cardiaque rare mais potentiellement grave, elle n’a que très peu
d’indications et ne peut être utilisée qu’en milieu hospitalier.
**La dihydroartémisinine-pipéraquine est disponible en France depuis juin 2012. Elle n’a donc pas été prise en compte dans la
révision de conférence de consensus de 2007. Compte tenu de sa proximité avec l’artéméther-luméfantrine, il est légitime de la posi-
tionner au même niveau que les 2 antipaludiques recommandés en première ligne.
***Cinchonisme : troubles digestifs, céphalées, acouphènes ++ (vers J2 ; ce n’est pas un signe de surdosage mais un signe “d’impré-
gnation” par quinine ; elle ne doit pas entraîner une réduction de posologie) ; troubles du rythme (surdosage).
****Troubles digestifs, céphalées, vertiges (fréquents) ; troubles neuropsychiques (dont convulsions) : rares, mais potentiellement
graves (contre-indication en cas d’antécédents neuropsychiatriques, dont convulsions).

La Lettre de l’Infectiologue • Tome XXVII - n° 6 - novembre-décembre 2012 | 231
DOSSIER THÉMATIQUE
dernier venant d’obtenir l’autorisation de mise sur
le marché et disponible en France depuis juin 2012 :
la dihydroartémisinine-pipéraquine (12-14). L’ar-
téméther-luméfantrine et la dihydroartémisinine-
pipéraquine font partie des ACT. Cette nouvelle
classe d’antipaludiques basée sur une bithérapie
comportant un dérivé de l’artémisinine (à demi-
vie courte) et une autre molécule de demi-vie plus
longue s’est imposée en zone d’endémie. L’objectif
est de contrer la résistance et de freiner la chaîne
de transmission, car les dérivés de l’artémisinine
ont une action très rapide, effondrant précocement
la charge parasitaire (ils rendent donc plus difficile
l’émergence de mutants résistants) et sont parmi les
rares antipaludiques actifs sur les formes parasitaires
sexuées circulantes (gamétocytes) prélevées par les
anophèles (15).
Chez la femme enceinte, chez qui une hospitalisation
pour surveillance obstétricale est systématiquement
recommandée en raison des conséquences potentiel-
lement graves que peut avoir chez l’enfant l’infection
placentaire, seule la quinine a fait la preuve d’une
parfaite innocuité.
Le paludisme viscéral chronique évolutif et sa
variante, la splénomégalie palustre hyperimmune,
se traite en France (pas de réinfection possible)
comme un accès simple.
Traitement des accès liés aux espèces
autres que P. falciparum de l’adulte
Le traitement de référence reste la chloroquine par
voie orale (Nivaquine®) à la dose de 10 mg/ kg à H0
suivie de 5 mg/kg à H6, H24 et H48, soit 25 mg/
kg au total. En raison du risque de reviviscence
pour P. ovale et P. vivax (formes hypnozoïtes hépa-
tiques échappant à la chloroquine), un traitement
complémentaire par la primaquine à la dose de 15
ou, mieux, 30 mg/j pendant 2 semaines est recom-
mandé, soit d’emblée, soit après la première crise
de reviviscence. Un dosage de l’activité G6PD est
indispensable au préalable, un déficit faisant courir
un risque d’hémolyse d’autant plus grave que le
déficit serait important.
Traitement de l’accès simple de l’enfant
à P. falciparum
La quinine per os (8 mg/kg/8 h de quinine-base) n’est
en pratique pas utilisée chez l’enfant, en raison de son
goût amer, de la longue durée du traitement (7 jours)
et d’un possible cinchonisme (acouphènes, vertiges,
troubles de la vision, nausées, céphalées, baisse de
l’acuité auditive) pouvant aboutir à l’arrêt prématuré
du traitement.
L’halofantrine (Halfan
®
, 3 prises de 8 mg/kg, données
à 6 heures d’intervalle), longtemps utilisée en
première intention chez l’enfant, a été rétrogradée en
deuxième ligne (cardiotoxicité bien que limitée à un
allongement de l’espace QTc rapidement réversible,
et 10 à 20 % de rechutes du fait d’une absorption
digestive modeste justifiant une deuxième cure à J8
dont les modalités ne sont pas clairement définies)
[3]. Certaines équipes continuent de l’utiliser volon-
tiers chez l’enfant de moins de 6 ans, sous réserve
d’une surveillance possible jusqu’à J30, du fait de
sa rapidité d’action et de sa présentation adaptée
(sirop).
La méfloquine (Lariam®), bien qu’elle soit éméti-
sante, est utilisée chez l’enfant de plus de 5 kg ou
3 mois à la posologie de 24 mg/kg en 2 à 3 prises
espacées de 6 à 12 heures selon l’âge. Avant 6 ans,
les comprimés quadrisécables de 250 mg doivent
être écrasés.
L’atovaquone-proguanil (Malarone
®
), également
émétisante, en comprimés à 250 mg d’atovaquone,
est utilisée chez l’enfant à partir de 11 kg (3 prises à
24 heures d’intervalle de 1 comprimé de 11 à 20 kg,
2 comprimés de 21 à 30 kg, 3 comprimés de 31 à
40 kg, 4 comprimés au-delà de 40 kg). En dessous de
11 kg, la prise hors AMM de 2 ou 3 comprimés pédia-
triques pour, respectivement, 5 à 8 kg ou 8 à 10 kg
de poids est possible. Les comprimés doivent être
écrasés chez l’enfant de moins de 6 ans et donnés
avec un repas riche en graisse.
L’artéméther-luméfantrine dispose en France d’une
AMM à partir de 5 kg, mais on manque de données
chez l’enfant dans le cadre du paludisme d’impor-
tation. Avant 6 ans, les comprimés doivent être
écrasés ou dissous dans de l’eau, et les prises sont
administrées avec un repas riche en graisses. Les
effets indésirables rapportés en zone d’endémie sont
la toux, l’anémie et des troubles digestifs.
La dihydroartémisinine-pipéraquine a une forme
pédiatrique (160/20 mg) permettant la prescription
à partir de 5 kg (et 6 mois d’âge). Le principe de prise
est le même que chez l’adulte, la dose répétée 3 fois
à 24 heures d’intervalle étant d’un demi-comprimé
chez l’enfant entre 5 et 7 kg, 1 comprimé chez l’en-
fant entre 7 et 13 kg, 1 comprimé chez l’adulte entre
13 et 24 kg, 2 comprimés chez l’adulte entre 24 et
36 kg, 3 comprimés chez l’adulte au-delà de 36 kg.
L’expérience est très limitée dans le cadre du palu-
disme d’importation.
 6
6
 7
7
1
/
7
100%