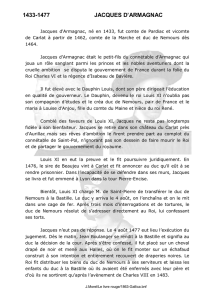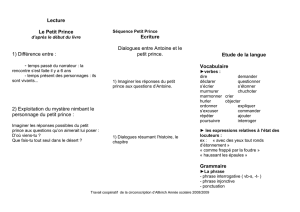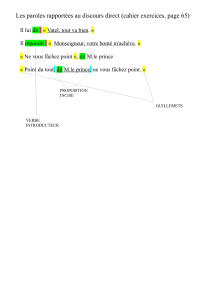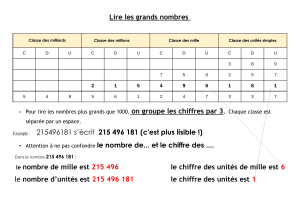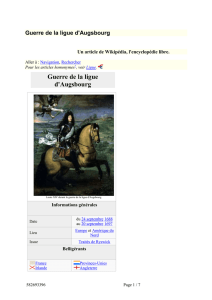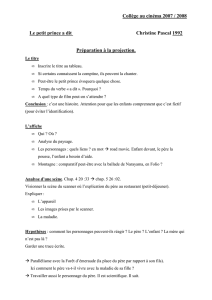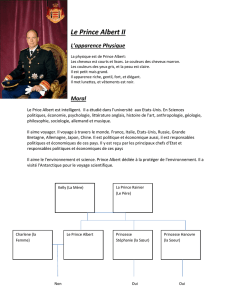Le Siècle de Louis XIV

Chapitre 1
Ce n’est pas seulement la vie de Louis XIV qu’on prétend écrire ; on se propose
un plus grand objet. On veut essayer de peindre à la postérité, non les actions d’un
seul homme, mais l’esprit des hommes dans le siècle le plus éclairé qui fut jamais.
Tous les temps ont produit des héros et des politiques tous les peuples ont
éprouvé des révolutions : toutes les histoires sont presque égales pour qui ne veut
mettre que des faits dans sa mémoire. Mais quiconque pense, et, ce qui est plus
rare, quiconque a du goût, ne compte que quatre siècles dans l’histoire du monde.
Ces quatre âges heureux sont ceux où les arts ont été perfectionnés, et qui, servant
d’époque à la grandeur de l’esprit humain, sont l’exemple de la postérité.
Le premier de ces siècles à qui la véritable gloire est attachée, est celui de Phi-
lippe et d’Alexandre, ou celui des Périclès, des Démosthène, des Aristote, des Pla-
ton des Apelles, des Phidias, des Praxitèle ; et cet honneur a été renfermé dans les
limites de la Grèce ; le reste de la terre alors connue était barbare.
Le second âge est celui de César et d’Auguste, désigné encore par les noms de
Lucrèce, de Cicéron de Tite Live, de Virgile, d’Horace, d’Ovide, de Varron, de Vi-
truve.
Le troisième est celui qui suivit la prise de Constantinople par Mahomet II. Le
lecteur peut se souvenir qu’on vit alors en Italie une famille de simples citoyens
faire ce que devaient entreprendre les rois de l’Europe. Les Médicis appelèrent à
Florence les savants que les Turcs chassaient de la Grèce : c’était le temps de la
gloire de l’Italie. Les beaux-arts y avaient déjà repris une vie nouvelle, les Italiens
les honorèrent du nom de vertu, comme les premiers Grecs les avaient caractéri-
sés du nom de sagesse. Tout tendait à la perfection.
Les arts, toujours transplantés de Grèce en Italie se trouvaient dans un terrain
favorable où ils fructifièrent tout à coup. La France, l’Angleterre, l’Allemagne, l’Es-
1

pagne voulurent à leur tour avoir de ces fruits : mais ou ils ne vinrent point dans
ces climats, ou bien ils dégénérèrent trop vite.
François Ier encouragea des savants, mais qui ne furent que savants : il eut des
architectes mais il n’eut ni des Michel-Ange, ni des Palladio : il voulut en vain éta-
blir des écoles de peinture ; les peintres italiens qu’il appela ne firent point d’élèves
français. Quelques épigrammes et quelques contes libres composaient toute notre
poésie. Rabelais était notre seul livre de prose à la mode, du temps de Henri II.
En un mot les Italiens seuls avaient tout, si vous en exceptez la musique, qui
n’était pas encore perfectionnée, et la philosophie expérimentale, inconnue par-
tout également, et qu’enfin Galilée fit connaître.
Le quatrième siècle est celui qu’on nomme le siècle de Louis XIV ; et c’est peut-
être celui des quatre qui approche le plus de la perfection. Enrichi des découvertes
des trois autres, il a plus fait en certains genres que les trois ensemble. Tous les
arts, à la vérité, n’ont point été poussés plus loin que sous les Médicis, sous les
Auguste et les Alexandre ; mais la raison humaine en général s’est perfectionnée.
La saine philosophie n’a été connue que dans ce temps ; et il est vrai de dire qu’à
commencer depuis les dernières années du cardinal de Richelieu, jusqu’à celles
qui ont suivi la mort de Louis XIV, il s’est fait dans nos arts, dans nos esprits, dans
nos mœurs, comme dans notre gouvernement, une révolution générale qui doit
servir de marque éternelle à la véritable gloire de notre patrie. Cette heureuse in-
fluence ne s’est pas même arrêtée en France ; elle s’est étendue en Angleterre ; elle
a excité l’émulation dont avait alors besoin cette nation spirituelle et hardie ; elle
a porté le goût en Allemagne, les sciences en Russie ; elle a même ranimé l’Italie
qui languissait, et l’Europe a dû sa politesse et l’esprit de société à la cour de Louis
XIV.
Il ne faut pas croire que ces quatre siècles aient été exempts de malheurs et de
crimes. La perfection des arts cultivés par des citoyens paisibles n’empêche pas
les princes d’être ambitieux, les peuples d’être séditieux, les prêtres et les moines
d’être quelquefois remuants et fourbes. Tous les siècles se ressemblent par la mé-
chanceté des hommes ; mais je ne connais que ces quatre âges distingués par les
grands talents.
Avant le siècle que j’appelle de Louis XIV, et qui commence à peu près à l’éta-
blissement de l’Académie française (1), les Italiens appelaient les ultramontains
du nom de barbares ; il faut avouer que les Français méritaient en quelque sorte
2

cette injure. Leurs pères joignaient la galanterie romanesque des Maures à la gros-
sièreté gothique. Ils n’avaient presque aucun des arts aimables, ce qui prouve que
les arts utiles étaient négligés ; car lorsqu’on a perfectionné ce qui est nécessaire,
on trouve bientôt le beau et l’agréable ; et il n’est plus étonnant que la peinture, la
sculpture, la poésie, l’éloquence, la philosophie, fussent presque inconnues à une
nation qui, ayant des ports sur l’océan et sur la Méditerranée, n’avait pourtant
point de flotte, et qui, aimant le luxe à l’excès, avait à peine quelques manufac-
tures grossières.
Les Juifs, les Génois, les Vénitiens, les Portugais, les Flamands, les Hollandais,
les Anglais, firent tour à tour le commerce de la France, qui en ignorait les prin-
cipes. Louis XIII, à son avènement à la couronne, n’avait pas un vaisseau. Paris
ne contenait pas quatre cent mille hommes, et n’était pas décoré de quatre beaux
édifices : les autres villes du royaume ressemblaient à ces bourgs qu’on voit au
delà de la Loire. Toute la noblesse, cantonnée à la campagne dans des donjons en-
tourés de fossés, opprimait ceux qui cultivent la terre. Les grands chemins étaient
presque impraticables ; les villes étaient sans police, l’état sans argent, et le gou-
vernement presque toujours sans crédit parmi les nations étrangères.
On ne doit pas se dissimuler que depuis la décadence de la famille de Char-
lemagne, la France avait langui plus ou moins dans cette faiblesse, parce qu’elle
n’avait presque jamais joui d’en bon gouvernement.
Il faut, pour qu’un État soit puissant, ou que le peuple ait une liberté fondée sur
les lois, ou que l’autorité souveraine soit affermie sans contradiction. En France,
les peuples furent esclaves jusque vers le temps de Philippe-Auguste ; les seigneurs
furent tyrans jusqu’à Louis XI ; et les rois, toujours occupés à soutenir leur autorité
contre leurs vassaux, n’eurent jamais ni le temps de songer au bonheur de leurs
sujets, ni le pouvoir de les rendre heureux.
Louis XI fit beaucoup pour la puissance royale, mais rien pour la félicité et la
gloire de la nation. François Ier fit naître le commerce, la navigation, les lettres, et
tous les arts ; mais il fut trop malheureux pour leur faire prendre racine en France,
et tous périrent avec lui.
Henri le Grand allait retirer la France des calamités et de la barbarie où trente
ans de discorde l’avaient replongée, quand il fut assassiné dans sa capitale, au mi-
lieu du peuple dont il commençait à faire le bonheur. Le cardinal de Richelieu,
occupé d’abaisser la maison d’Autriche, le calvinisme, et les grands, ne jouit point
3

d’une puissance assez paisible pour réformer la nation ; mais au moins il com-
mença cet heureux ouvrage.
Ainsi, pendant neuf cents années, le génie des Français a été presque toujours
rétréci sous un gouvernement gothique, au milieu des divisions et des guerres ci-
viles, n’ayant ni lois ni coutumes fixes, changeant de deux siècles en deux siècles
un langage toujours grossier ; les nobles sans discipline, ne connaissant que la
guerre et l’oisiveté ; les ecclésiastiques vivant dans le désordre et dans l’ignorance,
et les peuples sans industrie, croupissant dans leur misère.
Les Français n’eurent part ni aux grandes découvertes ni aux inventions ad-
mirables des autres nations : l’imprimerie, la poudre, les glaces, les télescopes,
le compas de proportion, la machine pneumatique, le vrai système de l’univers,
ne leur appartiennent point ; ils faisaient des tournois, pendant que les Portugais
et les Espagnols découvraient et conquéraient de nouveaux mondes à l’orient et
à l’occident du monde connu. Charles-Quint prodiguait déjà en Europe les tré-
sors du Mexique, avant que quelques sujets de François Ier eussent découvert la
contrée inculte du Canada ; mais par le peu même que firent les Français dans
le commencement du XVIe siècle, on vit de quoi ils sont capables quand ils sont
conduits.
On se propose de montrer ce qu’ils ont été sous Louis XIV.
Il ne faut pas qu’on s’attende à trouver ici, plus que dans le tableau des siècles
précédents, les détails immenses des guerres, des attaques de villes prises et re-
prises par les armes, données et rendues par des traités. Mille circonstances in-
téressantes pour les contemporains se perdent aux yeux de la postérité, et dispa-
raissent pour ne laisser voir que les grands événements qui ont fixé la destinée
des empires. Tout ce qui s’est fait ne mérite pas d’être écrit. On ne s’attachera,
dans cette histoire, qu’à ce qui mérite l’attention de tous les temps, à ce qui peut
peindre le génie et les mœurs des hommes, à ce qui peut servir d’instruction, et
conseiller l’amour de la vertu, des arts, et de la patrie.
On a déjà vu ce qu’étaient et la France et les autres États de l’Europe avant la
naissance de Louis XIV ; on décrira ici les grands événements politiques et mili-
taires de son règne. Le gouvernement intérieur du royaume, objet plus important
pour les peuples, sera traité à part. La vie privée de Louis XIV, les particularités de
sa cour et de son règne, tiendront une grande place. D’autres articles seront pour
4
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
 151
151
 152
152
 153
153
 154
154
 155
155
 156
156
 157
157
 158
158
 159
159
 160
160
 161
161
 162
162
 163
163
 164
164
 165
165
 166
166
 167
167
 168
168
 169
169
 170
170
 171
171
 172
172
 173
173
 174
174
 175
175
 176
176
 177
177
 178
178
 179
179
 180
180
 181
181
 182
182
 183
183
 184
184
 185
185
 186
186
 187
187
 188
188
 189
189
 190
190
 191
191
 192
192
 193
193
 194
194
 195
195
 196
196
 197
197
 198
198
 199
199
 200
200
 201
201
 202
202
 203
203
 204
204
 205
205
 206
206
 207
207
 208
208
 209
209
 210
210
 211
211
 212
212
 213
213
 214
214
 215
215
 216
216
 217
217
 218
218
 219
219
 220
220
 221
221
 222
222
 223
223
 224
224
 225
225
 226
226
 227
227
 228
228
 229
229
 230
230
 231
231
 232
232
 233
233
 234
234
 235
235
 236
236
 237
237
 238
238
 239
239
 240
240
 241
241
 242
242
 243
243
 244
244
 245
245
 246
246
 247
247
 248
248
 249
249
 250
250
 251
251
 252
252
 253
253
 254
254
 255
255
 256
256
 257
257
 258
258
 259
259
 260
260
 261
261
 262
262
 263
263
 264
264
 265
265
 266
266
 267
267
 268
268
 269
269
 270
270
 271
271
 272
272
 273
273
 274
274
 275
275
 276
276
 277
277
 278
278
 279
279
 280
280
 281
281
 282
282
 283
283
 284
284
 285
285
 286
286
 287
287
 288
288
 289
289
 290
290
 291
291
 292
292
 293
293
 294
294
 295
295
 296
296
 297
297
 298
298
 299
299
 300
300
 301
301
 302
302
 303
303
 304
304
 305
305
 306
306
 307
307
 308
308
 309
309
 310
310
 311
311
 312
312
 313
313
 314
314
 315
315
 316
316
 317
317
 318
318
 319
319
 320
320
 321
321
 322
322
 323
323
 324
324
 325
325
 326
326
 327
327
 328
328
 329
329
 330
330
 331
331
 332
332
 333
333
 334
334
 335
335
 336
336
 337
337
 338
338
 339
339
 340
340
 341
341
 342
342
 343
343
 344
344
 345
345
 346
346
 347
347
 348
348
 349
349
 350
350
 351
351
 352
352
 353
353
 354
354
 355
355
 356
356
 357
357
 358
358
 359
359
 360
360
 361
361
 362
362
 363
363
 364
364
 365
365
 366
366
 367
367
 368
368
 369
369
 370
370
 371
371
 372
372
 373
373
 374
374
 375
375
 376
376
 377
377
 378
378
 379
379
 380
380
 381
381
 382
382
 383
383
 384
384
 385
385
 386
386
 387
387
 388
388
 389
389
 390
390
 391
391
 392
392
 393
393
 394
394
 395
395
 396
396
 397
397
 398
398
 399
399
 400
400
 401
401
 402
402
 403
403
 404
404
 405
405
 406
406
 407
407
 408
408
 409
409
 410
410
 411
411
 412
412
 413
413
 414
414
 415
415
 416
416
 417
417
 418
418
 419
419
 420
420
 421
421
 422
422
1
/
422
100%