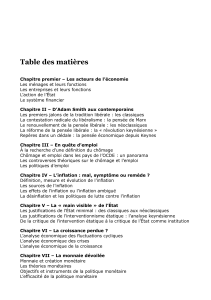Faut-il fixer des règles pour la politique

Faut-il fixer des règles pour la politique économique ?
Introduction
• En octobre 2002 Romano Prodi, président de la commission européenne déclarait : le
« Pacte de Stabilité est stupide ». Son commentaire a relancé des débats réguliers sur les
règles de la politique économique. C’est un enjeu politique et démocratique fondamental
puisqu’il s’agit là, de la capacité d’intervention des gouvernants et de leur marge de
manoeuvre.
• Rien d’étonnant à ce que la politique économique ait une place essentielle dans l’économie
puisqu’elle désigne l'ensemble des mesures prises par l'État pour modifier l'affectation des
ressources, réguler la conjoncture et redistribuer le revenu national. La tâche n’est donc
pas simple.
• Les politiques conjoncturelles ont pour objectifs de favoriser la croissance et de lutter
contre le chômage, l'inflation et les déséquilibres du commerce extérieur (objectifs que
l’on regroupe sous le nom de « carré magique »).
• L'État mène aussi des politiques structurelles en soutenant les secteurs jugés prioritaires, en
modifiant durablement le partage des activités entre le secteur privé et le secteur public ou
en rétablissant les règles de la concurrence.
• En économie de marché l’Etat ne peut pas « commander » de façon autoritaire, il doit
utiliser des instruments indirects pour conduire les agents éco à se conformer à ses
objectifs. Cette « boite à outils » est multi-usage car chacun d’eux peut être utilisés dans
des buts, et à des moments différents. Ces outils reposent sur deux principes : la règle de
Tinbergen qui recommande d’utiliser autant d’instruments que d’objectifs quantifiés et la
règle de Mundell qui préconise d’utiliser les instruments selon leur efficacité comparative,
ainsi l’outil budgétaire serait l’outil privilégié de l’action sur l’emploi, l’outil monétaire
celui de l’action sur les prix.
• A partir de là, 2 approches des politiques sont possibles : soit une politique
« discrétionnaire » qui consiste à optimiser à court terme le bien-être, au coup par coup, et
après formation des anticipations des agents privés. Soit une politique à partir de règles qui
consiste à définir à l'avance la réaction de la politique monétaire, aux différentes variables
et aux différents de Chocs pertinents. La règle doit porter sur les instruments de la
politique monétaire, par exemple sous la forme d'une variation de l'instrument en réponse à
une déviation par rapport aux objectifs finaux (absence d'inflation, stabilité des changes,
plein emploi...).
• Le problème alors qui se pose est celui de l’efficacité des instruments de ces politiques
économiques par rapport a ses objectifs : l’instauration de règles rend-elle la politique éco
plus efficace ?
Annonce du plan
I. POLITIQUES ECONOMIQUES « DISCRETIONNAIRES »…
1

1. Les fondements keynésiens de la politique économique
Durant les « 30 glorieuses », l’ensemble des pays industrialisés adoptent des politiques
keynésiennes à partir d’un certain nombre de fondements théoriques qui justifie l’intervention
de l’état.
Le 1er élément mis en évidence par Keynes c’est la limite du marché
Les mécanismes économiques ne s'expliquent pas par les comportements individuels mais par
des grandeurs globales interdépendantes telles que la production, le revenu, l'investissement,
la consommation, l'épargne. Les prix ne sont pas flexibles mais rigides à court terme. Les
déséquilibres entre l'offre et la demande sont donc possibles car les ajustements se réalisent
par les quantités et non par les prix.
Si les mécanismes du marché ne permettent pas l'équilibre entre l'offre et la demande, les
entreprises ne sont jamais sûres de pouvoir écouler la totalité de leur production. Elles
décident du volume de leur production en fonction d'anticipations sur la demande. Tant que la
demande anticipée par les entreprises est supérieure à l'offre, les entreprises sont incitées à
augmenter leur production. Cette « demande effective » détermine le volume de la production
et de l'emploi. Le niveau de l'emploi dépend donc de la demande anticipée et ne correspond
pas nécessairement à la population active. Le chômage involontaire est possible et s'explique
par l'insuffisance de la demande.
Pour réduire le chômage, il faut augmenter la production et par conséquent la demande.
Quand le marché des biens et services est en équilibre, les entreprises n'ont aucune raison
d'augmenter leur production et d'investir.
L'État doit se substituer à l'initiative privée défaillante et intervenir dans l’économie par une
politique active.
L’Etat dispose pour cela de plusieurs outils à sa disposition
La politique budgétaire est un instrument efficace pour stimuler la demande par les dépenses
et les recettes publiques (fiscalité). L'augmentation des dépenses publiques permet de
distribuer des revenus supplémentaires. La hausse de la consommation qui en résulte accroît
la production et l'emploi. Grâce au mécanisme du multiplicateur, l'impact sur la production est
supérieur à la hausse initiale des dépenses publiques. L'État peut aussi agir sur le revenu
disponible des ménages en baissant les impôts ou en augmentant les revenus de transfert et
sur l'investissement des entreprises par des subventions ou des allègements fiscaux. Il peut
également par une politique fiscale appropriée alléger les impôts sur les titulaires de bas
revenus dont la propension marginale à consommer est supérieure à celle des titulaires de
hauts revenus.
Les effets de la politique monétaire surtout pour l’école de la synthèse (Hicks, Hansen) avec
le modèle IS/LM, confirmé par la courbe de Phillips, fait du taux d’intérêt la variable
d’équilibre principale. A la différence des classiques, la demande de monnaie n’est pas slt
dépendante du niveau de revenu et du niveau de production ( c à dire un simple rôle
d’intermédiaire), mais elle est dépendante aussi du taux d’intérêt : les agents constituent des
encaisses liquides d’autant plus importante que les taux d’intérêt sont faibles. Le taux
d’intérêt est le prix de la renonciation à la liquidité ; il est donc à la jonction de la sphère
réelle et de la sphère monétaire. La monnaie et la politique monétaire ont donc des effets
2

réels. L’objectif de la politique monétaire est alors de soutenir la politique budgétaire pour le
plein emploi.
Les fondements théoriques vont avoir des conséquences pratiques.
2. Les implications dans les politiques économiques
Les politiques économiques des 50’ aux 80’ s’inspirent directement de cette approche
keynésienne permette un « réglage fin » de la conjoncture. Les politiques monétaire et
budgétaire sont combinées dans le cadre de politique mixte (policy mix) qui combine les
instruments budgétaires et monétaires, qui favorise l’expansion du budget (hausse des
dépenses ou baisse des impôts), tout en contenant l’inflation par une politique monétaire
restrictive (c à dire des taux d’intérêt élevés). Elle vise à maintenir la croissance de plein
emploi compatible avec la stabilité des prix et l’équilibre extérieur. Les Etats assurent une
régulation macroéconomique conjoncturelle, freinant l’activité économique en cas de
surchauffe inflationniste et/ou déficit extérieur et relançant l’économie en cas de croissance
trop lente et de montée du chômage. Ce sont les politiques de « stop and go ».
Plusieurs raisons se conjuguent pour expliquer l'efficacité de ces politiques. Conformément à
ce que nous avons déjà vu avec la règle de Tinbergen, il existe autant d'instruments que
d'objectifs à atteindre : politique budgétaire pour résorber le chômage, politique monétaire
pour lutter contre l'inflation, politique de change pour rétablir l'équilibre extérieur. La
combinaison de ces instruments permet d'agir sur la demande dont l'insuffisance est la cause
principale d'un chômage essentiellement conjoncturel. L'ouverture encore faible des
économies sur l'extérieur n'entraîne pas une trop forte hausse des importations en période de
reprise. Dans un contexte de taux de change fixes, l'utilisation du contrôle des changes limite
les mouvements de capitaux et assure l'efficacité de la politique monétaire. L'élasticité des
importations et des exportations à la variation des prix rend efficace la politique de change.
Enfin le contexte est favorable à la croissance : investissements élevés, gains de productivité
rapides, partage de la valeur ajoutée entre les entreprises et les salariés permettant aux
premiers de financer leurs investissements et aux seconds de consommer.
Mais le contexte change dans les années 70 et oblige à repenser les politiques économiques.
*
* *
II. …AUX REGLES
Les deux chocs pétroliers de 1974 et de 1979 dégradent simultanément les quatre côtés du
« carré magique » : ralentissement de la croissance, montée du chômage et de l'inflation, et
enfin déficit extérieur. La forte hausse des prix du pétrole alourdit les coûts des entreprises et
exerce un effet dépressionniste sur l'économie mondiale car les pays pétroliers ont une
propension à épargner plus forte que les pays industrialisés. Face à la stagflation (stagnation
de la croissance + inflation), les politiques de relance par la demande sont inefficaces. Elles
aggravent l'inflation sans résorber le chômage.
Parallèlement les thèses libérales remettent en cause l’interventionnisme keynésien.
1. La critique libérale
La critique est portée essentiellement par le courant monétariste (Friedman, Hayek) et par le
courant de la « nouvelle économie classique » ( Sargent, Wallace, Lucas, Barro et Gordon)
qui fait un retour à la théorie quantitative.
3

Un univers concurrentiel
Le cadre théorique est celui d’un système économique conforme à l’analyse néoclassique
traditionnelle, dans laquelle la flexibilité des prix assure l’équilibre.
Le Revenu permanent et stabilité de la demande de monnaie
• M. Friedman s'attache à démontrer que la consommation n'est pas fonction du revenu
courant mais du « revenu permanent », c'est-à-dire de l'ensemble des revenus présents et
futurs. Les ménages peuvent décider d'épargner la totalité de leurs revenus courants
supplémentaires. La propension marginale à consommer est instable, il n'est donc pas
possible de fonder une politique de relance de la consommation sur le multiplicateur ( car
la consommation dépend du revenu tendanciel et non du revenu courant : une hausse du
revenu n’a pas d’influence sur la consommation).
• Par ailleurs les agents économiques ont des comportements rationnels et optimisent la
gestion de leur patrimoine. Ce patrimoine est composé non slt d’actifs réels
(immeubles…), d’actifs financiers (valeurs mobilières) et d’actifs monétaires, mais aussi
de capital humain (c à dire le stock de compétences permettant à l’individu de tirer un
revenu, le revenu d’activité, de ce capital. La détention d’actifs liquides et donc la
demande de monnaie s’inscrivent dans le cadre de la gestion de ce « portefeuille ».
• De plus Friedman considère que la demande de monnaie peut-être instable à court terme,
mais reste stable à long terme car la demande de monnaie dépend du revenu permanent et
n’est donc pas en corrélation avec le revenu courant qui lui connaît des variations. A long
terme, revenu permanent et revenu courant se confondent.
Ensuite l’inflation est un phénomène monétaire
• L’inflation trouve sa source dans une création de monnaie excessive.
• Si à court terme, la monnaie peut avoir des effets réels, à long terme ça n’est pas possible :
les variations de la masse monétaire n’ont d’effet que sur le niveau général des prix. Les
prix relatifs sont flexibles et le salaire (réel) permet d’ajuster l’offre et la demande de
travail. Les politiques monétaires n’ont d’influence que sur le taux d’inflation, sans altérer
ni l’activité ni l’emploi.
• Par contre les perturbations de l’économie viennent des interventions inopportunes de la
banque centrale.
Friedman critique la courbe de Phillips
• Il l’exprime par une droite. Le taux d’inflation dépend de l’écart entre le taux de chômage
effectif et le taux de chômage naturel. Plus le niveau de chômage est faible, plus la
concurrence entre les employeurs pour embaucher les salariés est forte, plus le rapport de
force est favorable aux salariés, plus les salaires, et, par voie de conséquence, les prix ont
tendance à augmenter.
• La courbe ignore aussi les anticipations essentielles pour une politique de relance. Il faut
prendre en considération le fait que les agents tiennent compte de la hausse des prix à
laquelle ils s’attendent :
4

Tant que les salariés sont victimes d’une illusion monétaire et qu’ils ne voient pas
l’érosion du pouvoir d’achat du salaire, il est possible d’améliorer l’emploi et la
production avec en contrepartie une moindre stabilité des prix. Une hausse des
salaires incite les travailleurs à augmenter l’offre de travail, ce qui a une action
expansive sur la production et tend à réduire le chômage.
Mais dans un 2ème temps, les salariés font l’apprentissage de la réalité, modifient
leurs anticipations et réduisent leur offre de travail. Ils réalisent que leur hausse de
salaire est purement nominale et reviennent à l’équilibre réel antérieur et formulent
de nouvelles anticipations de prix.
L’économie se retrouve au niveau de chômage et de production initiale, avec un taux
d’inflation supérieur. L’arbitrage entre inflation et chômage n’existe qu’à court terme. A long
terme, l’économie revient tjrs au taux de chômage naturel. La politique de relance ne peut
faire reculer de façon durable le chômage ; elle ne fait qu’accroître le taux d’inflation. Elle est
donc condamnable.
Ces analyses ont des csq dans les politiques éco
• C’est d’abord le rejet de la politique budgétaire :
L’effet multiplicateur des dépenses budgétaires est faible si la consommation
dépend du revenu permanent et non du revenu courant.
le financement du déficit budgétaire par l’emprunt risque de générer une hausse des
taux d’intérêt, entraînant la baisse des dépenses privées. Ils soulignent également
l’existence d’un « effet d’éviction » : les emprunts publics deviennent plus attractifs
que les obligations privées.
Les déficits budgétaires conduisent aussi à un accroissement de l’endettement des
administrations publiques qui peut générer un « effet boule de neige » : le poids de
la dette publique augmente du fait que le taux d’intérêt réel est supérieur au taux de
croissance du PIB en volume. Quant aux solutions de financement monétaire du
déficit budgétaire, elles sont considérées comme inflationnistes par les monétaristes
qui vont ont alors...
• ...Une préférence pour la politique monétaire :
Elle est plus neutre que la politique budgétaire, plus respectueuse du jeu du marché.
L’objectif principal devient lutte contre l’inflation.
Il faut une politique monétaire restrictive pour lutter contre l’inflation c à dire une
contraction de la masse monétaire obtenue par une raréfaction de la monnaie
banque centrale et donc une hausse des taux d’intérêt.
mais il faut aussi une politique monétaire automatique pour neutraliser les effets
perturbateurs de l’intervention publique. L’existence de délais de réaction
nombreux justifie le recours à une politique automatique, plutôt qu’à une politique
discrétionnaire. La politique monétaire optimale consiste à fixer un taux de
5
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%