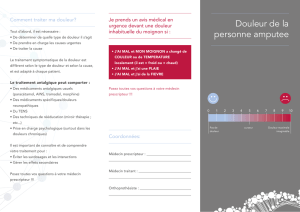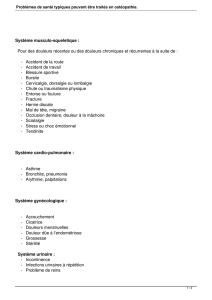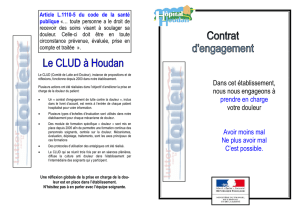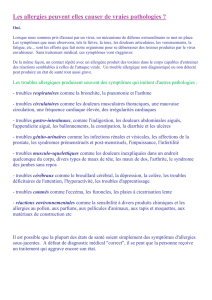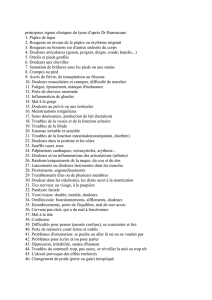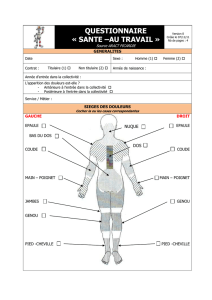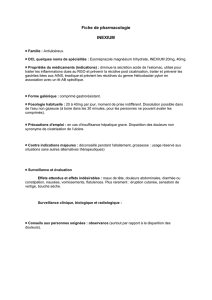Lire l`article complet

5
Le Courrier de l’algologie (2), no1, janvier/février/mars 2003
Mise au point
Mise au point
Conduite à tenir face à un patient se plaignant
d’une douleur fantôme après amputation
André Muller*
À
la suite de la première des-
cription attribuée à Ambroise
Paré en 1643, il a fallu attendre
les années cinquante pour que soient
proposées, dans les ouvrages de Le-
riche et de Bonica, des explications
physiopathologiques et des ap-
proches thérapeutiques. La fréquence
des douleurs chez les amputés,toutes
manifestations douloureuses impu-
tables à l’amputation confondues,
dépasse 70 % en postopératoire im-
médiat et affecte environ 50 % des
patients au long cours (1). Cette pro-
position signifie, d’une part, qu’il
existe différentes variétés de dou-
leurs et, d’autre part, qu’elles consti-
tuent un problème majeur, aussi bien
sous nos latitudes que dans certaines
contrées où les mines antiperson-
nelles sont la principale cause d’am-
putation de jambe.
Hallucinose
Aspects cliniques
L’hallucinose, ou membre fantôme,
n’est pas une douleur. C’est la sensa-
tion vivace de la présence de la partie
corporelle amputée : c’est donc la
“présence d’une absence”. La sensa-
tion fantôme peut survenir après
l’ablation de différentes parties du
corps, comme les dents, la langue, les
seins, les organes génitaux, le rectum
et, bien sûr, les membres : il s’agit de
parties du corps qui sont, à l’état nor-
mal, le siège de sensations extérocep-
tives et/ou intéroceptives : il n’y a,
dans la littérature, aucune mention de
rate fantôme, alors que d’autres vis-
cères, comme l’estomac ou la vessie,
peuvent être concernés. Cette simple
constatation clinique permet de dire
que la perception du corps, c’est-à-
dire le schéma corporel, est une pro-
duction du système nerveux central
alimenté en permanence par des in-
flux somesthésiques nés en périphérie.
La quasi-totalité des amputés de
membre est concernée par la sensa-
tion fantôme (1). Le fantôme est la
manifestation la plus immédiate de la
privation d’influx, qu’elle soit consé-
cutive à un arrachement de racine, à
une section nerveuse ou à un bloc
anesthésique, voire à une neuropa-
thie sévère. L’absence de perception
de l’illusion que constitue le fantôme
est exceptionnelle et ne se voit que
dans les états délirants ou les défi-
cits cognitifs, sauf cas particuliers.
Ainsi, chez l’enfant amputé avant
l’âge de 4 ans, le fantôme est rare et
transitoire. Chez les phocomèles, la
survenue du fantôme est tardive, vers
l’âge de 5 ans, lorsque la coordina-
tion motrice est bien établie, et sa
fréquence n’excède pas 15 %. Chez
les lépreux, pour lesquels la perte
d’un membre s’étale sur des mois et
survient en territoire anesthésié, le
fantôme est presque toujours absent.
Pour les patients affectés par l’hal-
lucinose, le fantôme est parfaitement
réel et fait partie intégrante du
schéma corporel (2),à tel point qu’il
apparaît en rêve ou qu’il peut être
touché par les dyskinésies aux neu-
roleptiques.
Le fantôme est le siège de sensations
non douloureuses, proprioceptives,
extéroceptives et motrices. Initiale-
ment, la longueur et le volume sont
“normaux”. En revanche, la position
est souvent identique à celle qu’oc-
cupait le membre juste avant l’inter-
ruption des influx afférents : cela est
particulièrement manifeste lors des
avulsions plexiques accidentelles ou
lors de la réalisation de blocs spinaux.
Par la suite, le fantôme peut rester in-
changé (5 % des cas), s’effacer pro-
gressivement (20 % des cas) ou se
raccourcir de telle sorte que l’extré-
mité du fantôme rejoigne le moignon
(75 % des cas). Ce télescopage
semble plus fréquent chez les patients
porteurs de prothèse. Katz (3) a sug-
géré que la forme du fantôme résiduel
constitue un reflet des phénomènes
de réorganisation somatotopique cen-
* Centre d’évaluation de la douleur, hôpital civil
de Strasbourg.
L
es douleurs des amputés ont été longtemps sous-estimées, pour
deux raisons : la première est qu’on omettait de les interroger à ce
propos ; la seconde est que les patients n’osent pas parler spontanément
de l’algohallucinose, douleur dans le membre absent, de peur d’être pris
pour des “malades imaginaires”. De plus, l’algohallucinose est en soi an-
goissante pour un patient non prévenu, puisque la sensation fantôme et
la douleur “contredisent” l’une et l’autre la perte du membre.
Mots-clés :Hallucinose – Algohallucinose – Traitements.

6
Le Courrier de l’algologie (2), no1, janvier/février/mars 2003
trale et que cela est conditionné par la
somme d’influx nés du membre avant
l’amputation. La forme du fantôme
reste sujette à des modifications spon-
tanées ou provoquées. La liste qui suit
ne constitue qu’un échantillon des si-
tuations qui peuvent influer sur les
sensations dont le fantôme est le
siège : variations climatiques ; défé-
cation, miction, orgasme (pour le
membre inférieur) ; pathologie du
moignon ; pathologie à distance, dans
les mêmes myélomères (cystite, par
exemple) ; facteurs cognitifs (atten-
tion, distraction) ; “manipulations”
thérapeutiques (palpation du moi-
gnon, infiltration de toutes les struc-
tures dépendant des mêmes nerfs ou
myélomères, stimulation électrique,
acupuncture, port de prothèse, stimu-
lation tactile à distance...). Les infor-
mations visuelles peuvent aussi in-
fluencer le fantôme. Ainsi, l’image
fournie par un jeu de miroirs qui
donne au patient l’illusion de voir son
corps entier et complet réactive le fan-
tôme, s’il avait disparu. De plus, si un
examinateur touche alors le membre
non amputé, ce qui donne au patient
la “vision” que les deux membres sont
touchés, il ressent aussi cette stimu-
lation dans le fantôme.
Les sensations extéroceptives peu-
vent être extrêmement variées : cha-
leur, froid, pression, port de chaus-
sure... La frontière avec des douleurs
superficielles n’étant pas toujours
très nette. Certains patients, et en par-
ticulier les plus jeunes, sont capables
de bouger volontairement leur fan-
tôme. Les mouvements involontaires
sont plus fréquents, confinant par-
fois à des postures irréductibles.
Par définition, l’hallucinose n’est pas
douloureuse et ne nécessite donc pas
de traitement. En revanche, chaque fois
que cela est possible, il serait souhai-
table de prévenir les patients de la sur-
venue d’un fantôme et de les rassurer.
Aspects physiopathologiques
La réalité du fantôme tient à ce qu’il
est généré par les mêmes mécanismes
centraux que ceux qui sous-tendent
le schéma corporel d’un organisme
intact, schéma dans la genèse duquel
l’accent est mis non seulement sur
l’acquis, mais aussi sur l’inné (4). En
effet, l’imitation des mouvements par
les nouveau-nés suggère l’existence
d’une forme innée du schéma corpo-
rel, qui précède la constitution, ou plu-
tôt le façonnage, du schéma corporel
de l’adulte (5, 6). Ce façonnage re-
pose sur des afférences visuelles, mais
surtout sur des afférences somato-sen-
sorielles et sur le contrôle en retour
exercé par des efférences motrices.
La neuromatrice est constituée par un
ensemble de neurones appartenant à
différentes structures (thalamus, sys-
tème limbique, cortex sensoriel, cor-
tex moteur, cortex insulaire, lobes pa-
riétaux postérieurs) et connectés entre
eux selon un déterminisme génétique.
Ces connexions sont modulées par les
expériences individuelles et sont res-
ponsables de la façon dont sont trai-
tées les informations, qui portent alors
une marque, appelée “neurosigna-
ture”. C’est la neuromatrice du
schéma corporel qui génère les expé-
riences sensorielles du corps, les in-
flux modulant les efflux. Ce qui dé-
coule de ce concept, c’est que les
perceptions sont produites, en réponse
à des influx afférents, par le système
nerveux central : ainsi, lors d’une lé-
sion d’un doigt, la douleur n’est pas
dans le doigt en question, mais dans
la partie du schéma corporel corres-
pondant à ce doigt ; de même, on peut
comprendre que des objets (chaus-
sure, bague, stylo, comme cela a été
décrit chez un écrivain amputé) “in-
tègrent” le schéma corporel. L’ampu-
tation ne peut pas supprimer la trace
du membre mais, en l’absence d’in-
flux afférents, peut le rendre vivace,
d’où le fantôme (figure 1).
Les stimulations nociceptives peuvent,
à elles seules, en l’absence d’amputa-
tion, déclencher des sensations fan-
tômes chez 30 % des sujets sains, par
réorganisation somatotopique de la
neuromatrice : ainsi, la stimulation tac-
tile de la lèvre inférieure peut évoquer
une sensation fantôme dans la main
homolatérale, à la condition que cette
dernière ait fait l’objet d’une stimula-
tion nociceptive préalable (5). L’ori-
gine centrale du fantôme après ampu-
tation tient également à une
réorganisation de la neuromatrice, et la
précocité des modifications observées
plaide en faveur d’une désinhibition
de connexions jusqu’alors silen-
cieuses. En effet, en quelques heures,
la partie désafférentée de la neuroma-
trice est activable par des stimulations
tactiles appliquées à distance, dans des
zones dont la représentation est voi-
sine de la zone privée de ses influx ha-
bituels. L’IRM fonctionnelle pratiquée
Mise au point
Mise au point
Figure 1. Concept de neuromatrice (d’après référence 6).
Thalamus Neurosignature (représentation stéréotypée du corps)
L’ischémie se
développe en
provoquant
une douleur
Neuromatrice
(connexions
neuronales vers
le système limbique
et le cortex)
Douleur ischémique
des membres dans
la neurosignature
Membre amputé :
la neurosignature
trace la sensation
de douleur ischémique
La neurosignature
génère encore
la douleur ischémique ;
le névrome contribue
vraisemblablement
à cette perception
2
134
Amputation Névrome

7
Le Courrier de l’algologie (2), no1, janvier/février/mars 2003
Mise au point
Mise au point
chez un amputé de bras a montré l’im-
plication des aires S I et S II et du gy-
rus cingulaire dans ce phénomène.
Cette théorie permet aussi d’appré-
hender l’algohallucinose (du fait d’in-
flux anormaux dus à l’électrogenèse
ectopique, et du fait de traces mné-
siques de douleurs préalables) et d’ex-
pliquer l’épilepsie du moignon, ainsi
que la possibilité de mouvements vo-
lontaires du fantôme, puisque la neu-
romatrice du schéma corporel projette
sur une neuromatrice d’action.
Diversité des douleurs
chez les amputés
Toute douleur affectant chez un am-
puté le fantôme ou le moignon n’est
pas forcément liée de facto à l’am-
putation. Ces régions peuvent être le
lieu de la perception d’une douleur
projetée ou d’une douleur référée.
Dans le premier cas, l’irritation
proximale d’une racine nerveuse ou
d’un tronc nerveux à destination de
la région amputée donnera une dou-
leur perçue sur le moignon ou dans
le fantôme : ainsi en est-il d’une her-
nie discale lombaire qui entraîne une
douleur ressentie dans une jambe
amputée. Dans le second cas, et le
phénomène est bien connu des pa-
tients, c’est une pathologie viscérale
ou somatique qui, du fait de conver-
gences viscéro-somatiques ou so-
mato-somatiques, entraîne une dou-
leur dans le moignon ou dans le
fantôme : ainsi en est-il d’une cystite
qui peut réactiver une algohalluci-
nose de membre inférieur, ou d’un
infarctus du myocarde qui, en plus de
la douleur viscérale rétro-sternale,
donne une sensation douloureuse
dans le bras gauche amputé.
Les douleurs relevant de l’amputation
sont de deux types : les douleurs du
membre fantôme (algohallucinose),
et les douleurs du moignon d’ampu-
tation. Si les premières relèvent des
conséquences de la section nerveuse,
les secondes peuvent être dues soit à
des pathologies locales, soit à des lé-
sions nerveuses cicatricielles.
Algohallucinose :
aspects cliniques
Ce terme recouvre les douleurs,
conséquences de l’amputation, res-
senties dans le membre fantôme.
Elles se voient chez près de 72 % des
patients en postopératoire immédiat,
et ressemblent, chez 36 % d’entre
eux, aux douleurs préopératoires (7).
Par la suite, ces douleurs n’affectent
plus que 40 à 60 % des amputés, la
proportion de similitude avec les
douleurs préopératoires n’étant plus
que de 10 % à 3 %.
La ressemblance, dans certains cas,
entre la douleur du fantôme et la dou-
leur préopératoire a conduit Katz (8)
à postuler l’existence d’une “mé-
moire somato-sensorielle”. Il a
constaté que l’algohallucinose est
plus fréquente lorsqu’il y a des dou-
leurs en préopératoire immédiat dans
le membre à amputer. A contrario, la
sédation des douleurs pré- et peropé-
ratoires semble diminuer la fréquence
de l’algohallucinose. Touchant en
postopératoire immédiat près d’un
tiers des patients atteints d’algohal-
lucinose, leur fréquence à long terme
se maintient autour de 10 %. Ces
douleurs concernent, pour l’essentiel,
des patients qui souffraient de façon
importante dans les jours ou semaines
précédant l’amputation (1). À tel
point qu’une sédation de ces douleurs
préopératoires fait disparaître toute
algohallucinose, du moins pour cer-
taines modalités antalgiques débu-
tées deux à trois jours avant l’ampu-
tation et poursuivies d’autant en
postopératoire. Il semble donc que
les mécanismes de plasticité qui au-
torisent l’inscription mnésique de ces
douleurs soient réversibles. Ces
traces sont présentes dans la neuro-
matrice, qui peut les libérer.
Mais il est aussi des douleurs du fan-
tôme tout à fait différentes des dou-
leurs préopératoires,qui seraient
dues à l’activation de la neuromatrice
par des influx inhabituels, en plus –
activité spontanée du névrome, par
exemple – ou en moins – absence de
bruit de fond somesthésique. Cela est
bien illustré par l’exagération des
douleurs de fantôme parfois obser-
vée lors des périodes d’installation
ou de régression des blocs anesthé-
siques spinaux. Ces douleurs consti-
tuent la majorité des manifestations
de l’algohallucinose. Elles sont ex-
ceptionnelles chez l’enfant jeune,
transitoires chez l’adolescent, et plus
fréquentes chez les sujets âgés. À
cette proportion grandissante avec
l’âge, il y a sans doute plusieurs ex-
plications : attitude face à la douleur,
expériences nociceptives antérieures
dans le membre, influence des neu-
ropathies. Il s’agit de douleurs le plus
souvent distales dans le fantôme.
Leur description, dans l’analyse par
questionnaires, revêt un caractère
neuropathique : “brûlure, décharge
électrique, froid, fourmillement,
crampe, contracture”, mais pas ex-
clusivement : “étau, ongle incarné,
fer rouge...”. Bien qu’elles ne soient
pas constantes, leur répétition en fait
des douleurs chroniques. Pendant les
périodes douloureuses, se manifeste
un fond douloureux, qui dure de
quelques heures à quelques jours, et
sur lequel se greffent des paroxysmes
de quelques secondes, survenant en
trains d’ondes répétitifs. Ces douleurs
sont plus fréquentes chez les patients
qui présentent des douleurs du moi-
gnon d’amputation, et sont atténuées
par le port d’une prothèse adaptée. Il
semble en effet exister une corréla-
tion entre l’état cutané, circulatoire,
musculaire du moignon et la présence
de douleurs dans le fantôme. Cela
atteste que, en partie tout au moins,
l’algohallucinose est étroitement dé-
pendante des conséquences neuro-
chimiques et électrophysiologiques,
périphériques et centrales, de la sec-
tion nerveuse. Les facteurs modulant
la douleur sont identiques à ceux qui
ont été décrits pour la sensation fan-
tôme.
Douleurs du moignon :
aspects cliniques
Nous n’aborderons que les douleurs
conséquences directes ou indirectes
de l’amputation, les autres douleurs
(poursuite de l’artérite, fracture...)
n’étant mentionnées que pour mé-
moire. Les douleurs du moignon sont

8
Le Courrier de l’algologie (2), no1, janvier/février/mars 2003
fréquentes : de 57 % en postopéra-
toire immédiat jusqu’à 20 à 40 % à
distance (1). Elles n’existent isolé-
ment que chez environ 20 % des pa-
tients et sont associées à l’algohal-
lucinose chez près de 20 % des
patients amputés.
Il y a indiscutablement différents
types de douleur, bien que cela ne
soit pas clairement précisé dans la
majorité des publications. Certaines
sont liées à une pathologie locale
(infection, ischémie, éperon osseux,
prothèse mal adaptée, névrome en
position sous-cutanée) aisément re-
pérable à l’examen clinique. D’autres
sont la conséquence de la désaffé-
rentation.
Le névrome du sciatique est ex-
ceptionnellement en cause dans la
douleur du moignon, alors qu’il est
l’une des sources de l’algohalluci-
nose d’un membre inférieur : son ac-
tivité anormale, spontanée ou pro-
voquée, est ressentie comme une
douleur projetée dans le fantôme.
En revanche, si la peau qui recouvre
la tranche d’amputation est plus sou-
vent le siège d’une hyperalgésie, cela
est la conséquence de la lésion de pe-
tits filets nerveux.C’est elle qui est
affectée par des douleurs à type, par
exemple, de dysesthésies, brûlures,
décharges électriques, survenant par
périodes, qui combinent un fond dou-
loureux avec paroxysmes surajoutés.
Ces douleurs ont fréquemment une
note causalgique et entrent dans le
cadre des douleurs entretenues par
l’activité sympathique. Les anoma-
lies du sympathique efférent sont
constantes, même en l’absence de
douleurs (9). L’effet délétère de l’hy-
peractivité du sympathique efférent
sur les douleurs est connu, bien que
l’intimité neurochimique en reste
partiellement inexplorée. Ce type de
douleurs est évoqué chaque fois
qu’est présente une constellation de
signes cliniques : altérations de la co-
loration et de la température cutanées,
hyperesthésie, hyperpathie, allody-
nie thermique, extension de la dou-
leur en quadrant.
L’épilepsie du moignon, accès de
mouvements cloniques, est la dernière
entité douloureuse. Elle est rare, pré-
cédée de peu par un accroissement du
tonus des muscles du moignon, et dé-
clenche des douleurs dans le fantôme.
Sa physiopathologie est mal élucidée.
Aspects
physiopathologiques des
douleurs neuropathiques
Toute ablation d’une partie du corps
s’accompagne d’une section complète
de certains nerfs, et d’une lésion par-
tielle de filets nerveux qui seront se-
condairement pris dans le tissu cica-
triciel. La lésion et/ou l’irritation de
filets nerveux ont un certain nombre
de conséquences, anatomiques et
fonctionnelles, neurochimiques et
électrophysiologiques,conséquences
qui permettent d’appréhender la cli-
nique et qui fournissent une base rai-
sonnée aux thérapeutiques (figure 2).
La conséquence anatomique la plus
évidente est la dégénérescence wal-
lérienne suivie de la régénérescence,
qui ne concerne que 85 % des fibres
lésées. Les fibres sectionnées ne re-
trouveront pas de cible et constitue-
ront un névrome dans lequel les fibres
C sont proportionnellement surre-
présentées, et dans lequel existent des
courts-circuits, ou éphapses, entre les
divers types de fibres afférentes et ef-
férentes. Du côté proximal spinal, la
dégénérescence transsynaptique
laisse des synapses vacantes qui sont
préférentiellement réinnervées par
des collatérales des grosses fibres so-
mesthésiques. Il y a donc une réor-
ganisation somatotopique dès l’éche-
lon spinal. Cette réorganisation se fait
à tous les niveaux, thalamique et cor-
tical, ainsi que l’attestent à la fois
l’imagerie fonctionnelle et certaines
constatations cliniques. C’est en effet
cette réorganisation centrale qui per-
met d’expliquer des sensations réfé-
rées, par exemple une perception tac-
tile dans un fantôme de membre
supérieur lorsqu’une pression est ap-
pliquée sur la joue homolatérale.
Comme cela a déjà été mentionné
Mise au point
Mise au point
Déficit
neurologique
Perte
de fibres
Sensibilisation
des nocicepteurs
DL nociceptive
du nerf Douleur
neuropathique Signes irritatifs
Causalgie Contrôles
descendants
perturbés
Électrogenèse
anormale
spontanée et/ou
provoquée
Réflexes
spinaux
perturbés
Activité
spinale
anormale
Réactivité
exagérée au
site de lésion
SENSATIONS
ANORMALES
SPONTANÉES ET/OU
PROVOQUÉES
Éphapses
M
É
M
O
I
R
E
LÉSION ET/OU
IRRITATION
DU NERF
Figure 2. Physiopathologie de la section nerveuse (les cases vertes désignent les cibles des
thérapeutiques).

9
Le Courrier de l’algologie (2), no1, janvier/février/mars 2003
Mise au point
Mise au point
dans la physiopathologie de l’hallu-
cinose, la réorganisation n’est pas
l’apanage des lésions nerveuses, et
peut aussi être obtenue par des sti-
mulations nociceptives répétitives.
Les fibres qui n’ont été que partiel-
lement lésées sont plus volontiers
source de douleurs car il persiste à
leur extrémité des nocicepteurs qui
peuvent être sensibilisés, et qui, de
fait, “alimentent” en influx anor-
maux les neurones centraux déjà
spontanément réactifs.
Les conséquences neurochimiques
sont multiples et affectent les noci-
cepteurs résiduels, les cellules du
ganglion rachidien et les neurones
centraux. Les cytokines pro-inflam-
matoires produites par les cellules de
Schwann contribuent, avec la volée
d’influx afférents, à ces altérations.
Initialement, on note dans les affé-
rences une élévation du taux de syn-
thèse des structures constitutives de
l’axone (tubuline, actine, GAP-43),
avec des exceptions (neurofilament),
une diminution du taux de synthèse
de certaines molécules informatives
(tachykinines,CGRP,somatostatine)
ainsi que de leurs enzymes de fabri-
cation, et une augmentation du taux
de synthèse d’autres neurotransmet-
teurs (galanine, VIP, NO, NPY, PA-
CAP et, dans les afférences fines,
CCK). La densité des récepteurs si-
tués sur les afférences est aussi per-
turbée, avec diminution de celle des
récepteurs aux opioïdes et au NPY,
augmentation de celle des récepteurs
à la CCK sur les fibres fines et éléva-
tion de celle des récepteurs au NPY
et à la CCK sur les grosses afférences.
Dans le ganglion rachidien, la densité
des fibres ß-adrénergiques croît. On
note aussi des modifications concer-
nant les diverses variétés de canaux
sodiques, puisque le nombre des
canaux sensibles à la tétrodotoxine
augmente alors que celui des canaux
résistants diminue ; ces canaux anor-
maux s’accumulent dans le névrome,
ce qui, avec l’invasion de canaux
mécano-sensibles et de fibres adré-
nergiques, contribue à son hyperex-
citabilité. Dans la corne postérieure
de la moelle, certaines altérations cor-
respondent à celles de la terminaison
des afférences, d’autres concernent
les deutoneurones et d’autres, enfin,
les interneurones et les fibres des-
cendantes. La dégénérescence des af-
férences s’accompagne, outre les va-
riations citées précédemment des
taux de neurotransmetteurs, d’une
perte des récepteurs à localisation
présynaptique : ainsi y a-t-il une
chute modeste de la densité des ré-
cepteurs ß2-adrénergiques et une
chute plus prononcée (environ 50 %),
et pratiquement réversible en quelques
semaines, de la densité des récepteurs
opioïdes µ et . Si le taux des enké-
phalines reste quasi inchangé, celui
des dynorphines s’élève considéra-
blement pendant les premiers jours
et cela semble être le fait de l’ex-
pression anormale de la protéine c-
fos, induite par la décharge d’influx
concomitante de la section. Les ré-
cepteurs postsynaptiques à la CCK
voient leur nombre s’élever, de même
que les récepteurs AMPA aux acides
aminés excitateurs. Quant aux mo-
noamines des voies descendantes,
leur taux est variable dans les axoto-
mies, où le métabolisme de la séro-
tonine est accru.
Les conséquences électrophysiolo-
giques,qui résultent des anomalies
citées précédemment, consistent pour
l’essentiel en une électrogenèse anor-
male, aussi bien au site de lésion que
sur les relais d’aval, et en une altéra-
tion des contrôles physiologiques de
la transmission nociceptive.
Témoignant de connexions anor-
males, les altérations touchent de
nombreux réflexes. L’amplitude et
le décours des réflexes moteurs
mono- et polysynaptiques à point de
départ somatique sont perturbés. La
vasodilatation cutanée qui fait habi-
tuellement suite à une stimulation no-
ciceptive est remplacée par une vaso-
constriction. Chez des amputés sans
douleur, la réponse sympathique à
destinée musculaire est exagérée lors
de variations thermiques, alors que le
sympathique à destinée cutanée pré-
sente une réactivité normale (9). L’at-
ténuation du potentiel de racine pos-
térieure qui, dans les conditions habi-
tuelles, joue un rôle inhibiteur, est
concomitante de la réorganisation so-
matotopique médullaire. L’inhibition
postsynaptique due aux fibres A est
diminuée. Enfin, les structures inhi-
bitrices du tronc cérébral deviennent
excitatrices pour les neurones médul-
laires, du moins après rhizotomie.
Les fibres nerveuses en cours de re-
pousse sont, au bout de quelques
jours, le siège d’une hyperactivité
qui concerne tous les types de fibres.
L’hyperactivité spontanée est va-
riable selon les espèces animales. Elle
concerne en premier les fibres myé-
linisées, pour lesquelles elle atteint
un maximum deux semaines après la
section, affectant environ 25 % des
afférences, avant de décroître sans ja-
mais disparaître totalement. L’acti-
vité spontanée de la majorité des
fibres myélinisées est de type ryth-
mique, par trains d’ondes survenant
à des fréquences supérieures à 20 Hz.
Les fibres amyélinisées sont concer-
nées plus tardivement, leur activité
restant plus soutenue et devenant pré-
dominante après le premier mois.
Elle est plus arythmique. L’environ-
nement physico-chimique du né-
vrome a son importance dans cette
activité spontanée puisqu’un né-
vrome “protégé” est pratiquement in-
actif. À cette hyperactivité spontanée
s’ajoute une plus grande sensibilité à
de multiples stimulations. Les fibres
myélinisées réagissent aux stimula-
tions mécaniques de façon limitée ou,
pour certaines d’entres elles, avec une
postdécharge prononcée. Les fibres
amyélinisées sont extrêmement sen-
sibles aux changements de leur envi-
ronnement physico-chimique et mé-
tabolique avec, en particulier, une
réactivité exagérée aux agents ß-adré-
nergiques. Leur excitabilité est ac-
crue par le froid alors que celle des
fibres myélinisées l’est par la chaleur.
Les cellules ganglionnaires,qui ont
spontanément des potentialités de
pacemaker, sont également le siège
d’une électrogenèse anormale, spon-
tanée et provoquée, en général de
type arythmique.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%