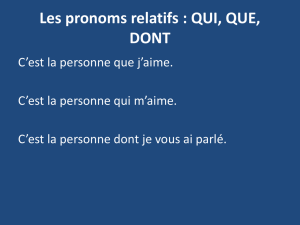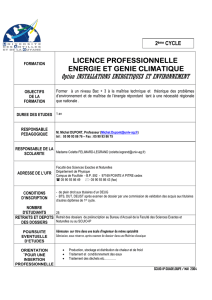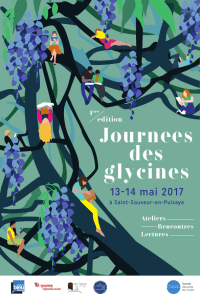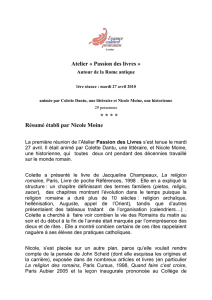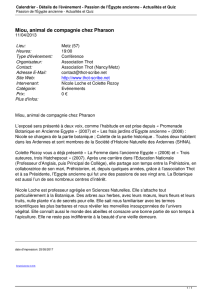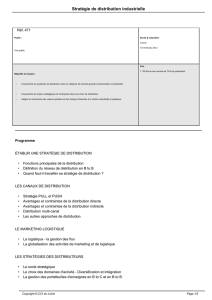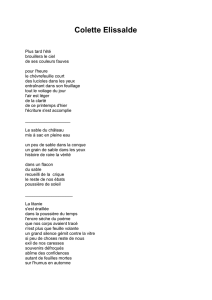Ouvrir dans une fenêtre indépendante

Louis Forestier
Professeur émérite à la Sorbonne, vice-président d'honneur de I'AMOPA
Au lendemain de la mort de Colette, en 1954, Jean Paulhan estimait que nous venions de perdre notre plus grand critique. Naturellement, le
public qui ne voyait dans l'auteur de « Gigi » que le peintre de la nature, des chats, des chiens, des perruches et de la femme, prit cette
affirmation pour une boutade. Pourtant, deux ans plus tard, le dernier compagnon de Colette, Maurice Goudeket, revenait sur la même idée
en la précisant: « On commence à s'apercevoir que [ses] chroniques dramatiques ont, dans l'œuvre de Colette, une importance majeure ».
N effet, en parlant de théâtre, Colette ne se comporte pas en critique banale. Elle ne se contente pas de s'asseoir
dans son fauteuil d'orchestre et de réagir en spectateur ordinaire. Elle a, si j'ose dire, un pied dans la salle et un
pied sur la scène. On se rappelle, naturellement, qu'au tournant du siècle -le vingtième- les nécessités de la vie
la conduisent à exercer la profession de danseuse et de mime. Elle débute le 2 février 1906, à l'âge de trente-trois ans, sur
la scène du théâtre des Mathurins. Elle y interprète le rôle d'un faune dans un mimodrame aguicheur
intitulé Le Désir. On la verra ensuite dans La Romanichelle, puis dans Pan où elle apparaît à peu près
nue sous une courte tunique largement flottante. Un an plus tard, c'est Rêve d’Égypte au Moulin Rouge.
Elle joue une momie qu'un archéologue délivre de ses bandelettes jusqu'à la faire apparaitre dans le
plus simple appareil toléré sur scène en ce temps-là. Scandale sans précédent : cris, insultes, jets de
divers projectiles à travers la salle et sur la scène. Le spectacle est interdit après la seconde
représentation. Colette n'en continue pas moins sa carrière, traînant après elle une odeur de soufre,
allant de ville en ville au hasard des tournées, familière du trac, des nuits sans sommeil dans les trains
et des coulisses parcourues de comédiens faméliques et de bises glaciales. Tout cela, elle nous l'a
raconté dans un roman, La Vagabonde, et dans un livre de souvenirs, L'Envers du Music-hall. Aussi,
devenue critique, se trouve-t-elle particulièrement réceptive, voire indulgente, à tout ce qui touche au théâtre et aux
comédiens.
On oublie trop, d'autre part, que, si Colette fut comédienne, elle fut également, tout au long de sa carrière d'écrivain,
dramaturge, essayiste, auteur de sketches pour revues, et critique dramatique.
Ces critiques parurent dans des périodiques et revues comme L'Eclair, La Revue de Paris, Le Matin; c'est surtout au
quotidien appelé Le Journal qu’elle fut le plus longuement fidèle. Ce quotidien, de tendance conservatrice, fondé en
1892 et actif jusqu'en 1944, est très lu à l'époque. C'est dans ses colonnes que, soir après soir, Colette rend compte de la
vie théâtrale depuis octobre 1933 jusqu'à juin 1938, date à laquelle elle rompt avec la direction. Elle poursuit alors ses
chroniques dans Le Petit Parisien et La Revue de Paris. Par chance pour nous, Colette a réuni la plupart de ses articles
en cinq volumes qu’elle a intitulés « La Jumelle noire ».
Pourquoi ce titre ? Pour un motif tout anecdotique qu'elle nous a confié elle-même. Colette ne jouissait pas d'une
bonne vue. Aussi, lorsqu’elle se rendait au théâtre, se munissait-elle d'une petite jumelle qui lui procurait la commodité
d'apprécier, dit-elle, « la physionomie des acteurs, la beauté des actrices ». Or, un soir que la romancière avait posé sa
jumelle sur la tablette d'un vestiaire, une main aussi adroite que coupable la subtilisa. Seul le souvenir en demeure dans
le titre de ce livre. Le contenu en est incroyablement varié, car Colette n’hésite pas à discourir de tous les genres
dramatiques possibles. Bien sûr, c'est le théâtre proprement dit qui remplit l'essentiel de ses comptes rendus; mais elle
parle aussi d'opéras, d'opérettes, voire de ballets à propos desquels passent le souvenir des ballets russes de Diaghilev et
l'émerveillement qu'elle éprouve devant « ce moment incalculable de délire qui, à l'apogée d'un bond, immobilisait
Nijinsky dans l'air ». Elle garde de ses années de jeunesse une sympathie attendrie pour le music-hall dont elle connaît
personnellement toutes les exigences et les difficultés. Quand elle parle de Joséphine Baker, de la revue des Variétés ou
de celle des Folies Bergère, c'est un peu de son expérience qu'elle revit. Enfin, elle n’oublie pas le cinéma dont elle
mesure l'intérêt par rapport au théâtre et dont elle pressent le prodigieux essor :

« J'ai vu naître le cinéma. Un mécanisme se mettait en route, et l'image minuscule d'une danseuse recevait le don de
la vie.., Le cinéma commet encore des balourdises d'une force neuve. Il crée des prodiges de poésie et les affuble du
vilain nom de “documentaire”. II n'arrivera pas à me détacher de lui, de son mauvais goût, de ses prestiges et de ses
vérités. Comme il est ma dernière curiosité, il sera mon dernier voyage terrestre ».
Curiosité qui se traduit par sa collaboration à plusieurs films : Lac aux dames, par exemple.
LES CHRONIQUES
Si le plan des chroniques est assez conventionnel (mise en situation de l'auteur, résumé de la pièce, appréciation des
décors, de la mise en scène et de l'interprétation), le ton en est extrêmement neuf et savoureux. Elles s'agrémentent de
souvenirs personnels (par exemple sur la rue de la Gaîté au temps où Colette elle-même y jouait la pantomime) ou bien -
à propos de la pièce Fric-Frac- de réflexions quasi philologiques sur l'argot, pimentées d'une traduction de « sauve-qui-
peut! » en javanais qui donne, comme vous le savez je suppose: savauvquavipaveu... Inattendues, cocasses, émouvantes,
ces chroniques procurent au lecteur un plaisir sans cesse renouvelé.
J'ai dit chroniques. Si je me réfère à l'étymologie, le mot implique un lien avec le temps. La chronique est un texte écrit
au jour le jour sous la pression de l'actualité. Elle suit le calendrier des répétitions générales et des premières, et plus
communément le cours des modes théâtrales. Elle est tributaire du goût des spectateurs, à un moindre degré de celui du
critique, voire des tendances du journal dans lequel elle paraît. À lire La Jumelle noire, on peut éprouver l'impression
superficielle d'un fatras: un compte rendu de la revue de l'ABC y précède sans logique celui d'une tragédie de
Shakespeare. En réalité, on est plongé dans la richesse et la variété d'une époque où le théâtre était encore roi. On le
devine, ces chroniques sont menacées par le vieillissement et le risque d'oubli entraîné par le temps qui passe: qui
connaît encore La chaleur du sein d'André Birabeau que le théâtre Daunou représenta en novembre 1937 ? Les
chroniques de Colette pourraient donc sembler la nécropole d'un théâtre mort. Il n'en est rien. Elles conservent tout leur
intérêt si on les envisage d'un triple point de vue : comme le témoignage d'un moment de l'histoire du théâtre;
comme le pressentiment d’un avenir en train de se dessiner; enfin, comme un lot d'observations éternelles. À la
question de savoir si ces chroniques, vieilles de quatre fois vingt ans, sont dépassées, je répondrai en effeuillant la
marguerite: très peu, beaucoup, et pas du tout.
Elles sont d'abord un extraordinaire panorama théâtral des cinq ou six années qui précèdent la
Dernière Guerre Mondiale. En effet, Colette est extrêmement consciencieuse et ne manque
pratiquement jamais la première d'une nouvelle pièce. Si elle le fait, elle s'en excuse auprès de ses
lecteurs. En cinq saisons, elle rend ainsi compte de plus de 210 spectacles. Elle se plaint,
d'ailleurs, de ce labeur contraignant, parfois ennuyeux ; car, rentrée chez elle, M
me
Colette doit
écrire son « papier » en tentant d'être exacte, équitable et attrayante. Avec le recul du temps, nous
constatons qu'il y a beaucoup de déchet parmi toutes ces pièces. Représenterait-on aujourd'hui -
lirait-on même- Maria d'Alfred Savoir ? Va savoir ! Et ce Gilles de Rais du romancier Albert-
Jean ? Il semble que l'auteur y ait pris quelque liberté avec l'histoire, ce qui conduit Colette à
nous raconter, avec humour, comment le seigneur de Tiffauges, tout en pataugeant dans le sang,
se trouve être le premier des communistes, dit-elle, (nous sommes en 1935) et développe un
« programme électoral [qui] comporte le partage des richesses et l'abaissement
des grands ».
Décidément, ce Gilles 1935 sent venir le Front populaire.
Cependant, La Jumelle noire fait apparaître quelques constantes plus intéressantes. L’une des plus évidentes est
l'importance que conserve le théâtre de boulevard. Par ses origines, il se veut populaire et pur divertissement. Il
s'épanouit au théâtre des Variétés ou au Palais Royal. Parmi ses illustrateurs, à l'époque de Colette, citons Marcel
Achard, Sacha Guitry ou Roger Ferdinand. Si certaines pièces comportent un brin de polissonnerie, dont Colette avoue
qu’il choque un peu sa « pudibonderie paysanne », elle ne boude pas son plaisir à la plupart d'entre elles. Elle analyse
finement ce qui caractérise les meilleures: le sens du mot et de la réplique chez Marcel Achard; une fluidité, un humour
nonchalant dans N'écoutez pas Mesdames de Sacha Guitry. L’objectif est de rendre le spectateur heureux. Colette, qui est
bon public et qui ne déteste pas la « bonne grosse pièce », comme elle dit, se laisse prendre au jeu et constate même que
ce type d'œuvre légère s'offre parfois « le droit de s’élever jusqu’à la grande comédie, jusqu'au seuil, entrouvert, puis
habilement refermé, d'un drame ». Et pourtant, c'est à peine si nous nous souvenons de Fric-Frac d'Edouard Bourdet,
que j'ai déjà cité; quant à des pièces, d'ailleurs estimables, comme Les Jours heureux de Claude-André Puget ou Liberté
provisoire de Michel Duran, c'est à peine si elles survécurent à la Seconde Guerre Mondiale.
Une autre constante de cette activité théâtrale d'avant-guerre est la présence à l'affiche des œuvres de Shakespeare.
Colette elle-même en est frappée : « Shakespeare à l'honneur toute la saison dernière », écrit-elle en 1934, « n'a pas fini
de renaître ». En effet, voici que sont représentés Richard III, Rosalinde, Beaucoup de bruit pour rien, Othello ou
Roméo et Juliette. Et je passe l'adaptation cinématographique du Songe d'une nuit d'été par Max Reinhardt dont Colette
parle longuement. On observe que ce ne sont pas toujours les plus grandes œuvres qui sont reprises. Ce ne sont pas non
plus les plus grandes salles qui montent ces spectacles. En dehors d'une mise en scène de Coriolan restée fameuse à la
Comédie Française, c'est à l'Atelier ou aux Mathurins qu'il faut aller rencontrer le grand Will. Il envahit le boulevard,
comme si le gros du public y retrouvait l'écho des problèmes qui agitent ces années 1933-1938 -barbarie, guerre civile-
en même temps que la manière d'y échapper en se réfugiant dans le spectacle de la passion ou les charmes du
merveilleux.
C'est surtout dans l'évocation d'une époque à la fois familière et révolue que nous plongent ces chroniques : soirées
brillantes des premières, causeries à l'entracte, charme froufroutant des toilettes, diamants et « petits chignons en noyaux
de pêche »; on aime le répertoire un peu suranné d'un François de Curel ou le scalpel d'un Henry Bernstein qui ne cesse
d'autopsier les cœurs; c'est le temps des vedettariats mythiques, celui d'une Mistinguett toujours jeune, celui d'une Cécile
Timbre-poste
à
l‘effigie
de
Colette

Sorel qui ne vieillit plus et va du rôle de Célimène au grand escalier du Casino de Paris, sans compter Joséphine Baker
dont la ceinture de bananes surprend encore. Nul n’échappe à la petite jumelle noire; et je ne parle pas d'un fringant
Maurice Chevalier que Colette croque avec le brio d'un dessinateur :
« Son canotier, son smoking, son teint de blond authentique [...] quant à l'œil nous savons qu'il est d'un bleu
indélébile, fais et gai, l'inclinaison du chapeau de paille, le coup de reins en arrière, le coup de lombes en avant, le jeu
précis des jambes, tout cela nous est extraordinairement connu, cerné d'un trait précis, et sympathique ».
LE RENOUVEAU DE LA SCÈNE THÉÂTRALE
Chère Colette toujours attentive à ce music-hall dans lequel elle
retrouve l'image de ses trente ans. Nostalgique certes, mais attentive
aussi à tout le bouillonnement théâtral de son temps, dont elle devine
les richesses et les promesses. Ne nous confie-t-elle pas, avec une
pointe d'humour et de fierté: « je m'accorde de temps en temps de faire
la devineresse » ?
Elle qui a été élevée dans la tradition des toiles peintes et des vieux
décors en trompe l'œil du XIX
e
siècle, elle qui était habituée aux acteurs
bichonnés dans les traditions du Conservatoire, assiste étonnée, parfois
réticente mais toujours curieuse, à l'éclosion d'une nouvelle conception
de la mise en scène. Elle s'effare devant les audaces d'un Antonin
Artaud, dont on sait qu’il tenta de promouvoir un théâtre de la cruauté. En 1935, il choisit de monter Les Cenci : cette
histoire de viol, d'inceste et d'assassinat, qu'on croirait sortie de feu le Grand Guignol, est propre à illustrer les théories
du metteur en scène. Mais Colette ne s'en laisse pas conter: elle ne croit pas que la véhémence échevelée est l'équivalent
de la terreur tragique, ni qu'un croque-mitaine est un monstre effroyable. Et pourtant, elle essaie de comprendre ces
tentatives et termine son article par une indulgence touchante : « Antonin Artaud [...] est insupportable, et nous le
supportons car sa lumière est celle de la foi ».
C'est, cette fois, dans le théâtre qu'elle est toujours prête à accueillir et à saluer.
Il se trouve que, dans les années que couvre La Jumelle noire, une audacieuse rénovation est tentée par quatre
comédiens, metteurs en scène et directeurs de théâtre que, en raison de leur nombre, on nomma le Cartel. Il s'agit de
Louis Jouvet à l'Athénée, Charles Dullin à l'Atelier, Gaston Baty au théâtre Montparnasse et Georges Pitoëff au
Vieux Colombier. Si Colette discute l'excès d'enthousiasme de Pitoëff, son accent, la fêlure de sa voix, elle reconnaît,
comme pour Artaud, sa foi et « la mission qu'il a choisie qui est belle » De Dullin, elle dit qu'il a toujours un peu l'air de
jouer un mystère, au sens médiéval du terme; c'est donc encore une forme de foi qu'elle discerne en lui. Croire dans le
théâtre, voilà l'essentiel, en dépit des erreurs. Colette observe aussi chez Dullin un don très neuf d'invention scénique; par
exemple, dans Richard III : « Les changements de tableaux s'annoncent soit par une résille de corde qui s’abaisse, des
panneaux d'étoffe croisés et décroisés, des rideaux qui glissent aisément. Ainsi l'action ne s'arrête point. Cette simplicité
rejoint le cinéma et ses moyens puissants d'ubiquité ». Colette souligne par là des effets scéniques, alors inédits, et qui
nous sont devenus familiers. Même nouveauté relevée dans les décors simultanés de Bary : la façon dont il monte Le
Chandelier de Musset est plus qu'ingénieuse. On pouvait encore en juger, au Français dans les années 1947. Mais le
metteur en scène qu'elle préfère, c'est Louis Jouvet. Elle aime son art qu'elle trouve chatoyant, mobile, aéré (si adapté à
Giraudoux!); elle s'interroge : « Quand aurons-nous une féerie montée par Jouvet ? ». Colette fut entendue: Jouvet
monta L'Illusion comique de Corneille à grand renfort de machines… et Colette fut horriblement déçue !
En revanche, elle est séduite par la mise en scène que le tout jeune Jean-Louis Barrault signe pour Numance et elle dit
de lui : « Il a bien l'air de ceux qui veulent tout, l'obtiennent et veulent davantage ».
Sensible à l'évolution de l'esthétique théâtrale, Colette ne l'est pas moins à l'éclosion des jeunes talents. Elle admire
justement Barrault dont elle ne voit d'abord que des « cheveux tziganes, un nez en proue, bossué au milieu, deux yeux
plus intenses que bienveillants »; mais elle affirme qu'il est déjà un maître à un âge où il pourrait encore être élève.
Comment mieux tourner l'éloge ? De Jean-Pierre Aumont, qui débute dans La Machine infernale de Cocteau, elle juge
qu'il sera toujours jeune. Il me semble que, à lire ces mots, j'entends le joyeux appel – « Le lait ! »- qu'il lance dans Drôle
de drame, le film de Marcel Carné. Drôle de drame, où sont justement réunis avec Aumont,
Jouvet, Barrault et Michel Simon. Ce dernier, comment Colette le voit-elle ? « Agile et lourd,
qui pousse de petits cris de vieille dame et pleure comme un chimpanzé triste ».
Elle flaire le talent et distingue, parmi les débutants, des artistes que nous connaîtrons au faîte
de leur gloire : chez la jeune Denise Grey elle sent l'art que nous verrons s'épanouir dans
l'inoubliable grand-mère de La Boum ou la trépidante interprète de La Soupière. Et Gisèle
Casadesus, qui -Dieu merci- est encore parmi nous et que nous avons aimée dans La Tête en
friche aux côtés de Gérard Depardieu, Colette la trouve « exquise » dans Les Corbeaux d'Henry
Becque et l'appelle affectueusement « la petite Casadesus », si fine, si émouvante dit-elle, un
vrai bouton de rose à qui, pour finir, elle crie : « Charmante Casadesus, fleurissez donc » !
Et, pour en terminer sur ce point, Permettez-moi d'ajouter deux noms. Celui d'Arletty,
d'abord, qui n’a pas encore incarné la Garance des Enfants du Paradis, ni jeté, face à l'Hôtel du
Nord, son « Atmosphère ! Atmosphère! ». Colette la voit comme la comédienne Ève Lavallière:
un peu gouape, ose-t-elle écrire, et faisant de nous ce qu'elle veut; elle ajoute que ses qualités la
destinent, sûrement, à l'emploi de grand premier rôle. Et voici, enfin, j'allais dire cerise sur le
gâteau, qu’en 1934, Colette assiste à une fête donnée par le quotidien qui l'emploie. Un acteur
polyvalent s'y révèle; il s'appelle Jacques Tati. Et Colette de s'enthousiasmer :
Jean-Louis Barrault et Michel Simon dans le film « Drôle de Drame ».
Giraudoux –Electre le jardinier

« Désormais, je crois que nulle fête, nul spectacle d'art et d'acrobatie ne pourront se passer de
cet étonnant artiste, qui a inventé quelque chose... Il a inventé d'être ensemble le joueur, la balle et
la raquette; le ballon et le gardien de but, le boxeur et son adversaire, la bicyclette et le cycliste ».
Merveilleuse Colette qui, au bout de sa lorgnette et avec quinze ans d'avance, voit venir Jour de
fête.
Colette ne distribue pas que des éloges. Elle sait manier la phrase feutrée, le discours enrobé qui,
sans y paraître, stigmatise la médiocrité d'une œuvre. Parlant de Tante Marie, une pièce et un auteur
justement oubliés, elle écrit : « Nous savons qu'une anémie gracieuse a ses attraits; nous avons lu,
dans Kipling, que Kaâ, le serpent, envoûte, lorsqu'il danse, parce qu'il n'a point d’angles, ni de
lignes droites, parce qu'il est mou ». Quel éreintement ! Elle ne ménage pas toujours, non plus, les
acteurs. Ces plus ou moins monstres sacrés tiennent-ils toujours compte des avis de « Madame
Colette » ? C'est selon, mais généralement oui. J'en ai au moins un exemple précis, Un soir de 1935,
Colette écoute L'Illusion comique; Jeanne Sully interprète un des principaux rôles. Elle n’est pas n’importe qui : fille de
l'illustre Mounet-Sully, sociétaire de la Comédie Française, elle est titulaire des emplois les plus prestigieux (la Reine
dans Ruy Blas, en attendant Roxane dans Cyrano). Ce n’est plus une débutante. Colette s'en moque et écrit tout
bonnement : « Vive, et par ailleurs excellente, on remarque à regret que M
lle
Sully "claque du bec", c'est-à-dire que
chaque fois qu'elle ferme la bouche, elle la rouvre avec bruit ». II se trouve que j'ai bien connu Jeanne Sully et je puis
témoigner qu'elle ne "claquait plus du bec"; c'est la faute à Colette !
L’INTÉRÊT GÉNÉRAL ET PERMANENT DES CHRONIQUES
Je voudrais enfin vous montrer que La Jumelle noire fait partie de cette éternité dans laquelle est entrée l'œuvre de
Colette.
En s'installant, tous les soirs, dans le fauteuil d'un théâtre, Colette se sent avant tout « bon public », elle le dit. Elle
participe à l'action presque aussi passionnément que cette petite fille qui assistant à la représentation du Bossu et voyant
le héros de Paul Féval se dissimuler derrière un meuble, se lève, pointe l'index vers lui et glapit : « Il est derrière la
table ! ». Scandale dans le public et explication de la gamine : « Ça lui apprendra! Il avait qu'à pas être bossu! ». C'est
Colette qui nous raconte cette anecdote et nous rappelle comment elle aussi se passionna pour Le Bossu, pittoresquement
représenté par une troupe ambulante dans son village de Saint-Sauveur-en-Puisaye; au moins ne dénonça-t-elle pas la
présence du bossu.
Au spectacle, elle est toujours prête à rire et pleurer; prête à admirer un costume, une coiffure ou un décor. Elle
signale, pour en rêver, la transparence des rideaux imaginés par Marie Laurencin pour À quoi rêvent les jeunes filles de
Musset (j'ai vu ce spectacle vers 1946 et, c'est vrai, c'était très vaporeux); elle est charmée par le décor de Christian
Bérard pour L'École des femmes : un mur coulissant qui, fermé, figure la rue et s'écarte pour dévoiler le jardin de la
maison d'Arnolphe; elle s'extasie devant les quatre décors brossés par Dunoyer de Segonzac pour Le Messager d'Henry
Bernstein et les décrit ainsi : « La case sordide, son auvent de roseaux levé sur une nuit opaque, ses taches de pluie, ses
haletantes lampes tempêtes s'opposent au second décor un salon-studio jaune et vert comme un feuillage naissant, au
fond duquel rayonne un paysage intime ». Colette parle d'un décor comme elle parlerait de sa maison de La Treille
Muscate : avec sensualité et gourmandise.
Les chroniques de Colette plongent naturellement dans l'actualité. Elles n'en possèdent pas moins un intérêt général et
permanent. Du lot des créations théâtrales quotidiennes, vouées pour la plupart à l'oubli, quelques productions émergent
dont l'auteur des Claudine sent d'instinct qu'elles sont de l'ordre des chefs d'œuvre. Elle assiste donc émerveillée à la
naissance de ce qu'elle pressent, à juste titre, comme de futurs classiques : La Guerre de Troie n'aura pas lieu,
L'Otage, La Machine infernale, Giraudoux, Claudel, Cocteau. Chez ce dernier, elle affectionne particulièrement
l'imagination et le sens du merveilleux. Rendant compte de La Machine infernale, elle écrit :
« Bénéficiant d'un privilège unique, Cocteau a gardé ce que nous avons tous perdu : la fantasmagorie intime. [...] Il
sait sereinement que l'enfer est d'un certain violet, que passer de la vie terrestre à la mort, c'est peser mollement sur le
tain en fusion d'un miroir indicible; qu'il suffit, pour voler, d'étendre les mains, de soulever légèrement les talons et de se
confier à l'air... ».
Ce n'est pas seulement la magie de Cocteau que Colette définit ainsi, c'est aussi une philosophie qu'elle fait sienne et
selon laquelle il n'y a pas d'au-delà, ou plutôt un au-delà qui n’est qu'une sorte de vie atténuée, silencieuse, où l'on
reconquiert, comme elle nous l'explique dans La Maison de Claudine, sagesse et liberté. Aussi est-elle sensible à cette
pièce où l'on voit errer les fantômes des vivants. À ses yeux, le personnage de Jocaste morte est tout semblable à la
Jocaste vivante, « allégé seulement de la vie, et un peu plus chargé de l'amour échappé à la morale humaine ».
Avec L'Otage de Claudel, Colette se demande si cette œuvre, d'un auteur « né riche et vigoureux », est bien faite pour
la scène. Il y a chez lui, dit-elle, « une richesse littéraire que le théâtre dédore ». Dans le flot de ce grand poème
dialogué, Colette se plaît à signaler ce qu'elle chérit elle-même : un sens du concret, un goût pour les beaux mots anciens,
un texte qui sent la terre avec ses fruits et ses fleurs. On sent, à ces propos, frémir la sensibilité de celle qui a écrit Flore
et Pomone.
Chez Giraudoux, Colette est sensible au caractère torrentueux du texte, aux grands morceaux de prose qui en assurent
la beauté. Elle reconnaît la délicatesse de l'écrivain, sa patte de velours, la séduction des mille facettes de son expression,
mais finit tout de même par lâcher ce jugement : « peut-être on ne fait pas une œuvre théâtrale avec des jeux de
l'esprit » ?
Ces réflexions sérieuses sont pimentées, ici ou là, de remarques inattendues et pittoresques. Le compte rendu d'une
reprise de L’Arlésienne d'Alphonse Daudet à la Comédie Française débute ainsi : « Mon Dieu ! Que cette pièce est
ennuyeuse. Et que cette musique est charmante ! ». Moyennant quoi, tout l'article consiste à louer l'orchestre pour son
Affiche réalisée pour
« Jour de fête » de
Jacques Tati.

exécution de la partition de Bizet et à vitupérer les vieux habitués du Français, jugés responsables du maintien au
répertoire d'antiquailles telles que la pièce de Daudet. Pas un mot du texte lui-même, ni des acteurs ! C'est un comble !
Au hasard de nombreuses chroniques, Colette propose des analyses subtiles. Sans doute, elle juge L'Illusion comique
médiocre et, sans prononcer le mot, la trouve un peu chargée de préciosité et un tantinet longuette. C'est un point sur
lequel notre époque a donné tort à Colette. En revanche, on s'accorde volontiers à ce jugement inspiré par Ruy Blas : « Le
théâtre de Victor Hugo demande à être joué tel que son auteur l'a conçu, c'est-à-dire avec grandiloquence, flamme,
grands éclats, égarements, contrastes de lumières et d'ombres, expressions démesurées. [...] Qui donc osera, à point,
gémir, hurler, se prendre à poignée les cheveux, tutoyer les grands de la terre, en appeler au démon et menacer les
dieux? ». Et, à propos du Misanthrope, joué par Barrault: « Il restitue au rôle sa fouge, sa chaleur amoureuse, ses larmes
violentes, sa lâcheté, sa belle figure, sa belle prestance, en un mot sa jeunesse ». Pour avoir vu Barrault dans le rôle
d'Alceste je souscris entièrement à l'opinion de Colette.
LES CHRONIQUES RÉVÈLENT LES PRINCIPAUX THÈMES DE SON ŒUVRE
Ces chroniques théâtrales nous réservent une dernière surprise. Elles révèlent, en transparence, les principaux thèmes de
son œuvre. Lun des plus manifestes est celui de la curiosité. Colette est attentive, jusqu'à l'anxiété, à ce que va devenir
l'instant présent. Le théâtre est bien le lieu privilégié de cette inquiétude, car une bonne pièce ménage
l'intérêt du spectateur; ce dernier attend avec impatience ce qui va sortir d'une intrigue bien combinée.
Ce souci se traduit dans une image : celle du rideau qui frissonne dans les secondes précédant le
spectacle et plonge le spectateur dans le désir de ce qu'il cache. Une autre image vient fréquemment
aussi sous la plume de Colette: celle de la floraison. Rappelez-vous, dans l'espérance de
l'épanouissement du talent de Gisèle Casadesus, elle lui crie « fleurissez ! »; la construction réussie d'un
personnage lui fait penser à « une floraison poétique et dramatique qui comble notre attente ». Et cela
nous renvoie à un passage d'un autre livre de Colette, La Naissance du jour. Elle nous y montre sa mère, Sido, refusant
une invitation parce que son cactus rose va fleurir : « C'est une plante très rare que l'on m'a donnée et qui, m'a-t-on dit,
ne fleurit sous nos climats que tous les quatre ans. Or, je suis déjà une très vieille femme, et, si je m'absentais pendant
que mon cactus rose va fleurir, je suis certaine de ne pas le voir refleurir une autre fois ». J'ai souvent pensé que, après
tout, La Jumelle noire aurait pu s'appeler « Le Cactus rose ».
C'est encore une parenté avec le reste de son œuvre que cette absence de frontière entre ce qu'un de ses livres appelle
Le Pur et l'impur. Aussi à propos d'une revue de l'Alcazar, développe-t-elle de longues considérations sur l'art du nu
féminin que lui suggèrent les danseuses « avec leurs quatre-vingts paires d'appas antérieurs et postérieurs ». Spectacle
doté d'innocuité pour les mâles latins, dit-elle. Dans la foulée, elle se révolte contre la mode qui impose aux jeunes
femmes une excessive maigreur : elle félicite M
me
Simone de jouer « comme une actrice qui mange à sa faim » et
déplore, en Bourguignonne bonne vivante, que « le thé sans sucre remplace .au saut du lit la tartine beurrée » et le café
noir la grillade. Les années 2010 seraient-elles proches, sur ce point, des années 1930 ?
Ce qui rend encore ces pages si proches du reste de l'œuvre, c’est la sensualité qu'on y voit. Passions humaines
évidemment : les amours adolescentes des Jours heureux de Puget intéressent l'auteur de Gigi et du Blé en herbe, tout
comme le velouté d'une joue ou le regard d'une femme. En écoutant telle ou telle autre pièce, des fragments de sa propre
création lui reviennent à l'esprit. Mais, vous vous en doutez, c'est l'extrême connivence sensuelle de Colette avec la
nature que ces chroniques attestent. Ici ou là, le lecteur rencontre soudain des phrases comme celle-ci : « Il y avait dans
le jardin zoologique d’une capitale étrangère, un "arbre à perruches" qui faisait ma joie, [...J habité de deux cents
perruches, ondulées, vertes, maillées de noir et de jaune, familières et pleines de coquetterie. Mais mieux encore que
leur plumage et leur gaieté, j’aimais leur langage. Le ramage des perruches entre elles est un gazouillis sans cris, égal,
clair qui ressemble un peu à celui de l'hirondelle posée... ». À propos de quoi ces remarques ? Du jeune public babillard
du Théâtre du Petit Monde attendant la représentation de Zig et Puce policiers !
Et quel plaisir enfin de rencontrer, à chaque pas, ces trouvailles, ces bonheurs d'écriture dignes des meilleures œuvres
de Colette. Ici, c'est une observation quasi clinique : « Seuls les enfants savent écouter jusqu’à la douleur »; là, c'est une
vue cavalière et pittoresque sur la dynastie des Valois : « Catherine de Médicis domine et surveille sa pâle couvée,
humide de scrofule et de flux d'oreilles »; ailleurs, c'est un bouquet de sensualité, femme et fruit tout ensemble : « Une
jeune Noire rehausse de quelques turquoises son incomparable vêtement de peau sombre, tendue et irisée comme le
grain du beau raisin dit "picardan" ».
Dans une page de ces chroniques, Colette nous rapporte l'exclamation qu'elle lance à son voisin au lever du rideau:
« Regarde! ». Toute sa critique illustre ce cri de ferveur, d'attente, d'attachement passionné aux pièces et aux interprètes,
et de déception quelquefois lorsque le désir est déçu. Ce cri, c'est aussi celui que Sido lançait à sa fille Colette :
« Regarde, Minet chéri ! ». En sorte que La Jumelle noire ne se limite pas seulement à un panorama du théâtre d'avant-
guerre; elle ne se limite pas non plus à une appréciation juste de ce qui est devenu pour nous du classicisme. C'est une
œuvre, riche, diverse, inattendue, savoureuse, au travers de laquelle apparaît en filigrane l'ensemble de la création de M
me
Colette; ou, si vous préférez, c'est, saisie à travers sa petite jumelle noire, la grande Colette tout entière à son œuvre
attachée
*
.
*
Pour lire La Jumelle Noire : Colette, Œuvres, tome III, coll. Bouquins, Robert Laffont
1
/
5
100%