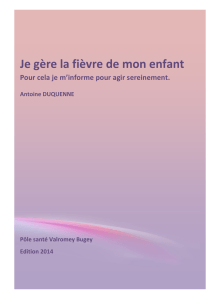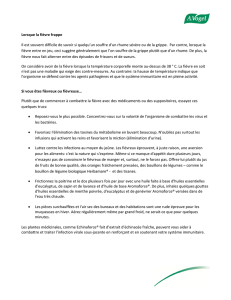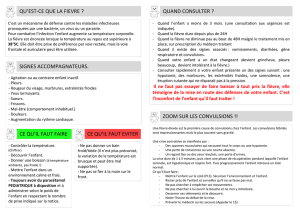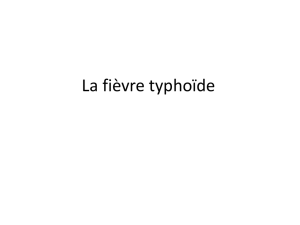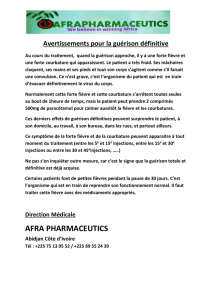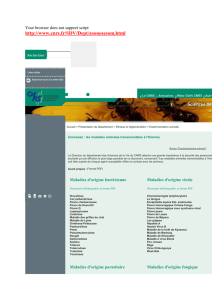Quelle est la démarche clinique appropriée devant une fièvre

Jean-Pierre Bouchon, Service d’Accueil des Urgences, Hôpital de la Pitié-
Salpétrière, 75013 Paris, France. Tél., Fax.: 01 42 17 72 63.
Auteur Correspondant : Pr Jean-Pierre Bouchon, Hôpital Charles Foix,
Article reçu le 19.02.2002 - Accepté le 21.06.2002.
ENSEIGNEMENT
Quelle est la démar
che clinique appr
opriée
devant une fièvr
e pr
olongée inexpliquée
chez un vieillar
d ?
What is the appr
opriate clinical appr
oach in the case of
unexplained pr
olonged fever in an elderly adult ?
Jean-Pierre BOUCHON
La Revue de Gériatrie, Tome 27, N°9
NOVEMBRE 2002
759
« Rien n’es
t
ja
m
ai
s
perdu
t
an t qu’il res
t
e quelque
chose à trouver » (P. Dac).
« L’établissement d’un diagnostic précis est un éta
-
blissement de premier ordre » (P. Dac).
« La
f
ièvre n’est pa
s
due à un dé
f
ici
t
en Rocéphine® »
(un -très bon- généraliste chargé de résumer
e
n
un
e
p
h
r
a
s
e
-c
h
o
c
un
e
s
é
a
n
ce
d
e
FM
C
consacrée aux infections).
M
ême si elle est critiquable, il n’y a pas de rai
-
son de ne pas appliquer au sujet âgé (SA) la
définition de la fièvre prolongée inexpliquée
donnée pour l’adulte jeune
(
A
J
), définition inchangée
depuis 1961 : «tout état fébrile persistant au-dessus de
38°3 C, plus de trois semaines et dont la cause n’est
pas déter
m
inée après une semaine d
’
hospitalisation,
est une fièvre prolongée inexpliquée (FPI)». Ce que les
anglo-saxons appellent «fever of unknown origin».
Les problèmes posés par ces FPI chez les SA sont sou
-
vent complexes. Pour les résoudre, il faut faire preuve
en même temps d’un «esprit interniste» et d’un «esprit
gériatrique», ce qui n’est pas un pléonasme.
Ce n’est pas la liste des étiologies qui va différencier le
SA de l’A
J
. On retrouve à peu de choses près les
m
êmes catégories dans les de ux groupes. Les diffé-
rences se situent à d’autres niveaux :
- Les fréquences respectives des étiologies des FPI ne
sont pas les mêmes
(tableau 1)
SA :Infections : 35 %
. Abcès intra-abdominaux 12 %
. Endocardite 10 %
. Tuberculose 6 %
Maladies systémiques : 28 %
. Horton 19 %
Cancers et hémopathies : 19 %
. Lymphomes 10 %
. Cancers 9 %
Divers : 9 %
Indéterminé : 9 %
AJ/PA : Infections
➚
Maladies dysimmunitaires
➴
Cancers et hémopathies
➙
Thermopathomimie
➴
Tableau 1 : Fréquenc
e
s r
e
spectives d
e
s diff
é
r
e
ntes étiolo-
gies de s fi
è
vres p ro lo ng
é
es in
e
xpliqué
e
s (F
P
I
) che z l
e
s
sujets âgés (SA) et les adultes jeunes (AJ)
(Travail de Knockaert (4), le plus récent, reprenant des tra
-
vaux plus anci
e
ns d
e
Esposito, d
e
Barri
e
r. High (3 ) a fait
une sorte de méta-analyse de ces 3 séries, ce qui est assez
discutabl
e
c
ompte t
e
nu d
e
s
é
p oques tr
è
s diffé rentes d
e
s
publications.
Table 1 : Respective frequencies in the different etiologies of unex
-
p
l
ained prolonged fever (FPI) in the older adults (SA) and younger
adults (AJ).

• Avez-vous des particularités alimentaires ?
• De quelle origine êtes-vous ?
• Quel métier avez-vous exercé ?
• Avez-vous des animaux chez vous ?
• Tabagisme ? Le «je ne fume pas», le «je n’ai jamais
fumé» n
’
ont pas la mê
m
e signification que le
«
je ne
fume plus» (quelquefois depuis une semaine suite à une
hémoptysie !).
• Avez-vous été transfusé ? Certaines interventions
(
orthopédie, urologie
)
sont parfois très hé
m
orragiques
et le vieillard ne sait pas toujours qu’il l’a été.
• Y a-t-il eu des malades dans votre entourage récem
-
ment ?
• Que prenez-vous, qu’avez-vous pris comme médica
-
ments ?
. Ceux qui décapitent la maladie causale.
. Ceux qui masquent la fièvre.
. Ceux qui pe uvent en donner (il n’y a pa s que les
jeunes qui sont sous progestatif).
. Ceux qui masquent certains signes : l’amiodarone qui
tout en donnant une hyperthyroïdie empêche la tachy
-
cardie.
. Ceux qu’on a sans ordonnance.
• Y a-t-il eu une porte d’entrée infectieuse, dentaire par
exe
m
ple, encore que chez le vieillard ce soit plutôt
l’absence de soins dentaires qui domine !
• Comment est apparue cette fièvre, brutalement, pro
-
gressivement, en premier ou précédée d’autres symp
-
tômes ? La fièvre apparue après dix jours d’alitement
pour lombalgie aiguë a plus de chance d’être liée à une
phlébite qu’à une spondylodiscite.
En retour, le gériatre n’oubliera pas :
•
De s’en quérir non pa
s
du mais des m
é
tie rs. Le
patient âgé a trop tendance à citer le plus valorisant ou
le dernier ou celui exercé le plus longtemps.
• De poser à son malade des questions sur sa sexualité
(il y a des vieillards qui ont des rapports exposant à des
risques de MST), ses habitudes vis-à-vis de l’alcool, des
drogues.
L’EXAMEN CLINIQUE
__________________________
Le gériatre sait que :
• Tout ce qu’il trouve à l’examen clinique est loin d’être
en rapport avec la maladie fébrile actuelle : cet oedème
d’un membre inférieur est en rapport avec une phlébite
d’il y a vingt ans, cette fibr illation auriculaire est
ancienne.
•
Tous le
s
souffles systoliques é jectionnels
irradiant
dans les vaisseaux du cou ne sont pas des souffles de
La Revue de Gériatrie, Tome 27, N°9
NOVEMBRE 2002
760
Qu
e
ll
e
e
s
t
la d
é
m
ar
c
h
e
c
liniqu
e
appropri
ée
d
e
vant un
e
fi
è
vr
e
pr
o
lo ng
ée
in
e
xpliqu
ée
c
h
ez
un vi
e
illard ?
- L
’
interrogatoire e t l’exa
m
en clinique qui re stent les
pièces
m
aîtresses du diagnostic sont, pour de no
m
-
breux motifs, plus difficiles, plus sujets à caution chez
les SA.
- L’idée, assez juste, qu
’
il faut faire vite chez la PA,
incite parfois (souvent ?) à donner des médica
m
ents
m
odifiant le tableau clinique avant mê
m
e d’avoir fait
une enquête correcte
(
antibiotiques, a nti-infla mma-
toires, corticoïdes).
Il faut clairement expliquer, clamer haut et fort que la
plupart des FPI le sont faute d’un interrogatoire et d’un
examen clinique rigour
e
ux d’une part et de quelques
examens complémentaires simples d’autre part.
L’INTERROGA
TOIRE
___________________________
Le gériatre sait :
- Que l’interrogatoire est nécessairement long, les anté
-
cédents étant souvent d’auta nt plus nombreux qu
e
la
personne est plus âgée.
- Q ue le te
m
p s p assant, la fatigue joue e t que les
réponses deviennent moins précises.
- Que les troubles de mémoire sont fréquents, portant
sur les faits récents. Ainsi, le vieillard peut-il donner
tous les détails d’une pathologie remontant à quarante
ans alors qu’il est incapable de décrire le début de sa
maladie récente, les médicaments pris, etc...
- Qu
’
u ne surdité mécon nue peut en traîn er des
réponses erronées à des questions précises.
- Qu
’
il faut parfois employer d
a
ns cet interrogatoire
un e «te r
m
inologie
»
ancienne , p éri
m
ée, inconn ue
d’ailleurs des jeunes médecins. Si l’on prend l’exemple
de la
t
uberculose, qui sait encore parler de
«
la tache
aux poumons» et l’interpréter à sa juste valeur, «le
p o i n t
de pleurite
»
, le «séjour de six
m
ois à la ca
m
pagne
»
, le
«séjour en preventorium
»
, le
«
H
»
«bleu» ou le
«H» «rouge»
sur la pancarte (recherche de BK négative ou positive
après homogénéisation des cra chats
)
, le «pneumo
»
,
«
l
’
extra-pleural», le traitement par «perfusion»
(
l’acide
para-amino-salicylique) ? Qui sait que la Streptomycine
est apparue en 1947, l’Isoniazide en 1952, qui se sou
-
vient du Trecator
®
, du Trevintix
®
? Et l’on pourrait dire
la même chose pour la maladie de Bouillaud, la syphi
-
lis, etc...
L’interniste n’oubliera pas quant à lui de poser
un certain nombre de questions :
• Jardinez-vous ? Vous êtes-vous promené en forêt ?
• Avez-vous voyagé à l’étranger récemment ? (les vieux
voyagent de plus en plus et de plus en plus loin).
• Quel est l’état de vos vaccinations ?

La Revue de Gériatrie, Tome 27, N°9
NOVEMBRE 2002
761
Qu
e
ll
e
e
s
t
la d
é
m
ar
c
h
e
c
liniqu
e
appropri
ée
d
e
vant un
e
fi
è
vr
e
pr
o
lo ng
ée
in
e
xpliqu
ée
c
h
ez
un vi
e
illard ?
rétrécissement aortique : souffles athéromateux banaux
du SA (bien sûr, sans I.A., sans disparition de B2).
Mais l’interniste dira
que s’ils ne sont pas hémody
-
namiquement significatifs, ils n’en traduisent pas moins
des valves anormales, susceptibles d’être le siège d’une
endocardite infectieuse.
Tous les deux se rejoignant
pour dire que si fièvre
et souffle systolique sont fréquents chez les SA, l’endo
-
cardite l’est moins mais que le médecin est là pour se
méfier et appliquer les règles !
I
ls se rejoignent aussi p our re cherche r un can cer
colique devant une endocardite ou une se pticémie à
Streptococcus Bovis, pour palper soigneusement les
artères temporales.
L’interniste sait aussi
que le diagnostic tient parfois
à peu de choses :
• L’auscultation cardiaque, surface de sthétoscope par
surface de sthétoscope, à tous les foyers, en décubitus
latéral, penché en avant, à la recherche de la petite
I.A., du petit frottement.
• L’exa
m
en de la peau, centimètre carré par centimètre
carré, sans oublier les recoins, les ongles, les phanères.
• L’examen de toutes les aires ganglionnaires, y com
-
pris épitrochléennes (le «ganglion de l’interniste»).
L’interniste n’oubliera pas que confusion
+
fièvre =
ponction lombaire. Le gériatre non plus, même s’il sait
qu’il risque plus souvent de se trouver en présence
d’une fièvre d’origine X + une confusion liée à la
décompensation d’une maladie d’Alzheimer sinon tout
simple
m
ent à un globe urinaire chez une vieille per-
sonne fébrile alitée !
Et pour terminer ce chapitre de l’examen clinique, c’est
le moment de ra
p
p
e
l
e
r
c
ette
r
è
gl
e
d’
o
r i
n
t
e
r
n
i
s
te
:
l’examen clinique devant une FPI
(comme l’inter
-
rogatoire et comme certains des examens complémen
-
taires initiaux, on le verra ci-dessous
)
, d
o
it
être
ré
p
ét
é
régu
l
ière m
e
nt.
P
endant que l’on attend de
nouveaux exa
m
ens complé
m
enta ires (rendez-vous
et/ou résultats), la clinique peut s’être modifiée !
• Le souffle diastolique est apparu.
• La rate devient palpable.
•
Le minuscul
e
ganglion perdu dans la graisse est
devenu évident.
• Un pouls périphérique a disparu.
• Une pleurésie est apparue.
• Etc...
LES EXAMENS COMPLÉMENT
AIRES
__________
Le gériatre sait que :
• Chez le SA, il faut aboutir rapidement à un diagnostic
car le vieillard malade, fatigué, anorexique, alité, fébrile
(
catabolisant ses
m
uscles
)
va vite être exposé à des
complications qui vont, en modifiant le tableau cli-
nique, en surimposant leurs signes à ceux de la maladie
initiale, rendre le diagnostic encore plus difficile.
• A l’extrême, il faut presque considérer la fièvre pro
-
longée... comme une urgence. Il ne faut pas attendre
que le vieillard ne soit plus en état de subir un examen
complémentaire pour le demander ou ne soit plus en
état de subir une intervention chirurgicale qui aurait été
réalisable trois semaines plus tôt.
• Mais on ne peut pas tout faire en quelques jours à un
vieillard fatigué, fragile, et l’hospitalisation est en elle-
même un facteur aggravant de pathologies préalables,
cérébrales dégénératives notamment.
• Préparer un grand vieillard à une coloscopie, adresser
un vieillard à un exa
m
en scanner avec injection alors
qu’il a une clairance de créatinine faible, tout cela peut
être mal supporté, voire dangereux (rappelons au pas
-
sage l’inocuité de l’interrogatoire et de l’exam
e
n cli-
nique : bien faits, ils n’ont jamais tué qui que ce soit...).
Le gériatre sait aussi que :
•
Si la chondrocalcinose
peut donner de la fièvre sans
arthrite, la fréquence de la chondrocalcinose radiologique
est telle à cet âge qu’elle perd de la valeur d’orientation.
•
I
l en est de
m
ême d
e
la trop fréquente présence à
l’E
C
BU de la vieille fe
m
me de colibacilles pour les
incriminer systématiquement dans la fièvre observée.
•
A la nu
m
ération for
m
ule sanguine d’un vieillard
fébrile, 2 000 polynucléaires neutrophyles avec dispari
-
tion des éosinophiles ont autant de valeur pour un dia
-
gnostic d’infection bactérienne que 30 000.
• La plupart des tuberculoses des SA ont pour origine
un BK resté quie scent dans un
e
ndroit quelconque
depuis la primo-infection remontant parfois à plusieurs
dizaines d’années. Il sait penser systématiquement à la
tube rculo se à chaque fois qu’il ne comprend pas
quelque chose en gériatrie (j’exagère un peu !) et il sait
se poser la question : pourquoi ce BK se
m
et-il, cin-
quante ans après, à faire des petits ? Immuno-dépres
-
Ecrire tout cela à propos d’une FPI n’est pas
enfoncer des portes ouvertes. C’est rappeler
qu’à l’époque de l’Evidence Based Medicine,
pour tr
o
uv
e
r
d
e
s
pre
u
v
e
s
,
faut-il
e
n
cor
e
l
e
s
avoir correctement recherchées. Il y a moins
d
e
fi
è
vr
e
s
i
n
explica
b
le
s
qu
e
d
e
fièvr
e
s
i
n
ex-
pliquées.

Q.C.M.
_________________________________________
A- Ch
e
z l
e
vi
e
illa rd
,
u
ne
e
n
do ca r
d
ite
av
e
c
hémoculture positive à Streptococcus Bovis est
s
ouvent
a
ss
o
ci
é
e
à
(u
n
e
s
eul
e
r
e
pon
s
e
e
xa
c
te
,
laquelle ?)
:
a -
Une tuberculose.
b -
Un cancer colique.
c -
Un myélome.
d -
Un SIDA.
e -
Un cancer bronchique.
B
- Chez le vieillard (une seule réponse fausse,
laquelle ?) :
a - Une fièvre
prolongée ine xpliquée est une fi
è
vre
durant depuis plus de 3 semaines, au-dessus de 38°3,
sans cause déterminée après une semaine d’hospitali
-
sation.
b -
Les causes de fièvre prolongée sont les mêmes que
chez l’adulte j
e
une
m
ais avec des fréquences respec-
tives différentes.
c -
Tout souffle systolique éjectionnel irradiant dans les
vaisseaux du cou est synonyme de rétrécissement de la
valve aortique.
d -
Même si les méningites ne sont pas la cause la plus
fréquente des confusions fébrile s, l
’
adage
«
confusion
fébrile = PL» reste valable.
e -
La thermopathomimie reste rarissime.
La Revue de Gériatrie, Tome 27, N°9
NOVEMBRE 2002
762
Qu
e
ll
e
e
s
t
la d
é
m
ar
c
h
e
c
liniqu
e
appropri
ée
d
e
vant un
e
fi
è
vr
e
pr
o
lo ng
ée
in
e
xpliqu
ée
c
h
ez
un vi
e
illard ?
sion
m
ais de quelle origine : dénutrition psychogène,
so matique, socia le ? Hém opa thie ? Cancer ?
Traitement corticoïde ?
• Dans une maladie de Horton sous corticoïdes, cette
fièvre qui (ré)apparaît, cette CRP, cette VS qui remon
-
tent : insuffisance du traitement ? Non, tuberculose !
• Chez ce cancéreux du poumon droit, cette pleurésie
gauche : métastase ? Non, tuberculose !
• L’unicité n’est pas toujours la règle en gériatrie.
Mais l’interniste sait qu’il faut répéter les exa
-
mens complémentaires simples initiaux :
•
C
ette radiographie thoracique était normale il y a
deux semaines ; une nouvelle montre que la miliaire est
apparue.
- Cette numération ne montrait qu’une petite anémie.
Dix jours après, les blastes sont là.
Il connaît aussi les maladies rares qui ne sont pas fami
-
lières au g
é
riatre, le dernier anticorps pointu, le seul
endroit en France où se fait telle ou telle recherche.
Alors ? Alors, quand, chez un SA, le gériatre bute sur
une FP
I
, qu’il appelle donc un interniste et quand
l’interniste, chez un SA, bute sur une FPI, qu’il appelle
donc un gériatre !
TRAITEMENT D’ÉPREUVE, TRAITEMENT SANS
PREUVE
________________________________________
Il y a des cas où, malgré les explorations bien choisies,
les avis multiples pris, l’état du patient laisse penser
qu’il faut tenter quelque chose : suivant le cas, traite
-
ment antibiotique, traite
m
ent anti-tuberculeux, traite-
ment corticoïde. C’est une décision difficile à prendre.
Elle ne peut être prise qu’après une révision collégiale
du dossier et un dernier réexamen complet du patient
(«qu’a-t-on pu oublier ?»). C’est dire qu’une fois ce trai
-
tement e ntrep ris, avec le consenteme nt éclairé du
patient, de son entourage, la surveillance devra conti
-
nuer d’être attentive.
■
POUR EN SA
VOIR PLUS
_______________________
A – Articles généraux «internistes»
1.
Piette J
.
Ch
,
We ch
s
cler
B,
P
i
ette A
.
M
.
Fièvre s au long c ours de
l’adulte. In : Godeau P., Herson S., Piette J.Ch. : Traité de Médecine, 3e
édition (pp 89-98) – Flammarion Médecine Sciences Edit., Paris, 1996
2.
Rousset H, Lucht F.
Fièvres prolongées inexpliquées. In : Rousset H,
Vital-Durand D, Dupond J.L. : Diagnostics difficiles en Médecine Interne,
2e édition (pp 357-380), Maloine Edit., Paris, 1999.
B – Articles généraux «gériatriques»
3. Hig
h
K.P. Fever on un kno wn origin. In : Hazzard W.R
,
Blass
J
.P ,
E
t
tin ger W.H
,
Ha lter
J .B, Ouslander J. G. :
P
rinciples o f Geria
t
ric
Medicine and Gerontology, 4 th edition (pp 1448-1451), Mc Graw Hill,
New York, 1999
4.
Knockaert D.C, Vanneste L.J, Bobbaers H.J.
Fever of unknown ori
-
gin in elderly patients.
J Am Geriatr Soc
1993;41:1187-92.
RÉPONSES
1
/
4
100%