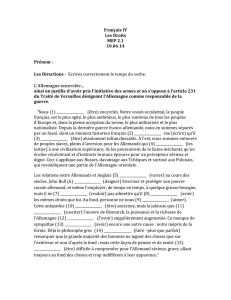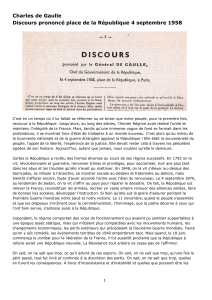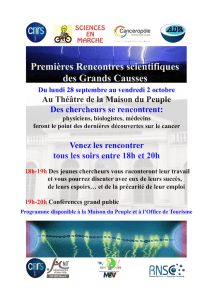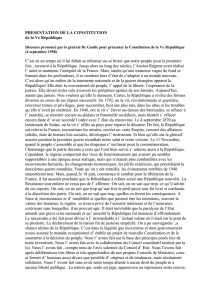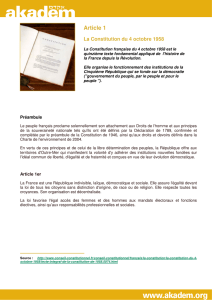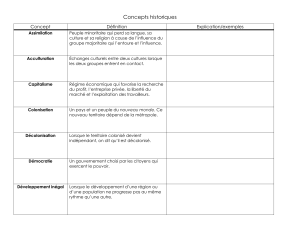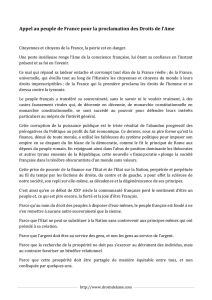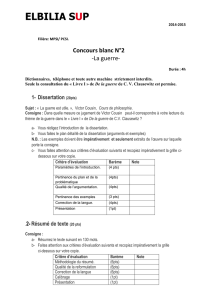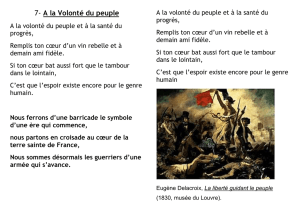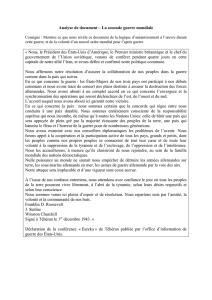PDF 840k - Revue germanique internationale

Revue germanique internationale
21 | 2004
L’horizon anthropologique des transferts culturels
L'identité comme différence. L’allemand comme le
non-français chez Herder, John et Arndt
Wolfgang Kaschuba
Édition électronique
URL : http://rgi.revues.org/1011
DOI : 10.4000/rgi.1011
ISSN : 1775-3988
Éditeur
CNRS Éditions
Édition imprimée
Date de publication : 15 janvier 2004
Pagination : 183-195
ISSN : 1253-7837
Référence électronique
Wolfgang Kaschuba, « L'identité comme différence. L’allemand comme le non-français chez Herder,
John et Arndt », Revue germanique internationale [En ligne], 21 | 2004, mis en ligne le 19 septembre
2011, consulté le 02 octobre 2016. URL : http://rgi.revues.org/1011 ; DOI : 10.4000/rgi.1011
Ce document est un fac-similé de l'édition imprimée.
Tous droits réservés

L'identité comme différence.
L'allemand comme le non-français
chez Herder, John et Arndt
WOLFGANG KASCHUBA
I
L'Europe est une configuration des plus complexes dont l'architecture
politique mais surtout historique et culturelle doit sans cesse être rééqui-
librée. Nous en sommes aujourd'hui particulièrement conscients alors
qu'avec l'élargissement de l'Union européenne à l'est se pose la question
d'une identité européenne nouvelle, ou du moins clairement transformée.
Car de la sorte, les poids politiques et culturels en Europe seront sans
aucun doute déplacés de façon décisive. L'ancienne géographie symbo-
lique ancrée à l'est est rompue. L'Europe orientale est appelée à
s'émanciper du statut de région périphérique.
Toutes ces voies nouvelles en direction de l'Europe répondent claire-
ment au mot d'ordre de 1' « intégration ». C'est du moins ce que dit claire-
ment la proposition, voire l'ordre adressé par l'Europe occidentale aux can-
didats à l'adhésion à l'est. On exige d'eux qu'ils s'adaptent, et les critères de
la politique à la culture sont énumérés dans un catalogue concret de mesu-
res à prendre. Pour autant que le candidat apparaisse comme suffisamment
« européen ». Dans le cas de la Turquie, les doutes sont fréquents.
On occulte certes de la sorte que cette architecture européenne, péni-
blement édifiée, ne se fondait nullement dans le passé sur 1' « intégration »
mais toujours sur la « différence ». Pour les projets d'identité européenne,
les frontières, les tensions et les conflits nationaux et sociaux ont toujours
été constitutifs. Et la solidité et l'exactitude des images de l'Europe ont
toujours dépendu de ce que l'élément de tension et d'hétérogénéité y res-
tait visible. Car même la « différence » signifie une relation culturelle, sup-
pose l'échange et le contact, permet la perception réciproque et peut-être
aussi la compréhension.
Ce n'est pas pour rien que l'ethnologie en a depuis longtemps déduit
une théorie de l'interculturalité. L'aptitude à la compréhension sociale y
est décrite comme la conséquence de contacts culturels qui peuvent être
Revue germanique internationale, 21/2004, 183 à 195

consensuels aussi bien que conflictuels. Oui, la capacité de compréhension
est expressément liée à la capacité de déterminer les différences, car la
capacité à dépasser la frontière entre le « propre » et F « étranger » dépend
de la connaissance de cette construction de contraires : seul celui qui a
conscience des différences culturelles peut les rompre en tant que construc-
tions de différences, au niveau de la réflexion.
Il est actuellement beaucoup question de cette interculturalité - par
exemple quand il
s'agit
de problèmes de migration, de possibilités
d'entente entre les sociétés ou de la question de la possibilité de rattacher
l'Islam aux valeurs européennes. Cette « interculturalité » apparaît un peu
comme une formule magique qui promet de toutes nouvelles solutions à
de tout nouveaux problèmes. Dans le vin de ce savoir postmoderne, je
voudrais verser un peu d'eau. Car précisément un regard rétrospectif sur
l'histoire primitive de l'anthropologie et de l'ethnologie montre facilement
que l'idée de l'interculturalité n'est pas si nouvelle. Et que la conjonction
de constructions culturelles liées à l'intégration et à la différence, notam-
ment dans l'espace historique et discursif franco-allemand, a sa place
assurée depuis déjà presque deux cents ans. Comment cela
s'est
produit,
c'est ce que je voudrais brièvement expliquer.
II
Comme on sait, il n'y avait pas au début de la création du monde
Dieu, mais les Lumières européennes. Du moins tant qu'il
s'agit
du
« concept » de monde. Car ce sont les Lumières qui, dans un acte de créa-
tion authentiquement européen, projettent une véritable « image du
monde ». Une image qui montre un paysage et une humanité globale sub-
divisés en continents et en pays, en peuples et en cultures.
Ce projet se constitue dès le
XVIe
siècle : d'un côté sous la forme d'une
pratique culturelle du voyage qui depuis longtemps conduit aussi dans
d'autres continents et devient désormais la clef décisive d'une expérience et
d'une appropriation bourgeoises du monde ; d'un autre côté dans l'idée
théorique d'une identité européenne qui repose sur l'humanité, sur
l'opposition « civilisé » / « sauvage », « propre » / « étranger » et est pensée
comme valable partout et universelle.
De ces deux sources résulte le modèle d'une image protomoderne du
monde et de l'homme une image systématiquement développée à l'époque
des Lumières. De la sorte l' « élément étranger » est progressivement
conçu comme l' « élément autre » ; il est exploré et rapproché. Mais ainsi
cet autre n'existe plus seulement à l'extérieur mais aussi à l'intérieur de
notre propre monde et de ses aptitudes conceptuelles, en Europe. Et il
remplit une double fonction : d'un côté c'est une construction de différen-
ces permettant une nouvelle stratégie de l' autorenforcement cognitif et cul-
turel. C'est ainsi qu'on trace une ligne de développement de la société pri-

mitive jusqu'au présent et qu'on part d'un principe de progrès qui situe le
monde dans la temporalité et dans l'histoire, l'Afrique et l'Asie comme des
« âges de la pierre » dans l'histoire humaine, et l'Europe seule « au som-
met » des temps et du progrès.
D'un autre côté cette altérité fait l'effet d'un miroir qui rend possible à
l'inverse l'autocritique et la critique de la civilisation. Car la réflexion sur
la relation entre nature et culture conduit nécessairement à la connais-
sance de ce que 1' « originalité » de la nature dans le propre
s'est
depuis
longtemps perdue dans la civilisation européenne. Elle n'existe plus entre-
temps que chez l'autre chez ce non-civilisé, « dehors ». La connaissance
induite par les Lumières a donc une tête de Janus, produit une tension
réflexive faite d'auto-affirmation et de doutes vis-à-vis de soi-même.
Cette image du monde réflexive devient en tout cas une idée centrale
des Lumières européennes qui se manifeste le plus fortement en France
comme vision du monde et comme mouvement social. L'égalité et la rai-
son apparaissent aux encyclopédistes français comme les deux principales
pierres de construction d'un monde qui peut être exploré dans des for-
mes scientifiques et systématiquement appréhendé. D'un monde dont le
plan de construction est constitué par l'histoire et dont la carte s'articule
en peuples, cultures et nations. Jean-Jacques Rousseau est alors celui qui
- tout à fait animé par un pessimisme culturel - revendique une ouver-
ture européenne à « cette nature au-dehors », à cet « homme naturel »
pour retrouver sa propre authenticité. Et cette idée déjà préromantique
trouve son écho le plus fort dans le romantisme allemand et dans les
idées de Johann Gottfried Herder. Car il en résulte l'essai non plus d'une
vision du monde réflexive mais d'un modèle scientifique fondé sur le plan
anthropologique. - Et ainsi je suis finalement parvenu à mon premier
transfert culturel franco-allemand : au concept de culture de Johann
Gottfried Herder.
Herder dans ses Idées sur la philosophie de l'histoire de l'humanité reprend, on
le sait, dans les années 1780, les réflexions de Rousseau sur les «peuples
naturels » et les « peuples civilisés ». Mais il les intègre dans un autre
contexte fondé historiquement et en termes d'évolution. La pluralité glo-
bale des cultures lui apparaît en effet comme une véritable revue des
stades d'évolution de la civilisation humaine, l'espace rendant possible la
contemporanéité du non-contemporain : dans les lointains africains et asia-
tiques, Herder voit un âge de pierre de l'humanité. En Europe, en
revanche, il voit sa maturité civilisée. De la sorte, il esquisse un double axe
anthropologique : la pluralité des « cultures des peuples » ouvre sur le
monde une perspective spatiale et horizontale, l'historicité de la « culture
du peuple » ouvre en revanche sur les profondeurs de l'espace historique
une perspective historique et verticale. On peut bien dire qu'ainsi est
esquissé le premier modèle d'une anthropologie culturelle, d'un côté, et
d'une anthropologie historique de l'autre.

III
Or, dans un passé récent, on a déjà beaucoup discuté le concept her-
dérien de la culture qui a surtout joué un rôle important dans les
années 1980 lors de la découverte de la culture populaire européenne de
l'époque moderne, précisément aussi dans le dialogue entre des recherches
allemandes et françaises. Ce faisant, on a toujours souligné à quel point
Herder était déjà tributaire d'un concept large de la culture qui - comme
il l'écrit
—
conçoit « la culture elle-même comme une suite nécessaire de tel
ou tel mode de vie » (Herder, Idées, liv. 8, p. 82). La culture n'est donc pas
encore réduite chez lui à la culture intellectuelle selon le modèle ultérieur
de la bourgeoisie cultivée, mais ouverte au « quotidien » et à « la vie ».
De fait, Herder est attaché à un regard anthropogéographique. Ce
regard considère les facteurs naturels et environnementaux comme au
moins aussi déterminants pour former les caractéristiques culturelles d'un
peuple que la langue ou la tradition. La culture est pour lui la diversité des
formes d'expression d'une « âme du peuple » où l'histoire et la mémoire,
les styles de pensée et les formes linguistiques se cristallisent avant tout
dans des formes spécifiques de la « poésie populaire » : dans des chants,
des contes et des légendes, comme pratique esthético-mentale de
l'inscription et de la transmission de ce qui est finalement aussi un savoir.
L'anthropologie de Herder apparaît ainsi comme une association élégante
de discours de son temps, issu de l'Europe entière et portant sur l'histoire
culturelle, la géographie, la linguistique et la psychologie des peuples. Ce
sont leurs motivations singulières qu'il cherche à associer dans la perspec-
tive d'une image universelle de l'homme et du peuple.
Je voudrais ici aborder une autre dimension du concept herdérien de
la culture qui recueille moins d'attention : la question de la consistance his-
torique et sociale de la culture. Quelle homogénéité ou hétérogénéité,
quelle identité des cultures devons-nous nous représenter ? La réponse de
Herder est particulièrement révélatrice précisément du processus d'anthro-
pologisation scientifique de notre image du monde — aussi parce qu'elle
apparaît tout à fait contradictoire.
D'un côté en effet, Herder attribue à la culture des qualités quasi « sys-
témiques » : l'authenticité historique, le caractère ethnique, l'homogénéité
sociale, une grande capacité de se couper des autres peuples et cultures. La
culture a ainsi toujours été présente dans l'histoire comme idée et comme
pratique. Elle apparaît universelle, mais ne se trouve que sous des formes
chaque fois spécifiques comme un Ken de la pensée et de l'action humai-
nes hérité, tribal,
collectif,
marquant des limites extérieures, un lien exis-
tant dans un domaine déterminé et à une époque déterminée, valable seu-
lement pour un « peuple » déterminé — une « culture » à côté d'autres
« cultures ». Ainsi Herder caractérise les peuples comme des « collectivités
culturelles aussi originelles que naturelles », qui sont et restent les véhicules
de l'histoire et de la culture. Avec cette mystification de la génétique histo-
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
1
/
14
100%