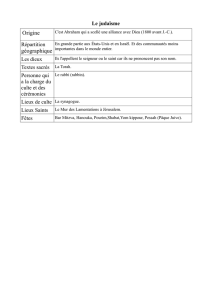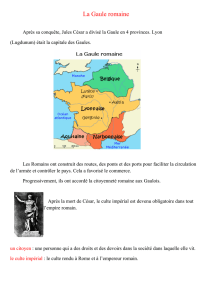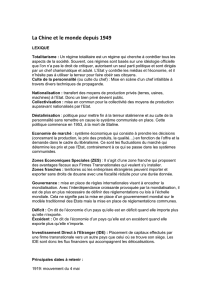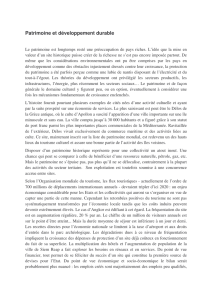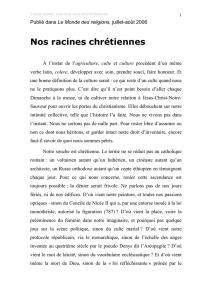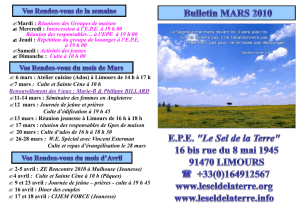se retrouver au centre le sens du culte

1
Le culte à coeur
Symposium de culture liturgique pour la Suisse réformée
SE RETROUVER AU CENTRE
LE SENS DU CULTE
Exposé et Thèses de Matthias Zeindler
Mercredi, 7 septembre 2011 Université de Berne

2
1. Le culte – un événement marginal?
Le culte passe toujours dans la compréhension que les Églises réformées ont d’elles-
mêmes et pour ses pasteurs pour une manifestation centrale. Cette conviction est
cependant depuis longtemps mélée d’une incertitude. En effet, l’abstinence dominicale
si souvent citée d’une claire majorité des membres de l’Église ne fait pas que durer, elle
augmente. Pas un article de presse qui ne commence par rappeler le cliché des bancs
d’église vides – une remarque qui montre que même pour les journalistes, le culte reste
la manifestation centrale de l’Église, sauf que le constat s’avère négatif pour l’Église.
On a l’impression que beaucoup restent membres de l’Église à cause de ses
prestations en faveur des marginaux et de sa fonction de socialisation pour la jeune
génération. Cette interprétation se trouve confirmée par le débat au Grand Conseil
bernois de l’été 2007 sur une motion du PLR demandant la suppression de l‘impôt
ecclésiastique des personnes morales. La motion fut rejetée clairement par 119 voix
contre 20. Mais ce qui nous intéresse ici, ce sont les arguments invoqués de droite à
gauche de l’hémicycle contre la motion. La plupart des parlementaires mirent l’accent
sur la position indispensable de l’Église dans la société. Un inventaire impressionnant
des offres de l’Église fut présenté. Une manquait: le culte. La proclamation, la liturgie de
l’Église ne furent pas mentionnée sous la coupole. L’Église jouit du PS à l’UDC d’une
haute estime – mais pas à cause du culte qu’elle célèbre. C’est pourquoi les
sociologues conseillent de temps à autre à l’Église de prioriser différemment ses offres.
Charles Landert par exemple constate dans son étude sur la ville de Zurich que "les
Églises jouissent d’une large approbation plus à cause de l’utilité de ses services et
oeuvres qu’à cause de sa liturgie et de sa proclamation". Il suggère discrètement un
"changement de perspective vers des activités régies par les besoins et non par
l’offre".1 S’il en est ainsi, est-ce que les „simples“ membres perçoivent le culte à la
différence des théologien-ne-s comme un phénomène marginal? Doit-on voir ici
l’ancienne priorité réformée du „faire“ de l’Évangile sur son écoute, du service sur le
témoignage ?2
Il y a toutefois des observations qui corrigent cette image. L’étude du Fonds National
„Coût et utilité des églises en Suisse“ (Dienstleistungen, Nutzen und Finanzierung von
Religionsgemeinschaften FAKIR) de l‘automne 2010 arrive à la conclusion que les
1 Charles Landert, Reform als Chance. Hintergründe und Gelingensbedingungen der Stadtverbandsre-
form, in: Niklaus Peter (Hg.), Urbanes Christentum. Festschrift zum Jubiläum 100 Jahre Verband der
stadtzürcherischen evangelisch-reformierten Kirchgemeinden, Zürich 2009, 97-112.110f.
2 Sur le lien qui réunit témoignage et service voir: Die Kirche Jesu Christi. Der reformatorische Beitrag
zum ökumenischen Dialog über die kirchliche Einheit (Leuenberger Texte 1), Frankfurt a.M. 1995, 35f.

3
offres de cultes et de célébrations des étapes de la vie étaient considérées comme
primordiales par une grande majorité des personnes interrogées – également par les
non-membres.3 Un indice supplémentaire nous est livré par les chiffres des actes
ecclésiastiques qui restent considérables, mêmes s’ils sont en régression. A cela
s’ajoute ce que David Plüss nous rappellait dans son exposé lors de l’inauguration du
centre de compétences liturgiques ici-même en juin: le culte importe à beaucoup dans
notre société parce qu’ils le considèrent comme un acte vicaire. David Plüss: "Pour
beaucoup, il importe de savoir que l’Église invoque Dieu chaque dimanche, lui rend
grâce et prie pour le bien-être de tous les humains."4
Le culte a-t-il sa place au centre ou à la périphérie? Les études empiriques ne peuvent
de toute évidence pas nous donner de réponse univoque. Si nous posons la question
de l’Église comme lieu du culte, la réponse empirique ne peut constituer qu’un aspect
de la réponse. Car enfin le culte est la manifestation dans laquelle nous comptons tout
spécialement sur l’action de Dieu. La définition du lieu à accorder au culte ne peut être
donnée que dans la perspective de cette action divine. Seul Dieu peut donner au culte
de l’Église son lieu
2. Le culte – un acte qui se suffit à lui-même
Comme sous-titre de cet exposé, le groupe de préparation a choisi la formulation "Le
sens du culte". Nous parlons ici à dessein de sens de la célébration, et non pas de son
but ou de son objectif. On dénombre sans peine de nombreuses fonctions du culte: il
sert à ritualiser la semaine, il redresse ceux qui sont en proie au deuil ou au doute, il est
un lieu où apprendre la foi, il édifie la communauté, il mobilise pour le culte de la vie de
tous les jours etc. Tous ces objectifs et bien d’autres encore sont non seulement
justifiés du point de vue sociologique et psychologique, on ne peut que les affirmer
également d’un point de vue théologique. Et pourtant, personne ne pourrait prétendre
que ces fonctions saisissent de manière suffisante ce qu’est un culte.
Mettons en contraste à cette discussion des fonctions du culte ce que la première
Église concevait comme le propre du culte. La communauté rassemblée au culte est
l’ekklesía, la communauté de salut que Dieu appelle dans le monde. La célébration de
cette communauté anticipe le culte eschatologique du Royaume de Dieu. Cette
dimension eschatologique du culte de l’Église ancienne se révèle dans l’orientation
3 Michael Marti/Eliane Kraft/Felix Walter, Dienstleistungen, Nutzen und Finanzierung von Reli-
gionsgemeinschaften in der Schweiz, Glarus/Chur 2010, 54.

4
(vers l’est) du local de la célébration, qui marque l’attente de Christ qui vient mener le
monde à son accomplissement.5 Cette communauté religieuse minoritaire nous frappe
par une prétention à couper le souffle : elle vit dans son culte la réplique rituelle du
monde accompli à venir. Il n’est guère possible de traduire cette prétention en objectifs
anthropologiques ou de société. Vu de cet angle-là, un culte conçu comme tel est
véritablement sans objet. Par contre, d’un point de vue théologique, on ne peut formuler
de proposition plus haute qu’en disant que le culte garde vive l’attente du règne de Dieu
à venir. Il nous faut donc mieux parler du « sens » du culte et non de ses buts. Le
"sens" entend une signification qui dépasse les réflexions d’ordre utilitaire. Quelque
chose peut faire sens, même si cela est dépourvu d’objectif!
Dans les cours Gifford que Karl Barth a tenu en 1938 à l’université d‘Aberdeen, il se
place dans la ligne de cette conception du culte de la première Église: "Le culte de
l’Église est l’opus Dei, l’œuvre de Dieu, qui a lieu pour lui-même."6 Ici aussi : le culte n’a
pas d’objectif, pas d’utilité à mettre en évidence pour la société. Comment Karl Barth en
arrive-t-il à cette affirmation forte? Voici une citation plus étoffée:
"Le premier fondement du culte de l’Église se trouve en dehors de nous, dans la
présence et dans l’action de Jésus-Christ. Il veut être le maître dans sa miséricorde et
sa fidélité. Il veut que l’Église soit et demeure, comme lui est et demeure. Il veut être
aimé et loué par la vie chrétienne de ses membres, car il est le sens et la fin de toute
histoire humaine. Ce sens et cette finalité sont rendues visibles dans l’Église. C’est
pourquoi il crée et sauvegarde l’Église. C’est pour cela et finalement uniquement pour
cela que le culte chrétien est nécessaire."7
Le culte existe donc parce que Jésus-Christ le veut. Parce qu’il est le Seigneur de ce
monde. Et parce qu’il veut qu’une communauté humaine se réjouisse que lui, le
Ressuscité soit le Seigneur de ce monde présent et du monde à venir. Et qui témoigne
publiquement par cette célébration qu’il est le Seigneur du monde.
Le culte se voit ainsi pourvu d’une importance impossible à dépasser. Encore une fois
Karl Barth: "Le culte de l’Église est la chose la plus importante, la plus urgente et la plus
4 Liturgie als Kultur der Gegenwart, Manuscript 2.
5 Reinhard Messner, Art. Gottesdienst 5. Alte Kirche, RGG4 3, 1182-1184.
6 Gotteserkenntnis und Gottesdienst nach reformatorischer Lehre. 20 Vorlesungen über das Schottische
Bekenntnis von 1560, Zollikon 1938, 186.

5
magnifique qui puisse se dérouler sur terre."8 Vraiment, quoi de plus important, de plus
urgent et de plus magnifique que nous les humains nous rassemblions devant notre
créateur et rédempteur pour le louer ?
3. En présence du Ressuscité
Encore une fois: voilà une grande prétention de l’Église, une prétention grandiose. Et au
vu des 1 à 2% de membres qui vont au culte, c’est une prétention qui contredit la
réalité. Il nous faut donc reposer la question : comment mettre en évidence devant la
société et devant notre propre compréhension théologique le bien-fondé de cet énorme
prétention ? Complétons ce qui a déjà été dit par une remarque élémentaire.
L’Église chrétienne existe parce que Jésus a été ressuscité des morts. Ceci est vrai tant
du point de vue historique que du point de vue théologique. Si le témoignage de Jésus
lui a survécu en Palestine, c’est que des hommes et des femmes ont fait l’expérience
que cet homme n’est pas resté dans la mort, il vit de manière unique une vie nouvelle.
Sans cette expérience, aucune communauté chrétienne ne se serait rassemblée, le
Nouveau Testament n’aurait pas été mis par écrit, il n’y aurait pas eu d’histoire de
l’Église. Cela correspond à la première confession de foi chrétienne : "Jesus-Christ est
ressuscité", ce qui veut dire la même chose que: Christos kyrios, Christ est le Seigneur.
La foi chrétienne est foi en Jésus-Christ ressuscité. Foi que le Crucifié vit, qu’il est
présent et qu’il vient à nous de son à-venir.
Le culte chrétien n’est donc autre chose qu’une célébration en présence du ressuscité.
Dans l’Évangile selon Mattieu, Jésus promet à ses disciples : "Là où deux ou trois se
trouvent réunis en mon nom, je suis au milieu d‘eux. " (18,20). L’intention n’est pas de
nous consoler au vu des petites communautés qui se rassemblent pour le culte. Il s’agit
d’une promesse ferme que là où les humains se rassemblent dans l’espérance du
Christ, celui-ci est vraiment présent parmi eux.
Cette promesse du Ressuscité est premièrement le fondement du culte. Il existe à
cause de cette promesse. Les Églises chrétiennes ne célèbrent pas le culte en raison
d‘une demande de ses membres ou parce que la société aurait besoin de célébrations
7 Ebd.
8 A.a.O., 190.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%