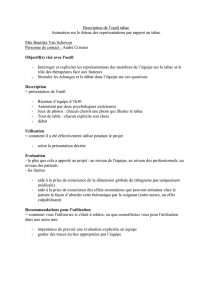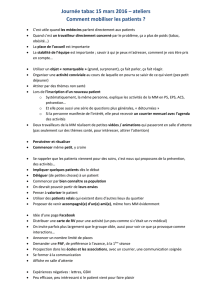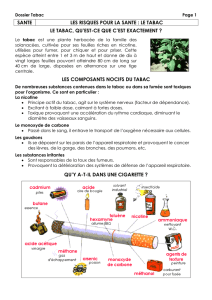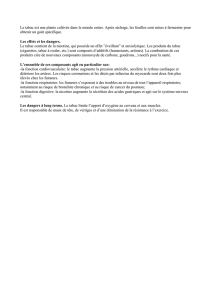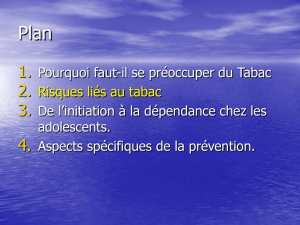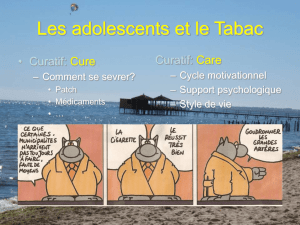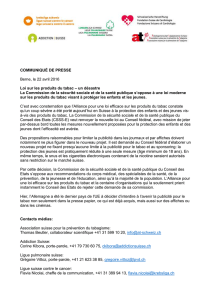5. Communication sur les produits à risque et communication du

J. Goudreau
2009-02-19 1
Projet de recherche
La communication sur les produits à risque
Chaire de relations publiques et de communication marketing
Décembre 2008
Table des matières
1. Sommaire..........................................................................................................................2
2. Question principale.......................................................................................................... 3
3. Questions secondaires.....................................................................................................3
4. Définition et inventaire des produits à risque.............................................................. 3
5.
Communication sur les produits à risque
et
communication du risque
...................4
6.
Clientèle à risque
et
clientèles vulnérables
..................................................................4
7. Lois sur les produits à risque ......................................................................................... 5
8. Codes d’éthique.............................................................................................................. 12
9. Autres règlementations................................................................................................. 12
10. Pratiques de communication reliées aux produits à risque.................................14
11. Exemples de publicités inacceptables (selon le Code des normes de la
publicité)..................................................................................................................................18
12. Autres références.......................................................................................................22

J. Goudreau
2009-02-19 2
1. Sommaire
Les travaux initiés par la Chaire de relations publiques et de communication marketing sur
les produits à risque répondent aux besoins des professionnels qui ont, par leur pratique, à
communiquer à leurs différents publics sur des produits qui sont fortement encadrés.
C’est grâce à une recherche exhaustive des lois, des réglementations et des codes d’éthique
au Québec et à l’extérieur du pays que cette recherche permettra aux professionnels des
relations publiques et des communications de connaître les meilleures pratiques éthiques et
socialement responsables lorsqu’il s’agit de communiquer ou de promouvoir un produit à
risque.
Par exemple, le sujet des enfants et de la malbouffe est un cas où l’on retrouve des
différences entre les législations canadiennes, québécoises et américaines.
Au Canada l'encadrement des publicités destinées aux enfants de moins de 12 ans est
volontaire et s'inspire du
Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants.
Ce code
porte entre autres sur certains éléments spécifiques tels que l'influence sur le subconscient
des enfants, le nombre, la durée et la fréquence des messages publicitaires diffusés,
l'utilisation de personnages connus des enfants, la véracité des caractéristiques du produit
commercialisé, les valeurs sociales, etc. Ce Code, administré par le NCP, ne vise pas
spécifiquement les produits alimentaires mais bien tous les produits et services.
Au Québec en plus de l'application des normes canadiennes, la publicité destinée aux enfants
de moins de 13 ans est interdite depuis 1980 en vertu de la
Loi sur la protection du
consommateur
(LPC).
Au États-Unis, La
Federal Communications Commission
(FCC), une agence gouvernementale
indépendante responsable de l'octroi des licences et de la réglementation des réseaux de
radiodiffusion et de télécommunications aux États-Unis, instaura en 1974 des limites sur le
temps dévolu à la publicité commerciale lors des programmations d'émissions télévisuelles
pour enfants. Ces restrictions, toujours en vigueur aujourd'hui, autorisent un maximum de
10,5 minutes de publicité par heure de diffusion les jours de semaine et 12 minutes par
heure de diffusion les jours de fin de semaine.
Source : Bureau de la consommation d’industrie Canada,
Marketing de la malbouffe pour enfants :
http://www.consommateur.qc.ca/union-des-consommateurs/docu/agro/malbouffe.pdf
En plus du recensement des différentes législations, cette étude vise entre autre à connaître
comment les professionnels communiquent sur les produits à risque ? Et quelles sont les
meilleures pratiques de communication relativement à ces produits ?
Les conclusions de cette étude mettront en lumière les pratiques de communication, qui en
plus de répondent aux législations et aux codes d’éthique, respectent le public envers qui le
produit s’adresse.

J. Goudreau
2009-02-19 3
2. Question principale
Comment encadre-t-on les pratiques professionnelles de communication sur les produits à
risque ?
3. Questions secondaires
- Comment les professionnels de la communication et des relations publiques
communiquent sur les produits à risque ?
- Comment utiliser les médias sociaux de façon responsable ?
- Quelles sont les meilleures pratiques de communication relativement à un produit à
risque ?
4. Définition et inventaire des produits à risque
Par « produits à risque », nous entendons :
- les produits du tabac,
- l’alcool et les spiritueux,
- les médicaments,
- les jeux de hasard et de loteries,
- la malbouffe,
- la conduite dangereuse sur les routes,
- les biotechnologies et autres produits dangereux.
Selon la
Loi sur les produits dangereux
, le terme « produits dangereux » réfère à tout
produit interdit, limité ou contrôlé (une liste de ces produits se trouve en annexe de la loi).
En pharmaceutique, selon le
Journal officiel de l’union européenne
, le «risque» est la
probabilité qu'un événement se produise; et un «risque potentiel grave pour la santé
publique» est une situation dans laquelle il existe une forte probabilité pour qu'un danger
grave provoqué par un médicament à usage humain, dans le cadre de l'utilisation qui en est
proposée, affecte la santé publique.
http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/eudralex/vol-
1/com_2006_133/com_2006_133_fr.pdf
Le risque est une exposition à un danger potentiel, inhérent à une situation ou une activité.
L'évaluation des risques est le facteur déterminant de toute prise de décision. Elle est bien
souvent intuitive dans nos actions de tous les jours, mais gagne à être formalisée dans le
cadre d'un projet financier ou industriel, par exemple.
http://www.previnfo.net/modules.php?ModPath=sujet&ModStart=wiki&op=aff&page=risque
http://www.hc-sc.gc.ca/hl-vs/iyh-vsv/environ/cepa-lcpe-prod-fra.php

J. Goudreau
2009-02-19 4
5.
Communication sur les produits à risque
et
communication du risque
Il est important de distinguer la communication sur les produits à risque qui réfère aux
pratiques de communication des entreprises entourant ces produits; et la communication du
risque qui réfère plutôt à la sensibilisation et à l’information du public concernant un risque à
la population. Cette communication met aussi l’emphase sur les moyens à mettre en place
pour en réduire les conséquences et les effets pervers de ce risque.
6.
Clientèle à risque
et
clientèles vulnérables
Selon la Régie de l’assurance médicaments du Québec (RAMQ), une clientèle vulnérable
répond à une ou à plusieurs des exigences suivantes :
- Il est âgé de 70 ans ou plus;
- Il est âgé de moins de 70 ans et présente l’une ou plusieurs des conditions suivantes :
√ Psychoses, étant entendu que la majorité des dépressions ne sont pas
considérées comme des psychoses;
√ Maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC), asthme de modéré à
sévère (patient ayant présenté un vems inférieur à 70 % de la valeur prédite),
pneumopathies professionnelles;
√ Maladie cardiaque artério-sclérotique (MCAS);
√ Cancer associé à un traitement passé, présent ou projeté en chimiothérapie
systémique ou radiothérapie ou en phase palliative;
√ Diabète avec atteinte d’organe cible;
√ Sevrage de drogues dures ou d’alcool, toxicomanie sous traitement à la
méthadone;
√ VIH/SIDA ;
√ Maladies dégénératives du système nerveux central.
Pour ce qui est des enfants, une étude américaine concluait que les jeunes enfants ne
possèdent pas la capacité d’évaluer la publicité qui leur est présentée. La seule solution était
l’interdiction de toute forme de publicité destinée aux enfants.
(In the Matter of Children’s Advertising, FTC Final Staff Report and recommendation – 31
mars 1981).

J. Goudreau
2009-02-19 5
7. Lois sur les produits à risque
7.1. Loi sur les aliments et drogues
Publicité interdite
Il est interdit de faire, auprès du grand public, la publicité d’un aliment, d’une drogue, d’un
cosmétique ou d’un instrument à titre de traitement ou de mesure préventive d’une maladie,
d’un désordre ou d’un état physique anormal énumérés à l’annexe A ou à titre de moyen de
guérison.
Vente interdite
Il est interdit de vendre à titre de traitement ou de mesure préventive d’une maladie, d’un
désordre ou d’un état physique anormal énumérés à l’annexe A, ou à titre de moyen de
guérison, un aliment, une drogue, un cosmétique ou un instrument :
a
) représenté par une
étiquette;
b
) dont la publicité a été faite auprès du grand public par la personne en cause.
Interdiction d’annoncer des moyens anticonceptionnels sans autorisation
Sauf autorisation réglementaire, il est interdit de faire la publicité auprès du grand public
d’un moyen anticonceptionnel ou d’une drogue fabriquée ou vendue pour servir à prévenir la
conception ou présentée comme telle.
http://lois.justice.gc.ca/fr/ShowFullDoc/cs/f-27///fr
7.2. Loi sur le tabac
CHAPITRE IV
PROMOTION, PUBLICITÉ ET EMBALLAGE
Exploitant, fabricant ou distributeur.
21. L'exploitant d'un commerce, un fabricant ou un distributeur de produits du tabac ne
peut:
1° donner ou distribuer gratuitement du tabac à un consommateur ou lui en fournir à des
fins promotionnelles quelles qu'elles soient;
2° diminuer le prix de vente au détail en fonction de la quantité de tabac, autrement que
dans le cadre d'une mise en marché régulière effectuée par le fabricant, ou offrir ou accorder
au consommateur un rabais sur le prix du marché du tabac;
3° offrir à un consommateur un cadeau ou une remise ou la possibilité de participer à une
loterie, un concours ou un jeu ou toute autre forme de bénéfice, si celui-ci doit, en
contrepartie, fournir un renseignement portant sur le tabac ou sur sa consommation de
tabac, acheter un produit du tabac ou produire une preuve d'achat de celui-ci.
Interprétation.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
1
/
22
100%