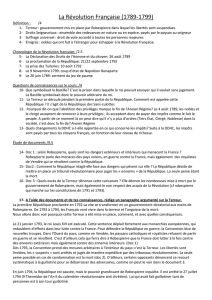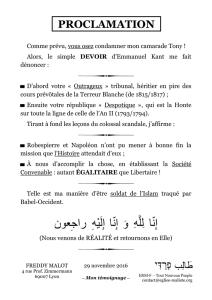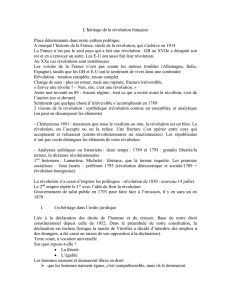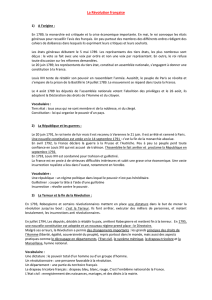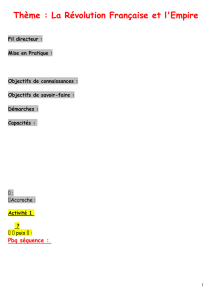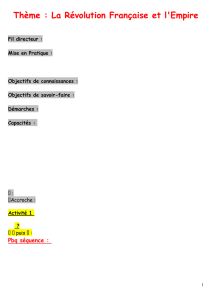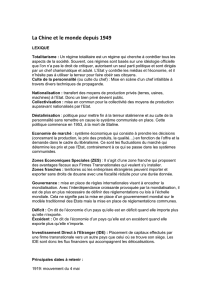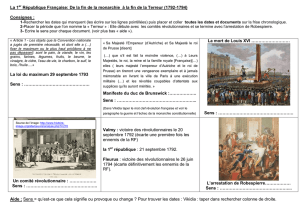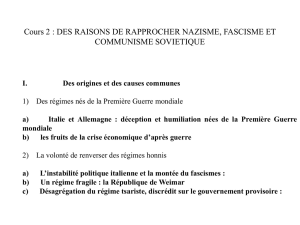Le Coût de la Terreur


LE COÛT
DE LA
TERREUR

DU MÊME AUTEUR
HISTOIRE GÉNÉRALE
Survol de l'histoire du monde, Fayard.
Survol de l'histoire de l'Europe, Fayard.
Survol de l'histoire de France, Fayard.
Paris, Fayard.
L'Histoire n'a pas de sens, Fayard.
D'Achille à Astérix, 25 pastiches d'histoire, Flammarion.
La Grande Aventure des Corses, Fayard.
Histoire des socialismes, Fayard.
La France de Babel Welche, Calmann-Lévy.
Le Coût de la Révolution française, Perrin.
ÉCONOMIE ET HISTOIRE ÉCONOMIQUE
Histoire du franc, Sirey.
Histoire des colonisations, Fayard.
Histoire des marchands et des marchés, Fayard.
Histoire des marchés noirs, Tallandier.
ABC de l'inflation, Plon.
ABC de l'économie, Hachette.
Onze Monnaies plus deux, Hachette.
Histoire de l'or, Fayard.
Histoire du pétrole, Fayard.
Du franc-Bonaparte au franc-de-Gaulle, Calmann-Lévy.
Le Fisc, ou l'école des contribuables, Amiot-Dumont.
All the Monies of the World, Pick, New York.
La Maison de Wendel, Riss.
Peugeot, Plon.
Les Deux Cents familles, Perrin.
Histoire morale et immorale de la monnaie, Bordas.
TRADUCTIONS
Allemagne, Angleterre, Argentine, Brésil, Canada, Chine, Danemark, Espagne,
États-Unis, Finlande, Iran, Israël, Italie, Norvège, Portugal, Roumanie, Suède,
U.R.S.S.


La loi du 11 mars 1957 n'autorisant aux termes des alinéas 2 et 3 de l' article 41, d'une part, que les
copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisa-
tion collective, et, d'autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d exemple et d 'illus-
tration, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de
l'auteur, ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (alinéa I de l'article 40).
Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contre-
façon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code pénaL
© Perrin, 1990.
ISBN : 2-262-00651-2
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
1
/
58
100%