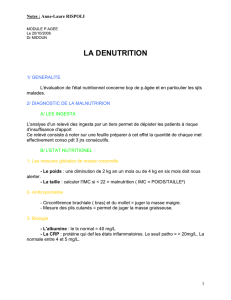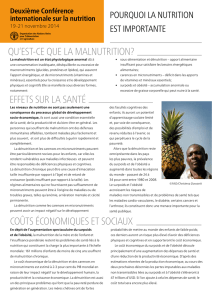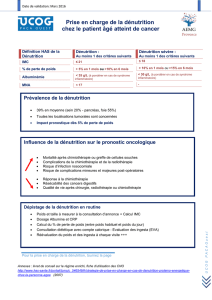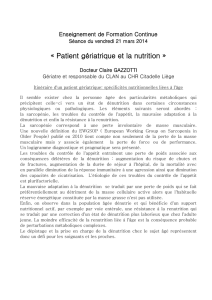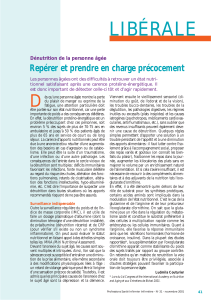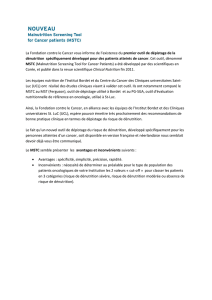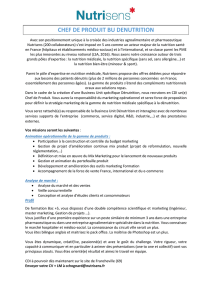Dossier - Edimark

F
aut-il s’étonner qu’au troisième millénaire,
dans un pays industrialisé et riche comme
l’est la France, on puisse parler encore (et
toujours) de dénutrition de la personne âgée ?
La réponse est évidemment négative pour au
moins trois raisons. La première est que la
France vieillit : en 2020, les plus de 85 ans
atteindront 4 % de la population française, or
ces grands vieillards sont particulièrement
vulnérables. La deuxième est qu’avec le
vieillissement, les maladies s’accumulent,
génèrent autant de circonstances d’anorexie
avec perte pondérale que de syndromes
d’hypercatabolisme mal gérés par un organis-
me vieillissant. La troisième, enfin, est que
cette dénutrition, la plupart du temps inappa-
rente, va provoquer des catastrophes en
cascade augmentant le risque de mortalité, de
maladies intercurrentes, de perte d’autono-
mie, de souffrance physique et morale et des
coûts de santé très importants.
Fréquence de la dénutrition (1)
De nombreuses études transversales et longi-
tudinales, françaises et européennes, éclairent
la situation nutritionnelle des personnes âgées
de 70 à 75 ans, vivant en apparente bonne
santé à leur domicile.
À domicile, en Europe et à l’étranger, les
valeurs de prévalence sont très proches de
celles des études épidémiologiques françaises
(de 3 à 5 %). En Europe, l’étude Euronut-
Seneca phase I concerne 2 858 personnes
âgées de 70 à 75 ans. Dans cette population,
on observe des valeurs d’énergie ingérée et
une répartition des macronutriments variant
avec les pays concernés et leurs caractéris-
tiques socioculturelles. La prévalence de la
malnutrition protéino-énergétique (MPE),
fondée sur les ingesta et les valeurs de
l’albuminémie, est inférieure à 4 %.
L’étude longitudinale (Euronut-Seneca
phase II) concerne 1 221 personnes de 75 à
80 ans. Une perte de poids de plus de 5 kg
touche près de 16 % des sujets âgés qui ont
fait l’objet de deux déterminations (1989-
1993), mais ils ne sont que 2,2 % à avoir des
valeurs d’albuminémie inférieures à 35 g/L.
Toutes les femmes et une partie des hommes
(selon les régions) ont, au dixième percentile
de la population, une diminution quantitative
des ingesta en deçà de 1 500 kcal/j et une
diminution qualitative des protéines en deçà
de 35 g/j. Cela confère à cette population un
état de santé en apparence excellent mais où
apparaissent déjà des facteurs de risque
reconnus de morbidité et de mortalité,
comme la perte de poids ou des ingesta quoti-
diens inférieurs à 1500 kcal/j. Dans toutes les
études, on remarque que l’apparition d’un
syndrome inflammatoire se traduit par un
retentissement profond et durable sur l’état
nutritionnel, et induit une diminution
progressive de la valeur de l’albuminémie.
L’intrication de la carence d’apport et de ses
conséquences (pathologie infectieuse ou
inflammatoire) rend rapidement indiscer-
nable la malnutrition dite exogène par
carence d’apport de celle provenant de l’aug-
mentation du catabolisme. Dans ces condi-
tions, la seule méthode à même d’évaluer
simplement les réserves métaboliques est
l’anthropométrie.
Les études réalisées au domicile concernent
habituellement des populations ambulatoires
dans des classes d’âge de 65 à 75 ans. Ces
personnes ont une meilleure autonomie et une
meilleure alimentation que les personnes
âgées de plus de 80 ans, à propos desquelles
on peut penser que l’association d’une
polypathologie à une perte d’autonomie les
rend également très fragiles sur le plan nutri-
tionnel. Le risque de MPE atteindrait alors,
non plus 4 %, mais 10 % de la population
testée. La malnutrition devient le facteur de
risque d’hospitalisation et de perte d’autono-
mie prépondérant.
À titre de comparaison, la prévalence de la
dénutrition à l’hôpital (court séjour ou
soins de suite) dans les populations les plus
âgées atteint des chiffres de 40 à 60 %. Dans
les services de médecine, l’hospitalisation
est souvent motivée par une affection d’ori-
gine traumatique, infectieuse ou inflamma-
toire. La malnutrition par carence d’apport
pure touche moins de 20 % des patients
hospitalisés. Pour tous les autres, la malnu-
trition d’apport est indiscernable de celle
provoquée par l’hypercatabolisme de la
maladie ayant justifié l’hospitalisation. Si la
prévalence de la MPE chez la personne âgée
passe de 4 à 10 % à domicile à un patient sur
deux à l’hôpital, c’est probablement parce
que les futurs hospitalisés se recrutent parmi
les sujets âgés déjà fragilisés par un état de
sub-carence négligé, provoquant une dépres-
sion immunitaire et une perte de masse
Comment repérer et corriger
une dénutrition débutante
chez la personne âgée “bien
portante” ?
E. Alix*
Texte présenté aux Entretiens de nutrition de l’Institut Pasteur de Lille, 14 juin 2001.
Act. Méd. Int. - Métabolismes - Hormones - Nutrition, Volume VI, n° 1, janvier-février 2002
13
Dossier
* Club francophone gériatrie et nutrition.

Act. Méd. Int. - Métabolismes - Hormones - Nutrition, Volume VI, n° 1, janvier-février 2002
14
maigre. Quant au milieu institutionnel
(maisons de retraite, soins de longue
durée), les valeurs obtenues dépendent des
normes de référence utilisées par les auteurs,
mais également du niveau de dépendance
des patients, en particulier pour l’alimenta-
tion, que ces structures prennent en charge.
Les valeurs décrites dans la littérature
s’échelonnent de 13 à 52 %. Des travaux
plus récents rapportent des chiffres plus bas
– de 13,5 % à 28,5 % –, peut-être plus
réalistes. Dans les services de long séjour,
on observe moins de 40 % de malnutrition
par hypercatabolisme alors qu’elle est de
plus de 80 % dans les services hospitaliers
de médecine gériatrique. La politique insti-
tutionnelle en faveur de l’alimentation,
partie intégrante de l’animation au quoti-
dien, devrait jouer un rôle déterminant pour
prévenir une baisse des ingesta et réduire la
prévalence de la malnutrition protéino-
énergétique en institution.
Conséquences de la dénutrition (2)
Conséquences aspécifiques
Les manifestations cliniques sont peu spéci-
fiques de la malnutrition protéino-énergé-
tique : asthénie, anorexie, amaigrissement
avec fonte musculaire, peau sèche, ongles
cassants, constipation et troubles neuro-
psychiatriques allant de la dépression à la
démence. L’absence de spécificité clinique
de la dénutrition explique le retard au
diagnostic constaté plus tard, à la phase
d’état. Les conséquences de la MPE s’observent
dans deux situations :
– à l’occasion d’une dépression, le patient
réduit progressivement ses ingesta. Ses
réserves de masse maigre, rapidement mobili-
sable, et de masse grasse s’amoindrissent
lentement. Lorsque les signes cliniques
apparaissent, ils traduisent généralement une
dénutrition profonde ;
– de manière parfois inaugurale chez une
personne âgée en apparente bonne santé, à
l’occasion d’un stress infectieux ou non, la
dénutrition se manifeste en empruntant les
signes liés au stress et en les aggravant.
●La masse maigre et la masse grasse (3)
La diminution de la masse musculaire
(sarcopénie) avec l’âge n’est pas totalement
inéluctable. Dans une population sélection-
née pour son bon état de santé, observé de 70
à 80 ans de manière longitudinale (au
Nouveau-Mexique, à Albuquerque), la réduc-
tion du poids et de la masse maigre ne s’obser-
ve que chez les patients victimes d’un
problème de santé : infection, cancer ou
traumatisme. En revanche, la réduction
progressive ou rapide des ingesta se solde
toujours par une diminution, en priorité de la
masse maigre, dont la mobilisation énergé-
tique est plus rapide et plus simple pour
l’organisme. Les conséquences cliniques sont
une diminution de la force aussi bien distale
que proximale, une diminution de la résistan-
ce à l’effort, et une diminution des réserves
d’énergie en cas d’agression infectieuse ou de
stress. La chute n’est pas loin si la personne
âgée présente par ailleurs une pathologie
neurologique ou locomotrice. La résistance
osseuse est également altérée par la MPE,
autant par la carence en apport calcique que
par la carence en apport protéique, indispen-
sable à la confection ou à la réparation de la
trame collagénique, véritable tissu de soutien
de l’os.
Si la dénutrition dure longtemps, le retentis-
sement sur la masse grasse périphérique
devient cliniquement significatif, la mobilisa-
tion progressive de l’énergie stockée sous
forme de graisse conduit à une réduction de
ce secteur et à une diminution des facultés
d’amortissement lors de la chute. Le risque de
survenue d’une escarre par augmentation des
forces de friction en cas d’alitement, même
bref, s’accroît également.
●L’immunodépression (4)
La dénutrition est toujours associée à une
carence en micronutriments dont le rôle sur le
fonctionnement du système immunitaire n’est
plus contesté. À un degré avancé de dénutri-
tion, on peut parler de syndrome d’immuno-
déficience acquise qui va rendre la personne
âgée particulièrement sensible aux infections.
Les mécanismes de cette immunodéficience
associent une atteinte des systèmes de
défense contre les agents microbiens intracel-
lulaires (rôle dévolu aux lymphocytes T), une
atteinte des systèmes de défense contre les
agents microbiens extra-cellulaires (rôle
dévolu aux lymphocytes B), enfin également,
une atteinte des systèmes macrophagiques de
défense non spécifique. Avec la carence
immunitaire, le temps de réparation tissulaire
lié au stress infectieux augmente et l’infec-
tion entraîne la production déséquilibrée de
cytokines pro-inflammatoires (provoquant
une anorexie durable) au détriment des
cytokines anti-inflammatoires par les
lymphocytes. La vaccination protège l’indivi-
du âgé dénutri de manière moins efficace,
mais la correction de la malnutrition restaure
l’ensemble des compétences immunitaires.
● Les troubles neuropsychiatriques
Ils sont très polymorphes dans leur présenta-
tion clinique, d’autant plus que l’âge est
également associé, indépendamment de la
dénutrition, à une augmentation de la préva-
lence de la démence et de la dépression. Les
vitamines du groupe B sont le plus fréquem-
ment en cause en raison de leur fragilité selon
le mode de cuisson ou la qualité des mets
choisis. Le ralentissement est un des signes
aspécifiques les plus constants, la dépression
est l’étape ultérieure (répondant mal aux
traitements antidépresseurs classiques), puis
Dossier
Fragilité
↓ Masse maigre Insuffisance d'apport
←c'est ici qu'il faut agir
Premier
épisode
pathologique
Dénutrition
exogène
↓ Poids
↓ Albumine
Deuxième
épisode
pathologique
Dénutrition
endogène
– infection pulmonaire
– stress fracturaire
Troisième
épisode
pathologique
Déficit immunitaire
– nouvelle infection
Escarres Quatrième
épisode
pathologique
Figure. La spirale infernale de la dénutrition.

Act. Méd. Int. - Métabolismes - Hormones - Nutrition, Volume VI, n° 1, janvier-février 2002
15
vient l’étape ultime des troubles cognitifs,
pouvant conduire la personne âgée à une
véritable démence ou en accélérer le cours
évolutif.
Conséquences spécifiques
●Les troubles digestifs
Si la fonction de digestion intestinale reste la
mieux préservée en cas de malnutrition, la
réduction de l’hydratation – qui accompagne
de manière quasi systématique la MPE – crée
un ralentissement du bol intestinal, provoquant
un véritable fécalome. Ce dernier est à l’origi-
ne d’un état subocclusif et d’une anorexie avec
perte hydrique par la muqueuse intestinale. La
pullulation microbienne qui accompagne la
stase fécale est à l’origine de diarrhées
chroniques et d’une déficience en vitamines et
oligoéléments. La baisse du taux sérique de
l’albumine peut être la conséquence d’un
défaut de synthèse hépatique de l’albumine en
cas de MPE, ou lors de l’inversion de synthèse
par le foie en cas d’inflammation ou, enfin, par
des pertes rénales ou vasculaires. La biodispo-
nibilité des médicaments fortement liée à
l’albumine ou à d’autres protéines en est
modifiée dans le sens d’une plus grande
biodisponibilité et donc d’un risque notable de
taux toxique.
●Les conséquences hormonales
Un faux diabète paraît être une conséquence
constante de la malnutrition par carence et de
la malnutrition endogène ; la stimulation du
cortisol et des catécholamines est à l’origine
d’une hyperglycémie par libération musculai-
re et d’une réduction de la synthèse de l’insu-
line, associée à une insulinorésistance. Les
cytokines déclenchent et entretiennent les
phénomènes hormonaux dont le passage à la
chronicité épuise les réserves et se traduit par
un syndrome de réponse sénile chronique
inflammatoire systémique.
●Les conséquences liées aux carences en
micronutriments
Les carences en vitamines du groupe B
(folates, B6) sont sans doute les plus impor-
tantes par leurs impacts sur le système
hématologique (anémie) et nerveux (périphé-
rique et central) : troubles neuropsychiques,
encéphalopathies ou polynévrites. La carence
en vitamine D est directement liée à la perte
d’autonomie, entraînant un défaut d’exposi-
tion solaire et elle détermine une augmenta-
tion de la synthèse de l’hormone parathyroï-
dienne, contribuant à accroître la fragilité de
l’os. La carence protéique associée à la
carence vitamino-calcique contribue à
majorer le risque de fracture lors d’une chute.
La carence en zinc est également fréquem-
ment retrouvée dans les dénutritions : elle
provoque une anorexie par atteinte des
bougeons du goût et une immunodéficience
car le zinc, métallo-enzyme, participe à de
nombreuses réactions du métabolisme cellu-
laire.
Conséquences sociales
Avec l’accumulation des maladies, la malnu-
trition contribue à la réduction de l’espérance
de vie et à sa qualité. La perte d’autonomie
induite aboutit souvent à une entrée en insti-
tution, facteur de risque encore trop fréquent
de désinsertion sociale par isolement, de
dépression, voire de syndrome de régression
psychomotrice et de décès prématuré. En
termes de santé publique, l’incidence de la
MPE sur la morbidité et sur la mortalité est
maintenant bien établie. La morbidité, c’est-
à-dire ici le risque de contracter une maladie
infectieuse, est multipliée par un facteur 2 à 6.
La mortalité est, quant à elle, accrue d’un
facteur 2 à 4. Lorsque le patient âgé est
malnutri, la durée d’une hospitalisation se
prolonge de 2 à 4 fois, la consommation
médicamenteuse augmente et le risque
d’entrée définitive en institution s’accroît.
Diagnostic de la dénutrition
Le dépistage permet d’agir plus tôt, d’éviter
la survenue de complications, et cela pour un
moindre coût. Pour dépister, il est possible
d’utiliser l’autoquestionnaire simplifié de
Brocker et al. qui permet, grâce à une série de
10 questions à réponse binaire (oui/non), de
détecter un seuil de risque. Au-delà de 3, le
dépistage est positif et implique la mise en
œuvre d’une évaluation plus complète, puis
d’une réponse thérapeutique.
Les 18 items du Mini Nutritional Assessment
(MNA) de B. Vellas et al. (4) permettent, au
prix de mesures cliniques anthropométriques
simples, d’une évaluation globale de l’état de
santé, d’indices diététiques et d’une évaluation
de la perception de sa santé par la personne,
d’améliorer la prédiction du risque (risque
élevé pour un score inférieur à 17, risque
modéré pour un score de 17 à 23,5, risque
absent pour un score au-delà de 24, maximum
30). Cet outil est plus particulièrement destiné
aux institutions d’hébergement des personnes
âgées. Une nouvelle version simplifiée est
maintenant disponible. Elle permet, avec
5items et 14 points maximum, d’assurer un
dépistage sur les questions suivantes : “existen-
ce d’une anorexie, perte récente de poids,
capacité motrice, maladies aiguës ou stress
psychologique, problèmes neurophysiolo-
giques, et BMI”. La réalisation du test complet
(qui dure une dizaine de minutes) devient
nécessaire si le score au dépistage est égal à 11.
Le diagnostic :pour évaluer, c’est-à-dire
qualifier et quantifier une malnutrition
protéino-énergétique avérée, il faut utiliser
plusieurs instruments, aucun n’étant à lui seul
suffisamment sensible ou spécifique pour
permettre un diagnostic de certitude. Les
instruments utilisables sont de trois types (5).
Les instruments d’interrogation
et d’observation
L’interrogatoire des habitudes alimentaires
de la vie passée, les rythmes et le nombre des
repas, les régimes observés constituent une
première approche qualitative. La quantifica-
tion, quant à elle, requiert des outils plus ou
moins sophistiqués selon le degré de préci-
sion souhaitée. On peut ainsi faire appel à des
techniques d’enquêtes diététiques lourdes et
coûteuses, tels le rappel des ingesta des
24 heures passées ou le semainier, voire la
pesée des restes de repas préalablement
calibrés, sur une période de 1 à 3 jours. De
manière plus simple, avec cependant un degré
Dossier

Act. Méd. Int. - Métabolismes - Hormones - Nutrition, Volume VI, n° 1, janvier-février 2002
16
de précision acceptable, une surveillance
simplifiée de ce que prend réellement le
patient. Cette surveillance est réalisée à
travers l’observation de chacun des trois ou
quatre repas quotidiens à l’aide d’une grille
cochée aux trois principaux repas et au
goûter, selon les modalités suivantes : aucune
prise alimentaire, moins de la moitié, plus de
la moitié ou la totalité du plat concerné. Son
objectif est de repérer d’un seul coup d’œil la
gravité de l’anorexie et, par l’interprétation
de la diététicienne, d’en établir l’importance.
Les outils anthropométriques
● La pesée :peser une personne âgée est une
tâche réputée ardue, en raison des troubles de
l’équilibre et des pathologies de l’appareil
locomoteur. La pesée doit être régulière (une
fois par mois) et réalisée dans les mêmes
conditions méthodologiques (heure et
habillement).
Une perte de poids de 2 kg en un mois ou
de 4 kg en six mois constitue un argument
pour évoquer une malnutrition protéino-
énergétique.
● Le rapport poids/taille (index de Quetelet
ou indice de masse corporelle IMC, ou BMI
en anglais) requiert une mesure précise de la
taille réelle, puisque l’argument du dénomi-
nateur est élevé au carré. Chez le sujet âgé, la
taille réelle est souvent réduite du fait d’une
tendance à la cyphose. La taille mesurée à
l’aide d’une toise ou par mètre ruban est
fausse. L’utilisation de la taille de la carte
d’identité constitue une alternative finalement
assez précise. La mesure de la hauteur du
genou permet, à l’aide d’une équation
obtenue après étude de corrélation sur de
grands groupes d’individus, de calculer une
taille réelle encore plus précise.
Les outils biologiques
Les dosages dans le sang sont coûteux et
d’interprétation souvent malaisée. Ils sont
néanmoins indispensables au diagnostic.
● L’albumine est une protéine de grosse
taille, synthétisée par le foie, de demi-vie
longue (21 j) ; sa valeur biologique apprécie
l’état nutritionnel au long terme, mais elle est
très sensible aux variations de l’hématocrite
(surtout de l’hémoconcentration) et à
l’inflammation.
● La préalbumine ou transthyrétine, égale-
ment synthétisée par le foie, est une protéine
liée au métabolisme de la thyroxine et de la
protéine vectrice du rétinol. Elle a une demi-
vie courte de 2 jours et elle est également très
dépendante de l’état inflammatoire du
patient.
● La CRP et l’orosomucoïde sont des
protéines de l’inflammation de demi-vie
courte (24 h) ou semi-longue (6 j), qui permet-
tent une interprétation plus fiable des protéines
dites “nutritionnelles”, albumine et préalbumi-
ne.
Les pièges du diagnostic sont multiples
Les enquêtes d’évaluation des ingesta
peuvent, selon la méthode, l’âge de la
personne évaluée, les qualifications de l’éva-
luateur et les sources des tables alimentaires de
référence, sous-estimer ou surestimer les
ingesta.
En clinique, la mesure du poids peut être
source d’erreurs : on peut, par exemple, être
obèse et dénutri. En effet, lorsqu’une
anorexie s’installe, quelle qu’en soit la raison,
la mobilisation de l’énergie se fait en premier
lieu au détriment des muscles, d’un volume
apparent moindre, donc moins visible à l’œil.
La mobilisation de la graisse en tant que
substrat énergétique est plus tardive. Un poids
apparemment stable peut être le résultat d’un
amaigrissement et d’une rétention d’eau et de
sel sous la forme d’œdèmes, dans un contexte
d’insuffisance cardiaque. En biologie, un
syndrome inflammatoire ou une insuffisance
hépato-cellulaire gênent considérablement
l’interprétation des données biologiques.
Le traitement (8,9)
Avant tout, la prévention de la MPE impose
de s’assurer, par une évaluation régulière de
l’appétit de la personne âgée, de ses varia-
tions pondérales ou de rechercher l’apparition
de facteurs de risque nutritionnel. Il est
possible, à cette période, de réduire les
risques de malnutrition en limitant les
régimes alimentaires restrictifs aux seules
personnes malades pour lesquelles ces
régimes seraient impératifs (ce qui est rare en
pratique), en combattant les idées reçues ou
mythes alimentaires (qui portent générale-
ment sur les œufs, le lait, certains fruits et la
viande [impact de l’EBS]). De plus, les idées
reçues suscitent l’élimination progressive du
catalogue alimentaire de la personne âgée de
nombreuses sources d’énergie et de protéines,
contribuant ainsi à une alimentation
monotone, c’est-à-dire à risque de carences
en micronutriments. Il faut également faire
l’éloge de la fourchette en restaurant les
qualités hédoniques du repas : plaisir de la
bouche, rencontre et partage avec l’autre
autour de la table. À la notion d’équilibre
alimentaire, on devrait, au grand âge, substi-
tuer la notion de plaisir.
Dossier
Formule française permettant le calcul
de la taille selon la hauteur du genou (7)
Taille homme =
(2,07 x hauteur du genou) - (0,21 x âge) + 74,69
Taille femme =
(2,20 x hauteur du genou) - (0,25 x âge) + 67,0
La malnutrition protéino-énergétique est
probable lorsque la valeur du BMI est < 22
On considère que :
La malnutrition est modérée si l’albuminémie
est entre 30 et 35 g/L et la préalbuminémie
entre 140 et 220 mg/L.
La malnutrition est sévère si l’albuminémie
est inférieure à 30 g/L et la préalbuminémie à
140 mg/L.
La malnutrition protéino-énergétique est dite
“caractérisée” lorsque au moins deux critères
cliniques ou biologiques ont des valeurs
inférieures au seuil de référence.

Act. Méd. Int. - Métabolismes - Hormones - Nutrition, Volume VI, n° 1, janvier-février 2002
17
Les compléments nutritionnels doivent être
utilisés avec discernement, à titre préventif,
car ces produits sont coûteux et risquent de se
substituer au repas normal. Il est possible
d’enrichir de nombreux plats à chacun des
quatre repas, avec de la poudre de lait appor-
tant un complément calcique et protidique,
sans dénaturer le goût et pour un faible coût.
Il n’existe aucun argument scientifique à ce
jour pour succomber à la tentation américaine
de supplémentation vitaminique systéma-
tique. En dehors de la supplémentation en
vitamine D et du calcium pour tous les
patients confinés ou à faible mobilité, on ne
dispose pas de données permettant de
proposer l’utilisation de cocktail vitaminique
incluant les vitamines anti-oxydantes A, C, E,
voire du sélénium et des vitamines hydro-
solubles thermolabiles du groupe B.
Il faut également améliorer l’environnement
du repas. À domicile, il est préférable de
faire appel à la famille ou à une aide
ménagère pour faire les courses et préparer,
ou aider à préparer, le repas que d’utiliser les
services de repas à domicile, souvent ressen-
tis par la personne âgée comme une dépos-
session de sa fonction de préparation du
repas. En institution, la mission de
l’ensemble du personnel soignant est d’amé-
liorer la prestation proposée pour le repas.
On peut ainsi proposer d’aménager les salles
à manger en plusieurs lieux, avec une
décoration différente et des couleurs harmo-
nieuses, des tables permettant la circulation
des fauteuils roulants, des nappes agréables
à l’œil et des couverts ergonomiques. Les
temps de repas seront adaptés selon les
habitudes passées de la personne, le repas
doit durer au moins 1 heure. Les menus
seront proposés aussi près que possible du
repas : ils seront écrits et présentés dans la
matinée pour préparer à l’idée du repas à
venir. La présentation de mets goûteux et
odorants sera précédée d’un apéritif et
accompagnée par un verre de bon vin.
Quatre repas par jour sont préférables à 3 :
une collation à dix heures et un goûter léger,
pour ne pas nuire au dîner, sont souhaitables.
L’heure du dîner doit être retardée à vingt
heures pour que la période nocturne à jeun
n’excède jamais douze heures.
À titre curatif, si l’apport oral spontané se
révèle insuffisant pour compenser la carence
nutritionnelle, on peut s’aider de complé-
ments du commerce qui permettent d’appor-
ter de 200 à 400 kcal/j. Il faut préférer des
compléments hyper-protéinés, en sachant que
le goût sur la langue (palatabilité) de ces
protéines se traduit souvent par une mauvaise
observance du produit au long cours. La
diversification de la nature de ces complé-
ments (laitages, desserts gélifiés, soupes)
permet une meilleure adhésion à ce qui doit
être présenté à la personne comme un
véritable médicament. Enfin, ces supplé-
ments ont un défaut majeur, celui de coûter
cher et ne faire l’objet d’aucun remboursement
par l’assurance maladie en dehors de cadres
réglementaires (TIPS), excluant à ce jour la
personne âgée. Le seul traitement médica-
menteux ayant obtenu une AMM dans l’indi-
cation de la dénutrition de la personne âgée
est l’alpha-cétoglutarate d’ornicéthine
précurseur de la glutamine, dont l’intérêt
(modeste) a été démontré, en particulier, dans
les situations d’hypercatabolisme.
Si le traitement des facteurs déclenchants,
l’aménagement des repas et la prescription
éventuelle de compléments se révèlent insuf-
fisants pour restaurer un bon état nutrition-
nel, il appartiendra au médecin de faire
admettre son patient en milieu hospitalier,
dans une unité spécialisée dans l’assistance
nutritionnelle pour la personne âgée.
Lorsque le tube digestif est fonctionnel, il est
possible d’assurer une assistance nutrition-
nelle par sonde naso-gastrique pour une
nutrition prévisible d’une durée de moins
d’un mois ou par gastrotomie perendosco-
pique pour des durées supérieures. Ces
gestes techniques sont simples et habituelle-
ment bien tolérés, sous réserve et dans la
mesure du possible, de passer un contrat
sur les objectifs espérés avec la personne. Il
est ainsi possible d’apporter, avec une assez
grande sécurité, de 1 800 à 3 000 kcal/j en
apport croissant selon l’urgence et le type de
malnutrition. Toutes les diètes vendues dans
le commerce sont de qualité identique et
peuvent être passées par déclivité ou à l’aide
d’une nutripompe d’utilisation simple. La
durée de la nutrition artificielle dépend de
l’intensité de la malnutrition, mais elle n’est
habituellement pas inférieure à un mois. Au
cours de la nutrition entérale, il est impératif
de tester régulièrement la bouche et de
reprendre dès que possible l’alimentation
orale.
L’objectif nutritionnel curatif doit toujours
être analysé avec beaucoup de soin, sous
l’angle de l’éthique. En effet, si le patient ou
son entourage se refuse à cette assistance
nutritionnelle, ou s’il existe une pathologie
démentielle évoluée, le risque est de traiter
par excès, sans bénéfice immédiat ni retardé
pour la personne âgée.
La MPE est donc bien une réalité médicale
dans nos sociétés industrialisées que l’on
pensait à l’abri de ces carences. À titre indivi-
duel, la prévention est certainement le moyen
le plus sûr de réduire les conséquences des
maladies liées à une immunodéficience ou à
Dossier
Tableau I. Signes d’alerte d’une possible dénutri-
tion.
- Revenus modestes ou mal employés
- Perte d’autonomie
- Solitude, état dépressif
- Difficultés d’approvisionnement
- Problèmes bucco-dentaires
- Régimes
- Trouble de la déglutition
- Moins de trois repas/jour
- Plus de cinq médicaments/jour
- Perte de poids
- Maladie sévère
- Constipation
- Albumine inférieure à 35 g/L
 6
6
1
/
6
100%