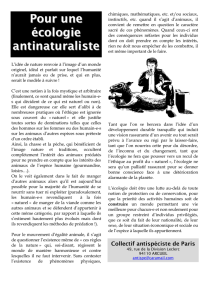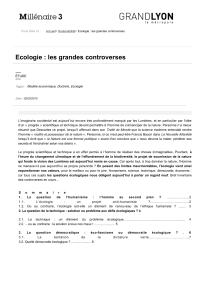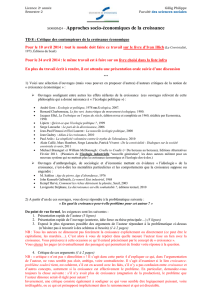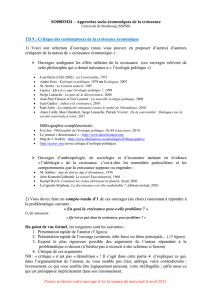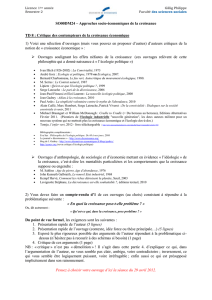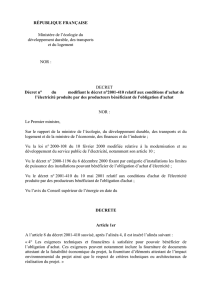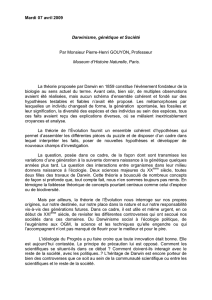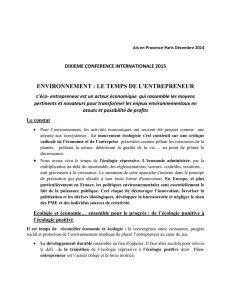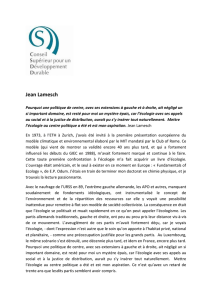Corpus économique vs corpus écologique : le

Colloque international francophone, « Le développement durable : débats et controverses », 15 et 16 décembre 2011, Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand.
1
Corpus économique vs corpus écologique : le problème de
l’expertise dans le domaine du développement durable
Arnaud Diemer, Didier Mulnet
Université Blaise Pascal, TRIANGLE, Lyon, CERDI, Université d’Auvergne
Opposées dans les faits, mais étymologiquement très proches, les relations
qu’entretiennent l’économie (l’administration de la maison) et l’écologie (étymologiquement
le discours ou la science de la maison ou habitat…implicitement des organismes) sont à la
fois, complexes et ambigus. L’histoire de l’économie est fondée sur la volonté de s’émanciper
des champs du politique et de la morale afin de se rapprocher des sciences dures. Bien
qu’étant fortement imprégnée d’idéologie, la science économique préfère insister sur
l’utilisation des mathématiques et de la modélisation (discours scientifique reposant sur des
hypothèses) afin de se forger une boîte à outils susceptible de répondre aux demandes des
décideurs politiques ou de la société civile. Cette évolution engendre un changement radical
dans la manière de penser le monde, nous assistons ni plus ni moins à une véritable crise de
vocation. A défaut d’apporter leur contribution à de nouvelles représentations du monde (une
tradition pourtant fortement ancrée chez Adam Smith, Léon Walras, Joseph Schumpeter,
Nicholas Georgescu-Roegen, Maurice Allais…), les économistes auraient choisi une voie plus
simple et plus tranquille, ils seraient devenus des techniciens au service de la société (ils
répondent à des questions qui leur sont posées), rôle qu’ils remplissent plus ou moins bien si
l’on tient compte des récents évènements liés à la crise financière (subprimes, dette publique)
ou écologique (réchauffement climatique, disparition de la biodiversité…). Dans ce dernier
cas, on peut considérer que l’acte économique ayant nécessairement une dimension
écologique (activités de production et de consommation provoquant une transformation de la
nature), l’économiste ne pouvait pas faire autrement que d’avoir un discours sur la nature.
L’histoire de l’écologie est différente (Matagne, 2002). L’écologie apparaît sous la forme
d’un discours scientifique traitant de l’interaction du vivant avec son milieu naturel. En 1864,
G.P. Marsh fut l’un des premiers à développer une analyse détaillée de l’impact destructeur de
l’homme sur l’environnement. Sa réflexion scientifique servira de base durant le début du
XXe siècle aux courants préservationnistes (vision romantique et non utilitariste de la nature)
de John Muir (1865-1946) et au courant conservationniste (perspective utilitariste de la
conservation des ressources naturelles) de Gifford Pinchot (1838-1914). Ces deux paradigmes
continuent d’être actifs au sein de l’écologie et pèsent sur son positionnement vis-à-vis du
développement durable. En France comme en Angleterre, les écoles naturalistes non

Colloque international francophone, « Le développement durable : débats et controverses », 15 et 16 décembre 2011, Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand.
2
protectionnistes fleurissent. Parallèlement à ces courants de pensée, E. Haeckel introduit en
1866 le mot écologie et J.E.B. Warming publie en 1895, le premier ouvrage d’écologie
scientifique. A la suite des travaux de Malthus, Verhulst (1838) publie la courbe logistique
qui ne sera redécouverte qu’en 1920 par des démographes américains à l’origine de l’écologie
des populations. L’écologie mathématique prend son essor, même si ce formalisme
mathématique rebute la majorité des écologistes naturalistes de cette première moitié du
XXème siècle. La deuxième moitié du XXème voit apparaitre l’écologie des écosystèmes
(Odum dès 1961) et des flux de matière et d’énergie dans des études synthétiques
(Duvigneaud, 1980). Progressivement deux tendances caractérisèrent l’évolution de
l’écologie : le réductionniste et le recours aux modèles face à la complexité des systèmes
étudiés. Mais l’écologie apparaît également sous les traits d’une idéologie s’opposant au
développement anarchique de la société industrielle (mouvements conservationnistes au début
du XXe siècle aux Etats-Unis contre l’exploitation du pétrole), à l’extension des valeurs
occidentales (utilitarisme, individualisme, …) à l’ensemble de la planète et à l’hégémonie du
discours économique (rationalité économique, ordre économique, autorégulation des
marchés…).
Ces quelques lignes sont symptomatiques des trajectoires suivies par ces deux sciences.
Elles buttent tous les deux sur la complexité des faits étudiés (l’étude du vivant et la crise
financière en sont des illustrations). Elles sont obligées de faire des va et viens entre holisme
et réductionnisme (individualisme dans le jargon de l’économie), entre vision naturaliste
(l’économie politique) et les mathématiques (économie mathématique), entre l’éthique et la
tentation utilitariste. Cette mise en perspective des deux sciences nous permet d’introduire un
élément clé du discours scientifique, le cadre méthodologique. Au cours des années 70, Joël
de Rosnay insistait sur le fait que nos sociétés devenant infiniment plus complexes, il fallait
nous doter d’un nouvel outil pour comprendre la variété des relations et le jeu des
interdépendances caractérisant le monde moderne. A côté du microscope qui nous ouvre le
champ de l’infiniment petit et du télescope qui nous introduit dans l’infiniment grand, il
conviendrait de donner une place au « macroscope », destiné à comprendre l’infiniment
complexe. Symbolisant une nouvelle manière de voir, de comprendre et d’agir, le macroscope
permettrait « de porter un regard neuf sur la nature, la société et l’homme » (Rosnay, 1975, p.
10). L’émergence du concept de développement durable, illustrée par la réunion des trois
sphères (économique, écologique et sociale) s’inscrit indéniablement dans cette démarche. Il
s’agit de formuler une nouvelle théorie « écologico-socio-économique » posant la complexité
comme approche méthodologique. Notre éducation universitaire ne nous prépare pas à cette
vision d’ensemble (la méthode analytique reste cantonnée aux limites posées par chaque
discipline). Cependant, c’est à ce prix que nous serons capables d’apporter une contribution
originale aux grands problèmes du monde. Le développement durable appelle de profonds
changements dans nos sociétés, ces changements concernent à la fois notre grille de lecture et
notre degré d’expertise. La contribution que nous proposons, entend faire de la complexité,
une méthode scientifique susceptible d’apporter des éclairages en matière d’expertise, qui
plus est, dans le domaine du développement durable.
Pour ce faire, nous procéderons en deux temps. Dans un premier temps, nous préciserons ce
que l’on entend par complexité. Cette notion nous invite à superposer trois niveaux : la
complexité scientifique, la complexité transdisciplinaire et la complexité des valeurs. Sans
pour autant constituer une méthode universelle, l’analyse systémique suggère de recentrer
notre attention sur une approche globale des problèmes étudiés. Il s’agit de dégager les grands
principes et les invariants qui relient les différents éléments d’un système. Dans un second
temps, nous utiliserons cette approche par la complexité afin de poser les bases d’une

Colloque international francophone, « Le développement durable : débats et controverses », 15 et 16 décembre 2011, Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand.
3
véritable expertise dans le cadre du développement durable. La question des biocarburants
constituera le terrain d’application de l’analyse systémique.
I. Ecologie et économie : comment penser la complexité ?
Il y a encore quelques années, pour tenter de percer les mystères de la complexité, il
suffisait de rechercher les unités les plus simples qui permettaient de l’expliquer. Que ce soit
en biologie, en physique, en économie…, l’approche analytique consistait à isoler les
éléments pour les étudier un par un (molécule, atome, particules élémentaires, producteur,
consommateur…). De nos jours, il s’agit plutôt de porter notre regard sur les systèmes qui
nous englobent et de faire un effort de synthèse. Cette vision globale, que nous qualifions
d’approche par la complexité, s’appuie sur deux notions importantes (la variété des éléments
observés et l’interaction entre ces éléments) et une révolution, la dynamique des systèmes,
plus connue sous le nom d’analyse systémique.
A. Différentes approches de la complexité
L’approche par la complexité comporte trois niveaux qui se superposent : la complexité
scientifique (il s’agit d’une approche globale des problèmes au niveau de chaque discipline),
la complexité transdisciplinaire (il s’agit de faire appel aux autres sciences pour se forger une
représentation pertinente du monde dans lequel nous vivons) et la complexité par les valeurs
(la recherche d’une vision globale du monde doit être compatible avec une éthique
personnelle, une action individuelle et collective).
1. La complexité scientifique
Dés l’origine, l’écologie s’est heurtée à la complexité tant de l’objet d’étude que des
méthodes employées. En 1866, E. Haeckel crée le mot écologie en faisant référence à la
biogéographie. En 1877, le zoologiste Karl Moebius crée à son tour le concept de biocénose.
En 1895, c’est le géographe botaniste, J.E.B. Warming, qui publie le premier ouvrage
d’écologie scientifique. Progressivement la notion d’écosystème intégrera au XXème siècle,
les concepts de biocénose et de biotope, eux-mêmes décomposés en sous systèmes (phyto,
zoo et micro biocénoses, facteurs climatiques et édaphique). Ceci a conduit les écologues sur
la voie de l’autoécologie (relation entre les êtres vivants et le milieu physique) avec des
approches quantitatives et l’intégration d’outils techniques de mesure des paramètres physico-
chimiques. Les approches synécologiques (relations au sein de la biocénose) étaient
initialement plus proches du monde naturaliste avec des méthodes proches à l’éthologie
mobilisant à l’origine les concepts de prédation et compétition. Dans tous les ouvrages
d’écologie générale à partir des années 1980 ces notions sont récurrentes (Ramade, 2009 ;
Barbault, 2008 ; Frontier, Pichod-Viale, 1991 ; Fischesser, Dupuis-Tate, 1996 ; Couvet,
Teyssèdre-Couvet, 2010). A la suite des travaux de Malthus, Verhulst présente la courbe
logistique en 1838. Celle-ci ne sera redécouverte qu’en 1920 par des démographes américains
et sera alors à l’origine de l’écologie des populations (Dajoz, 1974 ; Barbault, 1992). Les
courbes historiques de Volterra (Volterra, D’Anconna, 1935 ; Volterra, 1937)
sur les relations
proies prédateur ont été à la base de l’écologie mathématique, mais ce formalisme
mathématique rebute une partie des écologues naturalistes de cette première moitié du
XXème siècle. Les différents auteurs (Viera da Silva, 1979 ; Dajoz, 1974) intègrent
progressivement de nouveaux modèles plus fiables portant sur les autres relations
synécologiques, les mesures de niche écologique et qui poussent le formalisme mathématique
beaucoup plus loin (Couvet, 2010). Dans la seconde moitié du XXème siècle, les études

Colloque international francophone, « Le développement durable : débats et controverses », 15 et 16 décembre 2011, Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand.
4
structurales ont pris deux directions complémentaires : spatiale et temporelles. Sur le plan
spatial, le problème posé était celui de la structure continue ou discontinue des écosystèmes,
des zones de frontière entre les différents écosystèmes (écotones) (Barbault, 1992 ; Couver,
2010), des entités écologiques non perceptibles de visu telles les unités phytosociologiques
(Ozenda, 2000). Cette complexité liée à l’imbrication des échelles spatiales a imposé une
mathématisation des méthodes (Coquillard, Hill, 1997). L’intégration de la dimension
temporelle s’est faite dans plusieurs directions : le suivi de l’évolution par des études
diachroniques pour les petites échelles de temps et par des études synchroniques comparatives
pour certaines échelles plus longues (Blondel, 1995). La complexité gagne encore par la prise
en compte des évolutions à l’échelle des continents et des temps géologiques, des données
biogéographiques aux données paléontologiques. (cf complexité transdisciplinaire). La
complexité des techniques s’est accrue lorsque la description des systèmes complexes a
nécessité l’utilisation de statistiques performantes lors des plans d’échantillonnage (Frontier,
1983), des analyses multi-variées pour déterminer les facteurs de causalité (méthodes
d’analyse multifactorielles) (Legendre, Legendre, 1984), des modèles de type Preston,
Motomura ou Mandelbrot (Daget, 1979) pour décrire les structures et leurs évolutions.
Par la suite, les études empiriques qualitatives du début du XXe siècle sur le fonctionnement
des écosystèmes, ont laissé place aux études synthétiques quantitatives mobilisant de grosses
équipes de recherche sur des temps d’étude longs. Les mesures de biomasse ont laissé place à
l’estimation des flux de matière et d’énergie aux différentes échelles de temps avec des
techniques complexes renouvelées, souvent indirectes. A ces études globales des années
1960-70 (Lamotte, Bourlière, 1967), (Duvigneaud, 1980), ont succédé des études du
fonctionnement de sous-parties (réductionnisme qui permet d’affiner le fonctionnement, mais
fait parfois perdre de vue le fonctionnement global en raison des interactions de l’éco
complexe à l’écosystème, aux peuplements et populations….jusqu’aux individus et flux de
gènes (mutations, sélection naturelle, fardeau et dérive génétique, interactions et équilibre
entre ces facteurs) (Couvet, 2010). L’une des difficultés majeures de l’Ecologie est
l’intrication et l’interdépendance des échelles de temps et d’espace des systèmes étudiés, ainsi
que la multi-factorialité des facteurs qui rendent nécessaires la modélisation et le recours aux
mathématiques et statistiques pour conceptualiser ou visualiser les phénomènes. L’éthologie a
apporté une importante contribution complémentaire des études écologiques via
l’écoéthologie (Gauthier & al, 1978) aussi bien pour décrire les déterminants individuels
(individus, espèces ou entités écologiques) et collectifs (relations entre espèces).
L’écologie a comme toutes les autres sciences été tiraillée par le foisonnement conceptuel qui
la caractérise mais peut être plus encore par l’antagonisme entre holisme et réductionnisme.
(Gunnell, 2009). Le réductionnisme prétend qu’il est possible d’expliquer le fonctionnement
des systèmes complexes en étudiant les différentes parties de ce système. Le holisme qui
s’attache à étudier le système dans son intégralité a pris différentes formes, notamment lors
des débats sur l’hypothèse Gaia où la solidarité entre les différentes composantes de la terre
est mise en avant pour expliquer la stabilité terrestre. Le cœur du débat est ici de savoir si les
écosystèmes sont des entités ontologiques discrètes avec des propriétés fondamentales et des
assemblages spécifiques, ou s’il s’agit au contraire d’assemblages aléatoires. Si le
réductionnisme semble peu applicable à l’écologie. Le concept de climax est issu de Clément
qui en 1916 décrivait les écosystèmes comme des super organismes. Le glissement entre les
propriétés homéostatiques et la dérive téléologique est emprunte d’une certaine vision
religieuse.
Après Lindeman (qui avait établi le principe selon lequel 10% de l’énergie est transmise d’un
niveau trophique au suivant), la vision d’Odun (avec les mots de productivité, d’efficience et

Colloque international francophone, « Le développement durable : débats et controverses », 15 et 16 décembre 2011, Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand.
5
de rendement empruntés à la physique) qui présentait la nature comme un gisement de
ressources triomphait grâce à la respectabilité des sciences exactes. Cette interprétation des
faits scientifique a maintes fois été critiquée. La courbe aire espèce (Mac Arthur, Wilson,
1967) est un bon exemple de cette opposition entre holisme et réductionnisme. En effet cette
théorie qui permet de prévoir le nombre d’espèces sur une surface donnée insulaire est par
essence holiste mais des études réductionnistes ont permis d’en valider certains éléments (par
exemple la relation avec la présence ou absence simultanée de certaines espèces). Transposées
en milieu non insulaire, les conclusions sont très discutables, mais la mathématisation tend a
rendre indiscutable cette théorie et peut servir certaines idéologies.
La théorie de la niche écologique est issue de la compétition de Lotka-Volterra et d’une
lecture partielle de la théorie de Darwin. Une relecture plus attentive de Darwin montre qu’il
avait lui-même évoqué déjà de nombreuses interactions positives, qui ont été redéveloppées
(Lecointre, 2009) en insistant sur le fait que le succès reproductif d’une espèce dépend certes
de son aptitude à capter plus de ressources (compétition), mais aussi à échapper aux
prédateurs (mimétisme), se reproduire plus (sélection sexuelle), profiter des autres
(parasitisme), coopérer entre espèces (symbioses) ou au sein de l’espèce (entraide ou
compassion). Le réductionnisme est ici à la fois cause et conséquence d’une dérive
idéologique. Une dérive de nature proche est rencontrée avec l’exemple des espèces à
stratégies r (qui maximisent la survie de leur espèce en produisant un grand nombre de
descendants à faible espérance de vie) opposées aux stratèges K (qui produisent moins de
jeunes mais en maximisent la survie). Le problème ne réside pas dans les faits mais dans
l’interprétation qui en faite. Donner une finalité, une intentionnalité à ces stratégies témoigne
d’une certaine emprise finaliste et donc d’une dérive idélogique.
Contrairement à l’écologie qui au-delà de l’aspect purement disciplinaire, est un « concept
intégrateur, un mode de pensée global qui matérialise aujourd'hui l'irruption de la systémique
dans l'éducation, l'industrie et la politique » (Rosnay, 1994, p. 1), l’économie a mis plus de
temps à intégrer la complexité en tant qu’approche méthodologique. Elle s’est davantage
tournée vers la microéconomie et la macroéconomie.
La microéconomie
1
s’intéresse à l’affectation des ressources rares à travers un système de prix
de marché. Elle met l’accent sur les choix individuels et la notion d’individualisme
méthodologique. Parmi les individus (les microéconomistes utilisent le terme d’agents), le
producteur et le consommateur occupent une place privilégiée. La démarche
microéconomique procède généralement en deux étapes. Dans un premier temps, on décrit les
caractéristiques des unités de base (agents) de l’économie. Le producteur, sous la contrainte
de sa fonction de production, cherche à maximiser ses profits. Le consommateur, sous la
contrainte de son revenu, cherche à maximiser son utilité. Les deux agents doivent faire des
choix rationnels, c'est-à-dire mettre en balance les coûts et les bénéfices d’une décision (le
1
Si la microéconomie s’est progressivement imposée dans l’enseignement de l’économie, quatre raisons peuvent
expliquer ce succès. La première renvoie au contenu scientifique de la démarche. La microéconomique se prête
au calcul mathématique. La deuxième réside dans sa simplicité. En concurrence parfaite, tous les agents
économiques (consommateurs et producteurs) sont des preneurs de prix. Les prix concernent toute la durée de
vie de l’économie (existence de marchés complets et absence d’incertitude). Les conjectures des agents sont
également naïves, quels que soient les prix affichés, ils font comme s’ils étaient en équilibre. La troisième
renvoie au caractère normatif du modèle. Il est généralement admis, à tord ou à raison, que le modèle de
concurrence parfaite doit conduire à un relâchement des hypothèses, c'est-à-dire à un certain réalisme du modèle.
La quatrième raison tient à la sophistication et à la diversité des modèles. Plusieurs évolutions (prise en compte
de la nature de la firme, analyse des acteurs à l’intérieur de l’entreprise, analyse des stratégies des concurrents…)
ont donné un contenu opérationnel à la microéconomie. La dernière en date, la théorie des jeux, a amené les
microéconomistes à se pencher sur les croyances des agents économiques.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
1
/
37
100%